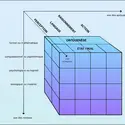HEURISTIQUE
Article modifié le
Ce terme de méthodologie scientifique qualifie tous les outils intellectuels, tous les procédés et plus généralement toutes les démarches favorisant la découverte – c'est la racine grecque du mot – ou l'invention dans les sciences. On a pu également désigner par là, d'une manière plus globale, l'une des deux dimensions épistémologiques fondamentales de l'activité scientifique, celle qui tente de réfléchir les conditions de ce que Bacon appelait « l'augmentation des Sciences ». Au travers de cette définition plus large, l'heuristique constitue une véritable théorie de l'élaboration de la science. Il conviendra donc de distinguer une qualification méthodologique qui désigne les techniques de découverte, et ce que l'on pourrait nommer une heuristique générale comme partie de l'épistémologie ayant en charge de décrire et de réfléchir les conditions générales du progrès dans l'activité scientifique – s'opposant, tout en la complétant, à cette partie qui s'intéresse aux conditions de justification et de légitimation des connaissances.
La technique ou l'art d'inventer
C'est en se reportant aux sources mêmes de la réflexion méthodologique sur la connaissance que l'on peut discerner l'apparition des premières considérations heuristiques. Le premier grand monument spéculatif sur les conditions de la connaissance que constitue l'Organon aristotélicien ne manque pas de faire une place aux techniques qui permettent de découvrir les choses que l'on ignore. On peut d'ailleurs considérer que c'est une des tâches de la dialectique de proposer des méthodes de « trouvailles », pour utiliser l'expression juste et imagée du père Le Blond. Certes, la dialectique se distingue de la méthode « scientifique », apodictique. Elle n'est en premier lieu qu'un art de la discussion et de l'examen, et si sa mission n'est pas la recherche de la vérité, pour ne s'intéresser qu'à l'opinion, au probable, elle ne fournit pas moins un ensemble d'instruments « permettant de raisonner sur n'importe quel sujet » et de la sorte finit par apparaître comme une sorte de méthodologie générale propice à la recherche et « à la connaissance des principes ». Les Topiques enseignent ainsi des procédés généraux destinés à poser convenablement les problèmes (procédés aporétiques).
Quand bien même le statut de la dialectique est incertain chez Aristote (cf. Le Blond, 1939), elle demeure la première présentation systématique d'une technique de recherche. La place accordée à l'étude de l' induction – thème qui demeurera l'un des points centraux de toute réflexion sur la découverte scientifique – et à la recherche des ressemblances et analogies – la venatio similitudinis – confirme que la dialectique aristotélicienne constitue le creuset de tout développement ultérieur concernant les techniques heuristiques. Organa et topoi représentent des procédés de recherche destinés à « se procurer en abondance propositions et raisonnements ». La dialectique, tout en n'appartenant pas à la méthode scientifique, reste tournée vers elle en raison même d'une généralité et d'une abstraction qui lui interdisent pourtant de prétendre à la scientificité. Dût-elle se contenter de rassembler « les petits moyens très divers qu'implique la recherche réelle » : instrument pré- ou parascientifique de la science.
C'est dans la technique rhétorique ancienne que l'on trouve une application, interne à la dialectique, de ces procédés heuristiques. Un discours persuasif doit être préparé en une suite de traitements dont les deux premières séquences vont finir par désigner les deux moments nécessaires à toute élaboration intellectuelle : l'eurèsis (ou inventio) et la taxis (ou dispositio). Il s'agit, dans le discours argumenté, d'abord de « trouver quoi dire », puis de disposer en ordre ce qui a été trouvé. C'est là l'origine de ce qui deviendra un canon méthodologique : l'ordre de la découverte opposé à l'ordre de l'exposition. Une chose est de faire surgir les idées, les arguments, une autre de les structurer de façon appropriée à leur communication. L'eurèsis mobilise les procédés dialectiques présentés par exemple dans les Topiques et vise à fournir un contenu au discours. Les lieux communs des Topiques représentent – métaphore usuelle de la réflexion heuristique – des filets destinés à pêcher les arguments et les preuves : « Certains chefs généraux auxquels on peut rapporter toutes les preuves dont on se sert dans les diverses matières que l'on traite » (Logique de Port-Royal) ; « des avis généraux qui font ressouvenir ceux qui les consultent de toutes les faces par lesquelles on peut traiter un sujet » (B. Lamy).
Avant de se réifier en des formes vides dépourvues de toute vertu heuristique, les lieux communs ont constitué de véritables sources d'inspiration pour l'orateur, proposant un chemin à suivre en toute confiance afin de faire surgir le contenu recherché. L'usage de ces topoi aura en définitive une double portée : d'une part, l'idée s'affirmera qu'il est possible d'adopter une attitude rationnelle et méthodique vis-à-vis de la recherche du « nouveau » et qu'en conséquence l'examen systématique et ordonné est substituable au « surgissement », à l'apparition spontanée et semble-t-il soudaine de l'idée ; d'autre part, les thèmes du dévoilement, de l'extraction s'imposeront comme des modèles de l'invention et de la découverte – « Les arguments se cachent, explique Barthes, ils sont tapis dans des régions, des profondeurs, des assises d'où il faut les appeler, les réveiller : la Topique est accoucheuse de latent. »
La première version de l'heuristique prend en conséquence la figure d'une technique générale, ou, dans l'interprétation latine, d'un art : ars brevis, un « ensemble de moyens courts et faciles » ; cet art est associé à une théorie, si fruste soit-elle, de la découverte, comme si cette technique appelait implicitement une théorie de la connaissance. Et cela, l'évolution de l'épistémologie le confirmera et l'amplifiera. L'idée qu'il existe des voies « compendieuses », économes en quelque sorte, pour accéder à la vérité, est probablement d'origine stoïcienne et se développera surtout au Moyen Âge. Cependant, il appartient bien à la logique des réflexions heuristiques de réfléchir sur la rationalité des techniques heuristiques utilisées. Les grands traités de méthode du xviie siècle sont en réalité le résultat d'une longue tradition de spéculations méthodologiques depuis Galien jusqu'aux dialecticiens de la Renaissance (en particulier à partir de Boèce). C'est au sein de cette tradition méthodologique que les techniques heuristiques issues de l'Organon aristotélicien vont être étudiées et intégrées ; on assiste peu à peu au développement de ce qui deviendra l'ars inveniendi compris comme partie d'une techné plus générale que constituera la méthode. Les discussions concernant le contenu de la méthode iront bon train, en particulier à partir du xvie siècle. Si, parfois, on nie à la méthode une portée heuristique (chez Temple par exemple, où elle n'a d'autre rôle que de disposer et d'ordonner les vérités, et non de les découvrir – elles se manifestent d'elles-mêmes), dans la plupart des cas on distingue technique de découverte et technique de présentation, d'ordonnancement, etc., analyse et synthèse, méthode résolutive et compositive, autant de manières d'exprimer la dualité fondamentale de la méthode issue de l'Antiquité. Bonitz consacre une telle évolution lorsqu'il assigne – en opérant un raccourci dans l'histoire de la notion – un sens double à « méthode » chez Aristote comme 1. via ac ratio inquirendi ; 2. ipsa disputatio ac disquisitio. La méthode constituera un art ou une technique ouvrant la voie de la recherche « en toutes choses ». Que la méthode, et par conséquent sa dimension spécifiquement heuristique, ait été appréhendée comme un ars n'est pas sans conséquence. Lentement extraites de leur cadre originel aristotélicien (accompagnées de quelques compléments platoniciens dans les détails desquels nous ne pouvons entrer), ces techniques vont se muer en un système de règles et recettes indépendantes de toute conception d'ensemble. Plus précisément, sous l'influence stoïcienne encore une fois, l'art va se définir dans une perspective essentiellement pragmatique : ad unum exitum utilem vitae pertinentium ou encore ad unum finem tendentium,... il ne s'agit plus que de viser des fins pratiques ; les règles ne valant en quelque sorte que par leur efficience pratique, indépendamment de toute autre justification : seule compte la puissance qu'il est possible de déployer à partir d'elles pour accéder aux choses. « Mieux vaut l'usage sans l'art que l'art sans l'usage », dira Pierre de La Ramée au xvie siècle. Il est clair qu'un tel développement était en germe dans les techniques de l'eurèsis rhétorique ainsi qu'on l'a vu. Une telle attitude se manifeste encore aujourd'hui dans certains traités d'heuristique : mélanges hétéroclites de procédés sans autre légitimité que leur efficacité concrète supposée.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Pierre CHRÉTIEN-GONI
: assistant au Conservatoire national des arts et métiers, membre du Laboratoire sur les sciences de la communication du C.N.R.S., secrétaire de rédaction de la revue
Agora , éditions du C.N.R.S.
Classification
Médias
Autres références
-
CATÉGORIES
- Écrit par Fernando GIL
- 6 073 mots
La sous-détermination des catégories fait que leur fonction est, au premier chef, heuristique. Cela est manifeste dans l'œuvre de C. S. Peirce, où les catégories se révèlent être, selon les mots de Peirce lui-même, « des idées si vastes qu'elles doivent être entendues comme des états (... -
COGNITIVES SCIENCES
- Écrit par Daniel ANDLER
- 19 265 mots
- 4 médias
Les heuristiques. Dans son effort pour faire exécuter à l'ordinateur des raisonnements complexes, qu'il s'agisse de jeu d'échecs, de compréhension de textes, de démonstration automatique de théorèmes ou de systèmes experts, l'intelligence artificielle a eu tôt fait de constater que, pour éviter l'explosion... -
CONTROVERSE
- Écrit par Fernando GIL
- 1 069 mots
À l'opposé de ce qui s'est passé en théologie, où l'on cultivait l'art de la controverse (le cardinal Bellarmin occupa, pour l'enseigner, une chaire à Louvain, puis, à partir de 1576, au Collège romain, et il écrivit un traité des Controverses), l'existence de...
-
INTELLIGENCE
- Écrit par Jean-François RICHARD
- 6 594 mots
...explorera les diverses conditions entraînant cette propriété : hauteur d'un triangle, triangles rectangles, angles opposés par le sommet à un angle droit, etc. On examine si chacune de ces conditions est contenue dans les données ou peut être déduite des données ; si c'est le cas, on essaiera de démontrer que... - Afficher les 7 références
Voir aussi