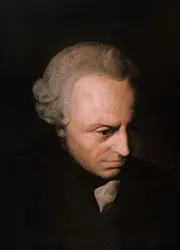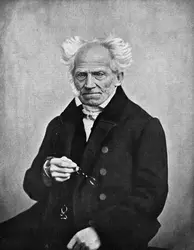ANIMALITÉ
Article modifié le
La refonte du concept d'animalité : les apports de la phénoménologie
Le comportement animal
C'est à la phénoménologie qu'il revient d'avoir ouvert la voie la plus féconde dans la compréhension de la singularité de la vie animale, en ruinant, par le type même des questions qu'elle pose, cette ontologie renversée qui, pour la métaphysique, qualifie l'animalité. C'est, entre autres, pour ne pas avoir regardé l'animal pour lui-même, dans son être propre, dans sa différence par originalité, que la métaphysique n'a pas pensé l'animal, pour construire, au lieu de cela, un concept qui se borne à dire le négatif de l'humain. Le fait de penser l'animal comme un sujet dans un monde, comme un être pour-soi, doté d'une structure de moi, ne saurait laisser indemne l'indigence ontologique sur laquelle repose l'appropriation, rendue de ce fait innocente, du monde animal.
La question du comportement est au cœur du débat ; c'est d'elle que dépend la reconnaissance ou non d'une relation au monde. Hésiter, renoncer, persévérer, inventer... sont autant de traits qui relèvent de l'intention, mettent en scène un sujet en avant de lui-même pris dans une structure signifiante. Ce qui constitue à proprement parler un comportement est cette projection et ce devancement constant qui créent une relation entre soi et l'entourage, observable chez les animaux les plus humbles, même s'il convient d'opérer des distinctions entre les mondes animaux. Aussi Merleau-Ponty, dans La Structure du comportement (1942), caractérise-t-il le comportement comme une forme signifiante qui conduit nécessairement à s'inscrire en faux contre le béhaviorisme. Dans une contribution intitulée « La „psychiatrie animale“ et les troubles du comportement chez les animaux », (in Psychiatrie animale, sous la dir. d'Henry Brion et Henry Ey, 1964), Georges Lanteri-Laura estime que les normes comportementales sont à comprendre comme « les mœurs coutumières » de l'espèce en question. Cela signifie qu'il n'y a ni indétermination absolue (en raison de ces normes), ni uniformité du comportement (en raison de son caractère individué), et que celui-ci exprime de manière chaque fois propre à un individu une relation avec l'entourage selon les possibilités d'action offertes par la structure de son organisme.
La refonte complète de la notion de comportement est au fondement des perspectives très neuves que la phénoménologie ouvre. Car en effet, l e comportement fut tout d'abord l'affaire du béhaviorisme. Le béhaviorisme, dont Broadus Watson est, au début du xxe siècle, le fondateur (Psychology as the Behaviorist Views It, 1913), a opté pour une interprétation mécaniste du comportement, que celui-ci soit d'ailleurs animal ou humain. S'agissant d'observer un organisme régi par un mécanisme strict, voire un système de stimuli et de réponses de l'arc réflexe, les conditions du laboratoire sont suffisantes. Fortes de ce postulat (l'animal est un organisme impulsé de l'intérieur), bien des recherches furent menées, et ce dès la fin du xixe siècle, sur les réflexes conditionnés ou les névroses expérimentales provoquées en laboratoire, sous la direction, notamment, de Pavlov. Tout un courant s'engagea dans cette voie mécaniste où les notions de comportement (vu comme une relation dialectique avec l'environnement, selon la définition qu'en donnera Maurice Merleau-Ponty), de monde, de sujet de l'action, etc., ne pouvaient avoir aucune place. La méthode comme la pensée de Pavlov ont profondément imprégné le béhaviorisme et la psychologie objective, qui ont emprunté aux sciences physiques le modèle de leur démarche : l'exclusion de toute référence à la vie mentale était présentée comme une caution de scientificité. Le recours, par exemple, à l'idée de conscience ou tout simplement à celle de vie mentale, était de ce fait proscrit. Il n'est pas sûr que cette option soit dépassée ; en témoigne la réduction du comportement à des mesures physiologiques et de la vie psychique au fonctionnement du cerveau. Il est un fait que l'éthologie phénoménologique n'a guère fait école, peut-être à cause de l'effort de réflexion philosophique qu'elle requiert.
« Revenir aux choses mêmes », aux phénomènes, à ce qui se manifeste dans le champ du sensible, constitue, dans la méthode même – laisser parler l'expérience afin qu'elle révèle sa structure propre –, la caution d'un regard dégagé des présupposés de la métaphysique. L'animalité s'en trouve de part en part repensée : il ne s'agit plus de déduire le concept d'animalité d'une essence de l'homme (d'ailleurs tout aussi construite que celle de l'animal), mais d'appréhender ce dernier pour lui-même, à la fois dans sa singularité et sa proximité ontologique avec l'homme, loin de l'anthropomorphisme comme du réductionnisme. Le comportement, tel qu'il a été repensé en profondeur par la phénoménologie, atteste tout autre chose qu'une « simple vie », termes employés pour qualifier un vivant pauvre en autodéterminations, la totalité de ses déterminations lui venant d'autre chose que de soi. Comme le note Edmund Husserl dans la cinquième des Méditations cartésiennes, « l'organisme étranger s'affirme dans la suite de l'expérience comme organisme véritable uniquement par son „comportement“ changeant, mais toujours concordant », et il ajoute ce point essentiel : « Ce comportement a un côté physique qui apprésente du psychique comme son indice ».
La notion de monde animal
En réaction contre le béhaviorisme, l'éthologie, dont Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen et Karl von Frisch furent les pionniers, prôna – c'est une première étape – l'observation des animaux dans leur milieu naturel, préférant systématiquement les études de terrain. Si ces derniers ont un comportement porteur de sens, il est indissociable du contexte dans lequel il s'élabore. Aussi, l'introduction de la notion husserlienne d'intentionnalité par Jakob von Uexküll, dans les années 1930, mérite d'être soulignée : elle permet de faire valoir que dans le monde animal aussi les phénomènes sont vécus et n'apparaissent pas dans une extériorité autonome. C'est de manière globale que la signification des objets perçus est donnée : voir un objet, c'est le doter d'une signification, le reconnaître en tant qu'élément occupant une place dans un ensemble signifiant, en relation avec d'autres éléments de ce tout. L'organisme et le milieu ne constituent pas deux éléments extérieurs l'un à l'autre, mais un système de relations étroites.
Jakob von Uexküll élabore, dans Mondes animaux et monde humain (1934, trad. franç. 1956), le concept d'Umwelt : ce monde environnant est en même temps un monde propre à chaque espèce. La distinction entre les animaux dits supérieurs et ceux dits inférieurs permet d'affiner la compréhension de cette notion : les premiers sont dotés d'un organisme qui leur permet d'intérioriser leur monde extérieur (Uexküll nomme cette reproduction le Gegenwelt, « monde opposé » ou « monde réplique »). Ce monde intériorisé comprend à son tour un Merkwelt (« monde de la perception », ou encore « monde caractéristique ») et un Wirkwelt (« monde de l'action », ou « monde agi »). Par ailleurs, chaque Umwelt possède une temporalité propre, un Merkzeit. En revanche, le monde des animaux inférieurs, comme l'oursin, a pour caractéristique de ne laisser entrer en lui que les éléments vitaux. Ces animaux forment avec leur monde une cohésion telle, que l'on peut parler d'ensemble fermé. La structure de monde propre aux animaux dits supérieurs indique un degré de perception élaboré et un entourage riche d'objets autres que ceux nécessaires aux échanges biologiques : l'air n'est pas seulement pour eux l'élément qui permet de respirer, l'eau de se désaltérer, la chaleur du soleil de synthétiser la vitamine D... D'autres types de relations (de jeu, de plaisir) existent avec ces éléments, et il semble bien que pour l'animal aussi il y ait des paysages et non un simple environnement constitué d'objets seulement utiles à la survie. Il y a, pour les animaux aussi, des choses désirables et qui ne servent à rien.
Dire que l'animal est bien une autre existence ne constitue aucunement, comme prend soin de le noter Merleau-Ponty dans La Structure du comportement, un retour aux thèses vitaliste, animiste ou encore à celle de l'âme des bêtes. La phénoménologie a regardé l'animal comme un sujet, un sujet dans un monde, et son comportement comme une relation dialectique avec l'environnement.
Élève de Jakob von Uexküll, Frederik Buytendijk, auteur de plusieurs essais de psychologie animale et de psychologie comparée parus en Allemagne durant la première moitié du xxe siècle, choisit la démarche phénoménologique pour étudier les relations que l'animal entretient avec ce qui l'entoure. Rejetant les situations expérimentales et les modèles mécanistes, il montre par exemple que l'on ne peut parler d'habitat animal sans faire intervenir une Stimmung (terme allemand généralement traduit par « disposition affective »), un sentiment de sécurité par exemple. Cette notion désigne « l'état affectif général dans lequel nous nous trouvons dans notre monde » ; une telle définition souligne la teneur psychologique qui la caractérise (L'Homme et l'animal. Essai de psychologie comparée, 1958, trad. franç. 1965). L'apport décisif des recherches d'éthologie et de psychologie phénoménologiques (Erwin Straus, Jakob von Uexküll, Frederik Buytendijk, notamment) ne saurait être négligé par quiconque entreprend une réflexion philosophique sur l'animalité, mais aussi par les chercheurs des sciences du comportement animal, que celles-ci s'apparentent à l'éthologie ou à des approches plus positives (neurosciences, physiologie du comportement...).
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Florence BURGAT : directeur de recherche deuxième classe à l'Institut national de la recherche agronomique
Classification
Médias
Autres références
-
ANIMALIER DROIT
- Écrit par Olivier LE BOT
- 4 687 mots
À l'époque actuelle, la question des relations entre l'humanité etl'animalité est, dans le domaine philosophique, dominée par les auteurs anglo-saxons. Cette influence se retrouve dans le domaine juridique, les termes des différents débats étant très largement définis là aussi par les juristes... -
ASCÈSE & ASCÉTISME
- Écrit par Michel HULIN
- 4 669 mots
- 1 média
Les diverses définitions classiques de l'homme prennent comme base son animalité à laquelle elles ajoutent la mention d'une différence spécifique : « animal politique », « animal doué de raison », « animal parlant » ou encore, comme dans la tradition indienne, « animal sacrifiant...
-
BESTIAIRES
- Écrit par Françoise ARMENGAUD et Daniel POIRION
- 10 732 mots
- 11 médias
Ainsi vont se nouer originellement les liens de l'humanité à l'animalité, et notamment l'échange des traits, des caractères, des destinées. Appropriation symbolique des qualités propres à chaque espèce dans un jeu de rivalité et de familiarité qui trouvera un accueil particulièrement riche dans les... -
ÉMOTION (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 3 349 mots
...haut » en supposant la toute-puissance de l’Esprit, de la Raison qui gouverne le monde. Rien de tel pour le penseur tragique qu’est Schopenhauer : les humains ne sont que des animaux orgueilleux qui se masquent à eux-mêmes la véritable origine de leurs actions. Mus par une force aveugle, le « vouloir-vivre... - Afficher les 16 références
Voir aussi