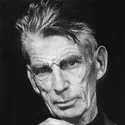TCHEKHOV ANTON PAVLOVITCH (1860-1904)
Article modifié le
Tchekhov est le maître russe de la nouvelle brève. Si sa création est parfaitement originale, si c'est là le genre où il excelle, il n'en est pas moins un grand auteur de théâtre. À la différence d'un Mérimée ou d'un Maupassant, Tchekhov nouvelliste réussit dans une courte page à rendre perceptible la complexité, la richesse, le tragique d'une vie entière.
La tragique condition humaine, voilà le domaine où s'est exercée son infinie capacité de sentir et de comprendre. En tant qu'auteur dramatique, il a envoûté des générations de spectateurs par la vérité subtile qui se dégage des lents cheminements et des pauses de ses compositions dramatiques, fondamentalement musicales.
La vie ardente
Une si sombre enfance
Anton Pavlovitch Tchekhov [Čekhov] est né dans la petite ville de Taganrog, située sur la côte nord-est de la mer d'Azov. Son père, Pavel Egorovitch, était épicier. Fils de serf, pour ainsi dire analphabète, ses aptitudes commerciales étaient à peu près nulles et constamment tenues en échec par ses goûts artistiques et son fanatisme religieux. Tyran domestique, il voulait inculquer de force à ses enfants (cinq garçons et une fille) les principes rigides d'une morale aussi conventionnelle que rudimentaire. La vie à la maison était rude. Été comme hiver, on se levait à l'aube ; l'épicerie tant détestée ouvrait à 5 heures du matin et ne fermait que vers 11 heures du soir. C'est là que les deux aînés, Alexandre et Anton, passaient toutes les heures laissées libres par le lycée et l'église. Le père avait enrôlé dans le chœur qu'il dirigeait ses trois fils aînés. « Pendant que tous nos camarades se promenaient, nous devions courir les églises », écrira Tchekhov à Ivan Chtchéglov (le 9 mars 1892). Et il ajoutera : « J'ai peur de la religion : quand je passe devant une église, je me souviens de mon enfance et la terreur me saisit. » Mais si l'enfant souffre, le futur écrivain s'enrichit. La langue si particulière du clergé, cette pittoresque langue ecclésiastique émaillée de locutions slavones et d'argot de séminaire, nul écrivain russe, sauf N. S. Leskov, ne l'a possédée aussi parfaitement que Tchekhov.
À la boutique et à l'église s'ajoute le lycée. Anton y côtoie pour la première fois des intellectuels et aussi des enfants « qu'on ne fouette pas », mais le lycée n'eut que peu d'influence sur Tchekhov. Des maîtres sans génie ne réussirent à faire de lui qu'un élève médiocre. De ces maîtres, de cette ambiance, il fera plus tard la caricature dans L'Homme à l'étui (Čelovek v futljare, 1889).
À ces trois décors si sombres il faut joindre un quatrième, tout de douceur et de parfums champêtres. C'est le village de Kniajaia où Anton passe ses vacances auprès de son grand-père, régisseur de la comtesse Platov. Le voyage, à lui seul, est une aventure inoubliable. Soixante verstes de steppe parcourues dans des attelages tirés par des bœufs, voyage qui durait plusieurs jours à travers « un pays fantastique que j'aimais, où autrefois je me sentais chez moi, car j'en connaissais chaque recoin » (lettre à Plechtchéev, 1888).
Nuits passées sous le ciel profond de l'Ukraine, dans le foin odorant. Visages entrevus, atmosphère étrange et poétique, Tchekhov s'en souviendra plus tard. Pendant longtemps, il gardera jalousement ces souvenirs vivants, intensément vrais, et quand, enfin, il les utilisera dans La Steppe (Step', 1888), ils feront sensation.
Une telle enfance a singulièrement mûri Tchekhov. Il sut, malgré tout, sauvegarder en lui la gaieté, l'ironie, l'humour, la veine satirique, qui ne l'abandonnèrent jamais complètement, et qui, dans sa jeunesse, se manifestèrent en un véritable feu d'artifice de bons mots, d'inventions drolatiques, d'histoires cocasses. Ce génie burlesque se révèle dès ses premières œuvres : pendant de longues années, Tchekhov fut essentiellement un auteur comique.
Tchekhov a seize ans quand son père fait faillite. La prison pour dettes existait encore en Russie. Toute la famille quitte précipitamment Taganrog et s'installe à Moscou. Anton reste seul dans sa ville natale pour terminer ses études. Il subsiste grâce à des leçons et à l'aide intermittente d'un oncle. Le fatalisme de ses parents leur permet d'espérer qu'il se tirera d'affaire. Non seulement il survit, mais il trouve encore le temps de penser à eux, comme à d'autres, plus malheureux encore.
La percée de l'écrivain
Bachelier en 1879, Anton Tchekhov arrive enfin à Moscou. Sa famille loge dans un sous-sol humide, par les fenêtres duquel on n'aperçoit que le trottoir et les pieds des passants. Triste foyer, mais qui rapidement se transforme grâce à l'énergie, à la volonté et au sens pratique d'Anton. Prévoyant, il a amené de Taganrog deux camarades qui prennent pension chez les Tchekhov. Cela permet de manger un peu mieux, de quitter le sous-sol pour un appartement plus décent, bien que situé dans un quartier mal famé, tout près de la fameuse impasse Sobolev, bordée de maisons closes, impasse et maison qu'il a immortalisées dans La Crise (Pripadok, 1888).
En contrepartie de l'humanité déchue et tragique de ce quartier, Tchekhov avait, toute proche, la poésie bigarrée de la place Troubnaïa, avec ses marchands d'oiseaux, si poétiquement décrits dans À Moscou, sur la place Troubnaïa (1883). C'est là qu'il vécut de 1879 à 1885. Ensuite, la famille émigra vers le quartier paisible du Zamoskvoretchie et enfin s'installa, en 1886, dans la maison du docteur Korneev, transformée en musée depuis 1954.
En 1879, Tchekhov s'était inscrit à la faculté de médecine. Il menait de front ses études et le travail littéraire qui lui permit, dès l'âge de dix-neuf ans, et jusqu'à sa mort, de devenir le seul soutien d'une nombreuse famille.
Il collabore à plusieurs publications humoristiques (de 1881 à 1887) : La Cigale (Strekoza), Le Réveil-Matin (Budil'nik), Le Spectateur (Zritel'), Les Éclats (Oskolki). Il signe de divers pseudonymes.
En 1884, Tchekhov exerce la médecine dans les environs de Moscou ; cette même année paraît le premier recueil de ses nouvelles, Les Contes de Melpomène (Skazki Melpomeny). L'année 1886 est décisive. C'est le début de sa collaboration au Temps nouveau (Novoe Vremja), quotidien de tendance gouvernementale et réactionnaire, et de sa longue amitié pour Alexis Souvorine, directeur du journal et futur éditeur de l'écrivain. A. S. Souvorine est un autodidacte, sorti lui aussi du peuple et remarquable par son intelligence et sa vitalité. Il sera l'ami et le principal correspondant de Tchekhov. C'est à lui que furent adressées les lettres les plus révélatrices. Cette même année paraît un deuxième recueil de nouvelles, Récits bariolés (Pestrye rasskazy), comprenant les premiers chefs-d'œuvre, Tristesse (Toska), La Sorcière (Koldun'ja), Agathe (Agafia), suivi de deux autres recueils un an plus tard : Dans le crépuscule (V sumerkakh) et Innocentes Paroles (Nevinnye reči). Le 19 novembre 1887 a lieu la première représentation d'Ivanov au théâtre Korch, à Moscou.
En 1888, Tchekhov publie La Steppe, Les Feux (Ogni), La Crise. L'Académie des sciences lui décerne le prix Pouchkine. Cette même année, un cinquième recueil de nouvelles, Récits (Rasskazy), et en 1890 un sixième, Hommes moroses (Khmurye ljudi), sont édités.
Le voyage à Sakhaline
La renommée littéraire de Tchekhov croît sans cesse. Il vit dans la confortable « commode » (surnom donné à sa maison) moscovite, entouré de soins, d'affection, d'amitié. Mais il traverse une sorte de crise morale, prend de plus en plus conscience de ce que doit être le rôle d'un écrivain digne de ce nom : rappeler aux hommes certaines vérités fondamentales, éveiller leur conscience, leur montrer que « le bonheur et la joie de la vie ne sont ni dans l'argent, ni dans l'amour, mais dans la vérité ». Il fait alors le procès de ce qu'on appelle le bonheur dans une étonnante nouvelle, Groseilles à maquereau (Kryžovnik, 1898) : « Nous ne voyons pas, nous n'entendons pas ceux qui souffrent, et tout ce qu'il y a d'effrayant dans la vie se déroule quelque part dans les coulisses. C'est une hypnose générale. En réalité, il n'y a pas de bonheur et il ne doit pas y en avoir. Mais si notre vie a un sens et un but, ce sens et ce but ne sont pas notre bonheur personnel, mais quelque chose de plus sage et de plus grand. » Rejetant cette « hypnose » générale, il veut se rendre compte par lui-même de la condition des plus misérables d'entre les hommes : les millions de condamnés déportés dans les bagnes de Sakhaline ; à la surprise de tous ses amis, Tchekhov décide de visiter l'île maudite. Il ne se laisse pas détourner de son projet. Et cependant, il est malade. Entre 1884 et 1889, il a eu onze crachements de sang. Les crises se produisaient deux ou trois fois par an et allaient en s'aggravant. En décembre 1889, Tchekhov décline l'invitation de Souvorine qui lui demande de venir à Saint-Pétersbourg : il a peur des secousses du train qui pourraient provoquer une nouvelle hémorragie. Pourtant, le 2 avril 1890, il s'embarque pour un voyage qui dura cinquante jours. Aux observations de Souvorine, il répond : « Vous dites que personne n'a besoin de Sakhaline et que cette île n'intéresse personne. Est-ce juste ? Nous avons chassé des hommes enchaînés, dans le froid, pendant des dizaines de milliers de verstes, nous les avons rendus syphilitiques, nous les avons dépravés, nous avons procréé des criminels... Nous avons fait pourrir en prison des millions d'hommes, fait pourrir inutilement, sans raison d'une manière barbare, en rejetant la responsabilité de tout cela sur les surveillants de prison aux nez rouges d'ivrognes. Non, je vous assure, aller à Sakhaline est nécessaire et intéressant, et on ne peut que regretter que ce soit moi qui y aille et non quelqu'un d'autre, plus qualifié et plus capable d'émouvoir l'opinion » (9 mars 1890).
Tchekhov passe trois mois dans l'île. Il en étudie tous les aspects : « J'ai tout vu. Il n'y a pas à Sakhaline un seul forçat ou déporté à qui je n'aie parlé » (Lettre à Souvorine, 11 septembre 1890). En effet, il fut le premier à recenser la population de Sakhaline. Fiches en main, il visite chaque isba, chaque casernement, chaque mine, chaque lieu de déportation. Il voit chacun des dix mille habitants de l'île et remplit de sa main dix mille fiches. Les conclusions qu'il tire de cet immense travail sont terribles. L'abaissement, l'avilissement, le mépris de la personne humaine, il les relate, avec la sécheresse bouleversante d'un compte rendu, dans L'Île de Sakhaline (Ostrov Sakhalin, 1894).
Après son retour de Sakhaline, dans une longue nouvelle intitulée Récit d'un inconnu (Rasskaz neizvestnogo čeloveka, 1893), Tchekhov fit une importante profession de foi : « J'ai maintenant fermement compris que la destination de l'homme, ou bien n'existe pas du tout, ou bien n'existe que dans une seule chose : un amour plein d'abnégation pour son prochain. » Ce thème apparaîtra désormais en filigrane dans ses nouvelles et dans ses pièces.
Trois mois plus tard, en mars 1891, il fuit Moscou, sa table de travail et ses souvenirs et part avec Alexis Souvorine pour un premier voyage en Europe. Il en fera cinq, entre 1891 et 1904, en Italie, en France, en Allemagne et en Autriche. Enthousiasmé par l'Italie, il écrit de Florence : « Tout est merveilleux ici. Celui qui n'a pas vu l'Italie n'a pas vécu » (lettre à Olga Knipper, 19 janvier 1901). Mais cet enthousiasme est intermittent. Le 15 avril 1891, il écrivait à son frère Michel : « De tous les endroits que j'ai visités, c'est Venise qui m'a laissé l'impression la plus lumineuse. Rome ressemble, somme toute, à Kharkov, et Naples est sale. »
En fait, Tchekhov se languit toujours à l'étranger. À une période d'exaltation et de fièvre succèdent très vite l'ennui et le désenchantement. Loin de chez lui, loin de Moscou et des paysages moscovites, il se sent incapable de travailler, donc de vivre. Les plus beaux paysages de France ou d'Italie ne l'inspirent pas ; il apparaît avec évidence que l'Occident lui a laissé peu de souvenirs : quelques pages sur Venise et Nice dans le Récit d'un inconnu (1893), sur Abazzia et l'Italie dans Ariadna (1895) ; juste quelques lignes dans ce chef-d'œuvre de lyrisme qu'est L'Évêque (Arkhierej, 1902). Mais qui sait si, par un travail inconscient et invisible, les expériences vécues, les paysages et les êtres admirés ou simplement entrevus n'ont pas contribué à l'élaboration de ce composé subtil qu'est l'art poétique de Tchekhov ?
L'amour, le théâtre et la mort
À son retour, Tchekhov se rend compte que Moscou devient invivable. Sa notoriété grandit : amis, admirateurs, curieux assiègent sa demeure. Une « mauvaise grippe » ne le quitte plus. Il tousse, maigrit, « ressemble à un noyé ». En février 1892, il trouve enfin la propriété de ses rêves et, le 5 mars, Tchekhov et ses parents, sa sœur et son frère cadet Michel s'installent dans un village, à Melikhovo, à une vingtaine de kilomètres de Moscou.
Il avait fait construire un minuscule pavillon de bois au fond du verger, c'est là qu'il écrivit notamment La Salle no 6 (Palata no 6, 1892), Les Moujiks (Mužiki, 1897), Le Récit d'un inconnu (1893), Le Moine noir (Černyj monakh, 1891), Trois Années (Tri goda, 1895), Ariadna (1895) et enfin La Mouette (Čajka).
Durant les six années passées à Melikhovo, Tchekhov écrit plusieurs de ses plus belles œuvres et prend également part à la vie locale. Avec son habituelle efficacité, il lutte contre la misère et l'ignorance, procède au recensement de la population du district de Melikhovo, soigne des centaines de malades (surtout pendant l'épidémie de choléra de 1892-1893). N'ayant pas les moyens de « prendre l'année de repos nécessaire », il dépense néanmoins dix mille roubles pour faire bâtir trois écoles.
Cette double activité, sociale et littéraire, a un effet désastreux sur sa santé. Dans la nuit du 21 au 22 mars 1897, il a une forte hémoptysie. Pour la première fois, il se laisse ausculter par des médecins (exactement douze ans et trois mois après sa première hémoptysie), avoue à son ami Souvorine : « Mes collègues me disent à moi, médecin, que c'est une hémorragie intestinale ! Je sais pourtant bien que c'est la phtisie ! »
Il passa l'hiver 1897 à Nice pour rentrer à Melikhovo en mai 1898. Sa santé est à peine meilleure. Les médecins insistent pour qu'il passe les hivers en Crimée. Il doit abandonner Melikhovo, qui semble vide et mélancolique après la mort de son père (1898). Tchekhov écrit à Souvorine : « Au point de vue littéraire, Melikhovo s'est épuisé pour moi après Les Moujiks et a perdu toute valeur » (lettre du 26 juin 1899). Tchekhov considérait Les Moujiks comme une somme de ses expériences paysannes et comme un adieu à sa vie parmi eux.
Sur la côte sud de la Crimée, à la porte de Yalta, Tchekhov achète un terrain caillouteux et aride où il décide de bâtir. En septembre 1899, il s'y installe avec les siens. Ce sera sa dernière demeure. Convertie en musée, elle fut, entre 1919 et 1957, confiée à sa sœur Maria Pavlovna et devint un véritable lieu de pèlerinage.
En 1899, l'année même de son installation en Crimée, la famine se déclare dans la région de la basse et moyenne Volga. Malgré un état de santé de plus en plus précaire, Tchekhov s'emploie activement à rassembler des fonds, écrit des appels et des articles dans les journaux. Il s'efforce en même temps de venir en aide aux tuberculeux. Il parvient à rassembler quarante mille roubles, en ajoute cinq mille et fait construire (en 1902) un sanatorium qui porte son nom.
Pendant les dernières années de sa vie, Tchekhov a cruellement souffert. Sa tuberculose pulmonaire s'est compliquée d'une tuberculose intestinale (qu'il appelle dans ses lettres « catarrhe »).
Très malade, exilé dans ce Sud qu'il ne peut pas aimer, dont la végétation lui semble « découpée dans de la tôle », il se sent irrémédiablement seul. « Comme je serai couché seul dans ma tombe, de même toute ma vie j'ai vécu seul », écrit-il dans ses Carnets.
Pourtant, depuis 1898, il y a dans sa vie une femme qu'il aime tendrement et qu'il épouse en mai 1901. Olga Leonardovna Knipper est une jeune actrice du théâtre d'Art de Moscou fondé en 1897 et dirigé par Constantin Stanislavski et Vladimir Nemirovitch-Dantchenko. Le 17 octobre 1898, La Mouette, qui deux ans plus tôt avait subi un échec retentissant au théâtre Alexandre de Saint-Pétersbourg, remporte un triomphe au théâtre d'Art. Durant les six dernières années de sa vie, Tchekhov fut en contact constant et étroit avec cette jeune troupe d'avant-garde pour laquelle il écrivit ses pièces les plus célèbres : Oncle Vania (Djadja Vanja, 1899), Les Trois Sœurs (Tri sestry, 1901), La Cerisaie (Višněvyj sad, 1903). Mais le théâtre d'Art est loin, et Olga Knipper retenue par son métier à Moscou. Tchekhov est seul avec sa mère dans la maison silencieuse. C'est dans ce modeste bureau de Yalta que cet homme qui se voyait mourir écrit des chefs-d'œuvre tels que Dans le ravin (V ovrage, 1900), La Dame au petit chien (Dama s sobačkoj, 1899), L'Évêque, ainsi que ses trois grandes pièces.
Élu à l'Académie des sciences de Russie (section belles-lettres) en janvier 1900, il renonce, en 1902, au titre d'académicien pour protester contre l'exclusion de Maxime Gorki. Anobli par Nicolas II (« noblesse héréditaire »), décoré, il n'en fit jamais mention.
Sa maladie progresse et les souffrances augmentent. Cependant l'amour est là, profond, tendre, désespéré, comme il se doit quand on est Tchekhov, hypersensible et supralucide, et qu'on aime une femme brillante, célèbre, coquette, lointaine.
Le dialogue avec le public, sous la forme du théâtre, est un ultime recours, le seul moyen de s'exprimer, de s'épancher, de partager tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a appris pendant ces longs mois de tête-à-tête avec la solitude et la mort.
Le dernier hiver de sa vie, Tchekhov le passe à Moscou et assiste le 17 janvier 1904 à la première de La Cerisaie. En mai, il part avec sa femme pour Berlin et la Forêt-Noire (« je m'en vais pour crever », dit-il à Bounine). Il meurt à Badenweiler ; son corps est ramené à Moscou et inhumé au cimetière Novodevitchiï.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Sophie LAFFITTE : professeur à l'université de Paris-X-Nanterre
Classification
Médias
Autres références
-
LA CERISAIE (mise en scène A. Françon)
- Écrit par Didier MÉREUZE
- 1 108 mots
Le 17 mars 2009, Alain Françon a signé son dernier spectacle en tant que directeur du Théâtre national de la Colline, avant de céder la place à Stéphane Braunschweig, ancien directeur du Théâtre national de Strasbourg. En l'espace de douze années, il aura fait de cette institution l'un des...
-
LA MOUETTE, Anton Tchekhov - Fiche de lecture
- Écrit par Hélène HENRY
- 1 271 mots
- 1 média
En 1895, Anton Tchekhov (1860-1904), médecin et écrivain, est l'auteur fécond et déjà célèbre de récits humoristiques, de nouvelles (Les Contes de Melpomène, 1884 ; Récits bariolés, 1886) qui réinventent le genre, d'un reportage saisissant sur le bagne de l'île Sakhaline (...
-
NOUVELLES, Anton Tchekhov - Fiche de lecture
- Écrit par Jean BONAMOUR
- 1 116 mots
- 1 média
Anton Tchekhov (1860-1904) a publié des nouvelles depuis l'âge de vingt ans jusqu'à sa mort. Ces textes constituent la majeure partie de son œuvre et lui ont valu la célébrité à l'égal de son théâtre, avec lequel ils sont d’ailleurs organiquement liés. C'est par ses nouvelles aussi qu'il est devenu,...
-
PLATONOV (A. Tchekhov)
- Écrit par Raymonde TEMKINE
- 915 mots
En 1880, Tchekhov a vingt ans, il se lance dans l'écriture d'une pièce de théâtre où il imagine pouvoir tout déverser de ce qui bouillonne en lui d'idées, de désirs, d'inquiétudes, d'espoirs. Son foisonnement et sa durée – six heures au moins – sont tels qu'elle est jugée injouable, et refusée. Tchekhov...
-
DRAME - Drame moderne
- Écrit par Jean-Pierre SARRAZAC
- 6 058 mots
- 7 médias
Strindberg etTchekhov ne se préoccupent plus, quant à eux, d'un pareil sauvetage des formes anciennes. Ils abandonnent sans remords leurs drames aux perversions du roman. Évoquant, dans une lettre à l'actrice Kommissarjevskaïa, Les Trois Sœurs, Tchekhov annonce avec une certaine jubilation... -
RUSSIE (Arts et culture) - La littérature
- Écrit par Michel AUCOUTURIER , Marie-Christine AUTANT-MATHIEU , Hélène HENRY , Hélène MÉLAT et Georges NIVAT
- 24 004 mots
- 7 médias
...Gorki (Gor'kij, 1868-1936), Ivan Bounine (Bunin, 1870-1953), Alexandre Kouprine (Kuprin, 1870-1938) et Léonide Andréïev (Andreev, 1871-1919). Porté à la perfection par Tchekhov qui peint les intellectuels moroses de sa génération avec le laconisme de l'humoriste et la lucidité impitoyable du... -
RUSSIE (Arts et culture) - Le théâtre
- Écrit par Béatrice PICON-VALLIN et Nicole ZAND
- 8 646 mots
...puis psychologique – un naturalisme historique, lié aux réalisations des Meininger, qu'ils ont vues en tournées en 1890, naturalisme des « états d'âme », promu par la dramaturgie d'Anton Tchekhov qui, au carrefour du réalisme et du symbolisme, prend modèle sur la forme du roman. Leur programme artistique... -
THÉÂTRE D'ART DE MOSCOU - (repères chronologiques)
- Écrit par Jean CHOLLET
- 462 mots
1898 Vladimir Nemirovitch-Dantchenko et Konstantin Stanislavski fondent le Théâtre d'Art de Moscou (M.H.A.T.). Création de La Mouette de Tchekhov.
1900-1904 Après Oncle Vania (1899), création des Trois Sœurs et de La Cerisaie de Tchekhov, dont les mises en scène du M.H.A.T. ont révélé...
Voir aussi