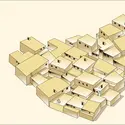PRÉHISTORIQUE ART
Article modifié le
Afrique
L'art rupestre du Sahara
Historique et répartition des découvertes
Sahara septentrional et central
L'un des tout premiers auteurs à avoir attiré l'attention du monde savant sur les gravures rupestres de plein air du nord de l'Afrique fut F. Jacquot, dans des articles consacrés, en 1847, aux stations de Tiout et de Moghrar et-Tahtāni en Algérie, l'année même où Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes publiait le premier volume des Antiquités celtiques et antédiluviennes, bien avant les premières découvertes de grottes ornées. Mais ces œuvres, jugées « affreusement indécentes » par Jacquot lui-même, n'éveillèrent qu'un écho discret, voire scandalisé, et les trouvailles ne se multiplièrent vraiment qu'au cours du xxe siècle.
Il n'est pas possible de citer toutes les contributions de voyageurs et de chercheurs, amateurs ou professionnels, qui ont fait connaître des documents rupestres provenant de l'ensemble du Sahara, car elles sont très nombreuses, et d'inégale importance. Cependant, il importe de rappeler que la découverte des peintures du Tassili-n-Ajjer revient au capitaine Cortier, qui les signala pour la première fois en 1909. Ces peintures furent ensuite documentées par le lieutenant Brenans, dont les carnets de terrain furent publiés par l'abbé Breuil en 1954, dans un article qui décida un jeune zoologiste, Henri Lhote, à consacrer sa vie à l'étude des arts rupestres du Sahara. À partir de 1956, celui-ci releva de nombreuses fresques au cours de ses expéditions au Tassili-n-Ajjer, puis organisa à Paris, dès 1957, une exposition sur les « Peintures préhistoriques du Sahara » (musée des Arts décoratifs).
Les peintures photographiées et relevées au cours des missions confiées de 1946 à 1949 à Yolande Tschudi par le musée d'Ethnographie de Neuchâtel, avaient été publiées en 1956 dans un ouvrage intitulé Les Peintures rupestres du Tassili-n-Ajjer. Mais cet ouvrage fut éclipsé par le récit qu'Henri Lhote fit de ses propres recherches en 1958, À la découverte des fresques du Tassili, bientôt traduit en plus de dix langues, et qui familiarisera le grand public avec l'art rupestre de cette région. Pour Henri Lhote, ce livre marquera aussi le début d'une longue carrière essentiellement consacrée à l'art rupestre saharien, avec la production de plusieurs centaines de publications. Cependant, les croquis qu'il publia ne sont pas toujours très fiables, ce qui conduisit Jean-Dominique Lajoux, l'un de ses anciens collaborateurs, à retourner sur le terrain pour y réaliser de remarquables photographies.
Les premières gravures rupestres sahariennes furent découvertes en 1850 à Tilizzaghen au Messak (Fezzan, Libye) par l'explorateur Heinrich Barth, alors en route vers Tombouctou. À son retour, il ne présenta que trois gravures dans le récit de son voyage, gravures qui ne soulevèrent guère d'intérêt avant 1932, date à laquelle l'anthropologue et préhistorien Leo Frobenius décida de consacrer une expédition à l'étude de ces œuvres. Un riche répertoire iconographique fut alors découvert, dont l'inventaire se poursuit encore de nos jours. En 1948, Roger Frison-Roche photographia les gravures de l'Adrar Iktebīn, dans la même région, y trouvant l'inspiration d'un récit romancé : La Montagne aux écritures. Les recherches se développèrent à la fin des années 1960, quand deux missions italiennes conduites par Paolo Graziosi, permirent à ce dernier de faire de nouvelles explorations au Messak. Dans cette zone, les découvertes étonnantes se sont multipliées ces dernières années, particulièrement grâce aux minutieuses prospections de Gérard Jacquet, Jan Jelínek, Giancarlo Negro, et enfin Rüdiger et Gabriele Lutz. Mais c'est surtout depuis 1990, date à laquelle Axel et Anne-Michèle van Albada ont fait connaître les premiers résultats de leurs recherches, que nos connaissances ont évolué de façon décisive, notamment en ce qui concerne les personnages masqués, les cynocéphales mythiques, les scènes de sacrifice et de partage d'antilope, etc.
Autre province rupestre importante, l'Akākūs, située dans l'extrême sud-ouest de la Libye entre le Messak et le Tassili, recèle des gravures et des peintures, mais ce sont surtout ces dernières qui ont attiré l'attention des chercheurs.
Le Tassili-n-Ajjer, lui aussi, est surtout connu pour ses peintures, les publications d'Henri Lhote ayant rendu célèbres celles de localités comme Séfar, Jabbaren ou Iheren, mais de nombreux ensembles restent encore à découvrir ou à publier. Parmi les études importantes pour cette région, il convient de citer les travaux de Ginette Aumassip sur le site de Ti-n-Hanakaten, et ceux d'Alfred Muzzolini, Aldo Bocazzi et Augustin Holl sur celui de Tikadiouine.
Le Tassili-n-Ajjer est également riche en gravures, l'oued Djerāt, découvert par le lieutenant Brenans en 1932, constituant à cet égard un site capital, presque aussi important, par le nombre et la qualité des œuvres, que les vallées du Messak libyen.
D'autres sites à gravures, signalés au Sahara central, ont été partiellement inventoriés, mais l'intérêt du livre que Théodore Monod a consacré à l'Ahnet dépasse largement celui des gravures qui y sont décrites, dans la mesure où les conceptions chronologiques qui y étaient développées dès 1932 connurent une très longue postérité. Elles influent toujours d'ailleurs sur les cadres de pensée des chercheurs qui travaillent sur l'ensemble du Sahara (cf. infra, Classification et datation).
Dans l'Ahaggar (Hoggar), depuis l'ouvrage rédigé en 1938 par F. de Chasseloup-Laubat à l'issue de l'expédition alpine française du Haut-Mertutek, l'essentiel de nos connaissances est dû aux minutieuses prospections et aux magnifiques monographies de Franz Trost sur l'Ahaggar central, publiées en 1981 et 1997.
Sahara oriental, occidental et méridional
Certaines découvertes ont joué un rôle important dans les discussions concernant les œuvres rupestres du Sahara central en général. Ainsi, en 1864, l'explorateur et géographe Henri Duveyrier signalait l'existence, au col d'Anaï, de gravures de chars tirés par des bœufs, sur « la piste que suivaient les Garamantes vers l'Aïr », et donnait ainsi naissance au mythe de la « route des chars », qui eut la vie dure. Douze ans plus tard, le médecin explorateur allemand Gerhard Rohlfs découvrait le site de l'oued el-Khēl en Sud-Tripolitaine, qui sera publié en 1968 par Paolo Graziosi, et qui est célèbre par ses nombreuses gravures de « femmes ouvertes », femmes accroupies, vues de face, souvent évoquées dans les études sur la signification de l'art rupestre. Cette même année, le Libyen Fathallah Ezzedīn remarquait sur des dalles horizontales de Sīdi Sharīb, près de Tarhūna, en pleine Tripolitaine, des gravures qui seront toutes publiées par Jan Jelínek en 1982, et qui sont parmi les plus septentrionales connues dans leur style. En 1979, le général Huard fera connaître la station de Timissit, au sud de Ghadamès, remarquable par ses nombreuses spirales et empreintes gravées. Une dizaine de gravures découvertes à Gārat Umm el-Mançūr (près de Sinawen) par Umberto Paradisi, en 1963, sont particulièrement intéressantes pour l'étude de la répartition des ovins ornés, car elles témoignent d'une extension méridionale inattendue.
Depuis les découvertes de Marc Milburn dans le nord-ouest de l'Aïr en 1976-1977, de Jean-Pierre Roset dans l'Aïr septentrional en 1971, et de Gérard Quéchon et Jean-Pierre Roset dans le massif de Termit en 1974, les figurations rupestres de la partie méridionale du Sahara sont beaucoup mieux connues, surtout grâce aux importants corpus réalisés en 1979 et 1987 par Henri Lhote pour l'Aïr, et en 1991 par Christian Dupuy pour l'adrar des Ifoghas (Iforas). Dans leur immense majorité, ces gravures appartiennent à l'école dite du « guerrier libyen », nom donné aux innombrables représentations de personnages géométriques stéréotypés qui couvrent les rochers de ces régions.
Par sa thématique et son style, le monde des gravures de l'Atlas saharien est souvent proche de celui du Sahara central, mais la plupart des ensembles connus n'ont été que très partiellement décrits et, depuis soixante ans, on publie régulièrement les photographies des mêmes œuvres. Depuis 1990, des sites de peintures ont été découverts en Tunisie, notamment dans la région de Ghoumrassen, attirant l'attention sur une zone jusqu'alors absente des cartes de répartition des arts rupestres sahariens. Du point de vue de l'art rupestre, le Haut Atlas marocain, le Rio de Oro et l'Adrar mauritanien semblent appartenir à un autre monde que les ensembles du Sahara septentrional et central. Au Maroc et au Rio de Oro, on remarque en particulier des gravures de poignards, de haches nervurées (dites « hallebardes ») et d'un type particulier de haches à manche coudé (dites haches peltes), qui ne se retrouvent nulle part ailleurs au Sahara, et qui signalent une période récente, où le façonnage du métal était évidemment acquis. De l'Adrar de Mauritanie et de l'Aouker, on retiendra surtout la présence de nombreuses gravures de chars schématiques souvent attelés à des bœufs, ce qui reste rare dans les autres provinces rupestres.
Dans le désert Libyque oriental, les gravures du Karkūr et-Talh ont été signalées en 1923 par Hassanan Bey alors que, de 1924 à 1926, le prince Kémāl ed-Dīn poursuivait le relevé de celles d'Awenāt. En 1933, un archéologue italien, di Caporiacco, découvrait les peintures d'Aïn Dūwa alors que, la même année, Hans Rhotert entreprenait la première étude générale de l'art rupestre de l'ensemble de la région, dans une monographie qui ne fut éditée qu'en 1952. De nombreuses peintures et gravures inédites du Karkūr et-Talh seront signalées en 1936 par le célèbre aventurier hongrois Lazlo de Almazy (héros du film Le patient anglais), et leur inventaire systématique sera entrepris par Hans Winkler deux ans plus tard. Enfin, une expédition belge dirigée par Francis Van Noten repérera de nombreuses peintures et gravures dans les vallées de la région d'Awenāt et du Gilf Kebīr, moisson qui se concrétisera en 1978 par la publication d'une synthèse magnifiquement illustrée. Hormis un énigmatique panneau de peintures représentant des Têtes rondes à Bū Hlēga dans le Karkur Drīs, les figurations observées à Awenāt représentent surtout des bovins, des chèvres et des personnages souvent comparables aux peintures du massif de l'Ennedi (nord-est du Tchad), avec lequel des relations devaient exister aux alentours du IIe millénaire avant J.-C.
La plupart des sites anciennement signalés dans l'Ennedi par D'Alverny, Gérard Bailloud et Paul Huard ont été revus en 1996-1997 par Adriana et Sergio Scarpa Falce, Jacques et Brigitte Choppy, Aldo et Donatella Bocazzi. À part quelques peintures qui évoquent les Têtes rondes du Tassili, l'ensemble ne peut guère être antérieur au IIe millénaire avant J.-C.
Le Djado a fait l'objet de recherches approfondies de la part de Karl Heinz Striedter et Michel Tauveron, alors que le Tibesti est désormais bien connu grâce à une publication collective dirigée par Giancarlo Negro, Roberta Simonis et Adriana Ravenna. Dans ces deux zones, il existe des gravures apparemment anciennes, qui pourraient correspondre à une extension méridionale extrême du style bubalin. Dans leur grande majorité, les peintures et gravures du massif sont pastorales au sens large, leur phase la plus ancienne étant représentée par le style dit de Karnasahi où abondent les archers en mouvement à tête zoomorphe.
Classification et datation
Les premières publications de « fresques » du Tassili suscitèrent un important mouvement d'intérêt de la part des préhistoriens et du grand public : on pensait qu'enfin se dévoilaient des témoignages de première main sur la vie quotidienne, les croyances et la culture matérielle de peintres et de graveurs ayant vécu « au temps où le Sahara verdoyait », et que les œuvres allaient nous livrer d'irremplaçables informations sur leurs cultures à jamais disparues. De plus, la qualité graphique de nombre de ces productions en faisait des œuvres de tout premier plan, capables de toucher notre propre sensibilité artistique, et dignes de figurer en bonne place dans toutes les anthologies et histoires de l'art.
Les découvertes se multipliant, il devenait indispensable d'introduire un ordre dans la masse grandissante des documents – bientôt connus par dizaines de milliers sur l'ensemble de l'hémi-continent – et l'on convint de les classer par périodes. Mais si les œuvres tassiliennes sont généralement les plus connues, et si leur étude a permis l'établissement de plusieurs systèmes chronologiques, il faut rappeler que la toute première classification des gravures fut proposée au milieu du xixe siècle par Heinrich Barth, qui distinguait les figurations « à grands animaux » des gravures « très mal et très négligemment tracées ». Cette distinction fut ultérieurement reprise par le géographe Émile Félix Gautier, lequel écrira dans la première décennie du xxe siècle : « Tout ce qui n'est pas belle gravure ancienne [...] est immonde graffiti libyco-berbère ». Ainsi, dès les premières tentatives de classification, apparaissait la regrettable intrusion de critères artistiques imputables au goût des classificateurs, et dont l'archéologie et l'histoire de l'art n'ont pas encore réussi à se dégager totalement.
Dès les premières découvertes, on avait remarqué que plusieurs époques étaient concernées, puisque certains des « graffiti » représentaient des dromadaires – d'introduction récente au Sahara – tandis que d'autres montraient des espèces disparues de la région (comme l'hippopotame, l'éléphant, la girafe ou le rhinocéros) voire définitivement éteintes (comme le grand buffle antique). L'habitude de classer les gravures rupestres en fonction des espèces animales représentées s'imposa donc et, à la suite de Théodore Monod, on considéra certaines figurations animales comme des sortes de fossiles directeurs. Les périodes les plus récentes, caractérisées par la présence de dromadaires et de chevaux, furent dites « cameline » et « caballine », tandis que les images représentant des bœufs domestiques étaient dites « pastorales » ou « bovidiennes », alors que la catégorie du « bubalin », considérée comme la plus ancienne, se fondait sur les figurations d'une espèce disparue de buffle géant, dite « grand bubale ».
Les premiers spécialistes de l'art rupestre, formés à l'école des anthropologues du xixe siècle et du début du xxe siècle, crurent alors découvrir, dans les œuvres qu'ils étudiaient, les témoignages du passage d'une culture de chasseurs à une civilisation de pasteurs. Aux premiers furent attribuées les gravures du « bubalin », et aux seconds les œuvres dites « pastorales », notamment les innombrables peintures de bovins domestiques. Ainsi, les premières observations de Lhote au Djerāt lui firent-elles « admettre l'existence, au Sahara central, d'un groupe archaïque néolithique où la faune est exclusivement éthiopienne ». À l'occasion de l'exposition parisienne des relevés qu'il avait effectués au cours de ses missions, il affirma que les gravures de la période dite par lui « des chasseurs » ou « du bubale » devaient être situées entre 6000 à 8000 ans avant J.-C. », alors que celles des « Pasteurs à bovidés » auraient débuté au Ve millénaire. Mais, reprenant le dossier du Djerāt plusieurs années après ses premiers séjours au Tassili, il reconnut qu'il y avait lieu « de revenir sur la conception qui n'admettait pas le bœuf (domestique ?) dans le groupe des gravures de style naturaliste, défini parfois sous le nom de groupe des chasseurs ou du bubale ou du bubalin ».
La périodisation des figurations anciennes en productions d'abord « bubalines » ou « des chasseurs » puis « pastorales », ne fut donc qu'une simple hypothèse construite à partir de quelques cas jugés exemplaires, et choisis sur une poignée de sites de l'Atlas, du Tassili et du Fezzān. Cette proposition fut progressivement figée en une théorie abusivement élargie à l'ensemble du Sahara, du Sud marocain et du Rio de Oro à l'Algérois et au Constantinois, de l'Ahaggar et du Tassili au Fezzān, voire jusque dans la vallée du Nil. Partout, les voyageurs trouvaient de nouveaux sites rupestres dont les productions graphiques étaient aussitôt attribuées, selon leur sujet, soit aux « chasseurs », soit aux « pasteurs ». Mais caractériser une « période des chasseurs » par l'absence totale de représentations d'animaux domestiques, ainsi qu'on le faisait alors (et comme on le fait encore trop souvent), expose au risque d'effectuer le raisonnement circulaire suivant :
1. L'art des « chasseurs » (ou du « bubalin ») est défini comme figurant essentiellement des animaux sauvages, et celui des « pasteurs » comme figurant surtout des animaux domestiques ;
2. Par conséquent, lors de l'étude des sites, faune sauvage et animaux d'apparence domestique sont traités séparément, de façon à constituer deux ensembles thématiques ;
3. Sans autre argument, ces deux ensembles – construits de toutes pièces par les chercheurs – sont alors considérés comme appartenant bien à deux entités culturelles différentes et successives.
On a parfois repoussé au-delà du Néolithique l'âge des gravures « bubalines » supposées appartenir à un monde de chasseurs paléolithiques. De nos jours encore, certains leur attribuent volontiers 10 000 ans d'ancienneté, voire 20 000 ans ou plus. Depuis les années 1970, les prises de position se sont succédé à propos des différents « étages » de l'art rupestre du Sahara et de leur âge, mais les chronologies qui en résultent sont fragilisées par nombre de défauts méthodologiques, dont les plus fréquents sont : l'attribution de gravures à des groupes stylistiques définis sur des peintures (ou l'inverse), l'absence de définition précise des styles, l'association systématique d'un style et d'un « étage », la définition a priori de chaque grande période par la présence d'un seul animal caractéristique, l'interprétation des différences de patine en termes de « quelques millénaires » supposés s'écouler entre chaque phase, l'attribution systématique et non étayée de tout « bubale » à une « période bubaline » et enfin l'amalgame entre les notions de style, d'époque et d'ethnie.
La chronologie
Les méthodes objectives de datation
Par la patine. Comme des estimations chronologiques très différentes coexistent dans les publications spécialisées, le prodigieux imagier rupestre saharien semble avoir perdu beaucoup de son intérêt pour les préhistoriens. Plusieurs tentatives ont donc vu le jour, qui visaient à ancrer l'art rupestre dans un cadre chronologique acceptable. À cet effet, pour dater les gravures, on a d'abord cru pouvoir utiliser l'étude des patines, puisque la roche fraîchement incisée ou percutée est d'abord de teinte très claire, avant de foncer avec le temps jusqu'à reprendre la couleur sombre qui était la sienne au départ. L'intensité des teintes devrait donc être proportionnelle à l'ancienneté des œuvres, rendant presque immédiate la lecture de leur position chronologique relative. Malheureusement, il est maintenant attesté que le processus de « patinisation » ne s'effectue pas selon une fonction linéaire du temps et qu'une patine extrêmement foncée peut parfois survenir très rapidement. Tout espoir de datation par les patines s'est donc révélé illusoire. Pourtant, des recherches récemment conduites au Messak ont montré que la formation de la patine noire qui recouvre généralement les gravures les plus anciennes, et qui est liée à l'activité de bactéries fixant le manganèse, s'était déroulée durant l'Holocène moyen, vers la fin du VIe millénaire beforepresent (B.P., c'est-à-dire par convention, avant 1950) et encore au début du Ve millénaire. Ce processus fut interrompu ou considérablement ralenti vers le IVe millénaire B.P., par suite de la détérioration climatique générale du Sahara à cette époque.
Par la sédimentologie. Des observations conduites dans la Tadrart algérienne concernent des gravures rupestres partiellement recouvertes par des sédiments holocènes, ce qui a permis d'intéressantes tentatives de datation. En effet, deux niveaux de terrasses ont été reconnus dans cette vallée : c'est le niveau le plus ancien qui se trouve au contact des gravures, alors que le plus récent résulte d'écoulements ayant entamé et déplacé des dépôts antérieurs. L'intensité des écoulements reconnus dans le niveau récent permet de supposer que sa formation précéda l'Aride généralisé dans l'ensemble du Sahara à partir de 4000-3500 B.P. L'autre niveau est donc plus ancien, mais toute la question est de savoir dans quelle mesure. On a proposé de le mettre en relation avec une accumulation de matériels détritiques antérieure à 7500 B.P. Si cette estimation était confirmée, il en résulterait que les gravures de bovinés en partie sous-jacentes à cette terrasse auraient forcément été réalisées avant cette date. En outre, comme le trait incisé des pattes de ces bovins fut repris par piquetage à une époque inconnue, mais également antérieure au dépôt de terrasse, il a été supposé que le trait original aurait été exécuté avant le premier Humide holocène, c'est-à-dire au Pléistocène final. Mais même si la date de 7500 B.P. était confirmée pour la formation de la terrasse ancienne, il resterait à mesurer l'intervalle entre la date de la reprise piquetée et celle des œuvres incisées originales. Et même en supposant que la reprise visait à restaurer l'œuvre originale en partie effacée, on resterait dans l'incapacité de délimiter avec certitude le laps de temps nécessaire à cet effacement. Ce temps pourrait se mesurer en millénaires, mais tout aussi bien en siècles ou en décennies, car il n'est aucunement prouvé que l'érosion des gravures nécessite toujours l'action de plusieurs millénaires, de périodes entières de la succession des « Arides » et des « Humides ». En fonction de la localisation des œuvres, très peu de temps pourrait y suffire, lors d'un épisode de corrasion (érosion éolienne) court mais intense, et il faut redire qu'il n'existe toujours aucun moyen de reconnaître la durée d'un processus d'érosion à partir de son action sur un trait gravé, une action importante ne correspondant pas forcément à une longue durée du processus.
Par le carbone 14. Afin d'employer les techniques de datation utilisant la spectrométrie de masse par accélérateur pour dater des peintures en n'utilisant qu'une très petite quantité de matière, il faut disposer d'échantillons contenant des matières organiques, ce qui est rare au Sahara. Une date de 6145 ± 70 ans B.P. a été obtenue sur une peinture peut-être bovidienne de l'abri Lancusi dans l'Akākūs (sud-ouest du Sahara libyen), et l'on peut supposer que de nouveaux résultats seront bientôt disponibles sur d'autres sites.
La méthode culturelle
Les présupposés évolutionnistes. Bien que depuis plus d'un siècle, de nombreux auteurs aient réfuté la doctrine évolutionniste voulant faire partout passer l'humanité de l'étage des « chasseurs » à celui des « pasteurs » et bien qu'une théorie aussi obsolète soit abandonnée par la plupart des anthropologues, il est curieux de constater qu'elle est toujours admise par la majorité des chercheurs en art rupestre saharien. Cette situation est dénoncée, depuis le début des années 1980, par Alfred Muzzolini, lequel conteste vigoureusement « ce paradigme qui revient à attribuer tous les chasseurs, par principe, à une phase „ancienne“ ». Ses critiques n'ont malheureusement guère été entendues, puisqu'elles visent des attributions qui ne s'appuient pas sur un raisonnement, mais sur l'un des fondements imaginaires de notre propre culture associant, dans les profondeurs de notre esprit, la chasse à l'archaïsme. En effet, les chasseurs symbolisent le primitif et le sauvage, et sont couramment associés, consciemment ou non, à une prétendue « mentalité archaïque ». Au point que, dans le vocabulaire des chronologies sahariennes, une expression comme « période des chasseurs archaïques » sonne presque comme un pléonasme.
Les chronologies traditionnelles des arts rupestres sahariens illustrent donc un état ancien des études anthropologiques, popularisé à la fin du xixe siècle par Lewis Henry Morgan, présupposant un progrès linéaire de l'humanité par complexification progressive des cultures et impliquant l'existence d'un ordre immanent dans la succession des phénomènes économiques et culturels. Ces chronologies, qui se plaisent à reconnaître parmi les gravures rupestres sahariennes des témoignages de la succession : « chasseurs », puis « pasteurs », prolongent aussi la thèse du père Wilhelm Schmidt qui, en 1926, affirmait dans Der Ursprung der Gottesidee, qu'il faut distinguer Urkultur (culture des chasseurs nomades) et Primärkultur (culture des pasteurs), la seconde succédant nécessairement à la première. Le postulat évolutionniste sous-jacent transparaît clairement dans le vocabulaire utilisé pour le Sahara. En effet, des chasseurs tardifs (Late Hunters) y succèdent régulièrement aux chasseurs précoces (Early Hunters), on évoque volontiers la « diminution de la qualité artistique », ou bien l'on commente l'évolution d'un « style des chasseurs » allant du « décoratif » au « simplifié » en passant par le « classique » quand certaines œuvres ou périodes ne sont pas qualifiées de « décadentes », voire de « grossières » et de « primitives », tandis que le « subnaturalisme » y succède forcément au « naturalisme ». Pourtant, contre le préjugé d'un évolutionnisme culturel linéaire et universel, se sont d'abord élevées les voix d'Eduard Hahn, de Franz Boas et de Robert Lowie, puis celles de Bronislaw Malinowski, Wilhelm Koppers et Alfred Reginald Radcliffe-Brown, pour ne citer que les auteurs les plus connus. De nos jours, les anthropologues ont donc très généralement abandonné la théorie selon laquelle les sociétés passeraient nécessairement par des phases historiques liées aux ressources alimentaires, techniques et intellectuelles mises en œuvre pour répondre aux pressions de l'environnement. Il est désormais admis qu'il s'agissait d'une idée reçue, largement controuvée par les observations ethnologiques et qui, sur le terrain, a souvent conduit à ne prendre en compte que les singularités culturelles jugées susceptibles d'indiquer des écarts historiques. C'est ainsi que, dans l'étude des arts rupestres du Sahara, ce présupposé conduit à ne s'intéresser aux figurations de bovinés que dans la mesure où elles pourraient livrer des indices de domestication, ou bien à ne relever les représentations de la grande faune sauvage et les scènes cynégétiques (ou supposées telles) que parce qu'elles révéleraient la présence de « chasseurs ».
Les styles de gravures. Dans l'attente de l'application généralisée d'un ou plusieurs procédés objectifs de datation absolue des images rupestres, les seuls arguments valides pour l'instant sont d'ordre stylistique et culturel. Du point de vue stylistique, on distingue trois grandes « écoles » de gravures : le « Bubalin », l'école dite « de Tazina » et celle dite du « guerrier libyen.
Le Bubalin. La plupart des auteurs ont affirmé jusqu'à présent que les gravures « bubalines » ou des « chasseurs » seraient d'un autre style que les œuvres proprement pastorales, mais des recherches précises, portant sur plusieurs milliers de figurations, font rejeter cette assertion.
Si l'on s'en tient à l'étude des seuls témoignages graphiques que nous ont laissés les anciens habitants du Sahara, il est impossible d'en déduire l'existence d'une « culture des chasseurs » qui aurait laissé place à des pasteurs. La fréquence des animaux sauvages représentés dans l'art bubalin a souvent été surévaluée, de même que celle des scènes de chasse véritable. En outre, la présence de ce type d'image n'implique aucunement qu'elles soient le fait d'une société de « chasseurs ». Le grand buffle antique traditionnellement dénommé « bubale » ne peut caractériser un « Bubalin » très ancien puisqu'il est désormais attesté qu'en plusieurs points du Sahara, il a vécu très tardivement, au moins jusque vers 4000 B.P. S'il est parfaitement exact qu'il fut chassé et consommé par certains Néolithiques du Sahara, on constate que l'appellation de « bubalin » a été utilisée, surtout dans l'Atlas saharien et au Sahara central, pour définir des ensembles rupestres où cet animal n'est pas toujours présent, et que ce dernier a disparu longtemps après la fin de la phase qu'il est supposé caractériser. Ce terme de « bubalin » ne saurait donc être conservé que comme une étiquette commode pour désigner le style des gravures sur lesquelles le grand buffle antique apparaît le plus souvent, mais en aucun cas pour qualifier un étage particulier.
Les gravures de ce style, souvent détaillées, sont essentiellement « naturalistes » et comportent des représentations de la grande faune sauvage (éléphants, rhinocéros, hippopotames, girafes) dont certains représentants ont disparu beaucoup plus tard qu'on ne le pensait il y a une vingtaine d'années (des ossements d'hippopotames abondent par exemple dans les restes de cuisine du Ténéréen, vers 3500-2000 avant notre ère). Mais la présence de bovins et d'ovins domestiques y est également bien attestée, ainsi que le prouvent les bœufs richement parés, tenus en longe, ornés de pendeloques à décor géométrique maintenues par un collier, et portant des selles décorées munies d'un pommeau en « V » sculpté, connus dans l'art bubalin du Messak libyen, pourtant considéré comme un des « foyers » de la « culture des chasseurs ». Aucun animal indéniablement domestique n'étant connu au Sahara avant le Ve millénaire avant J.-C., les peintures ou gravures qui en représentent ne peuvent être antérieures, à moins de supposer l'existence, en plein Sahara central, d'une zone de primo-domestication plus ancienne. Placer ces œuvres dans le Ve millénaire avant J.-C. les fait concorder parfaitement avec les estimations signalées plus haut à partir de l'étude des états de patine.
Comme, par ailleurs, aucun des critères de superpositions, style ou technique ne permet de dissocier objectivement les images d'animaux domestiques et les représentations de la grande faune sauvage, il faut bien admettre que l'art gravé de style (et non d'âge) bubalin ne correspond pas à la production artistique de prétendus « chasseurs », mais constitue bien l'œuvre gravé d'un seul et unique groupe culturel qui, il y a environ 6500 ans, avait élaboré une haute civilisation pastorale. Bref, le fait d'inclure, au sein d'un ensemble pleinement pastoral, les œuvres habituellement considérées comme bubalines ou « des chasseurs » ne devrait pas réellement surprendre. Henri Lhote et Paolo Graziosi avaient déjà suggéré un tel regroupement, et cela ne fait que confirmer une remarquable intuition de Théodore Monod qui, dès 1932, posait la question de savoir si certains groupes de gravures de l'ensemble « préhistorique bovin » ne seraient pas à intégrer au « Bubalin », dont ils auraient été « plus ou moins contemporains ».
Le style de Tazina. Ce style tire son nom d'une station située dans les monts des Ksour, en Algérie, et il est essentiellement caractérisé par de petites gravures de gazelles et de girafes finement incisées, plus rarement d'autruches ou de grands fauves, dont les extrémités sont prolongées de manière parfois très fantaisiste. La très large répartition de ce type de représentations pose des problèmes difficiles à résoudre, car elles dominent numériquement de larges ensembles du Sahara occidental (Haut Atlas marocain, Rio de Oro, Adrar mauritanien) et du Sahara centro-méridional (Messak libyen, Djado).
Les Guerriers libyens. Il s'agit d'un type de gravures le plus souvent piquetées, qui se trouvent en grand nombre dans l'Adrar des Ifoghas et de l'Aïr, moins fréquemment en Ahaggar, mais tout à fait exceptionnellement au Fezzan, au Djado et au Tibesti. Elles correspondent vraisemblablement à la première occupation berbère du Sahara, et représentent surtout des hommes dessinés en position frontale, arborant volontiers des lances aux armatures (lames) exagérément agrandies, qui sont souvent munis d'un bouclier rond et tiennent des chevaux par une longe. Des figures comparables existent dans l'Adrar de Mauritanie et l'Aouker. Toutes ces œuvres sont à situer entre le Ier millénaire avant notre ère et le Ier millénaire après.
Les styles de peintures. La zone du Sahara pour laquelle on dispose des meilleures données est celle du Tassili-Akākūs ; ailleurs, le regroupement en écoles est soit en cours (Tibesti oriental), soit n'a aucune assise chronologique fiable, soit encore souffre d'une multiplication excessive de petits styles très localisés et mal définis (Ennedi).
Les Têtes rondes. L'école des « Têtes rondes », essentiellement tassilienne, est surtout connue par la présence des « Martiens », sortes de personnages en aplat clair cerné d'un contour sombre, à grosse tête arrondie sans indication des traits du visage, et qui caractérisent les peintures les plus anciennes. La faune, dont l'identification est souvent malaisée, est surtout composée d'antilopes. Des réalisations probablement plus récentes mais dues à cette école, sont connues dans l'Akākūs, et il est bien difficile d'en préciser la position chronologique par rapport aux peintures du Bovidien ancien local. Dans les phases plus tardives, l'aplat clair cède la place au remplissage à l'ocre.
Le Bovidien. Pour le Bovidien ancien, il s'agit essentiellement de peintures de personnages négroïdes en aplats ocres, qu'Alfred Muzzolini a proposé de regrouper sous l'appellation d'« école de Sefar-Ozanéaré ». Elles n'ont été reconnues qu'au Tassili, et leur thème de prédilection est celui dit de « la conversation devant l'enclos », où des hommes et des femmes, aux cuisses volumineuses, sont assis ou allongés devant des habitations de plan elliptique ou sub-rectangulaire dont l'aménagement intérieur est en partie visible.
En ce qui concerne le Bovidien récent, les peintures de l'école d'Abaniora, en aplats ocres, comportent des personnages dont le profil évoque celui des Peuls actuels, ce qui a contribué à l'élaboration de théories interprétatives visant à expliquer très imprudemment l'art rupestre saharien par les traditions culturelles de ce peuple. Enfin, l'école d'Iheren-Tahilahi, caractérisée par les dessins au trait fin, nous a laissé de nombreuses peintures pastorales complexes (déplacement des campements, montage des tentes) où dominent les bœufs et les moutons, mais aussi des scènes de chasse au lion. Cette école trouve des correspondances dans l'Akākūs, notamment avec le style de Wa-n-Amil, avant de se prolonger insensiblement dans la « période du cheval » qui verra bientôt l'apparition des premiers chars « au galop volant ».
Caballin et camélin. Aucune rupture franche n'apparaît entre le monde des derniers pasteurs (par exemple l'école de Ti-n-Anneuin, caractérisée par des personnages rigides, longilignes, peints en blancs avec un manteau ocre) et celui des « Caballins » ou « Équidiens », qui affectionnent les personnages bi-triangulaires, dont la tête peut être réduite à un simple bâtonnet. Après le cheval, on voit apparaître les chars vraisemblablement introduits par l'intermédiaire de Cyrène, à partir du viie siècle avant J.-C. L'alphabet libyque, préfigurant les actuels caractères tifinaghs, n'apparaît probablement pas au Sahara central avant les ve-vie siècles avant J.-C. Enfin, le chameau fait son apparition dans le dernier quart du Ier millénaire avant J.-C. et permet la reconquête d'un Sahara que ses anciens habitants, chassés par la détérioration du climat, avaient presque totalement abandonné. De nos jours, les Touaregs continuent à graver ou à peindre dans leur environnement, surtout autour des gueltas (points d'eau temporaires), des figurations camélines et des caractères tifinaghs.
La recherche du sens
Les comparatistes
Les premiers découvreurs s'interrogèrent sur le sens des représentations qu'ils rencontraient et, très tôt, plusieurs interprétations et « clés de lecture » de l'art rupestre furent proposées, s'appuyant sur des rapprochements concernant d'abord des données grecques, puis égyptiennes et africaines. Les anciens chercheurs qui, sur les dispositifs rupestres sahariens, crurent reconnaître ici les taureaux du temple d'Assos, là Hécate dans la pause de Baubo, ailleurs le vol du bétail par Hermès, ne faisaient que projeter leur propre culture sur les images des parois ornées. Mais, pour être plus développées, nombre de comparaisons plus récentes, étayées par une connaissance parfois approfondie des mythologies égyptienne et africaine, n'en sont pas moins arbitraires pour autant.
C'est ainsi qu'en suivant la lecture de trois fresques tassiliennes proposée par l'ethnologue malien Hamadou Hampāté Bā, à la lumière des traditions ésotériques peules, on a pu espérer découvrir une clé de lecture susceptible de conduire aux significations profondes des images non descriptives, fréquentes sur nombre de sites. Mais là encore, il s'agissait d'une projection sans lendemain puisque, après cette intéressante tentative, aucune autre fresque n'a jamais pu être « lue » de cette façon. Il n'en est pas moins resté la thèse éminemment discutable et pourtant toujours citée, selon laquelle les auteurs des fresques tassiliennes auraient été des « proto-Peuls ».
Quant à la douzaine de rapprochements effectués depuis un siècle entre des œuvres du Sahara et de l'Égypte ancienne, ils s'appuient généralement sur des dossiers contestables et ne peuvent pas conforter l'idée d'une influence directe entre les deux zones. Mais quelques cas, énigmatiques, comme celui des béliers ornés d'un disque pourraient s'expliquer par l'hypothèse d'un héritage commun.
Le symbolisme et l'analyse interne
Les tentatives d'explications de l'art rupestre par de prétendus universaux symboliques se soldent régulièrement par l'oubli des contextes locaux et par la dislocation des ensembles graphiques hors desquels chaque symbolisme perd toute cohérence. Par exemple, il ne semble guère intéressant d'extraire, à partir des dispositifs rupestres sahariens, toutes les figurations de spirales, de mains ou de pieds, afin de les comparer à des exemples empruntés au monde entier, mais tout aussi décontextualisés.
Il est bien plus fécond de revenir à une analyse interne des sites, où l'on a trop longtemps négligé les interrelations existant entre les figures. On a aussi prêté trop peu d'attention au rapport que celles-ci entretiennent avec les parois rocheuses, car le choix d'un support faisait partie intrinsèque de la réalisation des œuvres, qui ne peuvent en être extraites. Des recherches de ce type, au Messak libyen, ont permis à quelques auteurs, non pas de révéler la signification profonde de l'ensemble des œuvres, ce que plus personne ne songe à faire, mais d'approcher les connotations probables de plusieurs d'entre elles. Des résultats encourageants ont été ainsi obtenus pour certains signes abstraits du Messak libyen, dont Axel et Anne-Michèle van Albada ont bien montré qu'ils correspondaient à des schématisations extrêmes du corps féminin.
La laïcisation progressive de l'art
Mais si cette approche du sens des œuvres est forcément limitée, il en est autrement de la perception du rapport qu'entretient ou non l'art avec le sacré. En effet, avec du recul, une grande différence apparaît à ce sujet entre figurations anciennes (avant 4000 B.P.) et récentes. Parmi les gravures de style « bubalin », nombre d'images ne visent évidemment pas à représenter des scènes de la vie quotidienne, puisqu'on y voit par exemple des géants zoocéphales capables de tirer un rhinocéros d'une seule main ou de le porter sous le bras. De telles images, illustrant les exploits d'un « maître des fauves » mi-homme mi-animal, correspondent probablement à des récits mythiques à jamais disparus. D'autres scènes avec des représentations de danses et de personnages portant des masques d'animaux présentent un indéniable caractère rituel.
Mais parmi les ensembles bubalins inventoriés, figure aussi une grande quantité d'images dans lesquelles nous ne pouvons reconnaître que de simples représentations animalières. Qu'au sein de la société des artistes préhistoriques elles aient été ou non le support d'un symbolisme particulier, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Toujours est-il que la liste des espèces représentées sur les parois ne correspond aucunement à un reflet fidèle de la faune de l'époque, et encore moins de l'ensemble du milieu naturel environnant (par exemple, les plantes et les insectes sont pratiquement absents du répertoire graphique). L'essentiel de l'art bubalin correspond donc à un immense bestiaire imagé, où certaines espèces ont été favorisées au détriment d'autres pour des raisons qui nous échappent, mais qui résultent des choix culturels ayant présidé à l'élaboration des dispositifs.
Le poids de ces choix est encore plus sensible dans le monde des « Têtes rondes », où l'on serait bien en peine de reconnaître une seule scène de la vie quotidienne. Tout n'est que personnages étirés ou flottant horizontalement dans les airs, « martiens » géants munis d'excroissances anatomiques monstrueuses, « orantes » aux têtes circulaires couvertes de motifs géométriques, animaux à longues pattes linéaires, ou motifs circulaires abstraits que, faute de mieux, on a baptisés « méduses » et « verseaux ». Presque tout dans cet art demeure absolument opaque à nos yeux et, pour expliquer l'atmosphère d'étrangeté qui s'en dégage, on a parfois supposé l'influence de substances psychotropes tirées de certaines convolvulacées sahariennes (Ipomaeapurpurua, Turbina corymbosa).
Aucune école de gravure ne rappelle l'atmosphère mystérieuse des peintures des « Têtes rondes » dans leur ensemble, mais plusieurs analogies notables se retrouvent par contre entre gravures et peintures pastorales. Dans ces deux groupes en effet, on connaît – au Tassili et en Libye – des représentations de femmes se déplaçant montées sur des bovins, ou des scènes montrant la vie paisible d'un campement de pasteurs. Mais cela n'empêche pas la présence de figures énigmatiques qui devaient se référer à des conceptions symboliques ou religieuses désormais perdues.
Ainsi, les arts peints et gravés des périodes anciennes sont toujours emprunts de religiosité, bien qu'à des degrés divers selon les écoles. Le contraste est total avec les périodes plus récentes, celles dites « caméline » et « caballine », où prédominent les représentations de guerriers en pied, munis de leur armement, et régulièrement montrés à la chasse ou au combat. L'apparition du métal et du bouclier, l'exaltation des armes et la représentation magnifiée d'individus stéréotypés témoignent d'un autre monde, qui n'a plus grand-chose en commun avec celui que présentent les images anciennes. Certes, ces représentations ont pu être investies d'une symbolique particulière, et l'on sait que des armes comme les poignards, par exemple, sont souvent riches de connotations cosmogoniques chez les populations qui les emploient. Mais, sur les ensembles rupestres, on ne trouve aucun indice de religiosité. Surtout, le contraste est si net entre la richesse imaginaire ou la liberté graphique des œuvres anciennes, d'une part, et le caractère statique ou la monotonie des productions récentes, d'autre part, que cette opposition doit bien correspondre à quelque chose comme une sorte de « laïcisation » de l'art ou à tout le moins, à des modifications consécutives à l'arrivée des premières populations méditerranéennes, porteuses d'une idéologie en rupture avec le fonds de croyance des anciennes populations sahariennes.
L'art rupestre de l'Afrique australe
Dans l'Afrique subsaharienne, l'art rupestre est souvent mal connu, ou peu étudié, à l'exception des centaines de pétroglyphes circulaires de Bidzar, au Cameroun septentrional, des gravures schématiques de la vallée de l'Ogooué, au Gabon, des représentations de couteaux de jet de la République centrafricaine, ou des peintures de l'Angola. Il est probable que le peu d'intérêt manifesté jusqu'à présent pour ces productions graphiques soit dû à leur caractère non figuratif, et au fait qu'elles sont le plus souvent composées de signes simples (cupules, cercles, traits) ou d'ensembles schématiques offrant peu de prise à l'interprétation. Mais on tend désormais à considérer l'art rupestre comme un objet archéologique parmi d'autres, quelle que soit sa signification, et il est probable que les travaux d'inventaire se multiplieront.
En Afrique australe, la situation est très différente, car les figurations rupestres y sont apparemment plus proches, dans leur conception graphique, des normes artistiques occidentales, et leur caractère éminemment symbolique laisse place à de nombreuses possibilités d'interprétation. Les peintures pariétales, surtout concentrées dans les abris de montagne, s'y comptent par dizaines de milliers, de la Namibie au Mozambique et du Zimbabwe au Cap, mais il existe aussi des sites à gravures remarquables sur le plateau central sud-africain au Botswana. Les deux modes d'expression (peinture et gravure) sont au service d'un art essentiellement animalier, où figurent la plupart des représentants de la grande faune africaine, avec une écrasante majorité pour les figurations de la grande antilope appelée « éland du Cap ».
Lorsque les premiers auteurs n'y virent pas le produit du délassement des San (alors appelés « Bushmen ») supposés occuper ainsi leur oisiveté, ils crurent y reconnaître les indices d'une magie imitative à vocation cynégétique. Au xviiie siècle, sir John Barrow attribuait aux peintures du Cap un rôle comparable, au sein de la société san, à celui que tiennent les tableaux dans nos musées, mais des explications aussi simplistes sont abandonnées de nos jours, comme du reste toute tentative d'élucidation globale et unique de cet art. Une longue tradition interprétative, dite « narrative » et fondée dans les années 1860 par le géologue George William Stow, préféra considérer les fresques comme autant de témoignages sur la vie quotidienne des San, leur culture matérielle et leurs techniques de chasse. Mais dès les premières études, il était apparu qu'un certain nombre de figures (séries de points, cercles, lignes reliant des personnages) résistaient à toute tentative d'interprétation, alors qu'elles devaient pourtant bien receler un sens précis. On s'aperçut également que toutes les superpositions n'avaient pas de valeur chronologique, que certaines d'entre elles avaient été pratiquées volontairement, et qu'elles devaient donc être chargées de sens. Quant à l'interprétation par la magie de la chasse, elle ne résultait que de la lecture forcée de quelques scènes montées en épingle à partir de l'a priori selon lequel les artistes auraient dépeint en quelque sorte leur vie quotidienne. En réalité, on sait maintenant que les vraies scènes de chasse sont particulièrement rares et que le bestiaire figuré, privilégiant l'éland du Cap, ne coïncide pas avec le régime alimentaire des San, dans lequel le gibier est essentiellement composé de petits animaux pris au piège. L'art figuré témoigne donc d'une sur-représentation de l'éland du Cap, et d'une sous-représentation des espèces réellement consommées. En outre, plus de 60 p. 100 de l'alimentation des San est habituellement constituée de plantes dont la récolte est une activité traditionnellement féminine, alors que les figurations de femmes sont rarissimes dans les peintures. Au bout du compte, la multiplication de ce type d'observations a finalement conduit à l'abandon de la théorie associant l'art rupestre sud-africain aux techniques d'acquisition de la nourriture.
Comme dans le domaine saharien, l'histoire de la recherche sur l'art rupestre de l'Afrique australe a été marquée par bien des tentatives naïves de lecture qui, en réalité, n'étaient qu'autant de projections. C'est ainsi que dans la première moitié du xxe siècle, Raymond Dart et l'abbé Breuil crurent percevoir des réminiscences phéniciennes, sinon babyloniennes, perses et sumériennes, dans des peintures du Drakensberg. Quant à C. van Riet Lowe, il avait même considéré que l'instrument tenu par un « théranthrope » (être mi-homme, mi-animal) peint dans cette région n'était autre qu'un aulos (double flûte) grec, et que l'instrumentiste rappelait la figure d'Anubis.
Tout en permettant de s'affranchir de conceptions à ce point eurocentriques, les recherches ultérieures ont montré que l'art rupestre sud-africain était bien descriptif, mais d'une façon très différente de celle supposée jusqu'alors. En effet, l'étude détaillée des publications laissées par les ethnographes, les voyageurs et les missionnaires du xixe siècle a montré que les rituels fondamentaux des San utilisaient le phénomène de la transe collective provoquée. Or plusieurs détails des peintures, jusqu'alors inexplicables, peuvent se comprendre dans un tel cadre. On peut citer en exemple la position contractée ou révulsée de certains danseurs, et le saignement de nez qui accompagne généralement la transe, car ce sont autant de traits qui ont été notés par les peintres. De même, on peut supposer que les nombreuses figures de théranthropes tendent à rendre visible le processus de transformation surréelle survenant au cours de la transe, alors qu'elles seraient totalement incompréhensibles dans le cadre d'un art vériste n'ayant pour but que de décrire la vie quotidienne des chasseurs.
Bref, les peintures rupestres, même les plus énigmatiques en apparence, représentent donc bien quelque chose mais, plus que le gibier convoité ou son mode d'acquisition, elles évoquent le monde spirituel des anciens peintres, leurs croyances et, en partie, leurs rites destinés à se concilier le pouvoir des esprits-animaux. Depuis les travaux fondamentaux du linguiste allemand Wilhelm Bleek, de sa belle-sœur Lucy Lloyd et de sa fille Dorothea qui, vers la fin du xixe siècle, consacrèrent leur vie au recueil et à l'étude de témoignages contemporains des derniers dépositaires de l'ancienne tradition picturale, il est admis que le seul moyen de comprendre les peintures rupestres d'Afrique du Sud est de les replacer dans le cadre élargi des données mythologiques et linguistiques recueillies chez les anciens San.
Mais à partir des années 1960, il devint patent qu'il n'était guère possible d'analyser les œuvres à partir des seuls relevés – incomplets, partiels, tronqués, arbitrairement sélectionnés et souvent « arrangés » – jusqu'alors publiés. Sous l'impulsion de Patricia Vinnicombe, un riche courant d'études quantitatives vit alors le jour, consacré à l'enregistrement détaillé des sites, tant dans l'espoir d'en comprendre ainsi la signification, que dans celui d'apporter une assise scientifique à ces études.
Ces espoirs ayant été quelque peu déçus, les chercheurs s'intéressèrent à nouveau aux San, d'une part grâce à la multiplication des travaux sur ceux du Kalahari, et surtout grâce au dépouillement systématique des quelque 12 000 pages de notes et de transcriptions intégrales de mythes laissées par les Bleek. Grâce à la perspicacité de chercheurs comme David Lewis-Williams, il apparut alors que les conceptions générales ayant présidé à l'élaboration de l'art rupestre avaient été miraculeusement préservées, et que de nombreux détails des peintures pouvaient s'expliquer grâce à elles. Contrairement à ce qui s'était passé lors de la « lecture » de trois peintures sahariennes à la lumière des traditions peules, il ne pouvait s'agir ici de coïncidences, car non seulement les concordances étaient multiples et précises, mais elles permettaient soudain d'approcher les conceptions complexes ayant présidé à la création de centaines d'œuvres. De plus, cette direction de travail allait également montrer que les symboles utilisés pour la composition des peintures présentaient une riche polysémie, interdisant toute lecture monolithique.
Du reste, toute tentative globale d'explication négligerait la très longue durée au cours de laquelle se développèrent les arts rupestres d'Afrique australe. De nombreuses peintures témoignent des contacts entre les San, les Khoi-Khoi (Hottentots) et les Bantous, ces dernières populations pratiquant l'élevage, mais on a certainement exagéré l'impact qu'aurait eu sur l'art le contact, voire l'antagonisme, établi entre tous ces groupes.
Sur les peintures les plus récentes apparaissent, par contre, des images qui témoignent de l'arrivée des colons européens, et du calvaire que durent alors subir les San, jusqu'à leur quasi-extermination : on connaît plusieurs représentations de cavaliers tirant au fusil sur des petits hommes qui tentent de s'enfuir en courant... Ce sont là les dernières manifestations d'un art dont les origines sont à situer en plein Pléistocène. En effet, à Apollo Cave, un abri des montagnes Huns au sud de la Namibie, cinq plaquettes de pierre portant des peintures d'animaux en noir et en rouge, furent découvertes dans des couches d'occupation où la date la plus ancienne était de 26700 ± 650 B.P. Cela ferait de ces œuvres les peintures les plus vieilles d'Afrique, et certains auteurs en ont déduit que l'art rupestre sud-africain pourrait bien être aussi ancien que son homologue européen. Mais il convient de remarquer d'une part qu'il s'agissait ici d'art mobilier et non d'art rupestre à proprement parler, et de l'autre que l'argument serait plus convaincant si ces dates étaient confirmées.
Quoi qu'il en soit, David Lewis-Williams a judicieusement utilisé cette découverte pour réfuter localement une hypothèse implicite naguère en vogue, et selon laquelle l'art des peintures rupestres aurait connu une évolution complexifiante en ayant d'abord été monochrome, puis bichrome et enfin polychrome. Une fois de plus, il s'avérait donc que cette idée n'était rien d'autre qu'une notion née des préjugés évolutionnistes cultivés par certains chercheurs occidentaux.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Laurence DENÈS : chercheuse en archéologie coréenne (CNRS, U.R.A. no 1474, études coréennes)
- Jean-Loïc LE QUELLEC : docteur en anthropologie-ethnologie-préhistoire, C.N.R.S., U.M.R. 7041, Archéologie et sciences de l'Antiquité, Centre de recherches africaines (université de Paris-I-Sorbonne)
- Michel ORLIAC : chercheur au C.N.R.S.
- Madeleine PAUL-DAVID : ancien maître de recherche au CNRS, professeure honoraire à l'École du Louvre, chargée de mission au Musée national des arts asiatiques-Guimet
- Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS : directrice d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)
- Denis VIALOU : docteur ès lettres et sciences humaines, professeur de classe exceptionnelle au Muséum national d'histoire naturelle, Paris
Classification
Médias
Autres références
-
ART PRÉHISTORIQUE EUROPÉEN - (repères chronologiques)
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 412 mots
— 40000-— 35000 Des traits gravés apparaissent à la fin du Paléolithique moyen. Dus aux derniers Néandertaliens, ils témoignent de l'existence de systèmes de signes matériels.
— 32000-— 28000 Datations par le carbone 14 de la grotte Chauvet (découverte en Ardèche...
-
ABRI-SOUS-ROCHE
- Écrit par Marie-Thérèse BOINAIS
- 626 mots
Parmi les divers types de gisements préhistoriques, les abris-sous-roche, sites d'habitat installés au pied des falaises et simplement protégés par un surplomb rocheux, sont extrêmement nombreux dans toutes les régions du globe, non seulement en Europe, notamment dans la région dite franco-cantabrique,...
-
AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire
- Écrit par Augustin HOLL
- 6 328 mots
- 3 médias
...(vers 7600-2500 av. J.-C.), Wilton postclassique (vers 2500 av. J.-C.-200 av. J.-C.), Wilton à céramique (vers 100-1870), et Smithfield (vers 1200-1870). L'art pariétal daté de 27000 BP fait son apparition dans la grotte Apollo 11 en Namibie et se généralise progressivement dans tout le sous-continent.... -
ALTAMIRA
- Écrit par Marie-Thérèse BOINAIS et Encyclopædia Universalis
- 613 mots
- 2 médias
La grotte d'Altamira, près de Santillana del Mar (Cantabrie), est la plus célèbre de toutes les grottes ornées d'Espagne : peu de grottes découvertes ultérieurement peuvent rivaliser avec ses peintures pariétales, chef-d'œuvre de l'art paléolithique.
Cette caverne,...
-
ANATOLIENNE PRÉHISTOIRE
- Écrit par Jacques CAUVIN et Marie-Claire CAUVIN
- 2 351 mots
- 3 médias
...pois, les lentilles, le lin, suivant des techniques impliquant désormais l'irrigation. On élève des porcs, des moutons, des chèvres et bientôt des bœufs. L'artisanat très élaboré ne se limite pas à la production de céramique et d'outils en obsidienne : de beaux miroirs sont aussi polis dans ce matériau,... - Afficher les 80 références
Voir aussi
- MONUMENTALE SCULPTURE
- BANPO CULTURE DE
- EUROPE, histoire
- TIFINAGH ou TIFINAR ALPHABET
- JAPONAIS ART
- CARTAILHAC ÉMILE (1845-1921)
- VOGELHERD SITE PRÉHISTORIQUE DE, Allemagne
- HOHLENSTEIN-STADEL SITE PRÉHISTORIQUE DE, Allemagne
- PARPALLO GROTTE DU, Espagne
- EL CASTILLO GROTTE D', Espagne
- ISTURITZ GROTTE D', Pyrénées-Atlantiques
- BERNIFAL GROTTE DE
- SANLIQIAO SITE PRÉHISTORIQUE DE
- CHINOIS ART
- CHEVAL
- DATATION, archéologie
- CARBONE 14 DATATION PAR LE
- CHRONOLOGIE
- SYMBOLE DANS L'ART
- JŌMON CULTURE
- BOIS, sculpture
- GALETS, industrie lithique
- FAUNE
- TASSILI DES AJJER FRESQUES DU
- HONSHŪ
- PASTORALE CIVILISATION
- MAMMOUTH
- CORÉEN ART
- BAS-RELIEF
- HOGGAR ou AHAGGAR
- VÉNUS PALÉOLITHIQUES
- PECH-MERLE GROTTE DE, Lot
- DÉESSE MÈRE
- PEINTURE TECHNIQUES DE LA
- PALÉOLITHIQUE ART
- ZHOUKOUDIAN [TCHEOU-K'EOU-TIEN] SITE PRÉHISTORIQUE DE, Chine
- PARIÉTAL ART
- DINGCUN [TING-TS'OUEN] SITE PRÉHISTORIQUE DE, Chine
- TÊTES RONDES, peinture saharienne
- BUBALE ou BUBALIN, préhistoire
- DŌGU
- LEVANT ESPAGNOL ART DU
- MAGDALÉNIEN
- LANTIAN [LAN-T'IEN]
- GOBI CULTURE DE, préhistoire
- LONGSHAN [LONG-CHAN] CULTURE DE, préhistoire
- MICROLITHES, préhistoire
- MAS-D'AZIL SITE PRÉHISTORIQUE DU, Ariège
- WÜRM, glaciation
- BOVIDÉS
- IDÉOGRAMME
- PATINE
- AFRIQUE, préhistoire
- MOBILIER ART, préhistoire
- GRAVURE, art préhistorique
- PEINTURE, art préhistorique
- SCULPTURE, art préhistorique
- CHINE, préhistoire
- MARSOULAS GROTTE DE, Haute-Garonne
- MOUTHE GROTTE DE LA, Dordogne
- TÊTE DU LION GROTTE DE LA, Ardèche
- FONTANET GROTTE DE, Ariège
- CHABOT GROTTE
- LABATTUT ABRI, Dordogne
- GARGAS GROTTE DE, Hautes-Pyrénées
- TROIS-FRÈRES GROTTE DES, Ariège
- PITHÉCANTHROPE
- SINANTHROPE
- COUGNAC GROTTE DE, Dordogne
- CHÂTEAUNEUF-LÈS-MARTIGUES SITE PRÉHISTORIQUE DE, Bouches-du-Rhône
- BIRSMATTEN SITE PRÉHISTORIQUE DE, Suisse
- TÉVIEC ou THEVIEC SITE PRÉHISTORIQUE DE, Morbihan
- KEHE SITE PRÉHISTORIQUE DE, Chine
- PEBBLE CULTURE, préhistoire
- SJARA-OSSO-GOL SITE PRÉHISTORIQUE DE, Chine
- SHUIDONGGOU SITE PRÉHISTORIQUE DE, Chine
- FUKUI ABRI-SOUS-ROCHE DE, Japon
- KUNDA CULTURE
- ETHNOLOGIE HISTOIRE DE L'
- SCANDINAVE ART
- SYMBOLISME ANIMALIER
- EXTRÊME-ORIENT, préhistoire et archéologie
- AURIGNACIEN
- YANGSHAO [YANG-CHAO] CULTURE DE, préhistoire
- ORDOS CULTURE DE L', préhistoire
- GIGANTOPITHÈQUE
- LITHIQUES INDUSTRIES
- FEMME IMAGE DE LA
- REPRÉSENTATION DANS L'ART
- HABITAT PRÉHISTORIQUE
- ANIMALIER ART
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, préhistoire
- ÉCLATS INDUSTRIES SUR, préhistoire
- MIAODIGOU CULTURE DE, préhistoire
- PEYRONY DENIS (1869-1954)
- MAIN NÉGATIVE, préhistoire
- PAIR-NON-PAIR GROTTE DE, Gironde
- FOURNEAU-DU-DIABLE SITE PRÉHISTORIQUE DU, Dordogne
- ROC DE SERS SITE PRÉHISTORIQUE DE, Charente
- COMBARELLES GROTTE DES, Dordogne
- ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC GROTTE DE, Dordogne
- FONT-DE-GAUME GROTTE DE, Dordogne
- CASTELNOVIEN
- KONGEMOSE CULTURE DE
- ERTEBÖLLIEN
- FIGURINE
- HOËDIC SITE PRÉHISTORIQUE DE, Morbihan
- MONTCLUSIEN
- SANCTUAIRE
- ARGILE, poterie
- SIGNE, art préhistorique