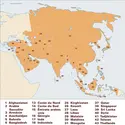BIRMANIE (MYANMAR)
| Nom officiel | Union de Birmanie, Myanmar |
| Chef de l'État et du gouvernement | Min Aung Hlaing - depuis le 1er août 2021 |
| Capitale | Naypyidaw (Naypyidaw a remplacé Rangoon en 2006.) |
| Langue officielle | Birman |
| Population |
54 133 798 habitants
(2023) |
| Superficie |
676 590 km²
|
Article modifié le
La Birmanie depuis 1962
À la suite du coup d'État de 1962, l'armée birmane (Tatmadaw), sous l'égide du général Ne Win, instaura un régime militaire autocratique fortement centralisateur, et opta pour une politique économique de type socialiste et autarcique. Pendant plus d'un quart de siècle, la Birmanie fut repliée sur elle-même, en dehors des grands enjeux internationaux. Mais ces années de « voie birmane vers le socialisme » ont épuisé le pays et sa société qui implosèrent en 1988 à la faveur d'un mouvement populaire, lequel provoqua le renouvellement de la dictature militaire. Un second coup d'État perpétré en septembre 1988 mit en selle une nouvelle junte aux orientations économiques plus libérales et ouvertes sur l'extérieur. Après avoir refusé de reconnaître le résultat des élections qu'il avait pourtant lui-même organisées en mai 1990 et qui avaient vu la victoire écrasante des forces de l'opposition civile menée par Aung San Suu Kyi (la fille d’Aung San, le leader du Conseil exécutif assassiné en 1947), le régime renforça ses positions en cherchant à contrôler l'ensemble d’un processus dit de « transition » vers un régime semi-civil dans lequel l’armée conserverait des prérogatives politiques essentielles. En mai 2008, la junte fit adopter une nouvelle Constitution codifiant ce nouveau système politique. Un Parlement fut réuni en mars 2011 après l'organisation, en novembre 2010, d'élections nationales dénoncées comme une « mascarade » par l'opposition. La junte fut dissoute, et un gouvernement civil, composé d'anciens militaires reconvertis, engagea alors le pays sur une voie résolument réformiste, acceptant le retour au premier plan d'Aung San Suu Kyi. Le parti de cette dernière, la Ligue nationale pour la démocratie (LND) remporta triomphalement les deux grands scrutins suivants, en novembre 2015 et en novembre 2020. Toutefois, l’armée rejeta les résultats des élections de 2020 – organisées en pleine pandémie de Covid-19 – et déclencha un nouveau coup d’État le 1er février 2021 qui mit fin à une décennie d’apprentissages démocratiques. Une vaste mobilisation populaire s’ensuivit, provoquant une escalade de violence et une recrudescence des conflits internes à travers le pays, sur fond de déplacements massifs de population, de résistance armée à la nouvelle junte, d’impasses diplomatiques et de divisions sur la scène internationale à propos de la façon d'aborder la nouvelle crise birmane.
Le régime militaire de Ne Win, entre autarcie socialiste et isolationnisme (1962-1988)
Le coup d'État de 1962 et la mise en place de la dictature militaire
Lorsqu'elle prit le pouvoir, l'armée birmane disposait déjà d'une solide assise. Auréolée du prestige acquis depuis sa création en 1941, elle s'était progressivement imposée comme la principale institution du pays. Sous la direction de son chef d'état-major, le général Ne Win, la Tatmadaw organisa diligemment un coup d'État dans la nuit du 1er au 2 mars 1962. Le gouvernement d'U Nu fut déposé, le Parlement dissous et la Constitution de 1947 suspendue. Un véritable système autoritaire se mit alors en place avec, au centre du pouvoir, un Conseil révolutionnaire, dirigé par Ne Win lui-même. Les premières formes d'opposition qui se manifestèrent dès juillet 1962 furent rapidement étouffées, à commencer par les étudiants et le Sangha, la communauté bouddhiste. Enfin, face au développement d'autres insurrections ethniques séparatistes (Kachin, Chin et Shan), Ne Win lança de nouvelles offensives militaires et instaura une forte centralisation administrative et politique.
La Voie birmane vers le socialisme
Faisant suite à une ordonnance du Conseil révolutionnaire du 28 avril 1962, le régime de Ne Win dévoila sa nouvelle doctrine : la « Voie birmane vers le socialisme ». Cette orientation idéologique prônait la recherche de la société socialiste parfaite mais adaptée à la culture et aux traditions birmano-bouddhistes. Mêlant autarcie et collectivisme, nationalisme et révolution socialiste, isolationnisme et xénophobie, elle rejetait toute influence étrangère, notamment l'héritage anglo-indien de la colonisation. À partir du 4 juillet 1962, la réalisation de ce projet révolutionnaire fut confiée au Parti du programme socialiste birman (Burma Socialist Program Party, BSPP, ou Lanzin en birman).
Le régime militaire s'attacha alors à mettre en place de vastes réformes. Avec la loi sur la nationalisation des entreprises du 27 février 1963, toutes les banques et les compagnies industrielles et d'import-export étrangères, puis birmanes, furent placées directement sous le contrôle de l'État birman (donc de l'armée). Face à la confiscation de leurs biens financiers et de leurs propriétés, de nombreuses communautés de marchands, banquiers et rentiers, en particulier d'origine étrangère, fuirent la Birmanie tout au long des années 1960. Ainsi, trois ans après l'arrivée de Ne Win au pouvoir, entre 300 000 et 400 000 Indiens et Chinois furent littéralement chassés du pays, désorganisant le commerce et l'agriculture qu'ils dominaient encore, malgré une première vague d'exil au lendemain de l'indépendance de 1948. Enfin, une brutale démonétisation, décidée le 17 mai 1964 (suppression des billets de 50 et 100 kyats), acheva de ruiner la classe moyenne birmane. La situation économique du pays, en raison de ces décisions aux fondements xénophobes, se détériora rapidement. La Birmanie cessa d'être le « grenier à riz » de l'Asie.
L'évolution institutionnelle
La brutale dégradation de la situation socio-économique provoqua un fort ressentiment dans l'ensemble des couches sociales du pays. La désorganisation complète des économies locales, avec l'exil des communautés de marchands, banquiers et propriétaires fonciers et la généralisation des pénuries dans les campagnes et les villes amenèrent le régime à corriger progressivement son discours. Le deuxième plan quinquennal (1966-1970) fut bien plus modeste que le premier. Un système de coopératives artisanales et agricoles se mit en place afin de pallier les insuffisances de l'État, tandis que le gouvernement tentait un changement politique de façade.
Après dix années au pouvoir, le régime de Ne Win devenait, en avril 1972, une autorité civile : officiellement, la Birmanie n'était plus gouvernée par une junte militaire. Une nouvelle Constitution fut proposée pour remplacer celle de 1947 abrogée en 1962. Elle prévoyait la création d'un système monocaméral, avec une Assemblée du peuple (Pyithu Hluttaw), et un parti désormais unique, le BSPP. Cette réforme institutionnelle fut entérinée par un référendum « encadré » en décembre 1973. Le 3 janvier 1974, le pays devenait officiellement « la République socialiste de l'union de Birmanie », dotée d'une nouvelle Constitution et d'un nouveau Conseil d'État – le Conseil révolutionnaire créé en 1962 était dissous. Ne Win fut élu président de la nouvelle République birmane.
Seul maître à bord, il organisa des purges dans son entourage, notamment à la suite des crises de 1974 (grèves ouvrières et manifestations populaires organisées en décembre 1974 lors des funérailles d'U Thant, ancien secrétaire général des Nations unies et fervent opposant de Ne Win), puis de 1976 (mouvements étudiants et éviction du général Tin Oo après sa supposée tentative de coup d'État). En novembre 1981, Ne Win céda sa place à la présidence du Conseil d'État en faveur de San Yu, tout en conservant les rênes du pouvoir grâce à son rôle au sein du BSPP.
La question ethnique
Outre les insurrections karen, karenni (kayah), môn et nãga qui s'étaient développées en même temps que celle du Parti communiste birman après l'indépendance, de nouvelles rébellions à caractère ethnique ont éclaté au début des années 1960. Les Shan (Shan State Army), les Kachin (Kachin Independence Organisation) et, dans une moindre mesure, les Chin (Chin Independence Army) et les Rohingya (Rohingya Independence Force) se sont organisés en groupes séparatistes, puissamment armés, en opposition frontale au régime militaire.
La politique très centralisatrice prônée par Ne Win dès 1962 et confirmée par la Constitution de 1974, ainsi que les sanglantes opérations de contre-insurrection menées par la Tatmadaw au cours des années 1960 et 1970 ont accentué la fracture entre les communautés ethniques minoritaires du pays et la majorité birmane, principalement concentrée dans la vallée centrale et le delta de l'Irrawaddy. Malgré l'existence de sept États fédérés disposant de quelques garanties administratives d'autonomie et dont la base territoriale était principalement ethnique (Shan, Karenni, Karen, Môn, Arakan, Chin et Kachin), la majorité birmane (répartie sur les sept autres divisions) dominait l'ensemble du pays et de ses institutions.
La question ethnique continuait ainsi de miner la stabilité intérieure du pays et les relations avec les voisins, eux-mêmes affectés par les flux transfrontaliers d'insurgés, de réfugiés ou de marchandises illicites finançant les diverses rébellions (drogues, armes). Bien que les diverses guérillas aient tenté de mettre en commun leurs forces en fondant, en 1976, le National Democratic Front, elles ne parvinrent pas à menacer le pouvoir central. Grâce à la détérioration de la situation interne et au maintien d'un équilibre diplomatique avec les pays frontaliers, le régime de Ne Win réussit à contenir ces forces centrifuges jusque dans les années 1980.
La crise de 1988
Après vingt-cinq années de socialisme et d'autarcie, la Birmanie se trouvait dans une situation économique et sociale déplorable. Le mécontentement social explosa à la faveur d'un soulèvement populaire au cours de l'année 1988.
Prélude à l'explosion sociale
En septembre 1987, le Conseil d'État ordonna une nouvelle démonétisation brutale. Les billets de 25, 35 et 75 kyats furent remplacés par des billets de 45 et 90 kyats – nouvelle lubie de Ne Win, le 9 étant son chiffre porte-bonheur. Cette décision eut pour conséquence directe de rendre caducs plus des deux tiers de la monnaie en circulation dans le pays. Si, officiellement, le régime souhaitait éradiquer le marché noir et affaiblir les économies parallèles des trafiquants et des groupes insurgés, les populations urbaines furent les premières affectées. Au lendemain de cette annonce, quelques étudiants du Rangoon Institute of Technology, qui ne pouvaient plus régler leurs frais de scolarité, organisèrent des manifestations.
Une nouvelle vague de manifestations éclata en mars 1988 à la suite du meurtre, par un soldat, d'un étudiant de l'université de Rangoun. La police anti-émeute réagit en réprimant violemment les défilés dans les rues, faisant plus de 200 morts en moins d'une semaine. Les universités furent fermées jusqu'au mois de juin. Les mouvements de violence spontanée qui éclatèrent à la réouverture de ces dernières furent à nouveau durement matés. Le 7 juillet, défiant l'interdiction de fonder un syndicat, l'All Burma Students' Federation Union (ABSFU) se reforma après vingt-six ans d'inactivité forcée.
Manifestations et répression
L'élan populaire gagna alors les campagnes et la périphérie du pays. Le 23 juillet, alors que le BSPP s'était réuni en congrès extraordinaire à Rangoun, Ne Win surprit ses collaborateurs en démissionnant de son poste de président du parti. Il nomma à sa succession son fidèle lieutenant, Sein Lwin, célèbre pour ses campagnes contre les Karen dans les années 1950 et pour sa barbarie lors des répressions des manifestations étudiantes de 1962 et du début de 1988.
Le 8 août 1988 (le chiffre 8 est symbolique dans la numérologie bouddhiste) débuta le plus grand mouvement protestataire jamais organisé dans la Birmanie indépendante. Les rues de Rangoun et des principales villes du pays se remplirent d'une foule enthousiaste, composée de bonzes, d'étudiants, de groupes de femmes, d'avocats ou d'instituteurs, portant bannières et drapeaux représentant des paons (emblème du nationalisme birman) et brandissant des portraits d'Aung San, le père de l'Indépendance. Mais rapidement, et pendant plusieurs jours, l'armée et la police anti-émeutes intervinrent pour réprimer ces manifestations populaires. À la fin du mois d'août, diverses organisations humanitaires et des diplomates présents à Rangoun estimèrent le bilan de ces violences à 3 000 morts et disparus.
À la suite de cette répression, Sein Lwin démissionna de son poste de président le 12 août 1988. Le Dr Maung Maung, historien officiel du régime, lui succéda six jours plus tard. Rapidement, la rumeur courut que la fille du général Aung San, Aung San Suu Kyi, allait prendre la parole lors d'un grand meeting public, la loi martiale ayant été levée par les autorités. Jusqu'alors restée en dehors du mouvement populaire, et à peine de retour au pays pour être au chevet de sa mère, Aung San Suu Kyi entra dans le jeu politique birman, à l'occasion de son premier discours prononcé devant 500 000 personnes réunies, le 26 août 1988, au pied de la pagode de Shwedagon à Rangoun. Conquise par ses mots simples, la foule trouva ce jour-là le leader charismatique (en raison de sa filiation) et médiatique (l'Occident fut tout de suite séduit) qui lui manquait. De nombreuses figures de la scène politique (et militaire) birmane se joignirent à elle, comme les généraux Tin Oo (ministre de la Défense de Ne Win en 1974-1976), Aung Shwe et U Lwin, pour fonder un nouveau parti d'opposition, la Ligue nationale pour la démocratie (LND).
Le coup d'État du 18 septembre 1988 et la création du SLORC
L'armée décida alors de reprendre le contrôle du pouvoir par un coup d'État rapidement exécuté. Le 18 septembre 1988, elle envahit à nouveau les rues de Rangoun, et le dernier ministre de la Défense de Ne Win et chef d'état-major, le général Saw Maung, prit les rênes du pouvoir. Il abrogea la Constitution de 1974 et annonça la création d'un nouveau Conseil d'État (composé de 18 officiers) chargé, en priorité, de ramener l'ordre dans le pays, le SLORC (State Law and Order Restoration Committee).
La répression organisée par la Tatmadaw, grâce à l'influence de Ne Win resté dans l'ombre, s'accentua. Près de 10 000 étudiants, intellectuels, syndicalistes et bonzes fuirent les villes principales du pays pour trouver refuge aux marges de la Birmanie et dans les pays voisins. Les Karen, Chin, Kachin et Shan, en lutte contre le pouvoir central birman depuis plusieurs décennies pour certains, accueillirent nombre de ces réfugiés, les aidant à franchir les jungles et montagnes hostiles vers les frontières de l'Inde, du Bangladesh ou de la Thaïlande. En novembre 1988, l'All Burma Students' Democratic Front (ABSDF) fut ainsi fondé pour continuer la lutte armée dans les zones frontalières. Néanmoins, la nouvelle junte parvint à reprendre progressivement le contrôle du pays grâce à l'efficace service de renseignements mis en place et dirigé par le général Khin Nyunt. Le SLORC se lança, en outre, dans une politique de négociation avec certaines rébellions ethniques et communistes. Une quinzaine d'entre elles signèrent, entre 1989 et 1993, des accords de cessez-le-feu avec les services de Khin Nyunt. En échange d'un arrêt des hostilités avec le gouvernement central, ces groupes signataires de cessez-le-feu purent bénéficier d'une marge de manœuvre élargie pour commercer et exploiter les ressources de leur territoire.
Les élections de 1990 et leurs conséquences
Une fois le soulèvement populaire de 1988 maté, le SLORC s'appliqua à légitimer son autorité politique. Le BSPP ayant été dissous après le coup d'État, un nouveau parti ne tarda pas à apparaître. Le National Unity Party, NUP, fondé en septembre 1988, reprit les cadres, les bureaux et les financements du BSPP. En février 1989, le nouveau régime, frappé d'ostracisme par l'ensemble de la communauté internationale à l'exception de la Chine, annonça sa volonté d'organiser, dans un avenir proche, des élections nationales. En outre, la Birmanie était désormais renommée Myanmar, par la loi de l'adaptation de l'expression du 18 juin 1989.
La campagne électorale vit apparaître, au cours de l'année 1989, plus de 200 partis régionaux, corporatistes ou simplement réunis autour d'une figure charismatique locale. La LND avait été fondée le 27 septembre 1988 et Aung San Suu Kyi en était devenue la secrétaire générale. Néanmoins, face à la ferveur populaire essentiellement déclenchée par les tournées incessantes de celle-ci à travers le pays, le SLORC mit brusquement fin à cet élan de liberté. Le 20 juillet 1989, le régime assigna à résidence Aung San Suu Kyi pour une durée illimitée, la privant de tout contact avec l'extérieur, tandis que nombre de dirigeants de son parti étaient emprisonnés. Bien que décapité, le principal parti d'opposition continua sa campagne électorale jusqu'aux élections organisées le 27 mai 1990.
Au grand étonnement de la communauté internationale, ces élections eurent non seulement lieu, mais en outre dans des conditions louables, compte tenu de trois décennies d'expérience dictatoriale du pays. En effet, ni le vote, ni le comptage des voix par la suite, ne semblent avoir été entachés d'irrégularités manifestes. Ce furent 20,8 millions d'électeurs potentiels qui avaient été appelés à voter ce jour-là, la plupart des groupes ethniques insurgés ayant par ailleurs choisi de ne pas perturber le processus. Or les premiers résultats annoncèrent un véritable triomphe pour la LND. Avec 60 % des suffrages exprimés, celle-ci obtenait 396 sièges sur les 485 à pourvoir. Une vingtaine de partis politiques, essentiellement régionaux, dont la Shan Nationalities League for Democracy (deuxième parti avec 23 élus), l'Arakan League for Democracy (11 sièges) et le NUP – soutenu par le SLORC – avec seulement 10 élus, se partageaient les sièges restants.
Face à cette déconvenue, largement relayée par les médias étrangers, la junte chercha à gagner du temps et les résultats officiels ne furent annoncés que six semaines plus tard. En juillet 1990, le général Saw Maung déclara une période moratoire de deux mois, le temps pour le SLORC de mettre en place la stratégie politique à venir. Finalement, en septembre 1990, les autorités militaires décidèrent qu'une Convention nationale (et non un Parlement composé des nouveaux élus) devait se réunir afin de rédiger une nouvelle Constitution (le pays n'en avait plus depuis 1988).
La mise en place du nouveau régime
Alors que certaines grandes puissances telles les États-Unis, le Japon ou l'Allemagne suspendaient – comme en 1988 – leur assistance économique et leur aide humanitaire, la junte birmane chercha à assurer sa légitimité politique interne, grâce à une assemblée constituante – dite « Convention nationale » – sous contrôle.
Convention nationale, acte I
À l'instabilité des années 1988-1990 succéda une période d'intense répression et de retour aux tendances dictatoriales de l'armée. Aung San Suu Kyi et les principaux dirigeants de la LND demeuraient emprisonnés ou assignés à résidence, tandis que ses militants étaient pourchassés. Parallèlement, les offensives contre les insurrections ethniques qui n'avaient pas conclu de cessez-le-feu se poursuivaient avec plus d'efficacité grâce au matériel militaire fourni par la Chine qui avait signé, dès 1989, un contrat d'armement de 1 milliard de dollars. Bien qu’en octobre 1991 le prix Nobel de la paix fut décerné à Aung San Suu Kyi, le SLORC s'estimait en position de force. Après une première purge interne en avril 1992, lorsque le général Than Shwe, numéro deux du régime, déposa le général Saw Maung pour devenir le nouvel homme fort du SLORC, la junte décida de poursuivre son programme politique en mettant enfin en place, le 9 janvier 1993, la Convention nationale.
Celle-ci devait, selon le régime, inclure les représentants de l'ensemble des partis, de l'armée et des groupes ethniques (signataires d'accords de cessez-le-feu), et non pas seulement les 485 élus de 1990. L’objectif était de marginaliser l'opposition démocratique civile incarnée par Aung San Suu Kyi et son parti. Cette marginalisation était pourtant déjà effective : le Dr Sein Win avait formé, en décembre 1990, en zone insurgée karen, un gouvernement birman de coalition en exil National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB).
Composée de 702 délégués soigneusement choisis par la junte (seuls 99 d'entre eux avaient été élus en mai 1990), la Convention nationale avait pour unique but de rédiger les principes fondamentaux d'une nouvelle Constitution. Très vite, le processus se révéla opaque et entièrement contrôlé par le SLORC. Pour celui-ci, la Convention devait légitimer le rôle essentiel de l'armée dans la conduite des affaires du pays et, de la sorte, établir légalement un régime autoritaire, prétorien et centralisé. Ainsi, selon 104 principes édictés lors de la Convention nationale, la Tatmadaw se voyait qualifiée d'organisation « extra-constitutionnelle », échappant ainsi à tout contrôle civil et parlementaire. Le futur chef de l’État devait, en outre, ne pas avoir de parents ou de conjoints étrangers, écartant ainsi Aung San Suu Kyi et de nombreux opposants exilés. De même, un quart des sièges de chacune des futures assemblées du pays serait réservé à l'armée.
Enfin, dans le but de s'assurer une nouvelle base sociale, le régime créa, en septembre 1993, l'Union Solidarity and Development Association (USDA). Cette organisation de masse à caractère social et non politique, patronnée par Than Shwe, était entièrement contrôlée et dévouée au régime à qui elle servait de relais sur l'ensemble du territoire. Elle comptait, dix ans après sa création, entre 15 et 18 millions de membres et devait former en 2010 les bases d’un nouveau parti politique une fois la dissolution de la junte actée.
La libération d'Aung San Suu Kyi et l'adhésion à l'ASEAN (1995-1997)
Deux ans après la Convention nationale, la situation politique n'avait pas évolué et les travaux de cette institution, maintes fois ajournés, n'avaient pas avancé. La surprise fut donc grande lorsque, le 10 juillet 1995, le SLORC annonça la libération sans condition d' Aung San Suu Kyi après six années d'assignation à résidence. Si le régime estimait que son contrôle sur le pays était désormais solide (opposition muselée, insurrections marginalisées, économie relancée dans une certaine mesure par les investissements asiatiques), les pressions diplomatiques extérieures à son égard semblaient également avoir pesé sur cette décision. L'Association des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) avait, en effet, lancé en 1995 l'idée d'intégrer la Birmanie, alors que l’organisation régionale s'élargissait au Vietnam. Il s'agissait donc pour la junte birmane de donner un gage de bonne volonté.
La libération d'Aung San Suu Kyi eut les effets escomptés au cours de l'été de 1995, l'initiative fut internationalement saluée. Tous les week-ends, Aung San Suu Kyi tint des discours publics devant sa résidence de Rangoun, en compagnie de ses proches collaborateurs. L'état-major de la LND étant désormais au complet, avec la libération parallèle de Tin Oo, la stratégie politique du parti fut révisée. La reprise de la Convention nationale, à l'automne de 1995, fut l'occasion d'une première confrontation directe entre les autorités militaires et le parti. Celui-ci choisit, en novembre, de quitter la Convention dans laquelle ses 86 délégués, menés par Aung Shwe, estimaient être bâillonnés et ne participer qu'à une mascarade orchestrée par la junte. En janvier 1996, la Convention nationale fut officiellement ajournée par le régime.
L'agitation qui suivit le retrait de la LND illustra l'impact de cette décision. Généreusement financé par d'anciens étudiants exilés (et enrichis) en Occident ou en Thaïlande et par de nombreux groupes de pression, l'activisme d'une nouvelle génération d'étudiants se réveilla. Après quelques actions sporadiques en octobre et en novembre 1996, le mouvement lança de grandes manifestations au début du mois de décembre, reprenant les slogans de 1988 avec le portrait d'Aung San Suu Kyi comme nouveau symbole. À nouveau, le régime réprima violemment ce mouvement protestataire. Il n'entendait pas laisser se développer une nouvelle forme d’opposition parallèle au mouvement politique de la LND, alors que s'achevaient les négociations avec l'ASEAN en vue de l'adhésion de la Birmanie. Après une participation en tant qu'observateur aux sommets de l’organisation depuis 1994, celle-ci intégra la Birmanie en juillet 1997 (en même temps que le Laos), espérant ainsi contrebalancer les effets des sanctions économiques prises à son encontre par les États-Unis et l'Union européenne (avril-mai 1997).
La radicalisation du régime, entre purges et répressions
Trois mois après l’adhésion de la Birmanie à l'ASEAN, la junte changea officiellement de nom en novembre 1997, devenant State Peace and Development Council, SPDC. Ce changement de rhétorique destiné à améliorer l'image du pays fut, dans les faits, l'occasion d'une nouvelle purge, la plus importante depuis 1992. Le généralissime Than Shwe écarta de nombreux membres de l'ancien SLORC et des commandants de région rivaux, officiellement soupçonnés de corruption. Une nouvelle génération d'officiers se forma derrière le triumvirat composé des généraux Than Shwe, Maung Aye et Khin Nyunt.
En 1998, les tournées politiques et les meetings organisés par l'opposition civile et ethnique furent de plus en plus surveillés, voire interdits par les autorités. À la fin de l'année, quelque 900 membres de la LND étaient emprisonnés. Aung San Suu Kyi poursuivit néanmoins son activisme jusqu'à être, de nouveau, assignée à résidence, le 23 septembre 2000, après cinq années de (relative) liberté. Six mois auparavant, les Nations unies avaient nommé un nouvel envoyé spécial pour la Birmanie, Tan Sri Razali Ismail, chargé de faciliter un hypothétique processus de transition démocratique. Mais, avec l'arrestation d'Aung San Suu Kyi, il devint un véritable médiateur entre la LND et le SPDC, alors que, parallèlement, les services de renseignements du général Khin Nyunt entamaient des pourparlers secrets avec la leader de l'opposition. Doublées de l'action du nouveau rapporteur spécial des Nations unies pour les droits de l'homme en Birmanie, Sergio P. Pinheiro, qui fut nommé en mars 2001, les négociations de Razali aboutirent à un certain assouplissement du régime, qui permit la libération de quelques dizaines de prisonniers politiques et leva, le 6 mai 2002, l'assignation à résidence d'Aung San Suu Kyi.
Le retour des tentations isolationnistes du régime militaire
Après une année de liberté, Aung San Suu Kyi fut de nouveau assignée à résidence. Les espoirs d'une transition politique rapide se brisèrent, tandis que la junte recherchait un isolement diplomatique toujours plus marqué.
L'échec de la deuxième libération d'Aung San Suu Kyi (2002-2003)
Libérée une seconde fois sans condition après dix-neuf mois de captivité, Aung San Suu Kyi reprit ses tournées et rencontres politiques à travers le pays, et ce dans une liesse populaire saisissante. Elle subit néanmoins les harcèlements des partisans du régime dans chaque province parcourue. Le 30 mai 2003, la situation dégénéra à Depayin, petite ville au nord de Mandalay, lorsqu'une foule surexcitée et armée agressa le cortège accompagnant Aung San Suu Kyi et son adjoint Tin Oo. Ceux-ci furent arrêtés par les autorités militaires locales. Le lendemain, le gouvernement reconnut que les incidents avaient provoqué la mort de quatre personnes, tandis que divers rapports publiés le mois suivant par des organisations non gouvernementales et le gouvernement birman en exil (NCGUB) ont avancé les chiffres de 50 à 80 morts. Exaspérés par la capacité mobilisatrice d'Aung San Suu Kyi, les sympathisants du SPDC ont rapidement mis fin à la période d'euphorie née de sa deuxième libération.
Niant le massacre de Depayin, le régime a de nouveau essuyé les critiques de la communauté internationale, en particulier des États-Unis et de l'Union européenne. En juin 2003, les pays occidentaux renforcèrent les sanctions économiques prises en 1997 à l'encontre du régime, interdisant toute importation de produits birmans et imposant des interdictions de visas aux dirigeants du régime. Tandis que le Japon suspendait ses projets d'aide au développement, les pays de l'ASEAN condamnèrent, à leur tour, et pour la première fois, le régime birman dans un communiqué. Ce rappel à l'ordre marqua une véritable rupture dans la position de l'ASEAN, qui s'était jusqu'alors refusée à toute critique sur les affaires intérieures d'un pays membre. L'Inde condamna également la Birmanie, alors que la Chine s'avouait, de son côté, profondément embarrassée par les décisions du SPDC.
Convention nationale, acte II : une feuille de route vers une « démocratie disciplinée »
Le 25 août 2003, le général Than Shwe, chef de l'État et de l'armée, abandonna la fonction de Premier ministre – qu'il cumulait avec ses autres fonctions depuis 1992 – au général Khin Nyunt, premier secrétaire du SPDC réputé plus pragmatique. Il fut remplacé au sein du parti, lors de ce remaniement ministériel (qui fut l'occasion d'une nouvelle purge) par un proche de Than Shwe, le général Soe Win, l'instigateur supposé du massacre de Depayin. Moins d'une semaine après sa nomination, Khin Nyunt prononça un discours qui annonçait la mise en place d'une « feuille de route » pour mener le pays sur le chemin de la démocratie. Celle-ci posait les bases d'une transition graduelle, dictée selon les termes du régime militaire, vers une « démocratie disciplinée et florissante ». La reprise de la Convention nationale, ajournée en 1996, était la première étape de cette feuille de route qui devait ensuite conduire à la rédaction d'une nouvelle Constitution, à l'organisation d'un référendum pour ratifier celle-ci et, enfin, à l'organisation d'élections parlementaires. Le 17 mai 2004, les travaux de la Convention nationale, composée cette fois-ci de 1 076 délégués, toujours choisis par le régime, reprenaient. La LND et quelques partis ethniques avaient, auparavant, signifié au gouvernement qu'ils ne participeraient pas à ce qu’ils qualifiaient de mascarade.
La purge des services de renseignements
Les premières divisions au sein de la junte, sur le rythme et les concessions imposés par le processus dit de transition, apparurent rapidement. En septembre 2004, le ministre birman des Affaires étrangères U Win Aung et son entourage – réputés proches du général Khin Nyunt – furent limogés par le généralissime Than Shwe. Un mois plus tard, le 18 octobre 2004, le général Khin Nyunt fut à son tour écarté du pouvoir lors d'une des purges les plus importantes jamais organisées par la dictature militaire depuis 1962. L'ensemble des officiers de l'appareil de renseignements que Khin Nyunt avait patiemment forgé depuis 1984 furent arrêtés. Près de 2 000 agents des renseignements furent remplacés par des officiers de la Tatmadaw, cinq ministres du gouvernement du SPDC et de nombreux ambassadeurs et diplomates birmans furent aussi évincés. Les procès débutèrent en janvier 2005 dans la prison d'Insein, alors que la feuille de route était reprise en main par les généraux Thein Sein et Soe Win, protégés de Than Shwe, désormais chef incontesté du régime. Ce dernier imposait un rythme ralenti au processus transitionnel en mettant à l'écart la faction de l'armée jugée trop ouverte et modérée, y compris à l'égard des groupes armés ethniques. La répression s'accentua contre ces derniers, Than Shwe lança de nouvelles offensives de contre-insurrection.
Les relations extérieures de la Birmanie : le choix subtil de ses partenaires
Sur la scène régionale, le SPDC a su habilement tirer avantage de la position stratégique de la Birmanie. La Chine, le puissant allié du nord, restait un partenaire incontournable de la junte depuis 1988. Rare puissance à ne pas avoir sanctionné le régime birman, Pékin constituait le premier soutien économique et diplomatique du pays. En 2005, les échanges officiels sino-birmans atteignirent 1,2 milliard de dollars américains, soit près d'un cinquième du commerce total de la Birmanie. Importatrice de bois (teck), de produits agricoles et de minerais précieux (jade) en provenance des riches territoires du nord birman, la Chine a également tissé un réseau d'infrastructures le long de la plaine de l'Irrawaddy. Ce réseau lui a permis de bénéficier, pour ses provinces reculées du Sud-Ouest, d'une ouverture sur l'océan Indien grâce, en outre, au réaménagement de différents ports birmans (Rangoun, Sittwe, Kyaukpyu...). Inquiète de cette poussée chinoise sur son flanc oriental, et soucieuse de contrebalancer l'influence de Pékin, l'Inde s'est à son tour progressivement rapprochée du régime birman au cours des années 2000. Multipliant les visites de hauts dignitaires (Than Shwe s'est rendu en Inde en octobre 2004 et le président de la République indienne à Rangoun en mars 2006), New Delhi s'est peu à peu intéressée à une région qu'elle avait longtemps ignorée. Attirée, elle aussi, par les ressources naturelles de la Birmanie, l’Inde cherchait surtout à y exploiter le gaz naturel offshore, secteur jusqu'alors dominé par quelques grandes multinationales (Total, Petronas, Unocal...).
La junte birmane a ainsi profité de sa position privilégiée entre l'Inde et la Chine pour obtenir deux soutiens diplomatiques importants qui lui ont permis de se distancer lentement de ses partenaires de l'ASEAN. De plus en plus critiques à l'égard de l'impasse politique qui régnait en Birmanie, ces derniers avaient pourtant tenté d’y faciliter la transition démocratique par une politique d'« engagement constructif » de la junte. Cet engagement consistait à poursuivre un dialogue diplomatique et à participer au développement économique du pays sans l'isoler ni lui imposer de sanctions.
Or, depuis l'adhésion de la Birmanie à l'organisation en 1997, la situation du pays avait peu évolué. À l’instar du Laos voisin, l'économie birmane demeurait l'une des plus faibles de la région, avec un PIB par tête estimé à moins de 500 dollars en 2005. En juillet 2005, le SPDC opéra même un retour à des tentations isolationnistes en annonçant qu'il renonçait à assurer la présidence tournante de l'ASEAN qui lui revenait pour l'année 2006.
Les Nations unies s'affichaient tout aussi impuissantes que les pays asiatiques. En janvier 2006, l'envoyé spécial Razali démissionna, faute d'avoir été autorisé à pénétrer en Birmanie depuis mars 2004. Malgré les visites à Rangoun, en mai puis en novembre 2006, du sous-secrétaire général des Nations unies Ibrahim Gambari, qui put rencontrer Aung San Suu Kyi toujours assignée à résidence depuis 2003, l'ONU éprouvait toutes les difficultés à peser sur le processus de transition démocratique du pays. En outre, le soutien de la Chine et, désormais, celui de la Russie – pays devenu un partenaire militaire important de la junte – entravaient toute prise de position ferme du Conseil de sécurité des Nations unies à l'encontre de la Birmanie.
Enfin, le 7 novembre 2005, le général Than Shwe ordonna le transfert de la capitale de Rangoun à Pyinmana, à 370 kilomètres plus au nord. L'ensemble des administrations politiques et judiciaires et des quartiers généraux de l'armée déménageaient dans une nouvelle capitale, renommée pour l'occasion Nay-Pyi-Daw (cité royale). Bien plus proche du cœur historique de la Birmanie des Birmans que Rangoun, trop marquée par l'héritage colonial, Naypyidaw marque la consécration symbolique d'un régime qui se complait dans ses habitudes isolationnistes et quasi autarciques héritées de l'ère Ne Win.
L’éclipse de la junte et le vent des réformes
L'échec de la « révolution safran » et les ravages du cyclone Nargis
En août 2007, une forte augmentation du prix de l'essence engendra un surprenant élan contestataire mené par une poignée d'activistes. Très vite écroués, ils furent cependant relayés dans leurs manifestations contre la vie chère par la communauté des moines bouddhistes, le Sangha. Au cours du mois de septembre, plusieurs milliers de bonzes défilèrent ainsi chaque jour à Rangoun et dans les grandes villes du pays. Le 26 septembre, la répression des autorités militaires mit un terme à la plus vaste fronde des bonzes auquel le pouvoir central ait été confronté depuis 1988. Les tentatives d'intervention diplomatique de l'ONU ne parvinrent pas à éviter une reprise en main brutale du SPDC qui reconnut un bilan de 31 victimes et plusieurs centaines d'arrestations.
Encore traumatisée par l'échec de cette « révolution safran », la société birmane subit un second traumatisme peu après, avec le passage du cyclone Nargis, le 2 mai 2008. Balayant le delta de l'Irrawaddy et l'ancienne capitale Rangoun, le cyclone laissa derrière lui quelque 140 000 victimes et 800 000 déplacés. Refusant une grande partie de l'aide humanitaire extérieure qui lui fut proposée, la junte s'enferma dans un repli xénophobe unanimement condamné. La tragédie favorisa toutefois l'émergence d'une société civile interne s’affichant « apolitique ». Celle-ci cherchant alors à pallier les déficiences, voire l'inertie, du pouvoir militaire, tout en restant à l'écart de la lutte polarisée entre la junte et Aung San Suu Kyi, assignée à résidence depuis 2003.
La transition par le haut : Constitution, élections et dissolution de la junte
Nonobstant ce contexte social troublé, la junte choisit de poursuivre sa feuille de route transitionnelle vers une « démocratie disciplinée ». Une nouvelle Constitution fut adoptée par voie référendaire le 10 mai 2008, une semaine après le passage de Nargis. Reprenant les conclusions des travaux de la Convention nationale, achevée en 2007, cette Constitution codifiait le paysage institutionnel de l’après-junte qui devait prendre forme une fois le SPDC dissous. Elle créa un système parlementaire bicaméral, décentralisé et semi-présidentialiste. Des élections nationales et locales furent organisées le 7 novembre 2010 pour élire les représentants des deux Chambres du Parlement national (Pyidaungsu Hluttaw) ainsi que des quatorze assemblées provinciales. Fortement décriées car encadrées par l'armée, ces premières élections depuis 1990 virent le parti proche de la junte – le Parti pour la solidarité et le développement de l'Union (USDP), héritier de l’USDA – emporter quelque 77 % des sièges à pourvoir. Une dizaine de partis ethniques et dissidents se partageaient le reste. La LND d'Aung San Suu Kyi avait fait le choix préalable de boycotter ce scrutin, jugé illégitime. Aung San Suu Kyi avait en outre vu son assignation à résidence reconduite en août 2009 après l'intrusion inopinée chez elle d'un activiste américain.
Ces élections controversées furent néanmoins le point de départ d'une spectaculaire transition qui s'échelonna au cours de l'année 2011. Les nouvelles institutions furent peu à peu mises en place selon un schéma prévu de longue date par une armée souhaitant malgré tout conserver son rôle primordial de garant de l'unité nationale. Le nouveau Parlement, dont un quart des membres était des officiers d’active nommés par le commandement militaire, fut convoqué en janvier 2011. Il élut alors un ancien chef d'état-major de l'armée, Thura Shwe Mann, président de la Chambre basse (Pyithu Hluttaw) tandis que le Premier ministre sortant du SPDC, Thein Sein, devenait président de la République. Ce dernier prêta serment le 30 mars 2011, le SPDC étant alors officiellement dissous. Les généraux Than Shwe et Maung Aye se retirèrent de la scène publique, et un général de cinquante-cinq ans, Min Aung Hlaing, fut nommé nouveau commandant en chef de l'armée.
L'ère des réformes et le retour en grâce
Sous l’égide de Thein Sein et Thura Shwe Mann, le nouveau pouvoir « civil » dominé par l’USDP se lança dans de nombreuses initiatives réformatrices. La porte de la réconciliation fut d'abord ouverte en direction d' Aung San Suu Kyi. Libérée le 13 novembre 2010 après sept années d’assignation à résidence, elle put faire réenregistrer son parti et participer aux élections partielles du 1er avril 2012. La LND les remporta haut la main, Aung San Suu Kyi étant elle-même élue à la Chambre basse du Parlement. En octobre 2011, puis en janvier 2012, deux lois d'amnistie avaient décrété la libération de plus de 800 prisonniers politiques, dont les leaders de la « révolution safran » de 2007 et les officiers de renseignements victimes de purges en 2004. En outre, une série de textes législatifs inédits fut adoptée : légalisation des syndicats, abolition de la censure, octroi du droit de grève et de manifestation.
En matière économique, une volonté réformiste fut aussi affichée par les nouvelles élites dirigeantes, malgré l'opposition de puissants oligarques et conglomérats militaires. Elles mirent en place une réforme bancaire, la libéralisation de divers monopoles d'État, une loi favorisant les investissements étrangers votée en septembre 2012, autant de décisions destinées à relancer la Birmanie sur la voie du développement. En outre, le président Thein Sein décida dès septembre 2011 de suspendre la construction d’un gigantesque barrage hydroélectrique à Myitsone, en territoire kachin. Projet pharaonique financé par un investisseur public chinois, le barrage de Myitsone menaçait l’écosystème du fleuve nourricier de la Birmanie, l’Irrawaddy, et un vaste mouvement social l'avait dénoncé. Cette annonce fut accueillie avec le plus grand enthousiasme par la population birmane.
Enfin, des négociations de paix furent entamées avec les rébellions ethniques encore actives dans les zones frontalières. Des accords historiques furent conclus de décembre 2011 à mars 2012 avec les minorités karen, shan, môn, chin et karenni. Mais la reprise, en juin 2011, du conflit kachin dans le nord, et la résurgence de violences intercommunautaires entre bouddhistes et musulmans dans l'ouest birman en 2012, attestaient encore des limites de la réconciliation.
Cet élan progressiste fut toutefois reçu positivement par la communauté internationale. Tour à tour, gouvernements occidentaux et puissances régionales ont révisé leur approche de la Birmanie. En 2012, l'Union européenne et les États-Unis amorcèrent le démantèlement de leurs sanctions imposées à partir des années 1990. Le Japon effaça l'équivalent de 3,7 milliards de dollars de dettes birmanes. Chefs d'État et grands de ce monde, du président américain Barack Obama aux Premiers ministres thaïlandais, indien ou britannique se succédèrent en visites officielles. Aung San Suu Kyi fut quant à elle autorisée en 2012, pour la première fois depuis 1988, à quitter la Birmanie – et à y revenir – pour se rendre en Europe, et y recevoir notamment son prix Nobel de la paix, décerné en 1991, ainsi qu’aux États-Unis et en Inde. Un véritable retour en grâce pour le pays après cinq décennies d'isolement.
Régressions démocratiques et tournant nationaliste
À l'issue des élections de 2012, avec Aung San Suu Kyi et 40 autres parlementaires LND siégeant dans les deux Chambres du Parlement national, ce dernier s’affirma comme un acteur majeur des transformations politiques du début de la décennie 2010. Toutefois, l’élan réformiste marqua le pas et l’opposition parlementaire ne parvint pas à imposer son agenda. Ainsi, une première tentative de révision de la Constitution échoua. Formé en 2013, un comité de 109 parlementaires publia en janvier 2014 un rapport détaillant une liste importante de propositions d’amendements. L’initiative peinant à aboutir au Parlement, la LND lança alors une pétition nationale pour recueillir le soutien de la population birmane à ce projet de révision constitutionnelle, dont le but ostensible était de limiter l’influence politique des militaires et d’autoriser Aung San Suu Kyi à devenir cheffe de l’État – l’article 59 f de la Constitution l’écartant de la fonction présidentielle en raison de son mariage avec un étranger. Le parti rassembla quelque 5 millions de signatures. Le projet de révision fut finalement soumis au vote des députés réunis en Congrès en juin 2015. Tous les amendements proposés furent rejetés par les députés militaires – les seuls à disposer d’un droit de veto en la matière – à l’exception d’un amendement mineur sur la formulation d’un article.
La fin de la première mandature de l’après-junte prenait ainsi un tournant résolument nationaliste. Au mois d’août 2015, quatre lois révélatrices de la montée en puissance de forces sociales extrémistes et en particulier islamophobes – sur la protection de la « race » (birmane ou « bamar ») et de la religion (bouddhiste) – furent adoptées par l’USDP et ses alliés. Allant à l’encontre de certaines obligations internationales de la Birmanie, signataire de conventions internationales sur le droit des femmes notamment, ces nouveaux textes législatifs ont depuis fortement restreint la liberté de mariage des citoyens birmans en dehors de leur propre sphère religieuse, ainsi que les possibilités de conversion, tout en facilitant le contrôle des naissances de certaines catégories de populations – en particulier des musulmans. Les violences intercommunautaires se sont par ailleurs étendues lors du mandat du président Thein Sein. Ainsi, à l’approche des secondes élections générales de l’après-junte (prévues pour le mois de novembre 2015), la radicalisation de groupes politiques ultranationalistes et autres réseaux bouddhistes violents – dont l’association extrémiste ouvertement islamophobe Ma Ba Tha – a bouleversé l’échiquier politique et social du pays.
Enfin, malgré son credo progressiste, le gouvernement USDP n’hésita pas à employer coercition et répression pour mater le renouveau activiste et syndicaliste observé depuis la levée de la censure et de l’interdiction de manifester. Entre 2012 et 2014, des grèves d’usines et de nombreuses manifestations d’étudiants furent étouffées par des violences policières que la communauté internationale condamna. Pourtant, la Birmanie ne cessa de gagner en respectabilité sur la scène régionale. Le pays organisa les 27e jeux du Sud-Est asiatique en décembre 2013, puis présida l’ASEAN en 2014, accueillant nombre de sommets internationaux à Naypyidaw, une décennie seulement après avoir renoncé à cette même présidence.
Limites de la transition démocratique et fin de la parenthèse parlementaire
Les élections de 2015 ou l’alternance en marche
L’organisation libre et régulière du scrutin de novembre 2015, sous le regard d’observateurs internationaux, ainsi que le triomphe électoral de la LND consolidèrent dans un premier temps le processus de transition démocratique. Pour la première fois depuis 1956, un gouvernement civil élu succédait à une administration sortante sans que l’armée intervienne. Aung San Suu Kyi fut réélue au Parlement, tandis que son parti raflait 77 % des sièges à pourvoir dans toutes les assemblées nationales et provinciales. Quatre mois plus tard, l’alternance politique était en marche : un confident d’Aung San Suu Kyi, Htin Kyaw, remplaça Thein Sein à la présidence de la République, puis forma un gouvernement fortement influencé par la LND. L’éminence grise de cette nouvelle administration restait toutefois Aung San Suu Kyi elle-même. Écartée de la présidence par la Constitution de 2008, elle sut faire adopter par le nouveau Parlement (désormais contrôlé par 390 parlementaires de la LND sur 664) un texte de loi créant pour elle la position de « conseillère pour l’État ». Le nouveau gouvernement trouva aussi un allié de poids en la personne de Thura Shwe Mann, ancien président de la Chambre basse démis de ses fonctions de chef de l'USDP par son propre parti en août 2015, à la veille des élections législatives. Il fut nommé à la tête d’une influente commission des lois (qui sera dissoute en 2019).
Au pouvoir, la LND tenta de relancer le programme de réformes. Plusieurs lois répressives furent abolies, notamment la législation sur l’état d’urgence de 1950. La législation sur le droit de réunion et de manifestation fut libéralisée, tandis qu’une commission intergouvernementale fut chargée de traiter l’un des dossiers les plus brûlants du monde rural birman : la confiscation de terres par les militaires et leurs conglomérats. Enfin, en 2019, le nouveau gouvernement parvint à détacher l’administration publique d’État du contrôle de l’armée en plaçant le tentaculaire General Administration Department (GAD) sous direction civile.
Toutefois, les transformations politiques, économiques et sociales tant attendues après la victoire électorale de la LND en 2015 ne se concrétisèrent pas. En particulier, le processus de paix avec les minorités ethniques entamé par le précédent gouvernement montra rapidement ses limites. Face au formidable défi posé par la légitimité politique d’Aung San Suu Kyi, les militaires utilisèrent de plus en plus les atouts et prérogatives qui leur étaient conférés par la Constitution de 2008. Peu disposée à laisser la LND négocier des accords politiques avec les groupes ethniques encore en conflit ouvert avec elle, l’armée poursuivit ses offensives contre-insurrectionnelles, sabotant ainsi les quatre conférences dites de Panglong, orchestrées en fanfare par le gouvernement LND en août-septembre 2016, en mai 2017, en juillet 2018 et en août 2020. Par ailleurs, Aung San Suu Kyi, elle-même perçue comme issue de la même élite politique appartenant à l’ethnie birmane (ou bamar) et bouddhiste que les chefs historiques de l’armée fondée par son propre père, le général Aung San, peinait à rallier à elle les principaux groupes et dirigeants des ethnies non birmanes.
Persécution des Rohingya et fin du mythe Aung San Suu Kyi
Les élections de 2015 avaient été célébrées à juste titre comme un moment crucial de la transition démocratique. Cependant, première ombre au tableau, quelque 400 000 membres de la communauté musulmane rohingya (sur 2 à 3 millions) furent alors exclus du corps électoral. Les Rohingya vivent principalement dans l’État de Rakhine (ancien État d’Arakan), frontalier du Bangladesh, et sont persécutés depuis des décennies par l’État birman, ainsi que par les populations bouddhistes majoritaires qui les considèrent comme bengali, et donc étrangères à la communauté nationale birmane. D’ailleurs, le second Parlement de l’après-junte, à majorité LND et issu des élections de 2015, ne comportait aucun député musulman. En outre, et ce constamment depuis 2012 – marquée par un regain de violences intracommunautaires –, des milliers de boat people rohingya bravaient les périls de la mer pour tenter de rejoindre les plages thaïlandaises et malaisiennes.
En février 2017, une mission des Nations unies publia un rapport accablant dénonçant les atrocités commises par les forces de sécurité birmanes à l’encontre des Rohingya, ainsi que d’autres minorités ethniques du nord du pays, Kachin et Shan notamment. Arrivée au pouvoir, la LND forma une commission consultative indépendante chargée de proposer une solution durable à la question rohingya. Aung San Suu Kyi nomma à sa tête l’ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan. En août 2017, cette commission rendit public son rapport, ainsi qu’une liste de propositions pour pacifier et développer l’État de Rakhine. Au même moment émergeait une nouvelle milice armée prétendant défendre les intérêts rohingya : l'Armée du salut des Rohingya de l'Arakan (ASRA). L’ASRA attaqua plus d’une vingtaine de postes de police et de gardes frontaliers birmans. La riposte de l’armée provoqua l’une des plus graves crises politiques et humanitaires des trois dernières décennies. À partir de septembre-octobre 2017, près de 900 000 Rohingya (chiffres de l’ONU) s'exilèrent au Bangladesh pour fuir les exactions, les pillages et les massacres orchestrés par les forces de sécurité birmanes.
Face à cette tragédie, Aung San Suu Kyi et son gouvernement se montrèrent distants, refusant de condamner publiquement les violences engendrées par les opérations de « nettoyage » menées par les troupes militaires. L’exode rohingya et l’apparente indifférence de l’administration LND provoquèrent une vive réaction internationale. Une pluie de critiques s’abattit alors sur Aung San Suu Kyi. Les appels aux sanctions contre la Birmanie redevinrent d’actualité, alors que les précédentes n'avaient été levées que quelques années auparavant. L’armée refusa toute enquête indépendante sur ses agissements dans l’État de Rakhine et élargit sa répression aux représentants des médias internationaux. Ainsi, en septembre 2018, deux journalistes de l’agence Reuters ayant enquêté sur la campagne d’épuration des Rohingya furent arrêtés et condamnés à sept années de prison, sans que le gouvernement LND intervienne pour défendre la liberté de la presse. Ils furent cependant amnistiés en 2019 par le président Win Myint et libérés.
En 2019, la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye était saisie du dossier birman pour violation de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, ratifiée par la Birmanie en 1956. Ce fut Aung San Suu Kyi elle-même, en tant que conseillère pour l’État birman, qui se rendit à La Haye pour défendre son pays de ces accusations, rejetant publiquement toute intention génocidaire. En janvier 2020, la Cour rendit cependant une ordonnance enjoignant le gouvernement birman de prendre des mesures d’urgence pour protéger les Rohingya – soumis selon elle à un « risque réel et imminent » de génocide – et pour conserver les preuves d’éventuels crimes commis à leur encontre. La Birmanie était redevenue un État paria, tandis que l’icône du combat historique des Birmans pour la démocratie se voyait dépouillée du prestige quasi mythique dont la communauté internationale l’avait auréolée depuis le soulèvement de 1988.
Le coup d’État de 2021 et la fin de l’expérience démocratique
Outre ces tensions sur la scène internationale, la fin de la deuxième mandature de l’après-junte fut marquée par l’accroissement des affrontements politiques entre le gouvernement civil de la LND et l’armée birmane dirigée par le généralissime Min Aung Hlaing.
Les milieux d’affaires, les donateurs internationaux et les investisseurs étrangers s'inquiétaient ouvertement de l'instabilité provoquée par la crise rohingya et par l’absence de progrès dans les pourparlers de paix entre la LND et les groupes rebelles contrôlant certaines zones frontalières du pays. C'est surtout le faible impact des réformes économiques et administratives sur la croissance, les inégalités sociales et la stabilité financière et fiscale du pays qui préoccupait les acteurs économiques. Par ailleurs, la Chine, principal partenaire commercial du pays, s'était rapprochée de la LND au milieu des années 2010, malgré les réticences birmanes vis-à-vis des mégaprojets chinois d’infrastructures dans le pays. Lors de sa visite à Naypyidaw en janvier 2020, le président chinois Xi Jinping tenta ainsi de consolider ses relations avec un gouvernement civil moins hostile aux intérêts de Pékin que ne l’avait été la précédente administration USDP.
C'est au cours de la même année 2020 que les dissensions entre la LND et l’institution militaire s'exacerbèrent, alors que le pays était confronté à la pandémie meurtrière de Covid-19. Le parti au pouvoir avait lancé en janvier 2019 un second projet de révision constitutionnelle. Une commission parlementaire dominée par des députés de la LND avait proposé, après six mois de travaux, quelque 4 000 amendements. En mars 2020, 114 d'entre eux avaient finalement été soumis au vote du Parlement réuni en Congrès. Cependant, seuls quatre amendements mineurs furent approuvés par l'assemblée, pourtant largement dominée par la LND. En effet, comme en 2015 sous l’USDP, les parlementaires de l’armée utilisèrent leur droit de veto. L'échec de cette seconde tentative de réforme constitutionnelle permit cependant à la LND de donner une impulsion à sa campagne électorale. Le parti au pouvoir, qui était chargé pour la première fois du processus électoral, parvint à organiser le troisième scrutin de l’après-junte en novembre 2020. Malgré le contexte sanitaire tragique et les effets meurtriers de la pandémie de Covid-19 au cours de l’été, les élections générales furent organisées librement dans la plupart des circonscriptions – État de Rakhine excepté. Elles furent considérées comme crédibles et régulières par les observateurs internationaux et confirmèrent le triomphe de la LND. Le parti parvint notamment à compenser les pertes de sièges qu'il avait subies aux élections partielles de 2017 et 2018 dans les circonscriptions à majorité ethnique non birmane. Aung San Suu Kyi fut réélue pour un troisième mandat au Parlement en même temps que 395 autres candidats de son parti.
L’armée et l’USDP, le principal parti d’opposition depuis 2015, refusèrent de reconnaître la victoire de leurs rivaux. Prétextant des fraudes électorales massives, le commandant en chef de l’armée déclencha le troisième coup d’État depuis 1962. Le 1er février 2021, le matin du jour prévu pour l’inauguration du nouveau Parlement élu trois mois plus tôt, le coup de force savamment orchestré par les militaires mit fin à une décennie de parenthèse démocratique. Ce nouveau coup d'État et l’annulation du vote de novembre 2020 par la nouvelle junte – le Conseil pour l’administration de l’État (SAC), dirigé par le généralissime Min Aung Hlaing – engendrèrent l’un des plus formidables mouvements contestataires que le pays ait connus depuis 1988. Le mouvement commença en février 2021 par des défilés protestataires pacifiques, auxquels succéda, au cours de l’année 2021, un vaste mouvement d'insurrection armé contre la junte dans les zones centrales et urbaines du pays, épargnées jusque-là par la guerre civile. L'opposition au nouveau régime provoqua aussi l'exode de nombreux Birmans vers les pays voisins et vers l’Occident, surtout parmi les plus jeunes et les plus éduqués. Un gouvernement parallèle, dit d’unité nationale (NUG), fut fondé par des élus de 2020, rejoints par des dirigeants des minorités ethniques, des syndicalistes et des activistes de la société civile, désormais persécutés par la junte. Le NUG entama alors avec les militaires birmans un duel de légitimité politique sur la scène internationale. Non reconnu par les grandes puissances, le NUG bénéficia cependant de nombreuses sympathies. Il parvint notamment à conserver, en 2021-2022, le siège de la Birmanie aux Nations unies. La junte quant à elle obtint à la même période le soutien, notamment militaire, de la Russie et de manière plus discrète celui de l'Inde et de la Chine.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Denise BERNOT : professeur émérite de birman à l'Institut national des langues et civilisations orientales
- Pierre-Arnaud CHOUVY : géographe chargé de recherche au C.N.R.S.
- Renaud EGRETEAU : enseignant-chercheur auprès de la City University of Hong Kong
- Bernard Philippe GROSLIER : directeur de recherche au C.N.R.S.
- Jean PERRIN : chargé d'affaires à l'ambassade de France en république islamique d'Iran
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
BIRMANIE (MYANMAR), chronologie contemporaine
- Écrit par Universalis
-
ASEAN (Association of South East Asian Nations) ou ANSEA (Association des nations du Sud-Est asiatique)
- Écrit par Encyclopædia Universalis et Anne-Marie LE GLOANNEC
- 205 mots
- 1 média
-
ASIE (Structure et milieu) - Géologie
- Écrit par Louis DUBERTRET , Encyclopædia Universalis et Guy MENNESSIER
- 7 936 mots
L'histoire géologique de la Birmanie et de la Thaïlande, mal connue, montre tout au moins une liaison étroite avec le Tibet, l'Himalaya et la Malaisie. À l'est se trouve le plateau de Shan, constitué de terrains métamorphiques prolongeant ceux du Tibet. Dans le nord de la Birmanie, une série sédimentaire... -
ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique
- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL
- 34 880 mots
- 8 médias
Le pseudo-socle de la Sonde s'étend à l'est jusqu'à la mer de Sulawesi (− 5 500 m), englobe au sud Bangka et Billiton et domine à l'ouest la dépression centrale de Birmanie par un escarpement de faille de 1 000 mètres (escarpement occidental du plateau Shan). -
ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales
- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE
- 24 799 mots
- 10 médias
...toponyme, il est vrai, ne va pas de soi, alors que l'Asie du Sud-Est, un temps partagée entre plusieurs puissances coloniales, Indochine orientale française, Birmanie (Myanmar) et Malaisie britanniques, Indonésie néerlandaise et Philippines espagnoles puis américaines, était intégrée à des ensembles soit... - Afficher les 39 références
Voir aussi
- STŪPA
- BOUDDHIQUE ART
- MINORITÉS
- DIDACTIQUE ART
- MIGRATIONS HISTOIRE DES
- ASIE DU SUD-EST
- BOIS, sculpture
- SHING ÇILA'WUNÇA' (1453-1520)
- SHING RA'TA'ÇARA' (1468-1530)
- SHING AGGAÇAMADI (déb. XVIe s.)
- U PONNYA DE SALÉ (1807-1866)
- U POQ NI (né en 1849)
- U 'KU (XIXe s.)
- KINWUNG 'MING 'JI (1822-1908)
- NAQ SHING NAUNG (1578-1612)
- LÈQ WÈÇONDARA (1723-1799)
- PAUVRETÉ
- THÂTON
- MÔN, langue
- SIAM
- PEINTURE MURALE
- ŚIKHARA ou ÇIKHARA, architecture
- ANORATHA ou ANAWRAHTA ou ANIRUDDHA, roi de Pagan (1044-1077)
- SHAN PLATEAU
- TENASSERIM
- TABINSHWEHTI, roi de Birmanie (1546-1551)
- PYU ROYAUME (IIe-IXe s.)
- ARAKAN YOMA
- THAN SHWE (1933- )
- BILINGUISME
- BIRMAN, langue
- TEMPLE, Asie du Sud-Est
- COUP D'ÉTAT
- BOUDDHIQUE LITTÉRATURE
- RÉFORME ÉCONOMIQUE
- KHIN NYUNT (1939- )
- MA' SANDA (1947- )
- LHA' PHÉ (1913- )
- NU'-NU' YI(1957- )
- ÉTUDIANTS
- ÉCONOMIES SOCIALISTES
- PARTI UNIQUE
- INDE, histoire : des origines au XIIe s.
- INDE, histoire : de 1947 à nos jours
- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946
- HAYE CONFÉRENCES ET CONVENTIONS INTERNATIONALES DE LA
- RÉPRESSION
- BIRMAN ART
- BRITANNIQUE EMPIRE, Asie
- ĀNANDA TEMPLE D'
- ROHINGYA
- SEIN LWIN (1924-2004)
- MAUNG MAUNG (1925-1994)
- PADÉÇAYAZA (1683-1754)
- MAUNG KALA (1714-1733)
- HLAING PRINCESSE DE (1833-1875)
- DAGONG KHING KHING 'LÉ (1904- )
- ÇAKHING KŌDO ‘HMAING (1875-1965)
- RIZICULTURE
- ÉMEUTE
- ‘CEING PHÉ MYING' (1914-1978)
- NGWÉ TAYI (morte en 1958)
- ÇILA SITÇU
- MAUNG THING
- MA MA LAY ou DO MA'MA'‘LÉ (1917-1982)
- BEIKTHANO
- HALIN
- ŚRĪ KṢETRA
- SAN YU (mort en 1996)
- POÉSIE DE COUR
- PROME, Birmanie
- ASIE DU SUD-EST, architecture
- ASIE DU SUD-EST, sculpture
- ASIE DU SUD-EST, peinture
- DÉMONÉTISATION
- ALAUNGPAYA ou AUNG ZEYA roi de Birmanie (1714-1760)
- THIBAW ou THIBO roi de Birmanie (1858-1916)
- ARAKAN ÉTAT D'
- KYANZITTHA roi de Pagan (1084-1113)
- AVA, Birmanie
- TRAFIC DE DROGUE
- SANCTUAIRE
- ARCHITECTURE RELIGIEUSE
- TERRE CUITE, sculpture
- THEIN SEIN (1945- )
- LND (Ligue nationale pour la démocratie), parti politique
- SAW MAUNG (1945-1997)
- MIN AUNG HLAING (1956- )