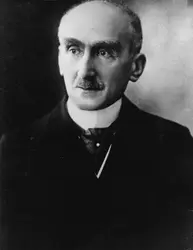CONSCIENCE
Article modifié le
La conscience et le cerveau
Les difficultés du problème des rapports de la conscience et du cerveau sont celles des rapports du « physique et du moral », de la matière et de l'esprit. Elles sont insurmontables dès que l'on tient le cerveau pour une chose et la conscience pour une pure spiritualité. Ce qui vient d'être dit de l'être conscient, de la multiplicité de ses structures, de son organisation dynamique, qui est comme un instrument de cette sorte de dialectique qui rapporte l'un à l'autre le haut et le bas, l'inconscient et le conscient, permet déjà d'entrevoir que, si l'« isomorphisme » (c'est-à-dire l'identité) du cerveau et de la conscience ne peut être pensé sur le modèle d'un simple décalque de l'un à l'autre, qui en supprimerait la dualité relative, les modèles architectoniques de l'un et de l'autre peuvent les articuler dans et par un mouvement dialectique, qui assure leur intégration réciproque, sans les assimiler purement et simplement l'un à l'autre. Car, d'une part, le cerveau, tel qu'il commence à être connu, n'est ni un objet, ni une machine, étant donné qu'il est animé lui-même par la finalité de l'organisme qu'il contrôle par l'effet d'une boucle de réverbération (d'autogouvernement) ; et, d'autre part, la conscience, telle qu'elle vient d'être décrite, implique, elle aussi, en tant que structure hiérarchisée de l'être conscient, une réflexion réciproque du supérieur sur l'inférieur.
L'impasse dualiste
Une telle « réflexion » permet de comprendre que le fameux problème constitué par la recherche d'un « centre de conscience » dans le cerveau est complètement dépassé ; ainsi qu'on le verra, il est annulé par cette nécessité d'un modèle circulaire, qui figure la réciprocité des rapports de l'organe cérébral et de l'être conscient.
C'est dans le schéma darwinien et spencérien de la superposition des stades de l'évolution et des segments du système nerveux que l'idée d'un centre de la conscience s'est imposée en même temps qu'elle s'engageait ainsi dans l'impasse de la concomitance. Pour H. Jackson, en effet, père de toutes les théories neurophysiologiques des Temps modernes, le modèle du système nerveux était essentiellement moteur ou sensori-moteur, ou encore réflexe ; de telle sorte, il serait constitué par une série verticale de centres superposés, dont chacun contrôlerait les instances ou centres inférieurs. De proche en proche, Jackson en est arrivé, en avril 1887, à examiner les highest levels de l'activité nerveuse ; pour lui, ils ne pouvaient être autre chose que les centres du lobe préfrontal (occupant à l'extrémité de l'axe cérébro-spinal une position supérieure, « télencéphalique »). Ce sont, disait-il, ces centres « sensori-moteurs supérieurs » (au pluriel) qui sont l'organ of mind. Mais, bien entendu, aux yeux de ce grand neurologiste spiritualiste, ces centres ne pouvaient être que des instruments au service de l'esprit (they are for mind) ; il niait (this I deny), en effet, que ces highest cerebral centers, qui sont « la base physique de l'esprit », puissent être considérés comme constituant l'esprit ou la conscience « elle-même », laquelle, précisait-il, n'est pas une fonction du cerveau. Et c'est ainsi que le modèle jacksonien des rapports du cerveau et de la conscience est resté celui de la « concomitance », notion dualiste ou paralléliste reprise par la plupart des neurophysiologistes (de Sherrington à Eccles), à qui elle assure une confortable position de « repos métaphysique » à l'abri du dualisme cartésien.
Mais cette idée de « centre de la conscience » (sorte de cellule « pontificale » ou de « Saint-Siège » de la conscience) s'est détruite elle-même. Car non seulement les neurophysiologistes de tradition dualiste ont, ainsi qu'on vient de le voir, séparé par un abîme la conscience des mécanismes du cerveau, mais encore ceux qui, au contraire, ont travaillé à édifier une théorie purement physiologique des mécanismes cérébraux du highest level, ont eu de plus en plus soin de substituer à la notion d'activité de conscience celle d'activité nerveuse supérieure excluant ( ?) la conscience. Rejetée ainsi soit vers le zéro soit vers l'infini, la conscience est vouée de la sorte à disparaître. C'est en tout cas selon cette mécanisation progressive, admise par les uns ou requise par les autres, que s'est développée depuis plus de cent ans la théorie corticale et réflexologique des fonctions supérieures, qui, sur le modèle de la psychologie associationniste (Pavlov) ou sur ceux de la cybernétique ou de l'informatique (Ashby, N. Wiener, W. Grey Walter, H. Kuhlenbeck...), considère l'activité supérieure du système nerveux comme celle d'une machine et lui dénie, par conséquent, toute conscience.
Structures cérébrales et activités de la conscience
Le rôle de l'écorce cérébrale ne fait pas de doute, car l'organisation du cerveau culmine dans ces « centres d'indétermination » ou de « complexification maximale », où se développent les mouvements facultatifs ou créateurs de la pensée. Ces centres correspondent aux « centres associatifs » de Flechsig, qui constituent dans le néo-cortex l'immense réseau neuronal (le « magic loom » de Sherrington) des milliards de connexions synaptiques. Toute la neurophysiologie moderne des fonctions supérieures intellectuelles, ou d'acquisition (ou encore d'information, ou enfin de mémoire, et du champ opératoire des relations et de l'adaptation de l'individu à son milieu) paraît avoir solidement établi que l'écorce cérébrale fonctionne, en effet, comme une machine électronique où circule l'information et où s'élabore la solution des problèmes.
Mais cette forme supérieure et proprement intellectuelle du highest level de la pensée ne saurait justement être considérée comme la structure fondamentale de la conscience. Cela pour deux raisons. La première tient au fait que ces mouvements de la pensée réflexive sont facultatifs : ils n'ajoutent aux structures de l'être conscient qu'une différenciation qui ne requiert le réseau neuronal cortical que comme l'instrument indispensable à sa virtuosité. La seconde consiste en cela même que l'organisation du conscient est axée par la motivation et enracinée dans la sphère de l'instinct : à cet égard, le fonctionnement logico-mathématique du cerveau télencéphalique dépend de la constitution du champ de la conscience et du système de la personne, mais ne les commande pas. Ainsi, le cortex ne saurait être considéré comme le centre de la conscience, mais en est plutôt – selon l'intuition jacksonienne – l'instrument.
C'est ainsi que les neurophysiologistes ont de plus en plus senti la nécessité de lier l'activité de conscience à la base du cerveau, à son enracinement dans les profondeurs de la vie animale et même végétative. Dès les années trente, ils ont reconnu dans le sommeil un phénomène strictement lié au problème des relations de la conscience et du cerveau (par-delà le sommeil, toute la pathologie de l'épilepsie). Le « centre du sommeil » (W. R. Hess) devint alors objet de recherche ; il a été localisé dans le diencéphale, car l'expérimentation et la pathologie de cette région cérébrale produisent des états de somnolence. C'était déjà une certaine façon de se représenter que la conscience dépendait d'un mécanisme régulateur sous-cortical.
Le rôle de la formatio reticularis du tronc cérébral dans la constitution de l'éveil cortical (arousal cortical) a été découvert et expérimentalement démontré par H. W. Magoun et G. Moruzzi, au début des années cinquante. Si l'on connaissait déjà l'effet de la fameuse transection cérébrale (préparation dite du « cerveau isolé » de Bremer) qui, séparant l'écorce cérébrale du tronc cérébral, entraîne une sorte de sommeil constant (alors que la fameuse décortication – la destruction de l'écorce cérébrale – de Goltz laisse persister l'alternance sommeil-veille), ce n'est que par les effets de l'excitation électrique de cette formation réticulée qu'a été démontré le rôle dynamogène des formations grises rhombo-mésencéphaliques. Ce « système activateur ascendant de l'éveil cortical » ne tire d'ailleurs pas des afférences sensorielles qu'il reçoit son pouvoir d'éveiller le néo-cortex, mais il le doit bien plutôt à l'activité propre de son neuropil, comme l'ont montré, dès cette époque, les expériences de déafférenciation sensorielle. Au cours de ses études d'expérimentation sur l'épilepsie, Penfield (1953) proposait de considérer les formations centrales du cerveau (centrencéphale) comme « la base physique de l'expérience vécue dans le champ de la conscience ». Dès lors, l'organisation de ce champ dans l'actualité du vécu peut apparaître (cf. H. Ey, La Conscience) comme incorporée à l'organisation de ce « vieux cerveau » (formation réticulée, thalamus, rhinencéphale), où convergent effectivement, dans le lobe limbique, la régulation temporelle des données du sensorium commune concernant les émotions et les pulsions, dont les mouvements sont intégrés dans ces structures qui constituent, a dit Wiener, un « totalisateur affectif ».
Le problème des rapports du cerveau et de la conscience, en cessant d'être par excellence celui de l'intelligence et du cerveau et en descendant au niveau (dans et par le cerveau) des rapports de la vie et de la conscience, a changé de sens, en même temps que s'en esquissait une première solution. Ce qui se trouve inscrit de l'être conscient dans le « vieux cerveau » et dépend de sa propre organisation fonctionnelle, c'est l'infrastructure du champ de la conscience, c'est-à-dire toutes les modalités et les conditions de constitution temporo-spatiales de ce milieu « privé », où se décrivent les configurations de ce qui est momentanément vécu. Ce qui, par contre, représente l'activité de la pensée réfléchie propre à l'être conscient se déroule certainement au niveau du néo-cortex, mais ne constitue que la partie, en quelque sorte, contingente ainsi que facultative du travail de création.
Intégration des fonctions psychiques
On comprend dès lors que, lorsque, pendant le sommeil, le régime cérébral s'inverse et centre son organisation sur ce « vieux cerveau », lorsque, avec l'arousal cortical, la possibilité même d'une conscience réfléchie ouverte sur le monde de la réalité disparaît, l'expérience, vécue alors dans et par l'activité de cette vie psychique fermée, soit précisément celle du rêve. Par la méthode des transections au niveau du tronc cérébral, M. Jouvet (1960) a montré que les phases de rêve onirique qui correspondent à un sommeil rapide avec mouvements oculaires (Kleitman, Dement, 1957) ne se produisent que lorsque le noyau reticularis pontis est intact. D'où cette conséquence que le rêve, en tant qu'il est, selon Freud, manifestation de l'inconscient, c'est-à-dire projection des désirs, ne se produit que par l'activité d'un système fonctionnel archaïque, qui a son organisation propre et ne s'installe que lorsque se renverse le régime cérébral. Autrement dit, s'il y a des modalités de conscience plutôt que des degrés de vigilance, il y a aussi des modalités d'inconscience et non pas seulement des degrés de sommeil. Autrement dit, et de façon plus radicale encore, le sommeil et la veille, le vécu dans un champ bien structuré de conscience et le vécu dans la destructuration de ce champ ne peuvent se réduire à l'opposition de deux phénomènes simples, car ils comportent une dialectique constante de l'être conscient avec son inconscient, une sorte de circularité de leurs rapports réciproques se situant à divers niveaux structuraux. Par là se trouve restituée à la neurophysiologie cérébrale son organisation vivante, envisagée non plus dans l'économie des partes extra partes, ou comme des fonctions isolées ou superposées dans l'espace, mais comme un réseau d'ensembles transanatomiques, de régimes fonctionnels à base de circuits de réverbération. Car le cerveau vivant (le cerveau dormant comme le cerveau éveillé ou pensant) n'est pas seulement un appareil in put-out put, un appareil de transmission : c'est un organe d'intégration qui, sans cesse et à tous ses niveaux, règle les relations de l'être conscient à son inconscient. En inversant la formule du physiologiste Johan Müller, « Nul n'est psychologue s'il n'est physiologue », il faudrait dire : « Nul n'est physiologue s'il n'est psychologue. »
Ce qui vient d'être exposé en peu de mots, tout en tenant lieu d'une sorte de révolution copernicienne dans le monde des rapports du cerveau et du champ de la conscience, laisse pourtant en suspens les rapports qu'il y a entre la constitution du sujet par la conscience de soi avec l'organisation du cerveau. Nul doute que, dans la formation de la personne, les rapports avec les fonctions spécialisées ou avec la masse fonctionnelle du cerveau ne peuvent être qu'indirects, pour être médiatisés dans le milieu même où s'élabore l'être conscient en tant que personne. L'on peut penser que ce qui commence seulement à être entrevu sur le codage des molécules d'ARN (acide ribonucléique) – portant la marque spécifique de l'ADN, acide désoxyribonucléique –, dont le modèle neuronal est emprunté au modèle génétique (Smitt, 1965 ; Bonner, 1966), peut nous faire comprendre que la synthèse des protéines spécifiques de l'information pourrait être le processus même de la construction en quelque sorte mnésique de la personne. De même que le modèle sur lequel se transmet et auquel se conforme l'intention organisatrice de l'espèce, qui a un caractère informatif absolu (M. Grünberg-Manago et F. Gros, 1964), et de même que l'organisme, grâce à son patrimoine héréditaire (génome), peut être considéré comme un « informostat » (Zuckerkandl et Pauling, 1965), l'informostat psychique, c'est-à-dire la formation du moi par sa propre information, résulterait d'une génération analogue à celle du message héréditaire ou de la spécificité des anticorps de l'immunité, mais avec une constance plus relative (et proportionnelle à son ouverture aux informations nouvelles). On voit à quelles spéculations, à quelle science-fiction peut entraîner cette nouvelle vision de la physique et de métaphysique de l'identité.
Ce rapide examen des rapports du cerveau et de la conscience montre que, s'il faut se méfier de toute mythologie cérébrale, il convient aussi d'éviter les excès auxquels donnerait lieu une saisie purement noétique de l'être conscient qui le désincarnerait dans une théorie « anencéphale » de sa constitution.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Henri EY : ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, médecin chef à l'hôpital psychiatrique de Bonneval
Classification
Média
Autres références
-
CONSCIENCE (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 2 719 mots
Lequel d’entre nous, enfant, traversant la rue sans regarder ou sautant du haut d’un arbre, n’a jamais été accusé d’être « inconscient » ? Nos parents ou nos éducateurs voulaient nous faire comprendre par là que nous étions aveugles au danger, que nous manquions de lucidité et de la plus élémentaire...
-
PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET CONSCIENCE
- Écrit par Axel CLEEREMANS
- 1 623 mots
La conscience, en tant qu’objet d’étude, représente un des plus grands défis scientifiques du xxie siècle. Le concept de conscience est multiple. Dans son sens premier, le mot « conscience », qui tire son origine du latin conscientia, « avec connaissance », fait référence au savoir : nous...
-
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...l'appétition pures et simples ; celui de l'âme, où la monade se perçoit dans le sentiment, perception déjà plus distincte que celle du simple vivant ; celui de la conscience proprement dite ou aperception, où la mémoire s'associe à la perception, et celui de l'esprit, où surgissent la réflexion et la raison. Il... -
ARCHITECTURE & MUSIQUE
- Écrit par Daniel CHARLES
- 7 428 mots
- 1 média
...démarquer de Hegel : à la différence de ce dernier, l'auteur de Sein und Zeit refusait d'admettre que la relation sujet-objet, c'est-à-dire la conscience dans l'acception traditionnelle, gouvernât l'élévation de l'étant en général – et notamment de cet étant qu'est l' œuvre d'art – à la vérité.... -
ATTENTION
- Écrit par Éric SIÉROFF
- 1 929 mots
Pour William James, psychologue américain de la fin du xixe siècle, l’attention est la prise de possession par l’esprit d’un élément de la pensée ou d’un objet du monde extérieur, afin que cet élément ou cet objet paraisse plus clair. L’attention a donc pour rôle de contrôler la ...
-
AUTO-ORGANISATION
- Écrit par Henri ATLAN
- 6 258 mots
- 1 média
...projets en général, indépendante de tel ou tel projet particulier ; autrement dit, l'expérience qui produit en nous la conscience de l'intentionnalité. Comme nous l'avions suggéré autrefois, la conscience volontaire serait le résultat de la mémorisation de phénomènes auto-organisateurs, alors que ceux-ci... - Afficher les 86 références
Voir aussi