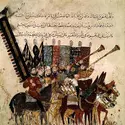IBN BAṬṬŪṬA (1304-1368 ou 1377)
Article modifié le
Écrivain de langue arabe et l'un des plus grands voyageurs de tous les temps, Ibn Baṭṭūṭa est l'auteur d'un récit de voyage (Riḥla) qui, par l'ampleur du champ parcouru et les qualités du récit, constitue une des œuvres de la littérature universelle (Riḥla, édition et traduction française par C. Defrémery et B. R. Sanguinetti, 4 vol., 1853-1859 ; réédition, avec préface et notes par V. Monteil, Voyages d'Ibn Baṭṭūṭa, 1968 ; édition, avec préface de K. al-Bustānī, Beyrouth, 1960 ; traduction anglaise par H. A. R. Gibb, The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, 1958-1971).
Né à Tanger et d’ascendance berbère, Ibn Baṭṭūṭa est voué à un exil continu (120 000 kilomètres parcourus et vingt-huit ans d'absence) où certaines haltes, plus prolongées que d'autres, permettent de découper, un peu artificiellement, une série de voyages. Le premier, comme pour nombre de musulmans, a pour but La Mecque par l'Afrique du Nord, l'Égypte, le Haut-Nil et la Syrie ; Ibn Baṭṭūṭa y arrive en 1326. Deux mois après, quittant l'Arabie, Ibn Baṭṭūṭa se rend en Irak, puis dans l'Iran méridional, central et septentrional, revient en Irak, à Bagdad, court à Mossoul, repasse par Bagdad et se retrouve en Arabie, où il mettra à profit un séjour de trois ans (1327-1330) pour accomplir, chacune de ces trois années, le pèlerinage à La Mecque. Il part ensuite pour la mer Rouge, le Yémen, la côte africaine, Mogadiscio et les comptoirs d'Afrique orientale, revient par le ‘Umān et le golfe Persique et accomplit un nouveau pèlerinage à La Mecque en 1332. Quatrième voyage : cette fois, ce sont l'Égypte, la Syrie, l'Asie Mineure, les territoires mongols de la Horde d'or en Russie du Sud, la visite de Constantinople, le retour à la Horde d'or, la Transoxiane et l'Afghanistan, d'où Ibn Baṭṭūṭa gagne la vallée de l'Indus en 1333 et séjourne à Delhi jusqu'en 1342.
De là, Ibn Baṭṭūṭa gagne les îles Maldives, où il demeure un an et demi : ce sera son cinquième voyage. Un saut jusqu'à Ceylan, le retour aux Maldives, puis le Bengale, l'Assam, Sumatra, la Chine : Zhuanshufu. Septième voyage : retour, par Sumatra et Malabar (1347), jusqu'au golfe Persique, puis Bagdad, la Syrie, l'Égypte et nouveau pèlerinage en Arabie. De retour en Égypte, à Alexandrie, Ibn Baṭṭūṭa s'embarque pour Tunis (1349), d'où il gagne la Sardaigne sur un bateau catalan ; il rentre par l'Algérie, Fès, le royaume de Grenade et, de nouveau, le Maroc, le pays natal. Un neuvième et dernier voyage : en 1352, le Sahara, les pays du Niger.
Cette fois, c'est bien la fin. Installé au Maroc, Ibn Baṭṭūṭa dicte à un lettré, Ibn Djuzayy, sur l'ordre du souverain mérinide, Abū ‘Inān, sa Riḥla : ce sera chose faite en 1356, sous le titre de « Cadeau précieux pour ceux qui considèrent les choses étranges des grandes villes et les merveilles des voyages » (Tuḥfat al-nuẓẓarfīgharā'ib al amṣārwa-‘adjā'ib al-asfār). Après quoi, le souvenir d'Ibn Baṭṭūṭa se perd ; on ne sait ce qu'il a fait jusqu'à sa mort, en 1368 ou même, car la date est peu sûre, en 1377. Dans le voyage, Ibn Baṭṭūṭa a coulé sa vie professionnelle et familiale, se mariant ici, exerçant ailleurs les fonctions de juge très écouté. Au reste le voyage n'a guère eu de prise sur cette personnalité, qu'on lit identique à elle-même tout au long du livre, sans qualité ni défaut majeurs et, surtout, qui promène, au milieu de tant de sociétés différentes, un islam impavide et sûr de soi.
Il sera facile de relever, entre les deux maîtres du genre que sont Ibn Djubayr et Ibn Baṭṭūṭa, les ressemblances qui tiennent à la forme et à l'esprit de la Riḥla, laquelle traite, comme on le dit à propos d'Ibn Djubayr, l'espace et le temps selon une vision propre. Pourtant, des difficultés considérables éclatent. Quantitatives d'abord : face au champ limité couvert par le voyage d'Ibn Djubayr, celui d'Ibn Baṭṭūṭa s'étend finalement, sans parler d'excursions à l'étranger, sur l'ensemble du monde musulman de ce temps. En outre, sur de telles distances spatiales et temporelles, et compte tenu du fait qu'il s'agit d'un récit dicté a posteriori et de mémoire, il ne pouvait être question de sérier le propos jour après jour ; l'unité de temps s'estompe ici dans des ensembles plus larges, la mémoire travaillant dans l'ordre de la semaine, du mois, de l'année. Ainsi la Riḥla d'Ibn Baṭṭūṭa, si elle reste fidèle aux lois du genre, les élargit à proportion de son ampleur à elle. Au bout du compte, elle débouche, plus directement que chez Ibn Djubayr, sur le panorama, sur la fresque dont il est à peine besoin de souligner l'intérêt pour l'historien.
Dans l'histoire de la géographie arabe, dont on continue à la faire relever, la Riḥlad'Ibn Baṭṭūṭa occupe une place cruciale. Si, à défaut de géographie, l'on parle plus justement de peinture d'un espace, la comparaison d'Ibn Baṭṭūṭa avec Ibn Khaldūn apparaît extraordinairement éclairante et symptomatique des choix que peut opérer un musulman convaincu en ce xive siècle. Les deux hommes interviennent à une époque où le monde arabo-musulman a été traumatisé par le choc turco-mongol, où l'ancien empire de Bagdad a péri, comme institution et comme concept inspirant la peinture du monde et le récit de l'histoire. Ibn Khaldūn et Ibn Baṭṭūṭa ont en commun leur appartenance à l'école mālikite autour de laquelle, dans l'Occident musulman, l'Islam cristallisera désormais ses forces de définition et de résistance. Mais la comparaison s'arrête là : chez Ibn Khaldūn, la contemplation désespérée de l'histoire, de la vie et de la mort des civilisations se fonde sur une étude en profondeur et quasi immobile, les rares déplacements consentis par le savant se comprenant comme des sursauts, des retours à l'espoir dans la praxis politique conçue comme source de résurrection et réfutation possible de l'histoire, et l'échec de ces tentatives venant finalement nourrir de nouveau le pessimisme du savant. Chez Ibn Baṭṭūṭa, au contraire, la réflexion en profondeur cède la place au mouvement, qui s'étale, pourrait-on dire, sur toute l'horizontalité du monde, et qui parvient, par son dynamisme et son allègre opiniâtreté, à faire oublier la disparition du vieil Empire dans l'étendue même d'un monde où, si loin que l'on marche, on finit, partout ou presque, par trouver des musulmans : tout se passe comme si, en allant d'un État à un autre État musulman, on voulait nous faire comprendre que, pour prix de son unité disparue, l'Islam avait gagné une géographie nouvelle : celle-là même qu'il avait gagnée, en effet, dans ses nouvelles frontières d'après l'an mille.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- André MIQUEL : professeur au Collège de France
Classification
Autres références
-
ARABE (MONDE) - Littérature
- Écrit par Jamel Eddine BENCHEIKH , Hachem FODA , André MIQUEL , Charles PELLAT , Hammadi SAMMOUD et Élisabeth VAUTHIER
- 29 248 mots
- 2 médias
...jusque-là, à savoir la présentation simultanée et progressive d'un temps, d'un espace et d'une aventure individuelle. Après Ibn Ǧubayr (mort en 1217), c'est Ibn Baṭṭūṭa qui va porter la riḥla à son apogée. Par l'ampleur même de la course, d'abord : né en 1304 et parti de Tanger, sa ville natale, en... -
ISLAM (La civilisation islamique) - Les sciences historiques et géographiques
- Écrit par André MIQUEL
- 2 149 mots
- 1 média
...c'est le journal de voyage (riḥla), que dominent les deux grands noms d'Ibn Jubayr (mort en 1217) et surtout, comme un pendant à Ibn Khaldūn, Ibn Battūta (1304-1377), l'un des plus grands globe-trotters de tous les temps. Installé pleinement dans le voyage, juge ici, commerçant ou diplomate... -
MAGHREB - Littératures maghrébines
- Écrit par Jamel Eddine BENCHEIKH , Christiane CHAULET ACHOUR et André MANDOUZE
- 14 202 mots
- 3 médias
Al-Idrīsī est en vérité le seul géographe maghrébin, les autres ouvrages relevant de la relation de voyage.Ibn Baṭṭūta (m. en 1377) a laissé de ses longs périples en Orient, Asie Mineure, Chine, Russie, Afrique noire... un récit étonnant où le merveilleux, le fantastique et l'absurde...
Voir aussi