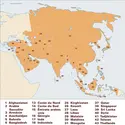KAZAKHSTAN
| Nom officiel | République du Kazakhstan |
| Chef de l'État et du gouvernement | Kassym-Jomart Tokaïev - depuis le 20 mars 2019 |
| Capitale | Astana |
| Langue officielle | Russe , Kazakh |
| Population |
20 330 104 habitants
(2023) |
| Superficie |
2 724 900 km²
|
Article modifié le
Le Kazakhstan, ancienne république soviétique indépendante depuis décembre 1991, est situé en Asie centrale. Ce pays vaste (2,7 millions de kilomètres carrés) compte une population de 16 millions d'habitants (recensement de 2009), dont le caractère multinational est surtout hérité des périodes tsariste et soviétique. Le cœur du territoire kazakhstanais, qui est constitué de déserts froids et de steppes, fut, jusqu'à la colonisation russe, le domaine des grandes confédérations nomades. Toutefois, c'est dans le cadre de l'U.R.S.S., qui a mené une politique d'aménagement du territoire très active, que le Kazakhstan a été fondé. Une profonde crise économique et sociale a accompagné les premières années de l'indépendance. Alors que le Kazakhstan, dirigé par Noursoultan Nazarbaïev de 1989 à 2019, a adopté les principes de l'économie de marché, le pays connaît désormais un développement rapide fondé sur l'exploitation des ressources naturelles (pétrole, uranium). Dans le cadre de la politique de consolidation de l'État, le Kazakhstan utilise ces revenus pour investir dans la nouvelle capitale, Astana.
Géographie
Un pays vaste, écartelé et enclavé
Au cœur du continent asiatique, le Kazakhstan s'étend sur 2 717 000 kilomètres carrés, superficie qui le classe au huitième rang mondial ; 3 000 kilomètres séparent les rives de la mer Caspienne, à l'ouest, de l'Altaï, à l'est ; 1 600 kilomètres, les montagnes du Tianshan et les oasis du Turkestan, au sud, de la Sibérie méridionale, au nord. Ce territoire a été délimité dans les années 1920 et 1930, dans le cadre de la réforme politique et territoriale menée par les autorités soviétiques qui fonda le Kazakhstan et en fit une république socialiste soviétique en 1936. Organisé suivant une disposition zonale des ensembles agroclimatiques, le pays est centré sur une grande étendue constituée de déserts continentaux froids (par exemple le Kyzyl-Koum, « les sables rouges ») et de steppes (Betpak-Dala, « la steppe de la faim ») qui furent, jusqu'au xxe siècle, le domaine des nomades kazakhs. Cette région de la cuvette aralo-caspienne, qui occupe la majorité du territoire, est marquée par l'endoréisme : le Tchou se perd dans le désert du Mouyoun-Koum, l'Ili se jette dans le lac Balkhach, tandis que l'Oural coule vers la Caspienne et que le Syr-Daria s'achève dans l'Aral, lac désormais divisé dont le volume a diminué de 80 % depuis 1960, à la suite de l'essor des périmètres irrigués dévolus à la culture du coton. Seul le nord du pays, drainé par l'Irtych et ses affluents (Ichim, Tobol), appartient au bassin versant de l'océan glacial Arctique. Les plaines et les plateaux du bouclier kazakh sont dominés par des petits massifs dont l'altitude n'excède pas 1 600 mètres. En revanche, au sud-est, une barrière montagneuse discontinue mais puissante, formée du Tianshan, où se situe le point culminant du pays (Khan Tengri 6 995 m), de l'Alatau de Dzoungarie, du Tarbagataï et de l'Altaï, ceinture le pays au niveau de la frontière chinoise.
Alors que la population kazakhstanaise s'élève à 16,9 millions d'habitants (2013), les inégalités du peuplement conditionnent des discontinuités majeures au sein du territoire. Deux foyers de peuplement séparés par la zone désertique et steppique, dont la densité est inférieure à 0,1 habitant par kilomètre carré, concentrent la majorité de la population. Celle-ci réside prioritairement dans les oasis et les piémonts méridionaux, où est localisée Almaty, la première ville (1,475 million d'hab.), et dans les régions septentrionales, où se trouve notamment Astana, la nouvelle capitale (officiellement 778 000 hab.). Malgré la forme compacte du territoire, les discontinuités du peuplement et les distances font ainsi du Kazakhstan un espace écartelé.
Sa situation géographique est en outre marquée par l'enclavement. Cette configuration territoriale introduit une dépendance vis-à-vis des pays riverains qui influence le positionnement géopolitique multivectoriel adopté depuis l'accession à l'indépendance. Par ailleurs, ce déficit d'accessibilité constitue une contrainte sur le plan économique, en ce qu'il renchérit les coûts de transport. Mais les autorités, soucieuses d'asseoir la légitimité du nouvel État, renversent cette représentation pour souligner la centralité et le rôle charnière joué par le Kazakhstan dans l'espace eurasiatique.
Une population en cours de « kazakhisation »
Héritage des politiques de peuplement et des politiques d'aménagement de l'espace conduites pendant la période tsariste et surtout pendant la période soviétique, la population kazakhstanaise est composite. Dès la fin du xviiie siècle, l'avancée coloniale s'est traduite par l'installation de populations slaves et chrétiennes, alors que les Kazakhs appartiennent à l'ensemble des peuples turciques et sont de confession musulmane. Mais c'est au xxe siècle qu'un renversement des équilibres démographiques s'est opéré. Au cours de la sédentarisation-collectivisation, qui s'est déroulée de 1928 à 1933, les steppes kazakhes ont subi une catastrophe démographique sans précédent, puisque près de deux millions de Kazakhs ont disparu sous l'effet de la famine et de l'exode. Or le Kazakhstan a parallèlement été le réceptacle de populations criminalisées et de « peuples punis » par le régime stalinien. De 1936 à 1945, 450 000 Allemands soviétiques, 400 000 Nord-Caucasiens (Tchétchènes, Karatchaïs, Ingouches...) et environ 100 000 Coréens ont été déplacés et assignés à résidence dans les villes et villages du Kazakhstan. Enfin, la mise en exploitation des gisements miniers du centre de la république comme la mise en culture des terres vierges ont mobilisé plusieurs millions de personnes originaires des régions européennes de l'U.R.S.S. Bien que ce flux se soit interrompu à la fin des années 1960, les migrations « soviétiques » ont fait que le Kazakhstan était, au moment de son indépendance, la seule république issue de l'U.R.S.S. à compter une population éponyme minoritaire, les Kazakhs ne représentant que 40 % de la population lors du recensement de 1989.
Au cours de la transformation postsoviétique, le Kazakhstan a connu une longue séquence de dépeuplement de 1993 à 2002 : entre les recensements de 1989 et de 1999, la population est ainsi passée de 16,2 millions à 14,9 millions d'habitants (— 8 %), du fait d'un important déficit migratoire. La dégradation de la situation économique et sociale et des facteurs ethniques expliquent que plus de 3 millions de personnes, parmi lesquelles principalement des Russes, des Allemands et des Ukrainiens, ont définitivement quitté le Kazakhstan après l'indépendance. Le déclin démographique a particulièrement affecté les campagnes et les villes du centre (région de Karaganda), du nord (régions de Koustanaï, d'Akmola et du Kazakhstan septentrional) et du nord-est (régions de Pavlodar et du Kazakhstan oriental), où les populations allochtones étaient les plus nombreuses. Depuis 2003, le Kazakhstan enregistre une croissance de sa population, stimulée par un solde naturel et un solde migratoire positifs, en raison du tarissement du flux d'émigration et de l'essor du flux d'immigration lié d'une part, aux « retours » de Kazakhs résidant à l'étranger (Ouzbékistan, Chine, Mongolie...), qui sont encouragés par les autorités et, d'autre part, à l'arrivée de migrants centrasiatiques attirés par l'essor économique.
Depuis l'indépendance, les comportements démographiques différenciés des groupes nationaux présents au Kazakhstan conduisent à une homogénéisation croissante de la population, du point de vue de la composition nationale. La part des Kazakhs, qui s’élevait à 63 % en 2009, connaît une progression régulière. La « kazakhisation » de la population apparaît comme un élément de la politique de stabilisation et de consolidation de l'État. Outre les mesures destinées à inciter les Kazakhs de l'étranger à migrer vers leur « patrie historique », le gouvernement mène une politique linguistique qui vise à affirmer la place de la langue kazakhe, alors que la période soviétique avait constitué un moment de forte russification. Toutefois, l'État veille à garantir les droits des minorités nationales (en 2009 : Russes, 23 % ; Ouzbeks, 2,8 % ; Ukrainiens, 2 % ; Ouïgours, 1,4 % ; Allemands, 1,1 %) et souhaite faire du Kazakhstan un exemple de société multiethnique et multiconfessionnelle.
De la crise postsoviétique à l'essor contemporain
Durant la première décennie d'indépendance, le Kazakhstan a subi une profonde crise économique à la suite de la désintégration du système de production et d'échanges soviétique. La production industrielle et la production agricole (céréales, élevage) ont chuté sous l'effet conjugué de la perte du marché soviétique et de la désorganisation du secteur économique.
Alors que le Kazakhstan a adopté au cours de la transition postsoviétique les principes de l'économie de marché, il connaît une croissance soutenue depuis le début des années 2000, quoique ralentie en 2008-2009 par la crise financière mondiale. Ce dynamisme, qui fait du Kazakhstan la seconde puissance économique du monde postsoviétique, repose essentiellement sur l'exploitation des richesses du sous-sol. D'importants gisements d'uranium sont exploités dans les régions méridionales, de sorte que le Kazakhstan en est le premier producteur mondial. Par ailleurs, le Kazakhstan est devenu un pays pétrolier, à la suite de la découverte et de la mise en exploitation de gisements importants dans l'ouest du pays. Les champs de la région caspienne (Tengiz, Karachaganak, Mangystau) fournissent une quantité croissante d'hydrocarbures. Aussi le Kazakhstan a-t-il produit 81 millions de tonnes de pétrole en 2012, soit plus du double de la production enregistrée à la fin de la période soviétique. Des compagnies pétrolières internationales américaines, européennes et asiatiques investissent également avec l'entreprise d'État pour exploiter dans les années 2010 le gisement offshore géant de Kashagan, découvert en 2000 dans le golfe du nord de la Caspienne, de sorte que les autorités envisagent de porter la production à 150 millions de tonnes, ce qui placerait le Kazakhstan parmi les pôles d'approvisionnement importants à l'échelle mondiale. Devant la situation d'enclavement, de nouveaux oléoducs et gazoducs sont construits à travers la Russie, le Caucase et à destination de la Chine pour assurer l'évacuation du pétrole vers le marché international.
L'essor du secteur des matières premières soutient l'économie nationale, notamment les services, quoique l'économie de rente induise des déséquilibres structurels qui marginalisent certaines activités. La rente stimule le dynamisme d'Almaty, la capitale économique, d'Astana, la capitale politique, et des villes du pétrole (Atyrau, Aktau, Aktobe). Les régions minières et industrielles du centre du pays (Karaganda, Temirtau...) mais surtout une grande partie des campagnes connaissent une situation moins florissante, bien que le pays demeure un grand producteur de céréales. Le Kazakhstan est traversé par des inégalités territoriales qui recoupent des différenciations sociales grandissantes.
Ouverture internationale et affirmation nationale
Le Kazakhstan poursuit depuis son indépendance une politique d'intégration sur la scène politique régionale et internationale. Ce processus tient aux dynamiques d'ouverture et de désenclavement vers l'Europe et l'Asie, et à l'élaboration d'un positionnement géopolitique fondé sur le multilatéralisme. Le Kazakhstan est un membre important de la Communauté des États indépendants (C.E.I.), fondée à Alma-Ata en décembre 1991 pour succéder à l'U.R.S.S. moribonde. Dans ce cadre, il maintient des relations privilégiées avec la Russie, qui continue d'exploiter le centre spatial de Baïkonour, à travers notamment sa participation à l'Espace économique commun créé avec la Russie et la Biélorussie en 2012. Plus largement, le Kazakhstan collabore avec les principales organisations internationales. Le pays participe aussi à des structures macrorégionales : il a rejoint en 1992 l'Organisation de coopération économique qui a été créée par le Pakistan, l'Iran et la Turquie, et a intégré l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette politique, qui s'accompagne de bonnes relations avec les pays européens et les États-Unis, permet au Kazakhstan de s'insérer dans le champ politique international. Manifestation du nouveau statut géopolitique acquis par le Kazakhstan, le pays fut en 2010 le premier pays de la C.E.I. à présider l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, avant de diriger en 2011 l'Organisation de la conférence islamique.
En Asie centrale, les processus d'intégration régionale se sont longtemps heurtés au cloisonnement qui découle de la fermeture croissante des frontières depuis la disparition de l'U.R.S.S. et à la rivalité avec l'Ouzbékistan pour la détention de la primauté régionale. Néanmoins, des coopérations sont mises en œuvre, notamment pour la gestion de l'eau dans le bassin de l'Aral. Plus de vingt ans après les indépendances, l'essor économique récent du Kazakhstan conduit à faire du pays la principale puissance régionale, l'exploitation du sous-sol ayant accru les écarts de richesse au profit du Kazakhstan.
Dans le cadre de la consolidation de l'État, le Kazakhstan mène une politique d'aménagement qui vise à unifier l'espace national. Les réseaux de transport continentaux sont reconfigurés pour limiter les discontinuités et améliorer l'accessibilité entre les régions. Par ailleurs, le Kazakhstan a décidé de transférer la capitale d'Almaty, qui est située à proximité des frontières kirghizstanaise et chinoise, vers Akmola rebaptisée Astana en 1998, qui est localisée dans le centre-nord du pays. Cette décision marque non seulement la rupture avec la période soviétique, mais participe également d'un rééquilibrage du territoire de la République. Astana, ville moderne au cœur de steppes, est désormais censée symboliser l'unité de la nation, la réussite du Kazakhstan indépendant et la justesse des orientations décidées par le président Noursoultan Nazarbaïev.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Isabelle OHAYON : docteure en histoire, chargée de recherche au CNRS
- Arnaud RUFFIER : anthropologue, chercheur à l'Institut français d'études sur l'Asie centrale
- Denis SINOR : professeur émérite d'études ouraliennes et altaïques, professeur d'histoire à l'université d'Indiana, Bloomington
- Julien THOREZ : docteur en géographie, chargé de recherche au C.N.R.S., membre de l'U.M.R. 7528 Monde iranien et indien (C.N.R.S., Sorbonne nouvelle, EPHE, INALCO)
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
KAZAKHSTAN, chronologie contemporaine
- Écrit par Universalis
-
ALMATY ou ALMA-ATA, anc. VIERNYÏ
- Écrit par Pierre CARRIÈRE
- 311 mots
- 1 média
Appelée Viernyï jusqu'en 1921, la ville d'Almaty (nommée Alma-Ata pendant la période soviétique), ville principale de la république du Kazakhstan, située au pied des monts Ala-Taou, sur le cône de déjection construit en commun par la Grande et par la Petite Almaatinka, comptait 1,5...
-
ARAL MER D'
- Écrit par Encyclopædia Universalis et Yves GAUTIER
- 2 373 mots
- 1 média
Partagé par la frontière entre le Kazakhstan au nord et l'Ouzbékistan au sud, la mer d'Aral occupe, au milieu de déserts sableux, une partie basse de la dépression touranienne ou aralo-caspienne ; elle a communiqué avec la mer Caspienne jusqu'à une époque géologique récente (quelques...
-
ASIE (Structure et milieu) - Géologie
- Écrit par Louis DUBERTRET , Encyclopædia Universalis et Guy MENNESSIER
- 7 936 mots
...le bouclier précambrien de l'Aldan. Les plissements calédoniens se trouvent à l'ouest où ils dessinent un V ouvert vers le nord-ouest (partie ouest du Kazakhstan central et chaînons septentrionaux du Kazakhstan). On y trouve de grands anticlinoriums à noyau précambrien, séparés par des synclinoriums... -
ASIE (Structure et milieu) - Géographie physique
- Écrit par Pierre CARRIÈRE , Jean DELVERT et Xavier de PLANHOL
- 34 880 mots
- 8 médias
Partout, les sables tiennent une grande place, la topographie variant selon qu'ils sont fixés par la végétation ou demeurent libres.Dans les secteurs les moins arides, Betpak-Dala et Semiretché kazakhes, les sables sont retenus par l'uvette ou l'erkek ou, même, le saxaoul. Le Kyzyl-Koum ne présente... - Afficher les 22 références
Voir aussi
- RUSSIE FÉDÉRATION DE
- ALMA-ATA ACCORDS D' (déc. 1991)
- RUSSE LANGUE
- RUSSIE FÉDÉRATION DE, économie
- NAZARBAÏEV NOURSOULTAN (1940- )
- MIGRATIONS HISTOIRE DES
- DÉPORTATIONS & TRANSFÈREMENTS DE POPULATIONS
- DZOUNGARS ou DJOUNGARES ou JÜNGAR
- KHAN
- PAUVRETÉ
- DOUANIÈRE UNION
- STEPPE
- SÉDENTARISATION
- COMPAGNIES PÉTROLIÈRES
- KAZAKH
- ALA-TAOU ou ALATAU
- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911
- CHINE, économie
- ASTANA, anc. NOURSOULTAN
- OPPOSITION POLITIQUE
- CROISSANCE ÉCONOMIQUE
- RÉPRESSION
- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE
- CEI (Communauté des États indépendants)
- RUSSIE, histoire, des origines à 1801
- URSS, histoire
- PRIVATISATION
- PAYS ENCLAVÉS
- CORRUPTION
- EXPLOITATION PÉTROLIÈRE
- PÉTROLIÈRE PRODUCTION
- KAZAKH, langue