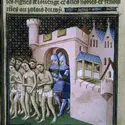LANGUEDOC, histoire
Article modifié le
Le Languedoc est, parmi les grandes provinces françaises, une des plus marquées par l'histoire. Son nom même est tiré de la langue qu'ont parlée, pendant des siècles, ses habitants.
Cette région fut successivement la Narbonnaise romaine, le comté de Toulouse des Raimond, la généralité du Haut et Bas-Languedoc de l'Ancien Régime ; et si la révolution de 1789 a supprimé administrativement la province en la divisant en huit départements, la personnalité languedocienne n'en subsista pas moins au xixe siècle sous la forme d'un certain conservatisme économique (primauté de l'agriculture, faiblesse de l'industrialisation). Aujourd'hui, tout en étant fidèle à un art de vivre propre et à une culture humaniste héritée de son histoire (profonde empreinte latine, civilisation des cathares, religion du désert), le Languedoc connaît de nouvelles mutations.
Depuis un siècle, le haut Languedoc, qui est le pays des grains (blé et maïs), se dépeuple au profit des villes, surtout de Toulouse ; la noblesse s'appauvrit, vend ses terres aux cultivateurs ; la polyculture et la petite propriété se développent, mais les paysans vivent difficilement. Le bas Languedoc, au contraire, s'est engagé dans la production commerciale du vin, avec la monoculture de la vigne ; devant les dangers de la surproduction et grâce aux progrès de l'irrigation, il tend à lui associer les cultures maraîchères et les productions fruitières. Mais, pour l'ensemble du Languedoc, la première révolution industrielle a été manquée. Heureusement, la seconde moitié du xxe siècle semble, avec les perspectives de la régionalisation, se présenter sous de meilleurs auspices.
Les origines
Les premiers hommes
Riche en sites préhistoriques, le Languedoc semble avoir abrité deux grands types successifs d'occupants au Paléolithique et au Néolithique. Ce furent d'abord des collecteurs de racines, de fruits et de baies sauvages, ainsi que des chasseurs, il y a peut-être un million d'années, correspondant à l'Acheuléen dont les représentants étaient établis de la Garonne au Rhône, puis à l'humanité néandertalienne, qui disparaît vers les XXXVe-XXXe millénaires. L'Homo sapiens, ancêtre direct de l'humanité actuelle, apparaît alors sous un climat très froid ; il vit dans les cavernes, et, le premier, donne les chefs-d'œuvre des grottes peintes (Niaux dans l'Ariège, grottes du canyon de l'Ardèche). À partir du VIIe millénaire, la rigueur du climat s'atténue et apparaissent progressivement des pasteurs et des paysans, dont la présence est attestée par des céramiques originales ; au cours du IIIe millénaire, les genres de vie et l'habitat se diversifient, le Languedoc méditerranéen est plus pastoral, le Languedoc aquitain plus paysan, et cette division persistera jusqu'au début du premier âge du fer (viiie siècle av. J.-C.), avec les « peuples des champs d'urnes » (agriculteurs sédentaires des plaines et des vallées) et les « peuples des tumulus » (pasteurs des plateaux, errant avec leurs troupeaux le long des drailles de transhumance, que leurs prédécesseurs avaient jalonnées de dolmens).
L'implantation commerciale grecque
La fondation de Marseille par les Grecs de Phocée vers 600 avant J.-C. allait entraîner en Languedoc l'afflux des marchandises helléniques et la fondation d' Agde (Agathè). Le commerce grec, avec ses poteries et ses monnaies, vivifia la région. Un type d'agglomération se développa, celui des oppida, dont Ensérune, dans l'Hérault, est l'exemple le plus caractéristique ; ces acropoles, outre leurs vertus défensives, permettaient aux indigènes (appelés tantôt Ligures et tantôt Ibères) de surveiller les mouvements des commerçants étrangers et de demeurer maîtres des voies terrestres et maritimes, notamment de la route aquitaine de l'étain, si importante à cette époque. Plus tard, entre le iiie et le ier siècle avant J.-C., les colonies de Grande-Grèce et de Sicile, particulièrement la Campanie, prirent le relais de la Grèce proprement dite, de telle manière que la romanisation fut la suite directe et le complément de l'hellénisation qui la prépara.
La colonisation romaine
La conquête du Languedoc par les Romains eut lieu vers 123-121 avant J.-C. Ce ne fut en réalité qu'une promenade militaire entre le Rhône, les Pyrénées et la Garonne, jusqu'à Toulouse où le consul Cneius Domitius Ahenobarbus installa une garnison. Si l'archéologie permet de déceler certaines destructions, comme à Ensérune, celles-ci peuvent aussi bien s'expliquer par une résistance aux Romains que par le passage des Cimbres. En tout cas, Domitius s'attarda plusieurs années dans la région afin d'en assurer la romanisation. Son fils créa, en 118 avant J.-C., la colonie de Narbonne, tandis que lui-même organisa la via Domitia, qui allait constituer pour toujours l'axe vital du Languedoc. La nouvelle province, après des débuts difficiles et la révolte manquée des Volques Tectosages de Toulouse, profita très vite des bienfaits de la paix romaine. Auguste vint à plusieurs reprises dans ce qu'on appelera la province Narbonnaise. De nombreuses colonies seront fondées : Béziers, Lodève, Carcassonne, Nîmes, Pézenas, Toulouse. Hadrien séjourna dans cette province et fit élever à Nîmes une somptueuse basilique à la mémoire de Plotine, veuve de Trajan ; Nîmes devait d'ailleurs donner à Rome un de ses empereurs, Antonin le Pieux. Le meilleur témoignage de la romanisation du Languedoc est son urbanisation, avec le développement de ces grandes cités, de leurs magnifiques monuments, dont subsistent encore aujourd'hui le célèbre pont du Gard, la Maison carrée et les grandioses arènes de Nîmes. Le port de Narbonne est alors, selon Diodore de Sicile, le « plus grand marché » du Midi gaulois, tandis que Toulouse, si l'on en croit Pomponius Mela, est devenue la ville la plus prospère de la Narbonnaise.
La décadence du Bas-Empire et les royaumes barbares
Malheureusement, à partir du iiie siècle, les invasions barbares (Alamans, Vandales) entraînèrent une anarchie générale, que le christianisme naissant s'efforça en vain d'atténuer. Partout, les villes déclinent et les ruraux retrouvent les modes d'existence qui étaient ceux de la préhistoire. Au ve siècle, les Wisigoths font de Toulouse la capitale éphémère de leur royaume ; ce dernier est en partie conquis par les Francs, et le Languedoc est partagé entre ces deux peuples.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean SENTOU : professeur d'histoire contemporaine à la faculté des lettres et sciences humaines de Toulouse
Classification
Média
Autres références
-
ALBIGEOIS (CROISADE CONTRE LES)
- Écrit par Jacques LE GOFF
- 4 153 mots
- 2 médias
...Raimond VII en 1249, Alphonse de Poitiers et Jeanne de Toulouse lui succédèrent. Comme ils disparurent en août 1271 sans laisser d'héritier, le comté de Toulouse fut alors réuni au domaine royal qui avait absorbé tout le Languedoc, à l'exception du comté de Foix, demeuré sous la suzeraineté royale. -
BÉZIERS
- Écrit par Jean SAGNES
- 822 mots
- 2 médias
Baeterra (premier nom de Béziers) apparaît dès le viie siècle avant notre ère. C'est alors la plus importante ville des Elysices après Narbonne. La cité originelle est une acropole bâtie sur deux collines surplombant l'Orb. La ville commerce avec les Étrusques et les Grecs dès le ...
-
CAMISARDS
- Écrit par Louis TRENARD
- 688 mots
Nom donné aux calvinistes cévenols révoltés à la fin du règne de Louis XIV et qui vient du patois languedocien camiso, chemise, parce qu'ils portaient, dans leurs opérations nocturnes, une chemise blanche sur leurs vêtements pour se reconnaître entre eux. Alors qu'ils paraissaient résignés...
-
CARCASSONNE
- Écrit par Régis KEERLE et Laurent VIALA
- 947 mots
- 4 médias
La ville de Carcassonne, chef-lieu de l'Aude, rayonne bien au-delà de sa région. Témoignage monumental de son passé médiéval, la Cité (la ville haute) a été inscrite en 1997 par l'U.N.E.S.C.O. au Patrimoine mondial de l'humanité, un an après le canal du Midi qui traverse la commune. Devenue pièce...
- Afficher les 14 références
Voir aussi