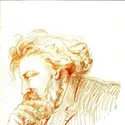LITTÉRATURE & PSYCHANALYSE
Article modifié le
Comment les apports de la psychanalyse peuvent-ils nous aider à apprécier les œuvres littéraires ? Quel bénéfice la critique, quel profit l'art de bien lire et d'aider les autres à mieux lire peuvent-ils retirer d'un savoir qui vise principalement la connaissance et la correction des troubles de la psyché ? Il y a quelque artifice à se dire étonné de la collaboration entre deux disciplines que beaucoup de choses rapprochent dès l'origine. Mais il y a autant de résistances, dans le public cultivé, à accepter l'idée que des spécialistes de la pathologie mentale viennent nous éclairer sur les belles-lettres, sur la naissance, le devenir, la signification des chefs-d'œuvre de la pensée humaine, alors même que, tout le monde le reconnaît par ailleurs, le génie des écrivains ne va pas sans un grain de folie, les jouissances qu'ils nous procurent plongent largement dans l'irrationnel, ou relèvent au moins d'une sorte de magie.
La littérature, ce sont des auteurs, des livres et des lecteurs. La psychanalyse, ce sont des concepts rassemblés en doctrine, des techniques d'exploration et des êtres humains qui se livrent corps et âme à l'écoute de ce qu'ils disent. On imagine volontiers que des liens de différente nature mettent en rapport ces composantes diverses. On admettra tout aussi vite que les conditions historiques du développement de la théorie freudienne et de l'évolution de la chose littéraire ont joué, continuent et continueront de jouer un rôle dans la façon dont se nouent des relations complexes. Il paraît être de bonne méthode d'observer les événements du passé avant de décrire la situation actuelle, mais il faut préciser d'emblée que nous n'aurons pas la facilité de suivre une série continue de métamorphoses : par l'effet du génie de Freud, tout fut envisagé dès le départ. Grâce à la diversité des penseurs et des courants de pensée, toutes les possibilités sont encore offertes, sinon exploitées, de nos jours. Comme il n'y a pas de création poétique sans mystère, il n'y a pas de prise sur l'inconscient sans intervention de l'inconscient : l'histoire des pratiques et des réflexions sur la pratique n'en est que plus délicate à démêler.
Schématiquement, toutefois, on repère tout au long du xxe siècle une évolution qui peut se caractériser par la formule suivante : de moins en moins l'homme, de plus en plus le discours. Pour éviter tout malentendu, précisons que cette phrase ne signifie nullement : Lacan a pris la place de Freud ; il ne serait pas exact non plus d'entendre que les philosophes, linguistes et littéraires ont peu à peu succédé aux médecins du début, même si le nombre des analystes non médecins, théoriciens comme thérapeutes, s'est nettement accru (en France tout au moins) depuis les années 1960. Dès lors, on peut remplacer la formule ci-dessus par cette autre : non plus les auteurs, mais les textes.
Le surplomb de l'auteur
On ne s'attardera pas ici sur la fraternité qui unit en profondeur la culture littéraire avec la découverte et la mise en place de l'inconscient. Non seulement Freud était un connaisseur et un amateur des ouvrages les plus variés, qui consacrait une grande part de ses loisirs à la lecture quand il n'était pas en voyage sur le pourtour de la Méditerranée pour admirer les productions de l'art gréco-latin et égypto-hellénistique ; non seulement il était de la race des écrivains authentiques, et l'on sait combien il se sentit honoré de recevoir le prix Goethe, mais deux des notions de base qui soutiennent l'édifice doctrinal de la psychanalyse ont trouvé le nom qui les désigne dans la littérature antique : l'œdipe chez Sophocle, le narcissisme chez Ovide. En outre, rien ne ressemble autant à une narration romanesque qu'un « récit de cas », pourvu que son conteur ait des lettres : or, de même que Socrate exigeait du philosophe qu'il soit d'abord « géomètre », la tradition analytique a toujours exigé du candidat qu'il n'entre en formation qu'après s'être richement doté de culture générale et pourvu d'un style original. L'écoute du patient requiert des qualités qui sont celles mêmes d'un artiste du langage, voire d'un poète.
Cette fraternité suffit à expliquer que dès les premières décennies du siècle les analystes aient mobilisé leur compétence pour « ausculter » les œuvres, prêter l'oreille à ce qu'elles ne savent pas qu'elles disent, et y reconnaître la parole d'un désir indicible. Ce qu'ils essayaient d'entendre, c'était l'inconscient d'un homme, exemplaire de l'Inconscient de l'Homme. Il était bien naturel que les psychanalystes d'alors, en commençant par le premier d'entre eux, aient du mal à perdre de vue l'artiste quand il leur arrivait de s'intéresser aux œuvres d'art : leur formation, acquise dans les facultés de médecine, leur profession de départ les préparaient d'abord à soigner des malades et à chercher comment élargir, assurer, perfectionner une doctrine dont ils devenaient à ce double titre les « docteurs ».
Et lorsque Freud, curieux de tout, choisit comme objet d'analyse un petit récit publié en 1903, Gradiva de W. Jensen, les buts qu'il se fixa étaient de vérifier sur pièces que la folie peinte dans une fiction autorisait les mêmes procédures de diagnostic et d'interprétation qu'une pathologie dans la réalité, et que les rêves inventés par le romancier obéissaient aux mêmes lois que ceux de la vie quotidienne ; aussi bien sut-il intituler son ouvrage : Délire et rêves dans la « Gradiva » de W. Jensen (1907). On constate en outre que Freud se déclare dans son étude bien près de traiter les héros comme des êtres vivants, faisant ainsi bon marché de tout ce qui dans une fiction est constitutif du personnage au titre de sa mise en scène et du décor qui l'encadre. En outre, il a essayé d'obtenir de l'écrivain, son contemporain, l'aveu que tel événement de sa vie était à la source de cette intrigue et de quelques autres. Cela revenait à transformer l'œuvre d'art en symptôme et à réduire, pour reprendre les termes fameux de Proust, le moi de l'artiste au moi de l'homme.
Cette manière de procéder, qu'on peut baptiser « médicalisante » pour l'expliquer, sinon la justifier, a donné le jour à deux séries de travaux. La première porte le nom de psychobiographie. Sa méthode a été définie, assez tardivement car la chose avait commencé sans le nom, par Dominique Fernandez, vers la fin des années 1960. Partant du postulat cher à Sainte-Beuve (« Tel arbre, tels fruits ») selon lequel on comprend mieux une œuvre si on fait la lumière sur la personnalité de l' auteur, le psychobiographe prolonge l'enquête vers la petite enfance de l'homme et le premier entourage familial, afin d'éclairer sa « personnalité inconsciente ». Pour ne pas nous appesantir sur les difficultés doctrinales et pratiques d'une telle reconstitution effectuée de l'extérieur, en n'insistant pas sur la fragilité des témoignages (d'où qu'ils viennent, de la famille, voire de l'intéressé), relevons seulement ceci, qui est révélateur : deux des principales études ainsi réalisées, et fort éloignées dans le temps, s'intitulent L'Échec de... – Baudelaire pour René Laforgue (1931), Pavese pour Dominique Fernandez (1967) –, ce qui est pour le moins embarrassant devant des écrivains qui ont réussi leur œuvre à défaut de leur vie (et qu'est-ce à dire ?). On se demande surtout en quoi une telle recherche concerne la littérature, en quoi elle permet de mieux apprécier les livres, ce génie, une écriture que nous admirons.
La seconde tentative, ou tentation, se nomme avec plus de légitimité psychocritique. Au moins veut-elle distinguer un homme de lettres de n'importe quel personnage ayant laissé des Mémoires ou ayant fait l'objet d'une chronique. Charles Mauron a bien reconnu la vanité et surtout le manque de rigueur de la psychobiographie. Il a fixé pour but à son approche critique de regarder d'abord et surtout les écrits littéraires des auteurs, d'en repérer les régularités et le système aussi bien dans la forme que dans le contenu, d'en dépeindre la fantasmatique de base (qu'il appelle le « mythe personnel ») et de ne faire appel à ce que l'on sait par ailleurs, grâce aux correspondances, journaux intimes, documents divers, que pour confirmer l'intuition de l'interprète. Toute une technique est ainsi proposée qui permet, en « superposant » les textes, de dégager des noyaux de signification particulièrement prégnants, investis par l'écrivain d'une préférence révélatrice. Tandis que les psychobiographes prétendent retracer les cheminements inconscients d'une âme pour apporter un éclairage synthétique ou spécifique sur l'œuvre, le psychocritique explore ce qu'il pense être le sens inconscient des ouvrages constitués en une œuvre, puis il projette cette lumière sur la personnalité de l'écrivain – au risque de reprojeter ce savoir à la fois sur son propre travail tant que tout n'a pas été analysé (piège en forme de tourniquet) et sur un écrivain auquel cette opération impose par sa convergence même un inconscient délimité, chosifié (piège en forme d'idéologie positiviste, voire de métaphysique spiritualiste). Rien n'est plus ruineux pour un travail qui se veut analytique que la recherche d'une unité, sinon la présupposition d'une unité. Il n'existe pas un sujet inconscient unifié à la source de quelque activité psychique que ce soit, et pas davantage une figure inconsciente unifiable au terme d'une description psychologique : croire le contraire, c'est revenir à une pensée préfreudienne, ce serait remettre la Terre au centre du monde, Adam et Ève à l'origine des hommes.
Il existe évidemment un cas où ces dangers sont à la fois apparents et moins perturbants : celui des œuvres qui sont en totalité ou en majorité constituées d'écrits autobiographiques. L'indistinction de principe entre l'homme et le héros-narrateur semble rendre tout à fait légitime une exploration de l'auteur à travers l'œuvre. Avant d'en reparler, notons que l'individu ainsi pris en charge (ou en chasse) l'est en tant qu'aboutissement de son œuvre et non en tant qu'il en a été la source. Il devient un personnage, privilégié peut-être, mais non plus un auteur : Henry Brulard, fils désigné de Chérubin Beyle, est plus proche de Julien, Fabrice ou Lucien que de Stendhal, et l'exploration de son inconscient (voir le livre exemplaire de Philippe Berthier, Stendhal et la Sainte Famille) relève plus d'un « contrat de lecture » que du « pacte d'écriture » analysé par Philippe Lejeune dans une autre perspective. Une psychobiographie de Sartre qui aurait pris Les Mots pour point de départ aurait du mal à nous persuader qu'elle trace un portrait total et véridique de cet écrivain. N'est pas si fou en l'occurrence le poète qui déclarait :
Moi Antonin Artaud je suis mon fils, mon père, ma mère et moi
Somme toute, que l'activité littéraire soit toujours peu ou prou autobiographique ne permet pas de conclure que sa lecture freudienne doit ou simplement peut donner accès à l'âme de son auteur. Une œuvre d'art n'est jamais un document, sauf pour l'historien, le sociologue, l'ethnographe, et sur une si grande échelle qu'elle en perd sa singularité et en devient indistincte. Donc défigurée.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean BELLEMIN-NOEL : professeur de littérature française moderne et contemporaine à l'université de Paris-VIII-Saint-Denis
Classification
Autres références
-
AUTOBIOGRAPHIE
- Écrit par Daniel OSTER
- 7 519 mots
- 5 médias
Aumoment où l'autobiographe énoncerait le constat de son imaginaire réussite – je parle et je dis cela de moi –, la psychanalyse pourrait lui souffler : ce n'est pas toi qui parles, ou bien : tu parles d'autre chose que tu n'énonces pas, ou encore : tu énonces une chose dont pourtant... -
AUTOFICTION
- Écrit par Jacques LECARME
- 2 427 mots
- 2 médias
Avec le début des années 1980, on a assisté à l'étonnante aventure d'un néologisme dont on ne sait encore s'il correspond à un nouveau genre littéraire ou à un effet spécial d'affichage, aussi séduisant que trompeur. En 1977, le mot fut inventé par Serge Doubrovsky...
-
BACHELARD GASTON (1884-1962)
- Écrit par Jean-Jacques WUNENBURGER
- 3 479 mots
- 1 média
Naît alors une seconde œuvre. Souvent rangée du côté des sciences littéraires, elle se révèle une défense et illustration de la face nocturne de l'homme, qui ne se réduit pas aux rêves de la nuit. Elle nous fait descendre vers l'inconscient, vers la mort, mais aussi vers les forces... -
BIOGRAPHIE
- Écrit par Alain VIALA
- 2 601 mots
...Angleterre de Lytton Strachey (La Reine Victoria, 1921), en Allemagne de Emil Ludwig (Guillaume II, 1926), en France d'André Maurois, cependant que la psychanalyse structure un système explicatif des faits et des créations par les traumatismes de la petite enfance (Edgar Poe, sa vie, son œuvre [1933],... - Afficher les 19 références
Voir aussi