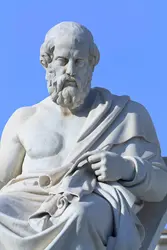MÉTAPHYSIQUE
Article modifié le
Du retour à la raison au discrédit de la métaphysique
La métaphysique de Descartes
La métaphysique de Descartes peut être considérée comme la source de toute métaphysique moderne. Il convient pourtant de remarquer ce que cette métaphysique a d'ambigu. On pourrait même prétendre que la métaphysique cartésienne est moderne dans la mesure où nous lui conférons un sens que Descartes, en son intention explicite, ne lui a pas clairement donné. En présentant l'ouvrage qui porte en latin le titre de Meditationes de prima philosophia, et en français celui de Méditations métaphysiques, Descartes annonce en effet que l'on y trouvera avant tout la démonstration de l'existence de Dieu et celle de l'immortalité de l'âme, ou, du moins, de la distinction de l'âme et du corps. C'est là conserver à la métaphysique sa définition médiévale : elle demeure bien la science de ces réalités invisibles et « transphysiques » que saint Thomas tenait pour ses objets propres. Elle est, pourrait-on dire, la science des objets immatériels.
Mais il faut convenir que Descartes ne consacre pas beaucoup de temps à l'étude positive de tels objets. De Dieu, il n'affirme guère que l'existence, l'infinité et la véracité. De l'âme, il se contente de dire qu'elle est pure pensée, distincte du corps. En fait, le Dieu de Descartes apparaîtra surtout comme le fondement et le garant d'une connaissance dont l'âme constituera le sujet. De ce fait, la nature même du savoir métaphysique sera profondément modifiée. Jusque-là, la métaphysique était savoir suprême. Avec Descartes, elle devient la racine de tout savoir.
« Toute la philosophie, écrit Descartes dans la lettre-préface de l'édition française des Principes de la philosophie, est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences. » Dans cette mesure, Descartes abandonne ce qu'on a appelé la métaphysique spéciale, étudiant ces objets spécifiés que sont, par exemple, l'âme et Dieu, et revient à une métaphysique générale, réfléchissant sur l'Être qui est à l'origine de tous les êtres, à la source de toute science et de toute réalité. Et sans doute, de la conception médiévale, Descartes garde-t-il l'idée que cet Être est un dieu créateur. Mais c'est aussi, et avant tout, un dieu véridique, un dieu qui garantit mes idées claires, et la prétention de mon esprit à atteindre le réel. Ce dieu se trouve à l'origine de tout savoir.
Chacun de ces deux aspects de la métaphysique cartésienne aura, dans la suite de l'histoire des idées, un sort bien différent. Nul ne prouve plus, aujourd'hui, l'immortalité de l'âme par des arguments empruntés aux Méditations, nul n'invoque plus à l'appui de sa foi les preuves que Descartes propose pour établir l'existence de Dieu. En revanche, la primauté de l'esprit sur l'objet, établie par Descartes, paraît toujours actuelle : elle annonce, en particulier, ce qu'on appellera chez Kant la révolution copernicienne, substituant à une explication de la connaissance opérée à partir de l'objet une explication partant du sujet ; elle rend possible tout ce qui, dans la philosophie contemporaine, dépend encore de cette révolution.
En dépit de son titre et de l'apparence, la métaphysique cartésienne n'a donc rien de médiéval. Elle n'est pas étude de Dieu, de l'âme et du monde. Elle est la mise en place de ces trois réalités, entre lesquelles elle établit une hiérarchie nouvelle, tout aussi contraire à celle de la scolastique qu'à celle du sens commun. Pour nous tous, en effet, ce qui semble le plus évident est le monde. L'âme paraît douteuse, et Dieu n'est l'objet que d'une difficile croyance. Or, par le doute, Descartes met d'abord en question l'ensemble des objets perçus, et la connaissance scientifique elle-même. Par la prise de conscience de ce doute, le moi pensant découvre son être propre, et devient notre première certitude ; notre âme, comme le dit Descartes, paraît ainsi plus aisée à connaître que notre corps. Réfléchissant sur soi, notre esprit découvre enfin l'idée de l'infini, à partir de laquelle il s'élève à l'existence même de Dieu, créateur de ma pensée et de toutes choses. La véracité divine fonde alors le droit qu'a notre raison de s'exercer sans contrainte, et son pouvoir d'atteindre la vérité. Et c'est à partir de cette garantie que le monde matériel lui-même pourra être retrouvé. En sorte que l'ordre commun des évidences se trouve bouleversé.
Ici, quelque chose commence, et les démarches qu'effectue Descartes, les réalités qu'il invoque, si elles sont encore désignées par des mots empruntés au vocabulaire ancien, prennent un sens nouveau. Le doute cartésien n'est pas doute sceptique, le sujet qu'affirme la « Méditation seconde » n'est pas ce sujet humain qui, pour les Grecs, n'était source que de l'erreur. L'esprit connaissant, découvrant ses pouvoirs, se trouve mis à la première place, et Kant n'aura plus qu'à reprendre et à approfondir son analyse pour y découvrir les conditions de possibilité de tout objet.
La métaphysique cartésienne innove aussi en ce que, loin d'être connaissance théorique et purement intellectuelle, elle est méditation et réflexion vécue. C'est par une expérience temporelle que l'esprit découvre qu'il est la condition de tout ce qu'il connaît et peut connaître. Cette insertion de la temporalité dans l'essence même de la découverte annonce Hegel. D'autre part, comme on le voit dans la célèbre analyse dite du morceau de cire, Descartes inaugure l'analyse transcendantale des conditions de notre perception. Il affirme à la fois que la conscience connaissante n'est qu'une manifestation de l'Être, auquel elle doit demeurer soumise, et qu'elle est supérieure à tout ce qui, apparaissant d'abord comme Monde, se révèle à titre d'objet connaissable. En ce sens, la démarche cartésienne ne saurait être dépassée, et ce n'est pas par hasard que Husserl intitulera l'un de ses ouvrages Méditations cartésiennes.
Et, pourtant, il faudra attendre Kant pour que la métaphysique de Descartes porte vraiment de tels fruits, fruits qui, du reste, seront méconnus par Kant lui-même. Dans les systèmes qui succèdent à la métaphysique de Descartes, chez les philosophes qu'on a coutume d'appeler les cartésiens, le mouvement essentiel qui animait les Méditations se trouve perdu : on ne rencontre plus ni le doute, ni le cogito. Rendue par Descartes à sa certitude, la raison humaine, oubliant la démarche par laquelle elle s'est libérée, a l'ambition de tout connaître ou, du moins, de donner une image exacte du tout de l'univers. C'est la période des grands systèmes, que beaucoup considèrent à tort comme l'expression la plus achevée de la métaphysique.
Les grands systèmes
On a souvent dit que la seconde moitié du xviie siècle fut l'âge d'or de la métaphysique. C'est vrai en un sens, car jamais on ne vit proposer tant d'explications de l'univers, ordonnées, cohérentes et profondes. Cette époque est celle des grands systèmes de Malebranche, de Leibniz, de Spinoza. Et, pourtant, cette apogée de la métaphysique est l'annonce de son prochain déclin.
Selon Malebranche, la raison aperçoit directement les idées en Dieu. Consulter sa raison, c'est consulter le Verbe, qui répondra toujours à nos interrogations attentives, l'attention étant une sorte de prière naturelle que l'esprit adresse à Dieu pour découvrir la vérité. Il nous est donc possible de pénétrer les desseins mêmes de Dieu. Malebranche prétend nous apprendre pourquoi Dieu a créé le monde, pourquoi il n'agit que par des lois générales, et à partir de quoi s'expliquent toutes les imperfections apparentes, les désordres, les douleurs et les monstruosités. En un tel système, c'est la totalité de ce que nous constatons qui se trouve justifiée. Mais, par là même, surnaturel et naturel tendent à se confondre, et l'objet dernier de notre connaissance devient cet univers étalé dans l'espace, dont la science découvre la structure et les lois. Le système de Malebranche tend au naturalisme. Autant qu'une métaphysique, il nous présente une cosmologie.
Selon le « principe de raison suffisante », Leibniz estime que, de toute chose, il est possible en droit de rendre raison. Mais les raisons dernières des choses ne se découvrent pas dans le plan du mécanisme. Métaphysiquement considéré, le monde est composé de substances spirituelles, ou monades, qui sont les sujets auxquels peuvent être logiquement attribués tous les événements qui leur adviennent. À une analyse infinie, toute proposition vraie apparaîtrait donc comme totalement rationnelle. Et sans doute Dieu, seul capable d'une telle analyse, a-t-il eu le choix, au moment de la création, entre une infinité de mondes possibles. Mais le principe du meilleur, que, dans sa bonté, il devait nécessairement suivre, l'a, cette fois, moralement déterminé à choisir et à créer le meilleur des mondes possibles. Une fois encore, il peut donc être rendu raison de tout, et le système proposé par le philosophe se donne comme le système même de l'univers.
Une même ambition se fait jour chez Spinoza, qui veut, par la connaissance, nous conduire à la liberté, à la béatitude et au salut. Dieu est la substance unique des choses. Nous connaissons deux de ses attributs, l'étendue et la pensée. Chacun se développe indépendamment de l'autre, et une infinité de modes peuvent en être déduits. Mais l'ordre et la connexion des idées ne font qu'un avec l'ordre et la connexion des choses. En sorte qu'en enchaînant ses pensées dans l'ordre dû, qui est celui de la raison, l'esprit pensera par idées adéquates, et en complète conformité avec le réel. Et, l'idée qu'il prendra de lui-même coïncidant avec celle que Dieu a de lui, il expérimentera sa propre éternité.
Il est clair que ces brèves indications ne tendent en rien à révéler la profondeur et la richesse des grands systèmes métaphysiques de la seconde moitié du xviie siècle. Elles veulent seulement mettre en lumière l'ambition rationaliste qui les inspire, ambition qui, aux yeux de la plupart, est le caractère essentiel de l'entreprise métaphysique. Les philosophes de cette époque pensent avoir atteint la vérité absolue : l'ordre qu'ils nous proposent pour enchaîner nos idées leur paraît être l'ordre même du réel.
Et c'est pourquoi l'on peut penser que cette apparente victoire de la métaphysique n'est en réalité que défaite de la véritable métaphysique. Elle l'est, d'abord, en ce que les systèmes proposés s'opposent entre eux : Malebranche, Leibniz, Spinoza prétendent nous enseigner ce qu'est le monde en sa réalité dernière. Mais chacun nous en donne une image différente. En outre, les systèmes de ces auteurs sont en grande partie des systèmes de l'objet : en ce sens, ils apparaissent, plus encore que comme métaphysiques, comme des systèmes physiques, des systèmes de la nature. Or, au même moment, l'étude de la nature est entreprise par une science qui réalise chaque jour de nouveaux progrès, grâce à une méthode patiente et à des expériences sans cesse renouvelées. En face des conquêtes plus modestes, mais plus solidement établies de la science, les grands systèmes de Malebranche, de Leibniz, de Spinoza vont donc apparaître comme des rêves, inspirés par l'oubli des limites de l'esprit humain. Avec le xviiie siècle on verra, au succès des systèmes, succéder le discrédit de la métaphysique.
L'empirisme
Le discrédit de la métaphysique au xviiie siècle a revêtu bien des aspects. Il prend parfois celui du scepticisme ou de l'agnosticisme : les problèmes posés par la métaphysique sont alors tenus pour insolubles et, en tout cas, comme étant au-dessus des pouvoirs de la raison humaine. Un certain esprit scientiste se développe d'autre part : on attend de la science, et d'elle seule, tout progrès positif de la connaissance. Tout cela apparaît chez Voltaire, qui se moque des métaphysiciens, chez Diderot, chez la plupart des Encyclopédistes. Au rationalisme doctrinal, affirmant que le fond de l'être est raison, succède alors un rationalisme méthodique, faisant de la raison, non la mesure de l'être, mais celle de notre connaissance. Et cette raison même est tenue, non point, comme chez Platon ou chez Malebranche, pour une faculté capable de nous donner l'intuition de l'être, mais pour le moyen d'organiser nos expériences et nos pensées. Pourtant, le xviiie siècle n'abandonne pas toute philosophie, au sens traditionnel de ce mot. Mais sa philosophie est empiriste et critique, elle dérive de Locke et de Condillac. Aussi son histoire est-elle marquée par la destruction des deux notions fondamentales sur lesquelles semblait reposer la métaphysique classique : la notion de substance, celle de cause. Berkeley ruine la notion de substance matérielle, Hume celles de substance spirituelle et de causalité.
Berkeley est lui-même un métaphysicien. Il nous présente un univers composé d'âmes, âmes que Dieu affecte de ces sensations qui composent pour nous le monde. Mais la méthode de Berkeley est empiriste et critique. Elle rejette avant tout les idées abstraites, idées que Locke avait admises pour expliquer le fait du langage. Berkeley remarque qu'aucune idée abstraite ne saurait se découvrir sans l'intuition de l'esprit. Peut-on se représenter une couleur qui ne serait aucune couleur particulière, peut-on se représenter un cheval qui ne serait ni grand, ni petit, ni blanc, ni noir, ni brun ? Or une telle critique, appliquée à l'idée de matière, révèle en elle une absence totale de contenu. Quand nous parlons de matière, nous ne saurions rien concevoir qui ne soit sensation, perception, ou idée de l'esprit. Seuls donc existent, comme substances, des esprits : l'existence du monde est celle de leurs idées.
Mais Hume, reprenant la méthode de Berkeley, l'applique à son tour à la notion de substance spirituelle. Quand je me retourne vers moi-même, je n'aperçois qu'une série d'états, et non ce moi, un et identique, ce moi substance, cette âme que Descartes avait cru découvrir. Dieu ne saurait davantage être prouvé avec certitude. Voilà donc la métaphysique privée de ses objets.
Nous ne saurions non plus atteindre, au sens métaphysique, une cause. Analysant cette idée, Hume établit que nous ne trouvons jamais, dans l'antécédent, la raison du conséquent. Nous ne percevons pas non plus de productivité, d'action passant du phénomène-cause au phénomène-effet. Seule nous est offerte une succession. Mais la constatation répétée de couples de faits développant l'habitude d'attendre l'un des termes lorsque l'autre est donné, le sentiment que nous prenons de cette attente engendrent en nous l'idée de causalité : c'est dans cette impression de transition espérée et facile que réside tout ce qu'il y a de positif dans l'idée de cause.
Ainsi se trouve consommée la ruine de la métaphysique. Chez Malebranche, chez Leibniz, le monde était soutenu par Dieu. Avec Hume, sa structure semble reposer tout entière sur le sujet humain. Or ce sujet n'est pas encore, ce qu'il sera chez Kant, un sujet transcendantal. C'est un sujet fait d'habitudes et de sentiments, c'est un sujet nature. La nature semblant se suffire, il n'y a plus de place pour cet appel à l'au-delà de la nature, qui constitue l'essence de la métaphysique.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Ferdinand ALQUIÉ : professeur honoraire à l'université de Paris-Sorbonne, membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques)
Classification
Média
Autres références
-
AGNOSTICISME
- Écrit par Henry DUMÉRY
- 226 mots
Terme créé en 1869 par un disciple de Darwin, T. H. Huxley (1825-1895). Il devrait signifier le contraire de gnosticisme, c'est-à-dire le refus d'une connaissance de type supérieur (procédés d'explication suprarationnels). En fait, « agnosticisme » a eu à l'origine un sens précis :...
-
ALAIN DE LILLE (1128-1203)
- Écrit par Jean-Pierre BORDIER
- 1 036 mots
Né à Lille, élève de Bernard Silvestre à Chartres, Alain étudie dans la mouvance de Gilbert de la Porrée ; il devient maître ès arts, puis maître en théologie à Paris, avant d'enseigner à Montpellier ; parvenu au sommet de la gloire, il suit l'exemple de son ami Thierry...
-
ANALOGIE
- Écrit par Pierre DELATTRE , Encyclopædia Universalis et Alain de LIBERA
- 10 429 mots
Connue par les Latins avant l'œuvre d'Aristote, la théorie métaphysique d'Avicenne a introduit la problématique de la pluralité des sens de l'être sous une forme qui définissait d'avance les conditions d'intelligibilité de la métaphysique aristotélicienne en fondant la possibilité de toute métaphysique... -
ANGOISSE EXISTENTIELLE
- Écrit par Jean BRUN
- 2 552 mots
- 1 média
Expériencepsychométaphysique, l'angoisse naît donc d'une remontée au primordial ne permettant pas de redescendre le long de coordonnées chronologiques au centre desquelles nous nous retrouverions. Elle peut devenir un piège si nous la cultivons dans ces dolorismes ontologiques qui hypostasient... - Afficher les 114 références
Voir aussi