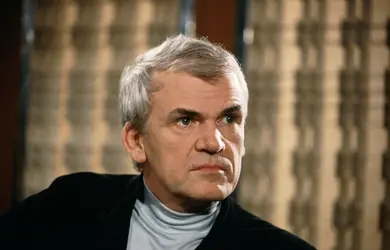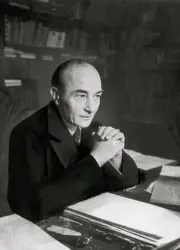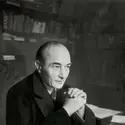MITTELEUROPA
Article modifié le
Si l'on parle en français de « Mitteleuropa », c'est bien que la notion géographique d'Europe centrale n'est pas une traduction suffisante du mot allemand. Celui-ci désigne, en dehors du contexte de la géopolitique, une représentation « géoculturelle » du rôle de la langue et des créations littéraires et intellectuelles allemandes dans cette région située au milieu de l'Europe. L'identité culturelle de cette autre Europe aura d'abord été définie par la littérature. Il est vrai que l'existence même d'une Mitteleuropa littéraire et intellectuelle a été parfois considérée comme le « mythe habsbourgeois » de l'unité des nationalités rattachées à la monarchie austro-hongroise jusqu'à la Première Guerre mondiale. Depuis les traités de 1919, le statut de la littérature germanophone d'Europe centrale et de la littérature « autrichienne » se présente sous un jour nouveau. L'identité culturelle de la Mitteleuropa est aussi caractérisée par un style de pensée qui, depuis le xixe siècle, rapproche plusieurs systèmes philosophiques et théoriques. En Mitteleuropa, modernité rime avec pluralité des langues et des cultures, pour le meilleur, quand on entend par là une interculturalité productive, et pour le pire, lorsque les identités s'affirment les unes contre les autres.
Définitions géoculturelles
Pour l'histoire culturelle, la notion de Mitteleuropa ne correspond pas à une réalité géographique mais à une représentation du rôle de la langue et des créations littéraires et intellectuelles allemandes en Europe centrale. La carte mentale de la Mitteleuropa a des frontières variables, à l'ouest et à l'est, suivant les époques. Si l'on remonte aux premiers peuplements allemands à l'est de la frontière du Saint Empire romain germanique, la Mitteleuropa s'étend jusqu'aux franges occidentales de la Russie et des pays Baltes. Si l'on considère que les deux empires, allemand et habsbourgeois, constituent la Mitteleuropa depuis l'époque moderne, il convient de distinguer la tradition fédérative et multiculturelle du Saint Empire (la Bohême et le nord de l'Italie en ont toujours fait partie) et celle qui résulte du dualisme austro-prussien depuis l'époque de Marie-Thérèse et de Frédéric II.
Un espace de rencontres et de conflits
La notion géopolitique de Mitteleuropa reste marquée par l'idéologie nationale libérale de Friedrich Naumann définissant les buts de guerre allemands en 1915 et, dans un ordre encore moins acceptable, par le programme pangermaniste. Voilà pourquoi l'histoire culturelle se doit de manier la notion de Mitteleuropa avec précaution. Affirmer que les peuples de langue allemande seraient le cœur de l'Europe centrale revient à rendre la notion de Mitteleuropa suspecte, voire insupportable à toutes les autres nations. Notre propos n'est donc pas de considérer l'Europe centrale comme une notion géopolitique, mais plutôt de mettre en évidence quelques aspects de l'identité culturelle de ce milieu de notre continent, dont l'oubli serait profondément regrettable au sortir d'un siècle qui s'est acharné à le démanteler et à le détruire, de la Première Guerre mondiale à la Seconde et d'une dictature exterminatrice à l'autre.
La diffusion de la culture allemande a structuré un espace qui, à partir du xixe siècle, est devenu le lieu, tantôt de l'affrontement entre la Kultur germanique et les autres identités culturelles, tantôt de l'interpénétration germano-slave, germano-juive, germano-hongroise. La Mitteleuropa culturelle consiste à la fois en ces conflits et en ces rencontres interculturelles. Dans certains contextes, elle évoque les pires cauchemars de l'humanité. Dans d'autres, elle désigne une civilisation suprêmement raffinée, résultat de métissages culturels entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, entre l'Europe occidentale, l'Europe médiane et l'Europe orientale.
Comment rendre compte de l'identité de ce « centre » du continent européen ? On doit d'abord revenir à la distinction entre l'Europe byzantine et l'Europe centrale, puis entre l'islam et la chrétienté. Ces frontières religieuses et culturelles séparent les peuples de religion orthodoxe (Russes, Biélorusses, Ukrainiens, Roumains, Serbes, Macédoniens, Bulgares, Grecs) des peuples de religion catholique romaine et protestante ; et d'autre part les îlots islamiques qui subsistent dans les Balkans. Une fois que l'on a constaté l'importance de ces délimitations et leur permanence jusqu'au temps présent, il faut se garder d'invoquer cette frontière comme la justification d'un rejet (russophobe ou antiserbe...) ou comme l'explication des conflits de l'âge postcommuniste. Car, à l'est comme à l'ouest, la sécularisation de la culture européenne (entendue au sens de la perte d'importance des clivages confessionnels, par rapport aux conflits nationaux, ethniques et sociaux) rend impossible de réduire les guerres, dont l'ex-Yougoslavie fut encore le théâtre durant les années 1990, à des guerres de religion.
La Mitteleuropa, vue de l'Est
Les deux « autres de l'Europe centrale », l'Est russe orthodoxe et le Sud-Est balkanique, regardent l'Europe centrale/Mitteleuropa d'un œil très différent. Vu de l'Est, le centre s'évanouit dans une perspective qui prend en compte avant tout la frontière qui sépare l'Est et l'Ouest. Les intellectuels russes, bien souvent, se sont représenté l'Europe comme un tout plus ou moins indistinct. Pour les slavophiles, les Slaves catholiques, protestants ou sans confession d'Europe centrale sont une très fâcheuse exception à la règle qui identifie l'âme slave et la confession orthodoxe. Pour les occidentalistes, l'Europe centrale n'est qu'une sorte de zone intermédiaire qu'on traverse pour arriver en Allemagne, en France ou en Italie. Enfin la Pologne, vue de l'Est, occupe une place à part, puisque, dans une certaine tradition, elle fait partie intégrante de l'Empire russe. En revanche, il est certain que l'Europe centrale se définit elle-même en fonction de la Russie, et le plus souvent contre elle. Vue de la Mitteleuropa, la Russie apparaît comme une menace de régression politique et culturelle.
Au contraire, les « Balkans » aspirent à la « débalkanisation » et à l'admission dans la civilisation centre-européenne. L'homo balkanicus est une caricature conçue par les Occidentaux pour désigner un être rustique et sauvage, un primitif européen, pittoresque lorsqu'il s'agit du folklore, mais barbare et sanguinaire lorsqu'il prend les armes. Les discours européens sur « les Balkans », surtout depuis le début du xxe siècle, ressortissent à un orientalisme dépourvu de tout trait positif, à un colonialisme culturel qui attend de la civilisation occidentale qu'elle ramène un peu d'ordre et de rationalité dans des territoires morcelés et sous-développés. « Les Balkans » s'opposent alors à l'Europe centrale du sud-est, de civilisation habsbourgeoise.
Les frontières orientales de l'Europe centrale sont au demeurant plus faciles à tracer que sa frontière occidentale. Les pays de langue allemande appartiennent-ils à l'Europe centrale ou à l'Europe occidentale ? C'est ce qui distingue la Mitteleuropa, qui inclut l'Autriche et l'Allemagne, de l'Europe centrale dans ses acceptions française ou anglaise, qui excluent toutes deux les pays de langue allemande. Lorsque ces pays germaniques étaient au contact direct de l'Europe de l'Est, en Prusse orientale ou dans la monarchie habsbourgeoise, ils faisaient sans aucun doute partie de l'Europe centrale. Entre 1949 et 1990, la R.F.A. restait au contact de l'Europe de l'Est par sa frontière avec la R.D.A., limite de la zone d'influence soviétique.
Mais depuis 1990, la frontière est de l'Allemagne tend à devenir une frontière entre l'ouest et le centre de l'Europe et l'appartenance de l'Allemagne à l'Europe centrale devient très discutable. Aujourd'hui, le centre de l'Europe n'est plus l'axe Berlin-Prague-Vienne-Budapest, mais l'axe Rotterdam-Milan. Ce qui revient à dire que malgré la réunification allemande et l'effondrement de l'empire soviétique, l'Europe dite centrale restait à la marge de l'Europe fondée par les traités de Rome. L'élargissement de l'Union européenne a visé précisément à rétablir une certaine forme de continuité historique.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jacques LE RIDER : directeur d'études à l'École pratique des hautes études
Classification
Médias
Autres références
-
CANETTI ELIAS (1905-1994)
- Écrit par Jacques LE RIDER
- 2 424 mots
- 1 média
Ayant connu dans son enfance la Belle Époque à l'est de l'Europe, en Bulgarie, puis à l'ouest, en Angleterre, avant de vivre en Autriche et en Allemagne les années convulsives de l'entre-deux-guerres, Elias Canetti est, selon les mots de Claudio Magris, « une des voix de cette... -
LA CONSCIENCE DE ZENO, Italo Svevo - Fiche de lecture
- Écrit par Gilbert BOSETTI
- 988 mots
- 1 média
Après l'insuccès de ses deux premiers romans, Une vie (1892) et Sénilité (1897), ignorés par la critique italienne alors que leur auteur n'est encore à Trieste qu'un sujet de l'Empire austro-hongrois, Italo Svevo (1861-1928) a renoncé à toute ambition littéraire. Toutefois, bien qu'absorbé...
-
HARMONIA CÆLESTIS (P. Esterházy)
- Écrit par Jacques LE RIDER
- 936 mots
- 1 média
Dans la magnifique floraison de la littérature hongroise d'aujourd'hui, se détache l'œuvre puissante et originale de Péter Esterházy. Depuis Trois anges me surveillent (1989), Le Livre de Hrabal (1990), Une femme (1998) et L'Œillade de la comtesse Hahn-Hahn - en descendant le Danube...
-
L'HOMME SANS QUALITÉS, Robert Musil - Fiche de lecture
- Écrit par Jacques LE RIDER
- 1 078 mots
- 1 média
Dans la deuxième partie se développe « l'Action parallèle » : un comité d'intellectuels et de hauts responsables politiques, économiques et militaires viennois s'efforce de programmer un événement autrichien qui serait capable de faire écho et contrepoint aux cérémonies de l'anniversaire de l'avènement... - Afficher les 14 références
Voir aussi
- EUROPE, histoire
- HISTOIRE LITTÉRAIRE
- AUTRICHE-HONGRIE ou AUSTRO-HONGROIS EMPIRE
- LITTÉRATURE THÉORIES DE LA
- WEININGER OTTO (1880-1903)
- MAUTHNER FRITZ (1849-1923)
- POLOGNE, histoire, de 1764 à 1914
- POLOGNE, histoire, de 1914 à 1945
- ALLEMANDE LANGUE
- AUTRICHIENNE LITTÉRATURE
- ALLEMANDES LITTÉRATURES
- JUIVE LITTÉRATURE
- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE
- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945
- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917
- LANGAGE & SOCIÉTÉ