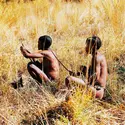CLASTRES PIERRE (1934-1977)
Article modifié le
Avec une sûreté, une concision et une élégance qui devaient marquer chacun de ses écrits, le premier essai de Pierre Clastres, Échange et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne, jetait les fondements de son anthropologie politique. Il contenait déjà, pour l'essentiel, l'interprétation du monde dit primitif ou sauvage que Clastres ne devait cesser d'enrichir dans la suite.
Nombreux ont été ses séjours parmi les Indiens. À partir de 1963, pendant plus de dix ans, il passe une longue partie de son temps en Amérique du Sud, successivement au Paraguay, au Brésil et au Venezuela. Auprès des Guayaki, d'abord, puis des Guarani, d'une importante tribu du Chaco ensuite, les Chulupi-Ashluslay, et, enfin, des Yanomami, il recueille une abondante information qui lui permettra d'écrire avec une égale compétence et un égal bonheur sur la vie quotidienne d'un groupe, sur la fonction des chefs, les mythes, les rites d'initiation et la guerre.
Au foyer des études de Clastres, une même certitude : les sociétés indiennes et, de manière générale, les sociétés primitives sont doublement méconnues. Ou bien l'on prétend les reléguer à un stade inférieur du développement de l'humanité, on les loge dans l'histoire, mais pour leur assigner le statut de ce qui n'est pas encore civilisé – telle est la perspective de l'évolutionnisme, et que celui-ci se pare des couleurs de la science marxiste ne le modifie guère. Ou bien l'on abolit la dimension de l'histoire, pour réduire leur singularité aux signes d'une structure ou d'un ensemble de structures qui les distingueraient, parmi d'autres, dans l'univers de la culture. Dans l'un et l'autre cas, demeure impensé ce qui fait qu'une société primitive est société, le mouvement par lequel elle se rapporte à elle-même, à la fois s'institue comme une et se représente comme telle – bref, demeure impensée son existence politique. Ni d'un point de vue évolutionniste, ni d'un point de vue structuraliste, ne fait question le statut du pouvoir.
Or, c'est justement à prendre en compte la manière dont la société primitive détermine la place du pouvoir qu'on peut s'affranchir d'une conception naïve et positiviste du développement de l'humanité et reposer en nouveaux termes le problème de l'histoire en pointant une mutation : le passage d'un monde sans État au monde de l'État (si diversifiées soient ses figures, depuis les anciens despotismes jusqu'aux démocraties ou aux totalitarismes modernes). Que les sociétés indiennes ne connaissent pas l'État, ou, à mieux dire, ne présentent pas trace d'un pouvoir détaché de l'ensemble social, d'un pouvoir exercé par un homme ou un petit nombre sur le reste des hommes, voilà certes qui fut communément signalé par les premiers observateurs et les ethnologues. Mais tel était le préjugé ethnocentrique, et précisément politique, que ce trait – lorsque l'on prétendait en rendre raison – fournissait l'indice d'un manque. L'absence de l'État, d'un pouvoir circonscrit dans les frontières d'une institution, représentant, garant, agent de transmission de la loi et, en tant que tel, détenteur de moyens de coercition, cette absence était censée témoigner d'une immaturité de l'organisation sociale, repérable d'autre part à la faiblesse du développement technique et de la division du travail.
Cependant, l'originalité de Clastres est de montrer que, loin d'être déterminantes, les conditions techniques et économiques sont elles-mêmes dans la dépendance d'un choix politique, qui interdit à la société, en même temps que la formation d'un pouvoir détaché et coercitif, la production d'un surplus de biens sans nécessité pour la subsistance de la communauté et contraire au principe de son équilibre. Renversant l'opinion accréditée, il soutient ainsi que l'essor des forces productives, dont les idéologues marxistes font le moteur de l'histoire et la condition de l'avènement de l'État, doit bien plutôt se concevoir comme un effet de l'apparition de celui-ci. Sa conviction est qu'il faut rétablir le primat du politique pour interroger l'histoire.
La thèse est remarquablement fondée sur l'analyse de la fonction des chefs dans les sociétés indiennes. Vaine demeurerait, en effet, l'observation qu'elles sont dépourvues d'une instance de pouvoir, si l'on ne repérait et ne savait interpréter le phénomène ambigu d'une institution qui tout à la fois instaure une division générale du groupe et en désamorce les effets, à la fois lui donne figure et l'annule. Tel est le paradoxe que Clastres s'est acharné à scruter : l'existence d'un chef auquel sont reconnus le prestige, le pouvoir de la parole, le privilège de la polygénie, la distinction de la richesse, mais qui, en dehors de circonstances exceptionnelles (la conduite de la guerre), ne saurait commander, dont la parole, faite pour rappeler les vertus de l'obéissance aux ancêtres et à la loi, s'avère sans autorité, et dont les biens sont péniblement acquis pour être redistribués généreusement aux membres de la communauté. De l'analyse ressort que le pouvoir, en son effectivité, demeure dans le groupe, mais que celui-ci ne l'exerce que par le détour de la négation de son extériorité.
La première proposition se vérifie à l'examen du sort des chefs qui, comme dit notre auteur, veulent « faire les chefs » : qu'ils cèdent en effet à la démesure de l'autorité et c'en est fini de leur prestige ; non seulement ils ne seront pas obéis et ne trouveront pas de sujets, mais ils perdront la reconnaissance sociale, voire la vie. La seconde proposition livre le secret de l'élaboration politique qui commande l'institution de la société. Et il convient de la souligner pour dissiper une équivoque déjà répandue. En effet, Clastres, quoiqu'il ait quelquefois parlé de l'indivision de la société primitive, nous fait entendre qu'elle affronte la question de sa division et lui apporte une réponse. La notion d'un pouvoir détaché ne lui est pas étrangère, elle en conjure seulement la menace. À ne pas l'admettre, deviendrait inintelligible sa formule d'une société contre l'État, son idée du refus d'une instance humaine législatrice et coercitive. Il faudrait alors lui prêter une conception naturaliste qu'il a mis toute son énergie à combattre. Quoique l'objet du refus ne soit pas représenté, quoique l'État ne soit pas connu de ceux qui se défendent contre son avènement, le discours et la pratique des primitifs témoignent d'une reconnaissance tacite de la division sociale et de la possibilité de son déploiement.
Enfin, quand on lit sa pénétrante étude sur la torture dans l'initiation (reprise dans La Société contre l'État) et ses derniers articles sur la guerre (parus dans Libre, I et II), thème auquel il souhaitait consacrer un prochain ouvrage, on se persuade que Clastres n'a jamais cédé à la fiction, que d'aucuns lui prêtent, de sociétés harmonieuses dont les sociétés étatiques figureraient l'antithèse maléfique. Assurément, il admirait la résistance que ceux que nous qualifions de primitifs ont su opposer pendant des millénaires à l'instauration de la domination de l'homme sur l'homme. Mais, attentif au phénomène de la violence comme peu d'ethnologues le furent avant lui, il n'a jamais accrédité la représentation du « bon sauvage ». Sa passion était d'interroger une humanité dont il cherchait à restituer l'interrogation propre, constitutive de son état social.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Claude LEFORT : directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales
Classification
Autres références
-
ABENSOUR MIGUEL (1939-2017)
- Écrit par Anne KUPIEC
- 898 mots
- 1 média
Utopie, émancipation, critique, politique – tels sont les termes qui peuvent qualifier le travail conduit par Miguel Abensour, professeur de philosophie politique, éditeur et penseur.
Miguel Abensour est né à Paris le 13 février 1939. Agrégé de sciences politiques, auteur d’une thèse d’État (...
-
ANTHROPOLOGIE ANARCHISTE
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 847 mots
- 3 médias
Il paraît pertinent de faire remonter ce courant anthropologique aux travaux dePierre Clastres (1934-1977) à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Ce dernier, à partir d’enquêtes poussées chez plusieurs groupes amérindiens d’Amazonie, comme les Guayaki, les Yanomani... -
CHASSEURS-CUEILLEURS (archéologie)
- Écrit par Jean-Paul DEMOULE
- 4 728 mots
- 3 médias
...ont des leaders, mais que ceux-ci ont au moins autant de devoirs que de droits et qu’il existe des mécanismes de résistance au pouvoir, comme l’a avancé Pierre Clastres à propos des Amérindiens d’Amazonie. Ainsi, le « chef » doit consolider son prestige en redistribuant régulièrement les biens acquis,... -
ÉTAT (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 3 054 mots
...d’une crainte quasiment prémonitoire de tous les excès dont s’avéreront coupables les États historiques ? Telle est l’hypothèse originale que l’ethnologue Pierre Clastres (1934-1977), cheminant dans les pas de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), a développée dans son ouvrage La Société contre l’État...
Voir aussi