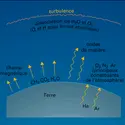POLLUTION
Article modifié le
Les principales causes de pollution
De nos jours, les principales causes de pollution de l'environnement proviennent en premier lieu de la production et de l'utilisation des diverses sources d'énergie, puis des activités industrielles et, de façon paradoxale mais néanmoins importante, de l'agriculture.
À chacune de ces causes fondamentales de pollution vont correspondre d'innombrables sources de dispersion des agents polluants. Ces dernières prennent place depuis l'amont (industries extractives) jusqu'à l'aval, c'est-à-dire jusqu'aux usages domestiques, lesquels peuvent jouer dans certains cas (matières organiques fermentescibles polluant les eaux par exemple). Ainsi, la consommation de substances chimiques commercialisées auprès du grand public intervient de façon non négligeable dans la contamination de l'environnement, sans oublier les masses considérables d'engrais et de pesticides dispersés dans l'espace rural par les activités agricoles.
Pollutions liées à la production et à l'utilisation d'énergie
La production et l'utilisation d'énergie viennent incontestablement au tout premier rang des causes de pollution de la biosphère.
Malgré les crises pétrolières de 1973 et de 1979, et celle larvée et chronique qui a émergé depuis 2004, la consommation globale d'énergie a continué de croître. La diminution épisodique de la consommation du pétrole ou, à tout le moins, le ralentissement de la croissance de son usage, observé depuis la fin des années 1970, a été compensé par l'augmentation de la consommation du charbon, du gaz naturel et aussi par le développement de l'électronucléaire. En 2005, la consommation mondiale d'énergie dépassait 10 milliards de tonnes d'équivalent pétrole (tep). Sur ce total, le pétrole représentait près de 3,9 milliards de tonnes, le charbon 3 milliards de tep, le gaz naturel 2,5 milliards de tep, le reste étant assuré par l'hydroélectricité et le nucléaire.
Cette consommation d'énergie fossile a rejeté cette année-là quelque 7,6 milliards de tonnes d'équivalent carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère, contribuant ainsi de façon significative à l'augmentation de l'effet de serre.
À cela, il faudrait ajouter l'usage du bois comme combustible dans les divers pays en développement (3 milliards de tonnes par an), qui est la source d'une déforestation massive et d'une pollution sous-estimée de l'intérieur des habitations en raison des mauvaises combustions.
De telles données numériques permettent de saisir le rôle majeur joué par la production de l'énergie dans la pollution de la biosphère. À tous les stades de l'activité humaine, l'usage des hydrocarbures liquides et du charbon, les place au premier rang des sources de contamination de l'environnement.
L'exploitation et la combustion des produits pétroliers s'accompagnent d'innombrables pollutions : marées noires provenant des fuites de puits offshore ou d'accidents de transport qui contaminent l'océan mondial, raffinage qui pollue les eaux continentales, de même que les vidanges « sauvages » et autres usages dispersifs des hydrocarbures. Enfin, leur combustion libère dans l'atmosphère divers polluants (dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, oxydes de soufre et d'azote, hydrocarbures imbrûlés, traces de métaux toxiques tels que le mercure, le molybdène, le vanadium). En définitive, la boulimie énergétique propre aux pays industrialisés s'accompagne d'une contamination sans cesse accrue de l'air, des eaux continentales, de l'océan et même des sols par les innombrables substances polluantes produites par les combustions.
D'autres inquiétudes résultent du développement de l'énergie nucléaire. Aux appréhensions justifiées dues à la prolifération des armements nucléaires s'ajoute la crainte d'une pollution insidieuse et généralisée provoquée par les rejets d'effluents radioactifs dans l'air et les eaux. On soulignera néanmoins, si l'on fait table rase de toute attitude « émotionnelle » sur ces questions, qu'un examen des données concrètes disponibles sur les pollutions potentielles ou observées dues à l'électronucléaire montre que le seul problème incontestable auquel on est confronté est celui de la gestion des déchets nucléaires, qui pourrait poser de sérieux problèmes de stockage au cours des prochaines décennies. On a pu calculer que, si les États-Unis voulaient subvenir à tous leurs besoins en électricité à l'aide de centrales nucléaires, ils devraient gérer dans les années qui viennent une production annuelle de déchets équivalente à celle engendrée par l'explosion de 8 millions de bombes atomiques de type Hiroshima. Force est de constater que ce problème deviendra préoccupant en l'absence de solution alternative aux modalités actuelles qui consistent à entreposer les déchets sur les sites de production ou dans des centres de stockages superficiels pour les moins radioactifs d'entre eux. Des études sont en cours pour valider la solution d'un stockage en profondeur, dans des couches géologiques judicieusement choisies. Il faut en effet convenir que le stockage des déchets radioactifs, pour l'instant maîtrisé, pourrait devenir critique en France dans la seconde moitié de ce xxie siècle, compte tenu d'un stock croissant de produits de fission et d'activation (déchets les plus radioactifs) dû au retraitement des combustibles irradiés des centrales nucléaires (cf. nucléaire - Les déchets). Cependant, aujourd'hui, les risques provenant de la filière nucléaire pour l'hygiène publique sont inférieurs, de plusieurs ordres de grandeur par kilowattheure produit, à ceux qui sont liés aux polluants rejetés par les centrales électriques au charbon ou au fuel, ce que les opposants au nucléaire omettent systématiquement d'évoquer.
En sus de la pollution chimique et autres nuisances engendrées par la production de l'énergie, on ne saurait omettre l'une d'entre elles, particulièrement importante, la pollution thermique des eaux, qui est de nature physique.
Comme le rendement thermodynamique des combustions excède rarement 40 p. 100, quelque 60 p. 100 de l'énergie potentielle est perdue dans l'environnement sous forme de basses calories inutilisables lorsque l'homme « brûle » du charbon, du pétrole ou de l'uranium 235. Le refroidissement d'une centrale électrique ayant une puissance nominale de 1 000 mégawatts nécessite de la sorte le débit d'un fleuve entier comme la Seine à son étiage ! La pollution thermique des eaux fluviales ou littorales qui en résulte se traduit par un réchauffement dont les conséquences sont catastrophiques pour les êtres vivants dulçaquicoles et marins.
Pollutions d'origine industrielle
L 'industrie chimique moderne, mais aussi la métallurgie, voire l'électronique mettent en circulation dans la biosphère d'innombrables composés minéraux ou organiques de toxicité souvent élevée ou encore peu dégradables, parfois même indestructibles : mercure, cadmium, niobium, antimoine, vanadium représentent autant de corps simples ne se rencontrant qu'à l'état de trace dans les milieux terrestres ou aquatiques mais qui sont aujourd'hui devenus d'usage banal dans diverses branches industrielles.
Quant à la chimie organique de synthèse, elle élabore des composés artificiels en nombre sans cesse accru. En 1992, on estimait déjà que plus de 500 nouvelles molécules étaient mises sur le marché chaque année et qu'au total environ 120 000 molécules minérales ou organiques de synthèse faisaient l'objet d'un usage commercial dans le monde. Plus inquiétant encore, en ce qui concerne les risques écotoxicologiques de cette invasion chimique, on considère que tout au plus un tiers de ces substances ont fait l'objet d'une étude crédible de leur impact potentiel sur l'environnement de l'homme. À partir d'un tel constat, la directiveReach (enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques), adoptée par l'Union européenne en décembre 2006 et entrée en vigueur le 1er juin 2007, oblige les industries chimiques à procéder d'ici à 2018 au réexamen approfondi de quelque 30 000 substances les plus utilisées dans le monde, afin de mieux connaître leur impact potentiel sur l'environnement et la santé publique.
Un nombre considérable de substances chimiques est rejeté dans le milieu naturel et contribue à une pollution à vaste échelle des divers écosystèmes. Si l'opinion publique des pays industrialisés est depuis longtemps au fait des « retombées » radioactives, elle ignore souvent que le même phénomène se produit pour un grand nombre de contaminants d'origine industrielle. On trouve des fragments de matières plastiques dérivant dans les zones les plus reculées des océans et des concentrations parfois importantes de composés organochlorés non biodégradables (insecticides tels que le dichloro-diphényl-trichloréthane – D.D.T. –, ou de substances d'usage industriel telles que les polychlorobiphényles ou PCB) dans l'organisme des mammifères du Grand Nord canadien (ours blancs, par exemple) ou dans celui des manchots de l'Antarctique ! Un autre exemple de cette invasion chimique de l'écosphère a été donné par la mise en évidence, dans la seconde moitié des années 1980, de traces de chlorofluorocarbures (CFC) dans la stratosphère antarctique.
Les déchets solides
La civilisation moderne produit aussi des masses colossales de déchets solides, qui peuvent se classer selon diverses modalités. On pourra, par exemple, distinguer des déchets domestiques (ordures ménagères), agricoles et industriels (cf. déchets). Les deux premières catégories sont essentiellement constituées de matières organiques, donc biodégradables. En revanche, les déchets des industries minières, métallurgiques, chimiques et nucléaires renferment des résidus intrinsèquement non biodégradables, voire inaltérables, et/ou des substances dont la toxicité est importante. Certains composés, tels que les dioxines, présentent même la particularité d'être à la fois peu ou pas dégradables et extrêmement toxiques.
Les déchets domestiques et agricoles peuvent représenter des volumes considérables. Ainsi, les seuls déchets solides de l'agriculture américaine excédaient 1,5 milliard de tonnes par an à la fin des années 1990. Les déchets urbains posent aussi des problèmes spécifiques, car leur « production », si l'on peut dire, se concentre sur de faibles surfaces. En outre, les ordures ménagères posent, par les volumes considérables produits, de sérieux problèmes de protection de l'environnement. En France, la production urbaine d'ordures excède 1 kilogramme par personne et par jour, et dépasse 450 kg par personne et par an dans certaines grandes agglomérations.
Parmi les divers déchets produits, les plus redoutables – en dehors des résidus de l'industrie nucléaire, qui font l'objet de traitements spécifiques et très stricts dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.) – résultent des industries chimiques et éventuellement métallurgiques, qui produisent de grandes quantités de déchets toxiques.
Depuis le début du xxie siècle, les déchets dangereux produits par les industries américaines excèdent 200 millions de tonnes par an. La production allemande de déchets chimiques toxiques dépasse 5 millions de tonnes par an et celle de la France 2 millions de tonnes. Ce dernier pays est en réalité un importateur net de déchets chimiques toxiques avec une balance des flux largement excédentaire, supérieure à 200 000 tonnes par an. En particulier, il dispose d'incinérateurs spéciaux dans lesquels sont brûlées d'importantes quantités de polluants organiques persistants, certaines étant importées de régions très éloignées comme l'Asie orientale.
Même si l'on prend en considération les seules ordures ménagères, en sus de la nuisance esthétique associée à l'accumulation d'une fraction non négligeable de ces déchets solides dans des décharges à ciel ouvert dites « contrôlées », le lessivage par les eaux pluviales d'anciennes décharges utilisées sans étanchéisation du substrat provoque aujourd'hui encore une pollution clandestine et préoccupante de certaines nappes phréatiques. On notera qu'en dépit de l'interdiction faite par l'Union européenne de la mise en décharge des ordures ménagères depuis juillet 2002, la France persévère dans ce type de gestion des déchets, les pouvoirs publics délivrant encore en 2008 des autorisations d'extension de décharges existantes !
Pollutions d'origine agricole
L' agriculture moderne représente une importante source de pollution de l'espace rural mais aussi des milieux intégrés par l'homme. L'usage massif des engrais chimiques, le recours aux pesticides ont permis une augmentation considérable des rendements agricoles. Ils se sont malheureusement accompagnés d'une pollution accrue des eaux continentales, des terres cultivées, ainsi que des productions végétales et animales par divers contaminants minéraux ou organiques.
La consommation mondiale des engrais chimiques, en croissance incessante depuis plus d'un demi-siècle, tant dans les nations développées que dans les pays en développement, est passée de 5 millions de tonnes en 1945 à plus de 150 millions de tonnes en 2000.
L'abus des fertilisants en agriculture a été tel que, dans de nombreux pays, la pollution des eaux souterraines atteint localement des niveaux qui excèdent les concentrations réputées admissibles en nitrates dans l'eau potable. En France, c'est le cas d'environ 10 p. 100 des eaux de puits situées en général dans des zones de céréaliculture intensive. Les métaux et métalloïdes toxiques (cadmium, vanadium, chrome, cuivre, arsenic, etc.) contenus comme impuretés dans la deuxième grande catégorie d'engrais chimiques, les superphosphates, s'accumulent dans les sols et peuvent passer dans les plantes cultivées. L'usage des pesticides (insecticides, fongicides, herbicides, etc.) a également connu une expansion spectaculaire en agriculture. La consommation mondiale de ces produits (matières actives pures) approchait les deux millions de tonnes à la fin du xxe siècle, en dépit de mesures de réduction de leur usage déjà en œuvre dans certains pays développés. La masse de ces substances dispersées est considérable si l'on songe au pouvoir extraordinairement biocide de certains de ces produits dont la toxicité compense largement sur le plan du potentiel toxicologique la réduction en tonnage de divers composés insecticides tel le D.D.T., dont la fabrication est interdite dans les pays industrialisés. Il en est de même de certains insecticides tels les pyréthroïdes qui, bien que quasi inoffensifs pour les animaux à sang chaud, sont très toxiques pour les poissons et les autres organismes aquatiques.
L'usage excessif des pesticides, qui s'accompagne aujourd'hui d'une pollution croissante des nappes phréatiques – en sus de leurs impacts écologiques indésirables –, a conduit des pays comme les Pays-Bas à diviser par deux les quantités de ces substances employées en agriculture depuis la fin des années 1980. De telles mesures ont également été mises en œuvre aux États-Unis par l'U.S.D.A. En France, plus de 260 molécules présentant des propriétés pesticides sont actuellement homologuées pour des usages agricoles. Bien qu'une diminution des tonnages utilisés ait eu lieu, notre pays, avec plus de 70 000 tonnes de matières actives répandues annuellement, figure au troisième rang mondial pour l'utilisation de ces substances dites phytosanitaires ! Ces masses dispersées dans l'espace rural sont considérables si l'on réfléchit à la toxicité et/ou à la persistance de certaines d'entre elles. Ainsi, la toxicité aiguë de certains insecticides, comme le dimefox ou l'aldicarbe, place ces produits à la limite de celle qui est propre aux armes chimiques. La persistance (mesurée par le temps de demi-vie) d'un insecticide organochloré comme le chlordécone, molécule longtemps utilisée pour lutter contre les charançons dans les bananeraies des D.O.M.-T.O.M., en particulier aux Antilles, se compte en siècles, ce qui explique le scandale soulevé par la « découverte », en septembre 2007, d'une contamination généralisée des eaux et des produits agricoles en Martinique et en Guadeloupe, bien que cette molécule y soit officiellement interdite depuis 1992. Plus de 4 millions de tonnes de D.D.T. ont été dispersées dans le monde depuis sa mise au point dans les années 1940. Comme le temps moyen de résidence dans les biotopes de cet insecticide excède souvent vingt ans, il en subsistera des quantités appréciables dans les milieux qu'il a contaminés plus d'un siècle après son interdiction. L'insertion de ces pesticides dans les chaînes alimentaires n'est plus à démontrer et concerne en dernière analyse l'homme, qui est situé au sommet de la pyramide écologique.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- François RAMADE : professeur émérite d'écologie à la faculté des sciences d'Orsay, université de Paris-Sud-Orsay
Classification
Médias
Autres références
-
SEVESO ACCIDENT CHIMIQUE DE (10 juillet 1976)
- Écrit par Yves GAUTIER
- 375 mots
- 1 média
Le 10 juillet 1976, des vapeurs toxiques de dioxine – précisément de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-para-dioxine, cancérigène et tératogène même à faible dose – s'échappent d'un réacteur chimique produisant du chlorophénol de l'usine Icmesa (filiale de Givaudan), près de Milan (Italie). Ce produit,...
-
AÉRONOMIE
- Écrit par Gaston KOCKARTS
- 4 158 mots
- 11 médias
...rayonnement cosmique corpusculaire avec l'atmosphère ; ceux du troisième cycle sont essentiellement d'origine anthropogénique (dus aux activités humaines). En effet, les chlorofluorocarbures (CFC), utilisés massivement comme gaz réfrigérants, ou comme gaz propulseur dans les aérosols ont libéré des composés... -
AÉROPORTS
- Écrit par Jean-Yves VALIN
- 6 574 mots
- 7 médias
...les stations de mesure de la qualité de l'air ambiant implantées sur les aéroports et dans leur voisinage permettent de suivre les concentrations des « marqueurs » habituels de pollution – ozone, oxydes d'azote, hydrocarbures imbrûlés –, généralement inférieures aux teneurs habituellement... -
AGRICULTURE - Histoire des agricultures depuis le XXe siècle
- Écrit par Marcel MAZOYER et Laurence ROUDART
- 9 999 mots
- 2 médias
Dans les pays développés,les pollutions environnementales ou alimentaires dues à l'usage abusif d'engrais minéraux, de produits de traitement des plantes ou des animaux, ou à de trop fortes concentrations d'animaux dans des ateliers de production hors-sol, sont devenues manifestes à partir des années... - Afficher les 154 références
Voir aussi
- CONTAMINATION
- ANHYDRIDE SULFUREUX ou DIOXYDE DE SOUFRE
- TOXICITÉ
- NAPPE PHRÉATIQUE
- OZONE
- ORGANOCHLORÉS COMPOSÉS
- BRUIT
- ACCIDENTS
- REFROIDISSEMENT, technologie
- DYSTROPHISATION, écologie
- DÉCHARGE DE DÉCHETS
- ÉGOUT
- ÉPURATION DES EAUX
- INCINÉRATION DES DÉCHETS ET ORDURES
- ORDURES MÉNAGÈRES
- INDUSTRIELLE SOCIÉTÉ
- STOCKAGE
- LOMBRIC ou VER DE TERRE
- OLIGOCHÈTES
- RÉACTEUR À EAU PRESSURISÉE (REP) ou PWR (pressurised water reactor)
- RADIOÉLÉMENTS ou RADIONUCLÉIDES ou ISOTOPES RADIOACTIFS
- IRRADIATION
- CONCENTRATION ou ACCUMULATION, écotoxicologie
- VITRIFICATION, génie nucléaire
- CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES
- DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGÈNE (DBO)
- INSECTICIDES
- EAU, agriculture
- CHIMIQUES SUBSTANCES, écotoxicologie
- AGGLOMÉRATION
- CIRCULATION ATMOSPHÉRIQUE GÉNÉRALE
- GISEMENTS MÉTALLIFÈRES
- TROPOSPHÈRE & TROPOPAUSE
- STRATOSPHÈRE & STRATOPAUSE
- ESSAIS NUCLÉAIRES
- COMBUSTIBLES
- EAU CYCLE DE L' ou CYCLE HYDROLOGIQUE
- EAUX CONTINENTALES
- RISQUES ALIMENTAIRES
- LAMINAIRE
- CATASTROPHES NATURELLES
- VÉGÉTALE BIOLOGIE
- COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE
- SELS MINÉRAUX
- CHIMIQUES INDUSTRIES
- PÉRIODE ou DEMI-VIE, radioactivité
- CHLORURE DE SODIUM
- ÉNERGIE NUCLÉAIRE
- DDT (dichloro-diphényl trichloréthane)
- PHYTOPLANCTON
- ZOOPLANCTON
- BIODÉGRADABILITÉ
- DOSE, radiobiologie
- NUISANCES
- pH
- PHOSPHATES
- SMOG
- FUMÉES
- OXYDES D'AZOTE
- EAUX USÉES
- EAU DE MER
- CARBONE CYCLE DU
- FOS-SUR-MER
- POUSSIÈRES
- RÉACTEUR NUCLÉAIRE EPR (European Pressurized Reactor)
- CHANGEMENT CLIMATIQUE
- MARINE BIOLOGIE
- STOCKAGE GÉOLOGIQUE DES DÉCHETS NUCLÉAIRES
- MONTRÉAL PROTOCOLE DE (1987)
- RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
- POLYCHLOROBIPHÉNYLS (PCB) ou BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS
- URBANISATION
- PEROXYACYLNITRATES
- RESPIRATOIRE PATHOLOGIE
- ENVIRONNEMENT, droit et politique
- FRANCE, droit et institutions
- ÉNERGIE ÉCONOMIE DE L'
- INDICATEURS BIOLOGIQUES
- BIODISPONIBILITÉ
- AÉROSOLS
- EFFET DE SERRE
- CENTRALE NUCLÉAIRE
- RETRAITEMENT, génie nucléaire
- RÉACTEUR NUCLÉAIRE
- ACCIDENTS NUCLÉAIRES
- ARCTIQUE RÉGION
- FLUORURES
- NITRATES
- ANTHROPISATION
- AQUATIQUE VIE
- NUCLÉAIRE INDUSTRIE
- TRANSPORT & TRAFIC MARITIMES
- RÉSEAUX TROPHIQUES ou CHAÎNES ALIMENTAIRES, écologie
- GAZ D'ÉCHAPPEMENT
- MONOXYDE DE CARBONE ou OXYDE DE CARBONE (CO)
- PLUIES ACIDES
- DULÇAQUICOLES MILIEUX
- PÉTROLIER
- FISSION PRODUITS DE
- DÉCHETS RADIOACTIFS ou DÉCHETS NUCLÉAIRES
- NUCLÉAIRE POLLUTION
- PAYSAGES, environnement
- TCHERNOBYL
- HADLEY CELLULE DE
- ÉNERGIE PRODUCTION D'
- CHLOROFLUOROCARBURES (CFC)
- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE
- ÉCOSPHÈRE
- RISQUES TECHNOLOGIQUES
- ÉNERGIE FOSSILE ou COMBUSTIBLES FOSSILES
- DÉPÉRISSEMENT DES FORÊTS
- ALUMINE (oxyde d'aluminium)
- POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ou POLLUTION DE L'AIR
- TRIBUTYLÉTAIN