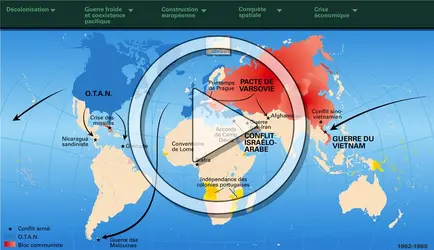- 1. Années de formation et de survie (fin 1917-1921)
- 2. La parenthèse de la NEP (1921-1929)
- 3. Les années 1930, une décennie décisive
- 4. Le « second stalinisme » : de la guerre à la mort de Staline (1941-1953)
- 5. Les années Khrouchtchev (1953-1964)
- 6. L'obsession de la stabilité (1965-1985)
- 7. De la perestroïka à la fin de l'URSS (1985-1991)
- 8. Bibliographie
U.R.S.S. Histoire
Article modifié le
De la perestroïka à la fin de l'URSS (1985-1991)
L'élection de Mikhaïl Gorbatchev, le 11 mars 1985, au poste de secrétaire général du PCUS, ouvre la dernière phase de la période soviétique de l'histoire russe, une phase de six ans au cours de laquelle, de réforme en réforme, d'emballement en emballement, le projet gorbatchévien originel, qui n'avait pour but que de rendre plus efficient le système soviétique existant, débouche sur l'implosion de l'URSS.
Les premiers choix de Gorbatchev, durant toute l'année 1985, ne semblent pas constituer une rupture radicale avec le passé. Néanmoins, dès le début de 1986, l'évolution s'accélère, avec la mise en avant de deux mots d'ordre : glasnost et perestroïka. La glasnost, c'est-à-dire la transparence, le fait de rendre public ce qui était jusque-là caché, et la perestroïka, c'est-à-dire la restructuration du système, n'ont aucunement pour but de torpiller le socialisme, mais de le rendre plus performant. Néanmoins, une fois le mouvement lancé, il devient très difficile de le canaliser. Censée révéler les insuffisances du socialisme, la glasnost se porte d'emblée au cœur même des instances de légitimation du pouvoir du Parti communiste : l'histoire et, à l'intérieur du champ historique, la question clé du stalinisme. La libération de la parole suscite inévitablement débats et résistances, débordements et effets pervers. L'interrogation sur le stalinisme entraîne celle sur ses sources, le léninisme. La remise en cause se développe bientôt sur les terrains les plus divers : l'écologie, l'histoire, l'idéologie officielle, la politique des nationalités. Les revendications nationales se multiplient : l'anniversaire de la signature du pacte germano-soviétique, dont le protocole secret est évoqué pour la première fois en 1987, provoque des manifestations de masse dans les trois républiques Baltes annexées en 1940. Ces manifestations sont le point de départ d'un processus qui conduit, trois ans plus tard, à la proclamation d'indépendance des pays Baltes.
Le pluralisme des opinions engendré par la glasnost pose rapidement le problème fondamental de leur expression politique, donc du pluralisme politique, terme inéluctable de tout processus de démocratisation. Mais Gorbatchev et son équipe refusent de s'engager dans cette voie, préférant axer, dans un premier temps, leurs réformes sur l'économie.
Dans ce domaine, toutes les mesures adoptées jusqu'à l'automne 1991 – développement de l'autonomie des entreprises, développement des sphères d'initiative privée (activités de service, commerce, artisanat), possibilité pour les agriculteurs de louer des terres pour une longue durée et de disposer entièrement de la production – sont marquées par une volonté de compromis entre le plan et le marché, entre les exigences d'une efficacité économique et celles d'un assistanat social, par un souci de retarder l'échéance décisive de la réforme des prix et du dégraissage des effectifs pléthoriques des fonctionnaires et du personnel des entreprises d'État.
Durant six années, il n'y a, en réalité, ni plan ni marché. La perestroïka casse les mécanismes de l'économie planifiée mise en place dans les années 1930, mais ne parvient pas à définir clairement de nouvelles règles économiques ni à proposer aux travailleurs de nouvelles motivations. Engluée dans des demi-mesures, la politique économique menée entre 1985 et 1991 ne fait qu'aggraver la crise qui s'était installée au cœur du système depuis le milieu des années 1970, portant à son comble le mécontentement populaire. Incapable d'améliorer les conditions de vie du plus grand nombre, le régime de Mikhaïl Gorbatchev devient de plus en plus impopulaire à l'intérieur du pays.
L'échec des réformes économiques éclipse largement des réformes politiques spectaculaires, mais toujours orientées vers le maintien à tout prix d'un système dirigé par le seul Parti communiste et d'une Union des républiques soviétiques fondée sur la coercition et la méconnaissance des aspirations nationales. Dans les années 1987-1990, de nombreuses réformes politiques et institutionnelles introduisent une petite dose de démocratie au sein de ce système : candidatures multiples, Congrès des députés du peuple élus en partie par un suffrage universel direct. Pour court-circuiter les oppositions de ses adversaires politiques dans les organes dirigeants du parti (notamment au Politburo), Gorbatchev taille à sa mesure une nouvelle fonction de chef de l'exécutif, le poste de président de l'URSS. Élu par le nouveau Congrès des députés du peuple, le président de l'URSS tient sa légitimité, même indirectement, du vote populaire. Au-delà de ces importantes réformes institutionnelles, le fait marquant de la vie politique soviétique des années de la perestroïka est le foisonnement de comités, d'organisations, de groupes, de « fronts populaires », embryons de partis politiques poussés sur le terreau des espaces de micro-autonomie qui s'étaient constitués au cours de la décennie précédente. Cette démocratisation par en bas met en lumière les limites et les contradictions d'une démocratisation partielle mutilée par le refus du pouvoir de mettre en cause le monopole du parti unique. À partir de 1990, la question du pluralisme est ouvertement posée lorsque Boris Eltsine, un des principaux dirigeants du PCUS, quitte le parti avec fracas.
C'est sans doute dans le domaine de la politique extérieure que les changements, dès 1985, sont les plus radicaux. Gorbatchev définit rapidement trois principaux axes pour la diplomatie soviétique, dirigée par Edouard Chevardnadze, qui a remplacé Andreï Gromyko comme ministre des Affaires étrangères : l'atténuation des tensions Est-Ouest par un désarmement négocié avec les États-Unis et par le règlement des conflits régionaux ; l'intensification des échanges économiques ; la reconnaissance du statu quo territorial dans le monde. À l'issue de plusieurs sommets entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, Américains et Soviétiques signent, le 8 décembre 1987, un accord sur le démantèlement des missiles nucléaires à moyenne portée, mettant ainsi fin à une période d'extrême tension. La nouvelle équipe met également fin à l'intervention militaire soviétique en Afghanistan (retrait soviétique unilatéral entre mai 1988 et février 1989). L'URSS normalise ses relations avec la Chine (visite de Gorbatchev à Pékin en mai 1989).
L'assainissement du climat international contraste, notamment à partir de l'été 1990, avec l'accumulation de problèmes intérieurs non résolus : la question du pluralisme politique, celle de l'économie de marché, la révision du pacte fédéral. Étroitement lié à l'introduction de l'économie de marché, ce dernier est censé élargir les droits des républiques. Sur toutes ces questions, les événements vont, en l'espace d'un an, prendre de vitesse législateurs, économistes et politiques. L'élection de Boris Eltsine à la présidence du Parlement de Russie (29 mai 1990) cristallise le conflit entre ce champion des partisans d'une poursuite résolue des réformes et Mikhaïl Gorbatchev, soucieux de sauvegarder les intérêts du centre face aux exigences croissantes d'autonomie, voire d'indépendance des républiques. Durant l'hiver 1990-1991, la tension monte entre Moscou et les pays Baltes, qui désirent proclamer leur indépendance. L'élection au suffrage universel de Boris Eltsine à la présidence de la Fédération de Russie (12 juin 1991) lui donne une nouvelle légitimité face à Gorbatchev. Face à l'accélération des événements qui semblent conduire à l'éclatement de l'URSS, divisée en pouvoirs concurrents, les éléments les plus conservateurs du Parti communiste fomentent un coup d'État, qui échoue au bout de trois jours (19-21 août 1991) face à la détermination et à la résistance de Boris Eltsine, soutenu par la population et par la majeure partie de l'armée.
L'échec du putsch accélère brutalement la désagrégation de l'Union : huit républiques proclament leur indépendance dans les jours qui suivent. Les activités du PCUS sont suspendues, puis interdites. Le comité central est dissous, et Gorbatchev doit démissionner de son poste de secrétaire général du parti désormais interdit. Le KGB est démantelé. Dans les semaines qui suivent, Gorbatchev apparaît comme le président d'une Union qui n'en est plus une. Le 1er décembre 1991, l'Ukraine se prononce, à son tour, pour l'indépendance. Le 8 décembre, les présidents de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie, réunis à Minsk, constatent que l'URSS n'existe plus et décident de former une Communauté des États indépendants (CEI) ouverte à tous les États de l'ex-URSS. Le 21 décembre, au sommet d'Alma-Ata, huit autres républiques rejoignent la CEI, entérinant ainsi la fin de l'URSS Il ne reste plus à Mikhaïl Gorbatchev qu'à mettre fin à ses fonctions de président d'une entité qui a cessé d'exister (25 décembre 1991).
L'année 1991 est ainsi entrée dans l'histoire comme le terme d'une expérience commencée en 1917, institutionnalisée en 1922 par le traité qui créait l'URSS La faillite du système qui avait, depuis sept décennies, soudé l'ex-Empire tsariste, pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Depuis 1991, ce qui se joue dans les pays issus de l'ex-URSS, c'est à la fois l'avenir d'une modernisation inachevée et celui d'une démocratie naissante et fragile.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Nicolas WERTH : directeur de recherche au CNRS
Classification
Médias
Autres références
-
ORIGINE DE LA VIE : L'HYPOTHÈSE OPARINE-HALDANE
- Écrit par Stéphane TIRARD
- 2 541 mots
- 2 médias
...scientifique soviétique porte la marque de sa proximité avec le pouvoir, puisqu’il devient directeur de l’Institut de biochimie de l’Académie des sciences d’URSS en 1946, après avoir participé à son organisation en 1935. Par ailleurs, en tant que secrétaire académicien du département des sciences biologiques...
Voir aussi
- INTELLIGENTSIA
- RUSSIE FÉDÉRATION DE
- WEIMAR RÉPUBLIQUE DE (1919-1933)
- PARTIS COMMUNISTES
- AGRAIRES RÉFORMES
- PAULUS FRIEDRICH VON (1890-1957)
- STALINGRAD BATAILLE DE (sept. 1942-févr. 1943)
- SINO-SOVIÉTIQUES HISTOIRE DES RELATIONS
- AUTOGESTION
- EUROPE DE L'EST
- KOLKHOZ
- COLLECTIVISATION
- AGRAIRE RÉVOLUTION
- PRODUCTIVISME
- CAPITALISME D'ÉTAT
- COEXISTENCE PACIFIQUE
- IMPÉRIALISME & ANTI-IMPÉRIALISME
- DÉPORTATIONS & TRANSFÈREMENTS DE POPULATIONS
- BLOCS POLITIQUE DES
- OUVRIÈRE CLASSE
- ÉPURATION POLITIQUE
- PAYSANNES RÉVOLTES
- FAMINES
- GUERRE CIVILE
- PLANIFICATION, économie
- RÉVOLUTION PERMANENTE
- KOMINTERN ou TROISIÈME INTERNATIONALE ou INTERNATIONALE COMMUNISTE
- DÉMOCRATISATION
- CURZON LIGNE
- RECHERCHE HISTORIQUE
- STALINISME
- BOLCHEVIQUE PARTI
- SOCIALISME VOIES DE PASSAGE AU
- NORMALISATION POLITIQUE DE
- DÉTENTE, politique internationale
- PCUS (Parti communiste d'URSS)
- COMMUNISME DE GUERRE
- UKRAINE, histoire
- NATIONALITÉS POLITIQUE DES
- FRACTIONNISME
- RÉFORME ÉCONOMIQUE
- COMITÉ CENTRAL, partis communistes
- LÉNINISME
- OPPOSITION POLITIQUE
- POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- GUOMINDANG (GMD) ou KUOMINTANG ou KOUO-MIN-TANG (KMT)
- GUERRE ÉCONOMIE DE
- RÉPRESSION
- POLOGNE, histoire, de 1914 à 1945
- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE
- MOSCOU PROCÈS DE
- CEI (Communauté des États indépendants)
- AMÉRICANO-SOVIÉTIQUES RELATIONS
- DISSIDENTS, URSS et Europe de l'Est
- SAMIZDAT, littérature soviétique
- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939
- KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) ou PARTI COMMUNISTE ALLEMAND (1918-1946)
- URSS, vie politique et économique
- URSS, histoire
- POLITIQUE INDUSTRIELLE
- SECTEUR AGRICOLE
- CONSTITUTION SOVIÉTIQUE DE 1924