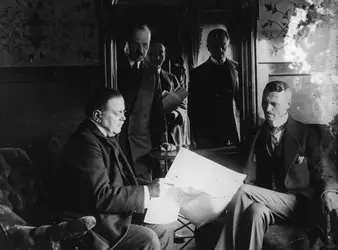ALLEMAGNE (Histoire) Allemagne moderne et contemporaine
Article modifié le
La République de Weimar (1919-1933)
Le traité de Versailles (28 juin 1919), les plébiscites de 1920 et 1921 ont enlevé à l'Allemagne – outre la totalité de son empire colonial – 72 112 km2, ramenant sa superficie de 540 858 à 468 746 km2. Ont été détachés de l'Allemagne sans plébiscite l'Alsace-Lorraine rendue à la France, Eupen et Malmédy donnés à la Belgique, les territoires polonais de Posnanie et de Prusse-Occidentale, le « petit pays de Hultschin » (au sud de la Silésie) cédé à la Tchécoslovaquie, Danzig et Memel érigées en villes libres. En 1920, les plébiscites ont rendu au Danemark le Schleswig du Nord, mais conservé à l'Allemagne la Mazurie, au sud de la Prusse-Orientale. À la suite du plébiscite du 20 mars 1921, les communes polonaises de haute Silésie ont été attribuées à la Pologne. Enfin un plébiscite était prévu dans le territoire de la Sarre pour 1935. Plus frappante encore que ces amputations, apparaît la configuration de la nouvelle Allemagne, où la Prusse-Orientale est séparée du reste du pays par la ville de Danzig et par le « corridor » polonais.
La population
Elle est passée de 57 millions en 1920 à 62,4 en 1925 et à 65 en 1930. Le résultat de la forte poussée démographique d'avant la guerre risque de ne pas se maintenir, car le taux de natalité ne cesse de baisser : 25,9 p. 1 000 en 1920, 21 en 1923, 20,6 en 1925, 18,5 en 1927, 17 en 1930, 15 en 1932. Une telle régression continue – freinée en partie par la diminution de la mortalité infantile – n'est pas sans inquiéter, particulièrement en face d'une Pologne où le taux des naissances atteint 34 p. 1 000. La répartition géographique de la population allemande reste sensiblement la même qu'au temps du IIe Reich, mais la disproportion entre villes et campagnes s'accroît : 64,4 p. 100 d'urbains en 1925 contre seulement 35,6 p. 100 de ruraux. Les villes continuent leur progression : 45 villes de plus de 100 000 habitants en 1925, dont 15 atteignent 300 000, tandis que 7 dépassent le demi-million. Créé en 1920, le Gross Berlin englobe 4 millions d'habitants en 1925, 4,3 en 1930. Cette même année, Hambourg en compte 1 150 000, Cologne 740 000, Munich 730 000, Leipzig 720 000, Dresde 637 000, Breslau 615 000. Les villes de la région industrielle rhéno-westphalienne poursuivent leur croissance : Essen 650 000, Dortmund 535 000, Düsseldorf 465 000, Barmen et Elberfeld, réunis en 1930 sous le nom de Wuppertal, 420 000 ; parmi les ports, Brême 305 000, Stettin 270 000, Königsberg 290 000 ; et, dans l'intérieur : Francfort 550 000, Hanovre 445 000, Nuremberg 415 000, Stuttgart 375 000, Magdebourg 300 000. L'Allemagne tend de plus en plus à être un pays de villes.
La population allemande est plus homogène en 1921 qu'en 1914 ; les amputations subies par l'Allemagne en ont séparé les allogènes. Restent en Prusse-Orientale 41 000 Mazures et 2 700 Lituaniens, en Silésie (il n'y en a plus dans la Ruhr) 150 000 Polonais, de 10 000 à 15 000 Danois dans le Schleswig : ajoutons-y les Wendes ou Sorabes de Lusace au nombre de 33 000 (ils étaient 90 000 en 1871) : ce sont là minorités réduites, en voie d'absorption dans la nation allemande.
Les milieux sociaux
La Première Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne n'ont pas eu les conséquences sociales qu'on aurait pu attendre des crises qui l'ont secouée de 1918 à 1923. Le mouvement spartakiste n'a pas réussi à instaurer la dictature du prolétariat. Les membres des corps francs qui s'étaient battus en Allemagne et dans les pays baltes – ceux qu'Ernst von Salomon a appelés die Geächteten (les hors-la-loi) – se sont peu à peu réadaptés à la vie normale L'inflation démesurée et galopante de 1923 a ruiné une partie de la classe moyenne, mais les effets de cette année catastrophique ont été bientôt effacés par la prospérité qui a suivi.
L'aristocratie a été atteinte par la chute des dynasties et l'instauration du régime républicain dans les États qui composent l'Allemagne de Weimar. Elle a perdu ses emplois dans les cours allemandes, et la limitation de la Reichswehr à 100 000 hommes, dont 4 000 officiers, l'a privée de carrières qu'elle considérait comme lui étant réservées par priorité. Les professions libérales attirent dans une proportion plus forte qu'avant 1914 les membres de la noblesse. Celle-ci a pu se maintenir grâce à sa richesse foncière et mobilière. Les anciennes maisons princières ayant obtenu, en 1926, la restitution intégrale de leurs biens mis sous séquestre au début de la révolution, il ne pouvait être question de limiter la propriété noble. Les grands domaines de l'Allemagne du Nord subsistent donc, et, si les derniers droits seigneuriaux des junkers de Prusse-Orientale disparaissent en 1927, cette mesure ne touche pas au droit de propriété du sol. La crise de 1930 affecta cette catégorie de propriétaires. Lorsque fut créée l'Osthilfe (Assistance de l'Est) pour venir en aide à toute l'Allemagne transelbienne, les junkers furent accusés d'avoir accaparé la majeure partie des secours distribués. La divulgation de ces faits incita Hindenburg à renvoyer Schleicher, le 28 janvier 1933, ouvrant ainsi à Hitler les portes de la chancellerie.
Dans l'histoire de la paysannerie allemande, les années 1918-1933 ne sont pas une période caractéristique. On a noté l'accentuation de l'exode rural, qui réduit à un tiers de la population du Reich celle des campagnes. L'inflation a moins touché les paysans que les autres milieux sociaux, car ils sont habitués à vivre en économie fermée et disposent des ressources alimentaires essentielles. Comme tous les Allemands, ils profitent de la prospérité des années 1925-1929. La crise de 1930 les affecte par la baisse des prix agricoles ; cependant la gêne qu'elle provoque n'est pas comparable au désarroi que cause la montée continue du chômage. La situation des paysans allemands n'a pas joué de rôle déterminant dans l'avènement du national-socialisme.
Il n'en est pas de même de la classe moyenne. L'histoire de la République de Weimar peut être étudiée à travers ses velléités, ses réticences et, finalement, son impuissance à faire vivre un régime issu de la défaite. En 1922-1923, l'inflation a ruiné les rentiers et mis en difficulté les petits et moyens industriels. Mais le retour au calme et à la prospérité, à partir de 1924, profite à tous, aux industriels et aux commerçants qui bénéficient de l'essor des affaires comme aux fonctionnaires et aux membres des professions libérales rassurés par une monnaie stable. Mais, en 1930, le marasme économique va avoir sur la majeure partie de la bourgeoisie une influence décisive. Le trouble et l'incertitude où se débat l'Allemagne la poussent vers le national-socialisme, seul capable à ses yeux de faire sortir l'Allemagne d'une situation désespérée.
La République de Weimar – dans les années du moins où elle a semblé se consolider – a été favorable aux ouvriers. Leur condition s'améliore, avec une tendance au nivellement par le haut. Les salaires augmentent d'une façon constante jusqu'en 1931. La journée de huit heures est accordée en 1919 et, sous l'effet de la crise économique, on s'orientait vers la semaine de quarante heures lorsque la démission du chancelier Brüning (mai 1932) amena l'abandon du projet. Aux assurances sociales des années quatre-vingt s'ajoute, en 1927, l'assurance-chômage. Cette amélioration est due à deux facteurs. D'une part, la Constitution de Weimar, en reconnaissant les syndicats, en leur accordant le droit de traiter avec les employeurs sur un pied d'égalité, avait prévu toute une hiérarchie de conseils ouvriers. Seuls, ceux d'entreprise (Betriebsräte) ont été organisés par une loi de 1920. S'ils ne participent guère à l'organisation et à la gestion de la production, ils ont cependant un rôle non négligeable dans la surveillance des conventions collectives et des arrêtés de conciliation. D'autre part, sous l'action de dirigeants tels que Fritz Tarnow et Theodor Leipart, les syndicats libres, c'est-à-dire socialistes, s'efforcent de « socialiser le capitalisme », sans pour autant recourir aux mesures de socialisation. Fort de 4 millions et demi de membres environ (parmi lesquels il faut d'ailleurs compter les travailleurs agricoles, les fonctionnaires et les employés), ils inspirent la plupart des mesures sociales prises pendant ces années. Les conseils d'entreprise sont, en fait, le prolongement des syndicats. Ceux-ci créent des banques ouvrières et, sans qu'il y ait subordination, travaillent en liaison avec les coopératives de consommation. Après deux périodes difficiles où augmente le chômage (1920, 1924-1925), l'essor de l'économie allemande ne peut manquer d'avoir sur la condition ouvrière des répercussions favorables. Mais la crise économique mondiale de 1929 ne tarde pas à se faire sentir dans le domaine de l'emploi. De 500 000 en 1927, le nombre des chômeurs passe à 2 300 000 au cours de l'hiver de 1929-1930, 4 millions à la fin de 1930, 5 en février 1931, 5,6 au début de 1932, 6 millions en janvier 1933 : situation qui n'a certes pas été sans influer sur les progrès du mouvement nazi de 1930 à 1933.
Une économie « américaine »
Pendant les quinze années qui séparent la disparition du IIe Reich de l'avènement du IIIe, l'économie allemande voit alterner les crises et les périodes de prospérité. Crise de l'après-guerre, que caractérise l'effondrement du mark, bien plutôt qu'une baisse de la production : si celle de charbon tombe de 120 Mt en 1922 à 62 en 1923 pour remonter à 120 en 1924, c'est en raison de la grève politique déclenchée par l'occupation de la Ruhr. Qu'elle soit due ou non au « fardeau » des réparations, fixées le 6 mai 1921 à 132 milliards de marks-or, la chute du mark est vertigineuse. Le dollar qui s'échangeait contre 4 marks en 1914 en vaut 75 en juillet 1921, 186 en janvier 1922, 402 en juillet, 6 000 à la fin de l'année, 7 200 en janvier 1923, 160 000 en juillet, plus d'un million en août, 13 millions en septembre, 242 en octobre, 130 milliards en novembre, plus de 4 trillions en décembre. L'inflation de 1923 a laissé dans la mémoire des Allemands un souvenir plus terrible que la défaite de 1918. Impuissant à arrêter cette débâcle, le gouvernement préfère créer, en octobre 1923, une monnaie provisoire, le Rentenmark, garantie par une hypothèque générale sur l'agriculture, l'industrie et le commerce allemands. L'adoption, en 1924, du plan Dawes – solution d'attente au problème des réparations – permet à l'Allemagne de lancer un emprunt de 800 millions de marks-or et de créer une nouvelle devise, le Reichsmark (RM), sur la base de 4,20 RM pour un dollar. Annulation des billets de banque antérieurs, échange des titres d'emprunt dépréciés de 87 à 97 p. 100 : la réforme ruine les rentiers et les épargnants. Du moins est-elle à l'origine d'une période de prospérité. Pas immédiatement toutefois : faillites et chômage suivent la stabilisation, le point culminant de la crise se situant aux deux premiers mois de 1926. Mais, dès le mois d'août, le mark est libéré de la subordination au dollar ; l'or afflue. Les capitaux étrangers investis en Allemagne depuis la fin de 1924 jusqu'en juin 1927 se montent à 4 milliards de Reichsmark, dont 70 p. 100 proviennent des États-Unis. Le gouvernement du Reich emprunte, pendant la même période, quelque 10 milliards de Reichsmark. Les traces de la guerre et de la défaite paraissent effacées, et on pense avoir retrouvé la prospérité d'avant 1914. C'est dans cette Allemagne de 1925 à 1929 qu'on peut étudier la structure économique du régime weimarien.
Les forces productives sont restées les mêmes qu'au début du siècle. Le seigle se maintient autour de 67 millions de quintaux, l'avoine de 60, le blé de 30 seulement, la pomme de terre de 350, la betterave au-dessus de 100 (moyennes annuelles). C'est là une agriculture perfectionnée, stimulée par l'augmentation de la population urbaine, mais qui ne tient dans la vie du pays qu'un rôle subordonné.
De plus en plus, en effet, c'est la puissance industrielle qui caractérise l'Allemagne. Le sous-sol est exploité à plein : en 1929, on extrait 162 Mt de houille (dont 123 du bassin de la Ruhr) et 175 Mt de lignite. Le pétrole fait son apparition en Allemagne du Nord ; nulle en 1920, sa production atteint 100 000 tonnes en 1926, le double en 1930. On notera les progrès de la sidérurgie : 13 Mt de fonte, 16 Mt d'acier, malgré la perte de la haute Silésie. Mais c'est l' industrie chimique qui connaît le développement le plus remarquable : son relèvement rapide, après la guerre, s'accompagne d'une transformation et d'une adaptation aux circonstances, car il faut lutter contre la concurrence des autres pays qui se sont équipés pendant les hostilités. Fondée, avant 1914, sur les colorants, les engrais et les produits pharmaceutiques, l'industrie chimique s'oriente de plus en plus vers la production de l'azote et des engrais synthétiques, de l'essence synthétique et de la soie artificielle, vers l'électrochimie.
L'essor de la circulation et des échanges n'est pas moindre que celui de la production. Aux routes, aux canaux, aux voies ferrées s'ajoutent maintenant les transports aériens groupés dans la Lufthansa (1926). La flotte marchande, réduite à 300 000 tonneaux en 1920 par le traité de Versailles, remonte en 1930 à 4 300 000, chiffre inférieur, toutefois, à celui d'avant la guerre. Les deux grands ports retrouvent ou dépassent leur mouvement de 1913 (Hambourg 17 Mt, Brême 5,3 Mt). Le commerce extérieur dépasse le chiffre de 1913 et atteint 27 milliards de marks, dont 15 aux importations, 12 aux exportations.
Mais plus encore que les niveaux, ce sont les méthodes et les structures de l'économie qui caractérisent l'Allemagne weimarienne. L'Allemagne « s'américanise », notent les observateurs ; c'est l'ère de la rationalisation, du travail à la chaîne, de la standardisation, de la concentration. Celle-ci se fait sentir surtout dans les entreprises de navigation et dans l'industrie chimique : en 1925 est fondée à Francfort l'I.G. Farben, énorme Konzern réunissant plusieurs centaines d'entreprises groupées autour de la Badische Anilin de Ludwigshafen.
L'économie allemande donnait, en 1929, une impression de force retrouvée et semblait appelée à développer encore sa puissance. En fait, cette apparente prospérité cachait une situation assez malsaine : inflation de crédit, surcapitalisation, ampleur excessive de grands travaux qui déséquilibrent le budget. Le krach boursier d'octobre 1929, aux États-Unis, arrête les crédits américains qui alimentaient l'industrie allemande. Les usines ralentissent ou cessent leur production : l'extraction du charbon baisse à 105 Mt en 1932, celle du lignite à 125 ; la sidérurgie tombe à 4 Mt de fonte et 6 d'acier. En mai 1931, la déconfiture du Kreditanstalt viennois entraîne celle des banques allemandes (la Darmstädter Bank ferme ses guichets le 13 juillet). Les capitalistes américains vendent leurs valeurs allemandes et les devises étrangères désertent. 1931 et 1932 sont des années de marasme économique marquées par le ralentissement de la production, l'effondrement des prix, le chômage. Les conditions économiques et psychologiques sont réunies pour favoriser la montée du national-socialisme et son triomphe en 1933.
Sous le signe de la défaite
En dépit des espoirs qu'avaient fait naître, dans toute l'Europe, les années de stabilisation relative (1925-1929), jamais la République de Weimar n'a été vraiment acceptée de la majorité du peuple allemand. L'attitude la plus répandue est celle du refus : refus de la défaite, refus du régime, refus, chez certains, de sa structure capitaliste.
La défaite de 1918 marque non seulement Weimar, mais le IIIe Reich, qui est essentiellement une protestation contre les conditions imposées par les vainqueurs. S'il y a un sentiment qui puisse faire la quasi-unanimité des Allemands, c'est bien le refus du Diktat de Versailles, des clauses dures, et surtout inégales, qu'il a fallu signer sans pouvoir les discuter. Il s'agit avant tout des nouvelles frontières qui consacrent la mutilation du territoire : en signant les accords de Locarno (1925), l'Allemagne a bien reconnu ses frontières occidentales, mais elle s'est toujours refusée à faire de même pour ses frontières orientales, et l'hostilité envers la Pologne est une des constantes de sa politique. Sont également en question les clauses militaires (désarmement, limitation de la Reichswehr à 100 000 hommes) et les réparations fondées sur le « mensonge » de la responsabilité allemande. La « politique d'exécution » d' Erzberger et de Rathenau en 1921-1922, celle de Gustav Stresemann, à la Wilhelmstrasse de 1923 à 1929, sont simple expédient, tactique destinée à inspirer confiance et à obtenir, peu à peu, la destruction du traité de Versailles. Ce refus de la défaite et de ses conséquences est d'autant plus catégorique que la légende du « coup de poignard dans le dos » est, pour la plupart des Allemands, une vérité : l'armée n'a pas été vaincue, le front n'a pas cédé ; c'est l'arrière qui a été miné par les spartakistes et leur propagande défaitiste. D'où le succès des associations patriotiques comme le Stahlhelm (Casque d'acier), d'où l'espoir d'une revanche qui effacera la honte de la défaite et du traité qui la sanctionne. Invictis victi victuri : la fière devise trouvée par Ulrich von Wilamowitz-Mœllendorf pour le monument aux morts de l'université de Berlin exprime les sentiments profonds de la majorité du peuple allemand. On ne saurait exagérer l'importance de ce courant nationaliste, le plus fort sans doute de ceux qui ont agité l'Allemagne après 1918.
La république et la démocratie sont filles de la défaite : aussi sont-elles englobées dans le discrédit qui frappe tout ce qui touche à cette sombre époque. La fête nationale du 11 août, anniversaire de la Constitution de 1919, ne donne lieu qu'à des cérémonies officielles et discrètes. Le drapeau noir, rouge et or – celui de 1848 – ne parvient pas à supplanter, dans l'esprit des Allemands, les couleurs impériales noir-blanc-rouge. Est-ce à dire qu'une restauration de la monarchie menace de supprimer la république ? Au niveau de l'Empire, il ne le semble pas : la fuite en Hollande n'a pas rehaussé le prestige de Guillaume II, et son fils – l'ex-Kronprinz – n'est guère populaire. La Prusse s'est d'ailleurs donné un gouvernement socialiste. L'attachement serait plus grand envers les dynasties saxonne et bavaroise, mais dans une aire territoriale limitée. Tous comptes faits, les chances d'une restauration sont moins grandes qu'on ne le pensait à l'étranger.
Ce qui domine, c'est un esprit conservateur, et même réactionnaire, qui s'accommoderait de la république, à condition qu'elle ne soit pas dirigée par des républicains : esprit fait d'hostilité à la démocratie, de mépris du socialisme, de peur du bolchevisme, d'antisémitisme. Ce qui fait la popularité du maréchal Hindenburg, ce qui a assuré en 1925 son élection à la présidence de la République, c'est qu'on a vu en lui, beaucoup plus que le Monk qu'il n'a sans doute jamais songé à être, le garant des traditions contre les doctrines néfastes à la grandeur et à l'existence même de la patrie.
Les oppositions
La « révolution » de 1918 n'a pas bouleversé les structures sociales de l'Allemagne wilhelminienne : la tentative des spartakistes a échoué, et la République de Weimar est demeurée un État capitaliste. Pourtant, deux mouvements politiques se proclament anticapitalistes.
La Sozial-Demokratie a repris en 1925, au congrès de Heidelberg, le programme d'Erfurt de 1891 ; mais ce qui était inspiration marxiste n'est plus que vocabulaire et phraséologie. La véritable doctrine du Sozial demokratische Partei Deutschland (S.P.D., Parti social-démocrate allemand) est donnée par Hilferding au congrès de Kiel (1927) : État et économie s'interpénètrent ; un État démocratique influencera l'économie dans un sens démocratique ; or une économie dirigée par un État démocratique, c'est le socialisme. Il n'est plus question de dictature du prolétariat. Aussi bien, la social-démocratie est-elle devenue un parti de gouvernement : elle détient le pouvoir dans les Länder de Bade, de Hesse, de Prusse, à Hambourg et à Berlin. Sur le plan fédéral, le parti est représenté au Reichstag par une importante fraction : 163 députés en 1919, 131 en décembre 1924, 152 en 1928, 143 en 1930. Il participe aux gouvernements de coalition ou leur accorde son soutien ; en 1928, c'est un socialiste, Hermann Müller, qui devient chancelier du Reich. Dans le pays, le S.P.D. compte environ un million de membres, contrôle les syndicats et les coopératives, inspire de nombreuses associations. Mais il est bien évident que toute volonté révolutionnaire l'a abandonné.
C'est dans le parti communiste ( K.P.D.), fondé en décembre 1918, qu'il faut chercher cette volonté. Puissant en 1923 grâce, en particulier, à l'entrée d'une partie des socialistes indépendants, le K.P.D. décline, à partir de 1925, sous la direction de Thälmann, étroitement soumis à l'autorité de Moscou. Les communistes allemands, intransigeants sur la doctrine, pratiquent la politique du pire, contribuant à faire élire Hindenburg contre le catholique W. Marx, dirigeant leurs attaques les plus dures contre les socialistes, se tenant aux côtés des nazis lors de la grève des transports berlinois, en novembre 1932. Au Reichstag, ils sont 76 en septembre 1930, 89 en juillet 1932, 100 en novembre 1932, 81 encore en mars 1933. Disposant de formations de combat (Antifa, groupes d'auto-protection), ils représentent, dans la République de Weimar finissante, une force qui a contribué à affaiblir le régime et profité, en définitive, aux nationaux-socialistes.
Hostilité au traité de Versailles, à la République de Weimar, à la démocratie bourgeoise, au grand capitalisme, tout cela se retrouve, mêlé à bien d'autres tendances, dans l'idéologie nationale-socialiste. Le Parti ouvrier allemand national-socialiste (N.S.D.A.P.), interdit après l'échec du putsch de novembre 1923, se reconstruit. C'est à Munich, en février 1925, que se place la « seconde fondation » du parti, sous la direction de Hitler récemment libéré. Elle ne va pas sans difficultés, sans heurts entre Hitler et les frères Strasser qui accentuent le caractère socialiste et anticapitaliste du mouvement. Pourtant Hitler réussit à l'emporter ; le docteur Goebbels, qui le rejoint en 1926, entreprend la conquête de Berlin, dépassant ainsi le cadre purement bavarois des débuts. Malgré son échec aux élections de 1928 (12 députés), le parti se développe – 27 000 membres à la fin de 1925, 176 000 quatre ans plus tard – crée des ligues professionnelles et des formations armées. La propagande des nationalistes contre le plan Young, qui remplace le plan Dawes, fait en 1929 connaître à toute l'Allemagne les idées et la personnalité du Führer. Les 107 députés (6 400 000 voix) élus en septembre 1930 révèlent l'ampleur du mouvement et le succès d'une propagande qui va trouver dans la crise économique un appui considérable et qui conduira au triomphe de 1933.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Michel EUDE : maître assistant à la faculté des lettres et sciences humaines de Rouen
- Alfred GROSSER : professeur émérite des Universités, Institut d'études politiques de Paris
Classification
Médias
Autres références
-
ALLEMAGNE - Les institutions
- Écrit par Stéphane SCHOTT
- 4 250 mots
Les institutions de la république fédérale d’Allemagne sont définies par la Loi fondamentale (L.F.), ou Grundgesetz, du 23 mai 1949. Pensé à l’origine comme une Constitution provisoire pour l’Allemagne de l’Ouest, le Grundgesetz s’applique à toute l’Allemagne depuis le 3 octobre 1990....
Voir aussi
- JOSÉPHISME
- CLERGÉ
- ZOLLVEREIN
- JUNKER
- SADOWA BATAILLE DE (1866)
- CONFÉDÉRATIONS GERMANIQUES
- CONFÉDÉRATION DU RHIN
- CENTRE ALLEMAND LE, all. ZENTRUMSPARTEI
- KULTURKAMPF
- WEIMAR RÉPUBLIQUE DE (1919-1933)
- HINDENBURG PAUL VON BENECKENDORFF et VON (1847-1934) maréchal allemand
- REICHSWEHR
- BRÜNING HEINRICH (1885-1970)
- TODT FRITZ (1891-1942)
- LUDENDORFF ERICH (1865-1937)
- ROSENBERG ALFRED (1893-1946)
- RAUSCHNING HERMANN (1897-1982)
- GALEN CLEMENS AUGUST VON (1878-1946)
- DEUXIÈME REICH (1871-1918)
- PARTIS COMMUNISTES
- STRASSER GREGOR (1892-1934)
- STRASSER OTTO (1897-1974)
- CONCENTRATION CAMPS DE
- RÉSISTANCE EN EUROPE (1940-1945)
- RATISBONNE
- DOUANIÈRE POLITIQUE
- INDUSTRIELLE SOCIÉTÉ
- ARISTOCRATIE
- RÉSISTANCE INTÉRIEURE ALLEMANDE
- DARRÉ WALTER (1895-1953)
- IMPÉRIALISME & ANTI-IMPÉRIALISME
- UNITÉ NATIONALE
- ALLEMANDE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE (RDA)
- DÉNAZIFICATION
- MIGRATIONS HISTOIRE DES
- ALLEMAGNE RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D' (RFA), histoire, de 1945 à 1989
- OUVRIÈRE CLASSE
- CHARBON INDUSTRIE DU
- PARTITION POLITIQUE
- PATRIOTISME
- KONZERN
- CHIMIQUES INDUSTRIES
- COMMERCE, histoire
- COMMUNICATION VOIES DE
- ALLEMANDS TERRITOIRES COLONIAUX
- ÉGLISE & ÉTAT
- NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) ou PARTI NATIONAL-SOCIALISTE DES TRAVAILLEURS ALLEMANDS
- ALLEMAGNE, économie
- AUTRICHE, histoire jusqu'en 1945
- POLITIQUE MONÉTAIRE
- PARTI UNIQUE
- SOCIAL-DÉMOCRATIE
- TEMPOREL POUVOIR
- CONCENTRATION ÉCONOMIQUE
- PAYSAN CONDITION DU
- SIDÉRURGIQUE INDUSTRIE
- URBANISATION
- TEXTILES INDUSTRIES
- VILLES LIBRES
- POLOGNE, histoire, de 1764 à 1914
- POLOGNE, histoire, de 1914 à 1945
- ROMANTISME ALLEMAND
- ALLEMANDE LANGUE
- COMMERCE EXTÉRIEUR POLITIQUE DU
- ALLEMAGNE, histoire, du Moyen Âge à 1806
- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945
- REICHSMARK, monnaie
- KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) ou PARTI COMMUNISTE ALLEMAND (1918-1946)
- CONCENTRATION VERTICALE
- CONCENTRATION HORIZONTALE
- UNITÉ MONÉTAIRE
- PROTESTANTISME HISTOIRE DU
- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE