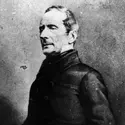LAMARTINE ALPHONSE DE (1790-1869)
Article modifié le
Un seigneur qui se divertit à écrire
Les sévérités sont usuelles sur Lamartine écrivain. Musset l'appelait « pleurard à nacelle » (allusion au Lac) et Flaubert le tenait pour le principal responsable de ce qu'il appelait « les embêtements bleuâtres du lyrisme poitrinaire ». Encore Flaubert, 1836 : « Que c'est mauvais, Jocelyn ! [...] détestable poésie, inane [...] ; ces phrases-là n'ont ni muscles ni sang. » Gustave Planche y découvrait des « buissons de solécismes », et Veuillot, féroce et jubilant, affirme, à propos de l'Épître à Alphonse Karr, que « la rime, le traînant où elle veut, l'accroche dans des asservissements qui feraient rougir un facteur de bouts rimés ». De fait, Lamartine poète s'accorde un excès de « licences » : impropriétés scandaleuses, inversions-contorsions, fautes de grammaire exprès commises pour que le vers ait son compte de syllabes. Sainte-Beuve prenait un air pincé : le génie ne suffit pas, disait-il, « il faut tout de même qu'un soin quelconque aide à l'exécution » ; et Alexandre Vinet, plus indulgent, déplore « ce nonchaloir un peu superbe » auquel il lui semble que l'écrivain, chez Lamartine, se complaît un peu trop.
Oui, Lamartine, comme le dira très bien Rimbaud, est « étranglé par la forme vieille » ; il a fait ses classes, en littérature, auprès des petits poètes du xviiie siècle, Voltaire y compris. Il vit sur leur rhétorique et leur vocabulaire. Les douze ans seulement qu'il a de plus que Victor Hugo n'en font pas moins de lui, par rapport à son jeune rival, un homme du passé. Son dictionnaire est mince, sa langue poétique est de routine. Les mots convenus ne le gênent pas. Mais il est bien certain, également, qu'il ne se donne pas beaucoup de mal, la plume à la main, ou, si l'on préfère, la lyre au doigts. Il se contente de l'à-peu-près. C'est un « honnête homme », un seigneur, qui se divertit à écrire, qui chante ou fredonne, parce qu'il en a envie ; il n'est pas un professionnel, pour rien au monde un professionnel ; il n'est pas du métier et attache du prix à marquer les distances entre les gens de lettres et lui-même. Hugo, qui l'aime bien, lui fait, malgré tout, l'effet d'un tâcheron, car il vit de ses livres, et s'applique, s'applique... Tandis que lui, le châtelain, il écrit « par surcroît » et dédaigne de collaborer à son génie.
Résultat : il agace, bien souvent, et on le sent aussi, parfois, indifférent, avec une espèce d'insolence, à la valeur esthétique de ce qu'il propose. Il affecte de ne point écrire pour vendre, mais dès les Nouvelles Méditations, il fait des calculs : tel nombre de vers promis par lui à l'éditeur, pour telle somme ; additionne ce qu'il a composé et pose une soustraction ; reste tant, qui manque encore ; alors il complète son recueil, vaille que vaille, y fourrant des pièces écartées l'avant-veille, ou des membres épars de ce Saül, refusé par Talma, et qu'il se met à dépecer. Deux fois de suite, et à trois ans de distance, il apparaît en « poète mourant », ce qui lui vaudra des rires et une objurgation indécente. Et c'est bien sa faute s'il se laisse prendre pour je ne sais quel mandoliniste languide, éthéré, gémissant, pour ce « femmelin » que Proudhon, mal perspicace et surtout malveillant, s'obstinera à voir en lui. N'empêche qu'un autre critique, s'imaginant sans doute le griffer, invente pour ses vers, dès 1821, une définition curieuse ; il les appelle des « romances sans paroles ». Trouvaille, cinquante ans plus tard reprise et personnellement adoptée par Verlaine, poète de sa race (mais travailleur et rusé technicien). Lamartine parlera, d'un ton noble, de « respiration de l'âme ». Disons simplement que des rythmes se forment en lui comme à son insu ; il ne les sollicite pas, il les constate et les accueille et les caresse ; une chanson se met à sourdre de son « âme » ; les mots comptent peu ; ce qui l'intéresse et l'enivre, c'est un élan, un mouvement, un vague bercement magique, un soulèvement profond, comme celui de la mer. Avec une préférence instinctive pour les images transparentes, lumineuses, à peine matérielles, à mi-chemin entre la réalité et le rêve, ascendantes et hors du temps.
Il avait voulu bâtir une très grande œuvre, un immense « poème philosophique » qu'il intitulait Les Visions (et Rimbaud, qui n'en savait rien, donnait pourtant à Lamartine le titre de « voyant, quelquefois », qualité suprême, à ses yeux, ou plutôt qualification unique, et irremplaçable, du poète). Jocelyn et La Chute d'un ange sont les vestiges de cette cathédrale ébauchée, La Chute en étant le porche, et Jocelyn le chœur. On n'a pas pris la mesure de Lamartine tant qu'on ignore, chez lui, ce puissant dessein, et tout ce qu'il y voulait mettre d'essentiel. Mais La Chute d'un ange, dans ses chants VIII, XIV et XV (en souvenir de son ancien projet, il nomme « visions » les chapitres de son poème), révèle à plein ce qu'attestaient déjà certains textes antérieurs, si l'on savait les écouter : à sa « lyre », une corde d'airain. Elle résonne dès ses premières Méditations, avec « Le Désespoir » ; la voici dans les secondes, avec « Bonaparte » et plus d'une fois dans Childe Harold et davantage encore dans sa Réponse à Némésis (1831) et dans Les Révolutions, l'année suivante. Que n'a-t-il conservé, pour ce qu'il baptisa Harmonies poétiques et religieuses, le titre auquel il s'était d'abord arrêté : Psaumes modernes ! L'hosanna de l'ensemble, souvent un peu fade, recouvre le cri des Novissima Verba. Lamartine a composé ces vers à l'automne de 1829, au seuil de ses quarante ans, l'âge où, dit Louis-Ferdinand Céline, l'homme commence à sentir qu'« il n'a plus assez de musique en lui pour faire encore danser la vie ». Et l'on connaît trop peu ses stances de 1850, Au comte d'Orsay ; et qui se souvient de ceci – 5 juin 1856 ; il a soixante-six ans – pour Mme Victor Hugo : « Où brûlèrent deux cœurs, il reste un peu de cendre » ?
Même dans ses écrits de la fin misérablement accumulés « pour le pain », des choses que l'on n'oublie plus : ces « profondeurs perpendiculaires » du ciel, dans le Nouveau Voyage en Orient ; et ceci, du Cours familier : « Les années, comme les fantômes de Macbeth, passant leurs mains par-dessus mon épaule, me montrent du doigt non des couronnes, mais un sépulcre » ; « mon cœur bat dans ma poitrine comme une horloge qu'on a oubliée en abandonnant une maison, et qui sonne encore, dans le vide, des heures que personne ne compte plus. »
Si Lamartine renonça, en 1839, à la poésie – du moins ouvertement, mais il lui arrive encore de composer des vers, en secret –, c'est qu'il en connaît trop la part de tricherie ; l'homme qui écrit, surtout lorsqu'il parle de lui-même, « en rajoute » toujours. Et puis, tout cela n'est qu'un simulacre. Chanter n'est pas agir. Dans l'armée humaine, Lamartine veut appartenir à autre chose qu'à la musique régimentaire. Sa place n'est pas « dans la musique », mais « dans le coup ».
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Henri GUILLEMIN : ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé et docteur ès lettres, ancien professeur aux universités du Caire, de Bordeaux, de Lyon et de Genève
Classification
Média
Autres références
-
MÉDITATIONS POÉTIQUES, Alphonse de Lamartine - Fiche de lecture
- Écrit par Yves LECLAIR
- 947 mots
Les Méditations poétiques d'Alphonse de Lamartine (1790-1869) sont publiées le 11 mars 1820, à 500 exemplaires, sans nom d'auteur, avec un « avertissement » liminaire signé E[ugène] G[enoude], chez l'éditeur Charles Nicolle, alors bien connu des cercles catholiques et royalistes. Soigneusement...
-
DEUXIÈME RÉPUBLIQUE
- Écrit par André Jean TUDESQ
- 4 302 mots
- 1 média
Dès l'abdication du roi et l'arrivée de manifestants à la Chambre des députés, l'insurrection devient révolution : dans la confusion, Ledru-Rollin, Lamartine, Dupont de l'Eure, qui étaient députés, repoussent l'éventualité d'une régence et annoncent l'établissement d'un gouvernement provisoire comprenant,... -
RÉCIT DE VOYAGE
- Écrit par Jean ROUDAUT
- 7 129 mots
- 2 médias
...s'accompagne de « lyriques », le voyage de Chapelle et Bachaumont passe de la prose au rythme guilleret de l'octosyllabe. Le vers, dans le Voyage en Orient de Lamartine, est le lieu du murmure, de l'intimité douloureuse, quand la prose est celui du récit public. Dominé par la figure rhétorique de la ... -
FIGURE MODERNE DE SPARTACUS - (repères chronologiques)
- Écrit par Xavier LAPRAY
- 157 mots
1850 Première de la pièce Toussaint-Louverture. Lamartine y utilise le personnage emblématique de Spartacus pour incarner la révolte des esclaves noirs des Antilles.
1916 Publication par les Allemands Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg d'un journal d'extrême gauche intitulé Spartakus...
-
FOYERS DE CULTURE
- Écrit par Gilbert GADOFFRE
- 9 694 mots
- 5 médias
...domaine revient à la fin des troubles, et du non moins pieux Mathieu de Montmorency, on y fait des retraites spirituelles très fréquentées. C'est là que Lamartine a passé la semaine sainte de 1819, qu'il a écrit l'une de ses Méditations et puisé l'inspiration religieuse d'une partie de son... - Afficher les 10 références
Voir aussi