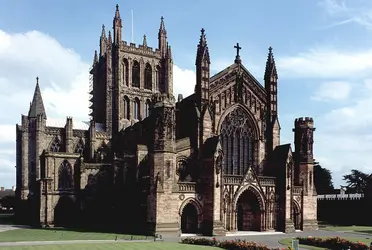- 1. La Renaissance : vitalité, fantaisie et élégance (1530-1625)
- 2. Inigo Jones et sir Christopher Wren : l'affirmation d'un style national sous les Stuart (1603-1714)
- 3. Brièveté et originalité de la phase baroque
- 4. La suprématie palladienne (1710-1760)
- 5. Néo-classicisme et mouvement pittoresque : le syncrétisme comme langage (1750-1820)
- 6. Renaissance hellénique et néo-gothique : les « revivals » victoriens
- 7. Bibliographie
ANGLAIS (ART ET CULTURE) Architecture
Article modifié le
L'architecture anglaise reste étrangement méconnue en France. Or le développement de cet art au cours des quatre siècles qui vont de la Renaissance à l'orée des temps contemporains, de l'avènement d'Élisabeth Ire à la mort de Victoria, prouve qu'à côté de l'Italie et de la France l'Angleterre fut une des terres les plus fécondes en grands praticiens et en monuments de premier plan. Il reste que l'extrême originalité des formes et des partis qu'elle mit en œuvre, alliée à de nombreux traits historiques spécifiques, peut en partie expliquer cette attitude, sorte de contournement d'un monde dont on ignorerait les clefs de lecture. Pourtant, de nombreux historiens britanniques ont depuis longtemps entrepris de brosser le tableau érudit et animé de leur paysage architectural ; il suffit de citer N. Pevsner, H. R. Hitchcock, J. Summerson et, plus récemment, le groupe de chercheurs réunis autour du Royal Institute of British Architects et de ses riches collections graphiques. Mais leur démarche, prise à l'intérieur d'une culture qui leur est familière, ne met pas toujours en perspective une production singulière, parfois paradoxale et qui, par exemple, échappe en partie à l'analyse stylistique traditionnelle plus ou moins valide pour les autres pays d'Europe. Très réceptive à certaines influences venues du continent, passionnée de culture classique et méditerranéenne, l'Angleterre a pu aussi manifester d'étranges résistances à d'autres mouvements de l'histoire du goût. Curieux phénomène que ce palladianisme, qui se confond presque avec la révélation du système classique des ordres, et qui devait à travers toute une lignée d'architectes devenir un des traits dominants de l'imaginaire anglais. Tout comme cette permanence du riche substrat gothique qui ne cessera à aucun moment d'inspirer les architectes jusqu'au revival du xixe siècle. Le terme même de revival dépasse d'ailleurs largement la signification de notre terne préfixe « néo- » par tout ce qu'il sous-entend de « retour à la vie », de « remise en vigueur » d'un système morphologique pris dans son intégrité. Étonnant encore ce court et éblouissant interlude baroque, resté sans équivalent. Or l'historiographie a préféré une périodisation correspondant aux règnes et aux dynasties : styles Tudor, élisabéthain, jacobéen ou encore victorien. Simple commodité lexicale qui ne correspond aucunement à une quelconque mainmise du pouvoir royal, tout au plus s'agit-il de quelques apports extérieurs rappelant les liens originels entre les nouveaux souverains et les Pays-Bas ou les principautés allemandes. En effet, jamais en Angleterre la production architecturale ne fut soumise à un encadrement institutionnel et centralisateur, comme ce fut le cas pour la France. Aucune structure académique, aucun enseignement officiel ne sont venus corseter la profession, qui ne se dotera d'une véritable organisation que dans la seconde moitié du xixe siècle. Seul le Royal Office of Works organise, gère et distribue la commande publique. Cette absence de doctrine officielle, que l'on songe au rôle de François Blondel ou encore à la toute puissante École des beaux-arts pour le domaine français, laisse le champ libre aux initiatives privées, au foisonnement des pratiques et favorise par là même une grande diversité d'options formelles et esthétiques auxquelles viennent s'identifier certaines sensibilités politiques, voire certains courants idéologiques. D'autres constantes géographiques, culturelles, sociales ou économiques achèvent de conférer à l'architecture anglaise des caractères fortement originaux. Ainsi en est-il du dialogue permanent qu'entretiennent l'architecture et la nature. Que l'on songe à ce type essentiel dans son extrême diversité : la country house, ni château, ni maison de campagne, mais élément organisateur du paysage même ; ou encore à « l'invention » du jardin irrégulier et au renouveau des cottages. Terre d'équivoques, l'Angleterre, pionnière du capitalisme industriel, a aussi connu les slums, ces tristes quartiers ouvriers, avant d'imaginer les « cités-jardins » et les « villes-satellites ». Il faut enfin signaler la figure du « gentleman-architecte », personnage dont la culture et les compétences font un rival direct de l'architecte professionnel. Sans oublier ce goût du « beau métier » (craft), du détail bien exécuté, du luxe et du confort, qui explique que presque tous les architectes anglais ont aussi su se montrer d'admirables décorateurs.
La Renaissance : vitalité, fantaisie et élégance (1530-1625)
On peut faire remonter la forte caractérisation stylistique de l'architecture anglaise au Moyen Âge et plus particulièrement à l'apogée du gothique. L'influence de la France avait été déterminante mais très vite les maîtres d'œuvre anglais établirent un style très particulier, dominé par une nette préférence pour les lignes horizontales. Au cours du xive siècle, à Wells, à Gloucester, se mettent peu à peu en place les composantes de ce que l'on appelle le « style perpendiculaire ». Cette forme du gothique, géométrique, transparente, bien articulée, marque une sorte de rupture, une inversion méditée des vides et des pleins, puisque c'est le réseau des fenêtres qui sert à définir l'architecture. Cette affirmation structurale va de pair avec le decorated style qui se manifeste dans la virtuosité des voûtes où le système des nervures devient pur jeu graphique. Ce rappel est indispensable pour comprendre le développement de l'architecture civile à la Renaissance. En effet, la Réforme a pour conséquence directe de mettre un terme aux grands programmes d'architecture religieuse, tandis que la rupture de la monarchie anglaise avec Rome rend plus difficile la pénétration des modèles italiens. En même temps l'ascension d'une classe dirigeante, récemment enrichie et promue au rang d'aristocratie, amène une véritable fièvre de construction, la maison devenant un indispensable instrument de prestige social.
La période Tudor qui correspond aux dernières années du règne de Henry VIII s'ouvre avec la construction du palais d'Hampton Court que le cardinal Volsey devait céder au roi en 1529. Si le plan reste inspiré des fondations monastiques et la structure purement gothique, on a cependant cherché à intégrer des ornements à l'italienne (têtes d'empereurs romains en médaillon, putti). La principale entreprise architecturale de Henry VIII fut la construction du château de Nonsuch, aujourd'hui disparu. Cette fantaisie architecturale, destinée à rivaliser avec Chambord, devait apparaître, avec son décor luxueux et fantastique, comme le « rêve monstrueux d'un truculent parvenu ». Si la reine Élisabeth Ire ne s'intéressa pas elle-même à la bâtisse, elle encouragea les extravagances financières de ses ministres et de ses courtisans. Mais ce gaspillage ostentatoire n'était en fait qu'une prodigalité calculée dans la mesure où il s'agissait d'obtenir des faveurs lucratives dispensées par la Couronne. La reine organisait ainsi des sortes de « tournées », allant de château en château, de fête en fête. L'architecture élisabéthaine (1547-1603) se situe à la jonction de trois grandes sources : la première Renaissance italienne, le style de la Loire en France et une forte influence flamande. Si cette dernière se manifesta par de véritables pastiches – sir Thomas Gresham copia la maison de la Hanse d'Anvers dans sa Bourse royale de Londres (1566-1570) – elle fut surtout sensible dans l'ornementation. Les livres gravés, les planches de Wendel Dietterlin et de Hans Vredeman De Vries diffusèrent ces éléments caractéristiques du maniérisme nordique, ces « cuirs » découpés (strapwork) qui marquèrent durablement le répertoire décoratif anglais.
Lord Burghley, ami et conseiller de la reine et amateur éclairé d'architecture, éleva (1556-1584) à Burghley House, près de Stamford, l'exemple le plus étonnant de cette architecture en quête d'identité. Le pavillon central associe une entrée en « arc de triomphe » à la française, un oriel (fenêtre en saillie) à meneaux typiquement anglais et un couronnement flamand avec décors de cuirs et obélisques. Cet édifice disparate n'est cependant pas choquant, il témoigne bien, selon N. Pevsner, de cette « vitalité débordante », de cette exubérance propre à une époque sûre d'elle-même. L'influence italienne se marque par des emprunts fréquents à Serlio pour le choix des plans ; des citations françaises se lisent ici et là, comme à Somerset House où Edouard Seymour se souvint de la leçon de classicisme administrée par Jean Bullant au château d'Écouen. Mais ce qui distingue le plus évidemment l'architecture élisabéthaine est une sorte de réflexion méditée de l'héritage gothique.
À Longleat House, construite pour sir John Thynne par Robert Smythson, « architector and surveyor », les façades animées de décrochements et percées de vastes fenêtres à meneaux créent un effet saisissant de quadrillage régulier, dont la dominante géométrique s'inscrit bien dans la tradition du style perpendiculaire. À Wollaton Hall, pour sir Francis Willoughby, sur un plan ramassé autour d'un hall central, le même Robert Smythson reprend le système de quadrillage ; ici, l'emploi des ordres (réduits à des pilastres jumelés) ne semble intervenir que pour accuser la linéarité et le rigorisme du parti. Il apparaît qu'un pas de plus a été franchi à Hardwick Hall, construit en 1591-1593 pour Élisabeth Talbot : les ordres ont disparu, le verre des vastes baies domine des façades désormais plates. On a voulu voir dans cette élégance hautaine, presque sévère, la marque même de la Réforme, sinon d'un certain puritanisme. On ne peut s'empêcher de signaler l'incontestable modernité de ce purisme géométrique, de ce désir d'ordre, d'équilibre et de clarté, idéalement illustré à Wootton Lodge (1612), qui tirent leurs effets d'un vocabulaire formel effectivement traditionnel mais en même temps « réinventé » et mis en œuvre dans une série d'éblouissantes variations. L'époque jacobéenne qui se confond avec le règne de Jacques Ier (1603-1625) semble renouer avec un certain climat de fantaisie. On assiste alors à une renaissance du mythe chevaleresque par lequel l'élite aristocratique redécouvre certains idéaux nationalistes et romanesques (Edmund Spenser, 1552-1599). On retrouve des échos des architectures de fêtes (tournois, feux d'artifice, « masques ») au château de Bolsover dont les créneaux et les pinacles illustrent l'archaïsme délibéré.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Monique MOSSER : ingénieur au C.N.R.S., enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles
Classification
Médias
Voir aussi
- WELLS CATHÉDRALE DE
- VILLA, architecture du XVIIIe s. à nos jours
- GOTHIC REVIVAL ou NÉOGOTHIQUE
- ANGLAIS ART
- DÉCORATION ARCHITECTURALE
- WHITEHALL
- LONDRES CATHÉDRALE SAINT-PAUL DE
- HAMPTON COURT PALAIS DE
- GANDON JAMES (1743-1823)
- BATH, Grande-Bretagne
- ANGLAISE ARCHITECTURE
- CIVILE ARCHITECTURE
- ARCHITECTURE DU XIXe SIÈCLE
- SQUARE
- ARCHITECTURE DU XVIIIe SIÈCLE
- ARCHITECTURE DU XVIIe SIÈCLE
- BURGHLEY HOUSE
- GREEK REVIVAL ou RENAISSANCE HELLÉNISTIQUE
- SMYTHSON ROBERT (1536 env.-1614)
- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA
- GOTHIQUE ARCHITECTURE
- ÉLISABÉTHAIN ART
- ARTS AND CRAFTS, mouvement artistique
- BUTTERFIELD WILLIAM (1814-1900)
- NÉO-CLASSIQUE ARCHITECTURE
- BAROQUE ARCHITECTURE
- ARCHITECTURE RELIGIEUSE
- ROMANTIQUE ARCHITECTURE