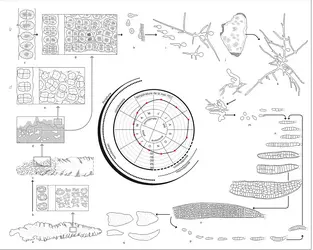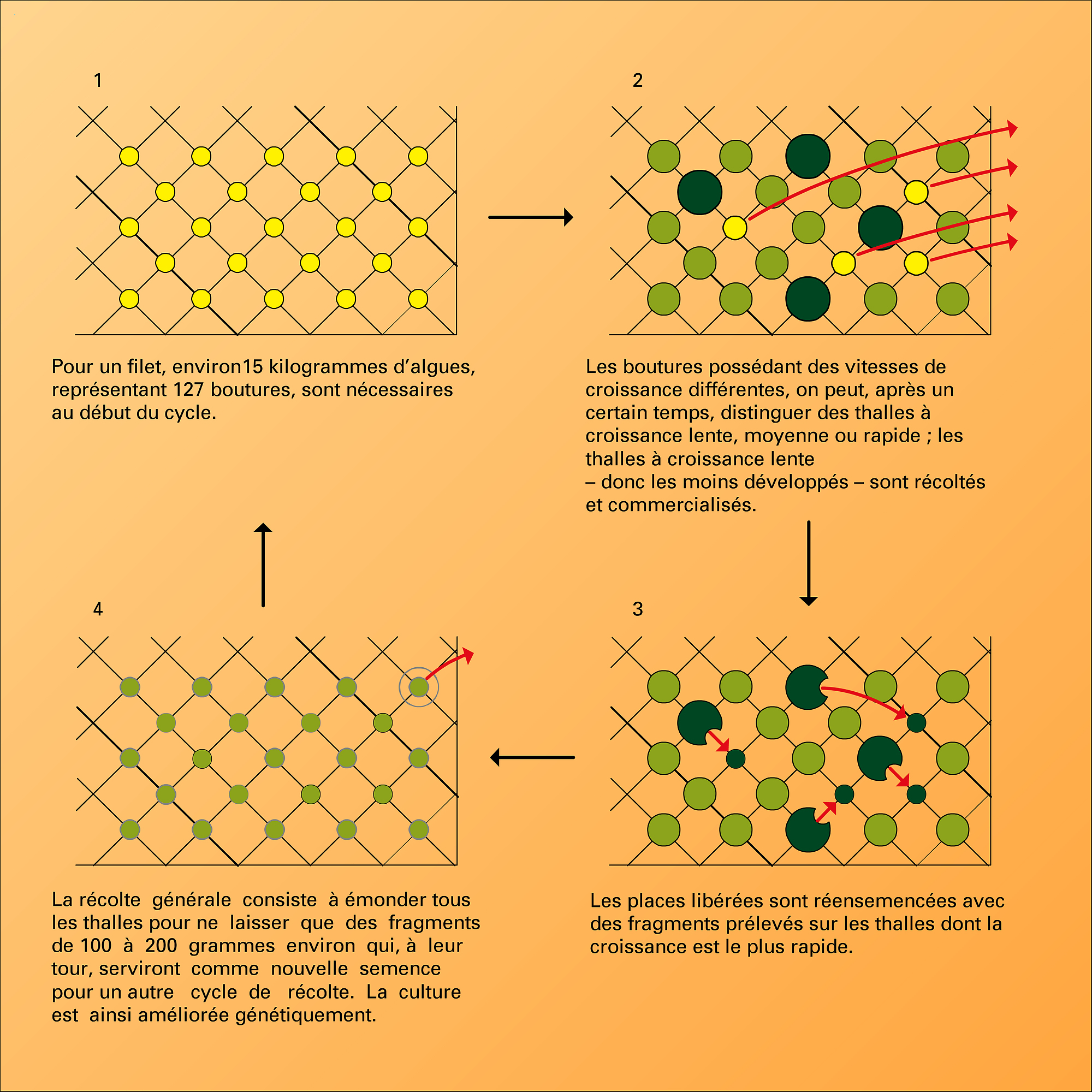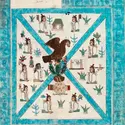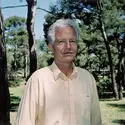AQUACULTURE
Article modifié le
Enjeux et problématiques de l'aquaculture
L'évolution de la consommation
Depuis le début du xxie siècle, l'homme consomme chaque année 100 millions de tonnes de produits aquatiques animaux ( poissons, mollusques et crustacés pour l'essentiel), ce qui représente six fois plus que la consommation de 1950. Pour de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, ces produits constituent la principale source de protéines animales. Ils proviennent pour 65 p. 100 de la pêche et pour 35 p. 100 de l'aquaculture. Depuis 1990, la production de la pêche mondiale est stabilisée aux environs de 90 à 95 millions de tonnes par an (dont une partie est utilisée pour la fabrication de farines afin de satisfaire le développement de l'aquaculture). Plus grave, selon la F.A.O., plus de 70 p. 100 des stocks sont aujourd'hui exploités au-delà de leur potentiel optimal de production. L'aquaculture est donc appelée à accroître encore sa production pour répondre aux besoins des consommateurs. En effet, indépendamment de l'accroissement démographique, la consommation mondiale moyenne de poissons et d'invertébrés marins a doublé en plus de quarante ans, passant de 8 à 16 kilogrammes par personne et par an entre 1960 et 2004. L'accès à la société de consommation de pays émergents (au premier rang desquels la Chine et l'Inde) et la progression de la population mondiale, attendue à 7,5 milliards d'habitants d'ici à 2020 et près de 9 milliards en 2050, vont encore accroître la demande en produits aquatiques, demande qui devrait, selon les économistes, atteindre 30 kilogrammes par personne et par an pour l'année 2020. Si la pêche reste stable, comme on peut l'imaginer devant les difficultés rencontrées pour modifier en profondeur les conditions d'accès à la ressource et de contrôle, la production aquacole annuelle mondiale devrait pour satisfaire la nouvelle demande passer de quelque 40 millions de tonnes actuellement à plus de 150 millions de tonnes d'ici à 2020. À en juger par sa progression entre 1990 et 2000 (10 p. 100 d'accroissement annuel), un tel objectif n'est pas irréaliste, la principale limitation étant certainement celle de la disponibilité des espaces nécessaires.
Caractéristiques et contraintes biologiques
Par rapport aux organismes terrestres, les organismes aquatiques vivent en permanence dans un milieu de densité à peu près égale à celle de leur corps. Il en résulte une réduction des structures squelettiques de soutien, une économie de l'énergie nécessaire au maintien de l'équilibre et aux déplacements, et, enfin, un rapport plus élevé entre tissus musculaires et tissus osseux. Les animaux qui se nourrissent de particules en suspension dans l'eau, comme les mollusques bivalves, ont même abandonné la possibilité de se déplacer en quête de nourriture.
En ce qui concerne la physiologie, la plupart des animaux aquatiques sont des poïkilothermes, c'est-à-dire que leur température interne est semblable à celle du milieu extérieur dans lequel ils vivent. L'absence de régulation thermique (à l'exception des mammifères aquatiques et, partiellement, des grands poissons pélagiques comme les thonidés) réduit considérablement les dépenses métaboliques et accroît donc l'efficacité de la conversion des aliments ingérés en gain de poids (le gain pondéral de poissons nourris d'aliments secs est 2,5 fois celui des bovins et des ovins et 1,5 fois celui des animaux de basse-cour).
La très grande majorité des animaux aquatiques ont un potentiel reproducteur extrêmement élevé : une moule ou une huître pond quelques millions à quelques dizaines de millions d'œufs par an, une crevette pénéide un million environ, et un poisson comme la morue plusieurs millions. Cette particularité présente l'avantage de réduire le nombre de géniteurs conservés en captivité par les éleveurs pour les animaux dont la totalité du cycle biologique se déroule en captivité. Chez d'autres espèces (bivalves et crevettes pénéides), une telle fécondité permet de prélever dans le milieu naturel des quantités importantes de juvéniles que la mortalité naturelle n'a pas encore décimées.
L'élevage aquatique se pratique dans un volume d'eau alors que l'agriculture et les élevages terrestres utilisent une surface. Il en résulte, dans certaines circonstances très favorables, des rendements à l'hectare extrêmement élevés. Ainsi, les élevages de moules sur cordes suspendues sous des radeaux dans la ria de Vigo (Espagne) dépassent 250 tonnes en poids frais par hectare et par an, alors qu'un hectare de luzerne ne produit qu'un veau de 250 kilogrammes par an.
Ces avantages de l'aquaculture ne doivent pas masquer certaines difficultés. La première tient à la nécessité de maintenir les conditions physico-chimiques de l'eau des enceintes d'élevage à des valeurs permettant le développement de la vie. L'eau est un remarquable solvant et de nombreux éléments chimiques s'y trouvent en solution. Les teneurs de l'eau en oxygène et en dioxyde de carbone dissous, en sels minéraux, en matières organiques, ont autant d'importance que sa température, son éclairement ou son agitation. Lorsque l'élevage est effectué en totalité dans le milieu naturel, le maintien de la qualité bactériologique et chimique de l'eau doit être assuré par la collectivité (d'où, dans le cas de l'Union européenne, la définition de normes de qualité des eaux conchylicoles, directive 79/923/CEE 30 octobre 1979). Lorsque l'élevage est pratiqué dans des enceintes de dimensions restreintes, il est indispensable de recourir à un renouvellement permanent de l'eau à raison de 10 à 20 p. 100 par jour, selon la quantité d'animaux en élevage (autrement dit, selon la charge en biomasse) et d'y adjoindre des systèmes mécaniques d'aération de l'eau. Pour le développement des œufs et, surtout, des larves, qui sont plus exigeantes que les organismes adultes correspondants vis-à-vis des facteurs physico-chimiques et microbiologiques, une filtration et un traitement de l'eau (par exemple, par exposition aux rayons ultraviolets) peuvent s'avérer nécessaires.
Une deuxième difficulté tient à ce que, contrairement aux animaux domestiques, les poissons et la plupart des invertébrés ont des formes larvaires de très petite taille, qui n'offrent aucune ressemblance avec les adultes. Très généralement planctoniques (elles constituent une fraction du plancton animal ou zooplancton appelée plancton temporaire ou méroplancton), ces larves ont non seulement une morphologie particulière, mais également des exigences écologiques, un comportement alimentaire et une physiologie tout à fait différents de ceux des adultes. Ainsi, chez les crevettes pénéides, les premiers stades larvaires sont herbivores, se nourrissant d'algues unicellulaires, alors que les stades larvaires plus âgés et les adultes sont carnivores. Chez les poissons, les très jeunes larves qui commencent à s'alimenter sont inexpérimentées : elles n'ont pas encore acquis le réflexe de retour en arrière lorsqu'elles ont manqué une proie, leur champ de vision est restreint et leurs capacités natatoires peu développées ; elles ne disposent guère de réserves et doivent impérativement être nourries plusieurs fois par jour avec des particules vivantes (algues unicellulaires, rotifères, nauplius d'Artemia salina, etc.).
Une troisième difficulté vient de la situation occupée par l'espèce dans la chaîne alimentaire. Beaucoup d'espèces à valeur économique élevée se nourrissent de petits carnivores. Le rendement du transfert de l'énergie apportée par la nourriture d'un niveau à l'autre de la pyramide alimentaire est faible, de l'ordre de 10 p. 100. Il faut donc disposer soit d'une nourriture naturelle, soit d'une nourriture artificielle à faible prix de revient. Des progrès considérables ont été obtenus au niveau des besoins nutritionnels des poissons et des crustacés élevés, en particulier en ce qui concerne les acides gras poly-insaturés à longue chaîne dits en oméga-3. On sait aujourd'hui fabriquer, à des prix acceptables, des aliments composés satisfaisant les besoins des organismes, tout au moins à l'état adulte. La hausse régulière du prix des produits de la mer a favorisé le développement rapide de l'aquaculture. On oppose fréquemment l'aquaculture dite de production, c'est-à-dire fondée sur l'exploitation de la production végétale naturelle, et l'aquaculture de transformation, qui vise à élever des animaux carnivores qu'il faut souvent nourrir avec du poisson non commercialisable (appelé le faux poisson) ou des farines de poisson. Contrairement à une idée assez répandue, il n'y a pas nécessairement dans cette aquaculture de transformation de gaspillage biologique : qu'ils soient libres ou enfermés dans des cages d'élevage, les thons ou les saumons, par exemple, consomment la même quantité de nourriture qu'en milieu naturel. La véritable interrogation est le déséquilibre que peut introduire l'aquaculture vis-à-vis de la chaîne alimentaire sauvage, en accroissant « artificiellement » le prélèvement fait sur les stocks de poissons herbivores (parfois appelés poissons fourrage). À l'heure actuelle, alors que les principales espèces commerciales de poissons carnivores sont toutes considérées en état de surexploitation avancée, le risque ne paraît guère important. La rapidité avec laquelle croît la production aquacole mondiale conduit néanmoins à recommander une certaine prudence, afin d'éviter que les progrès de l'aquaculture ne se fassent au détriment des stocks sauvages, donc de la pêche commerciale.
Enfin, une dernière difficulté résulte des rejets qui sont entraînés par les courants et finissent par retomber sur le fond. Il s'agit, principalement, des excréments solides rejetés par les animaux en élevage. Il faut aussi tenir compte de la nourriture non consommée, notamment dans les élevages en cage flottante, qui gagne rapidement le fond et s'accumule à la surface des sédiments, avec les excréments. Dans les élevages intensifs de poissons marins en Méditerranée, ces rejets représentent 12 kilogrammes de phosphore, 110 kilogrammes d'azote et 450 kilogrammes de carbone organique par tonne de poissons produite. Il convient donc de choisir des sites où la circulation générale des eaux entraîne vers le large la matière organique issue des élevages. Dans certains cas, comme celui de l'élevage des saumons dans les fjords de Norvège, les éleveurs pratiquent une véritable rotation et mise en jachère des sites d'élevage, permettant une bio-oxydation complète de la matière organique déposée sur le fond. Il existe d'autres rejets, plus toxiques : c'est notamment le cas des antibiotiques et d'autres produits chimiques utilisés dans les élevages de larves et de juvéniles, parfois à haute dose et sans discernement. Les élevages intensifs de crevettes pénéides de l'île de Taïwan ont été ainsi décimés par de tels excès au cours des années 1980.
Bien entendu, nombreuses sont les techniques qui utilisent des bassins à terre, des lagunes confinées ou les baies protégées de la zone côtière. Se posent alors les inévitables conflits d'usage, d'autant plus violents que l'occupation humaine du littoral considéré est importante et les enjeux économiques élevés.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Lucien LAUBIER : professeur émérite à l'université de la Méditerranée, Marseille
Classification
Médias
Autres références
-
AZTÈQUES
- Écrit par Rosario ACOSTA NIEVA , Alexandra BIAR et Mireille SIMONI
- 12 581 mots
- 22 médias
Dernières survivances du passé lacustre de la grande Tenochtitlán, les chinampas de Xochimilco sont devenues un passage obligé pour tous les visiteurs à la recherche du paysage culturel de l’époque préhispanique. Composé de canaux de navigation sillonnant entre des parcelles de production agricole,... -
BANGLADESH
- Écrit par Alice BAILLAT et Encyclopædia Universalis
- 8 410 mots
- 10 médias
Ensuite, le développement de la culture intensive de crevettes contribue significativement à l’augmentation des échanges commerciaux du Bangladesh : la crevetticulture est devenue le deuxième secteur d’exportation du pays. Implantée dans les années 1970, elle est considérée comme une formidable opportunité... -
BIOTECHNOLOGIES
- Écrit par Pierre TAMBOURIN
- 5 368 mots
- 4 médias
Le domaine d'application des biotechnologies modernes dans le monde aquatique en est encore à ses balbutiements.Il regroupe diverses techniques qui permettent d'augmenter le taux de croissance des espèces aquatiques d'élevage, d'améliorer la qualité nutritive des aliments aquacoles et la santé des... -
ÉQUATEUR
- Écrit par Jean-Paul DELER , Encyclopædia Universalis , Yves HARDY , Catherine LAMOUR et Emmanuelle SINARDET
- 8 605 mots
- 9 médias
...exclusive), la pêche, qui représente 8 % des exportations, stimule une industrie de la conserverie (exportation de thon) et dynamise le port de Manta. L'aquaculture du delta du Guayas, étendue au détriment des mangroves littorales,a fait du pays le premier exportateur de crevettes au monde, mais... - Afficher les 8 références
Voir aussi
- CONGÉLATION
- ALIMENTATION ÉCONOMIE DE L'
- ALTERNANCE DE PHASES
- LAMINARIALES
- EAU, écophysiologie
- PISCICULTURE
- SPORE
- LAGUNE
- ÉTANGS
- RHODOPHYTES ou ALGUES ROUGES
- PORPHYRA
- LAMINAIRE
- OSTRÉICULTURE
- ALIMENTATION ANIMALE, élevage
- ALEVIN
- MOULE, zoologie
- PECTINIDÉS
- COQUILLE SAINT-JACQUES
- PÉTONCLES
- MYTILICULTURE
- CLAMS
- PALOURDES
- PÉNÉIDES
- SALMONIDÉS
- CARPE
- AGROALIMENTAIRE TECHNOLOGIE
- LARVE
- THON
- SAUMON
- EUCHEUMA
- CONCHYLICULTURE
- ALIMENTS
- AQUATIQUE VIE
- HUÎTRE
- DULÇAQUICOLES MILIEUX
- CONSOMMATION ALIMENTAIRE