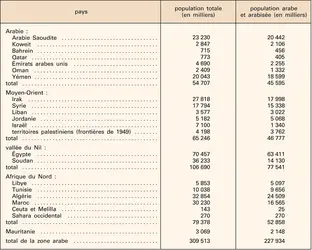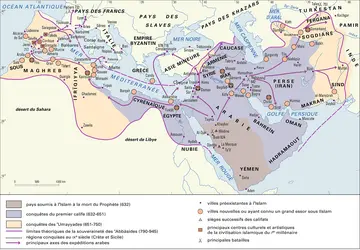ARABE (MONDE) Le peuple arabe
Article modifié le
Les Arabes forment un peuple ou ethnie dont le critère distinctif est l'usage de la langue arabe, qui est une langue sémitique comme l'akkadien l'araméen et l'hébreu. Cependant ne se considèrent et ne sont considérés comme Arabes que les individus et les groupes de langue arabe qui se reconnaissent un lien de parenté avec les groupes arabophones liés à l'histoire de l'ancienne Arabie.
Définition, extension, statistique
Les plus anciennes informations sur les Arabes proviennent des textes akkadiens (assyro-babyloniens) et hébraïques. À partir du ixe siècle avant notre ère, ils situent dans le désert syro-mésopotamien et le nord-ouest de l'Arabie une population dénommée en akkadien Aribi, Arubu, Urbu, en hébreu ‘Arab (‘Arbī, « un Arabe »). L'examen des noms propres des membres de ce peuple mentionnés par les textes akkadiens montre que leur langue était effectivement l'arabe. Ils devaient déjà se nommer eux-mêmes ‘Arab. Le mot – ou une forme qui en est dérivée – s'est spécialisé, à certaines époques et dans certains usages, pour désigner seulement ceux des habitants de l'Arabie qui menaient une vie nomade, les Bédouins selon un autre terme indigène.
Nous savons que des populations menant un genre de vie semblable occupaient, avant cette époque, le désert syrien et la péninsule du Sinaï. Mais nous ignorons absolument si ces populations étaient de langue arabe. L'étymologie du mot ‘Arab est obscure. On a supposé qu'il dérivait du mot ‘Arabah qui, en hébreu, désigne le désert et particulièrement la dépression désertique au sud de la mer Morte. Le terme, appliqué d'abord aux Arabes de cette région, se serait étendu ensuite à tous les éléments qui leur étaient apparentés, suivant un processus fréquent pour les noms de peuples. Ce n'est qu'une hypothèse.
Nous ignorons aussi jusqu'à quelle limite vers le sud s'étendait, aux diverses phases de l'histoire du Ier millénaire avant J.-C., la population arabe. Mais, en tout cas, dans la région méridionale de l'Arabie (Yémen, Hadramaout actuels), on parlait des dialectes d'une autre langue, que nous appelons sudarabique, apparentée, mais distincte. Les habitants de cette région considéraient les Arabes (‘rb dans leurs inscriptions) comme un peuple étranger, et réciproquement.
Les Arabes occupent actuellement une très vaste zone de l'Asie et de l'Afrique. Suivant la définition de l'ethnie arabe adoptée ici, il s'agit des nombreux pays où l'arabe classique est langue officielle, administrative, littéraire et culturelle, alors que la population dans sa majorité (sauf dans le cas du Soudan) parle des dialectes arabes. On peut en dresser la liste avec une estimation sommaire du nombre des arabophones sur l'ensemble de la population, mais tous ces chiffres sont souvent très peu sûrs et doivent être regardés comme donnant seulement des ordres de grandeur (cf. tableau).
On trouvait donc, en 2005, dans cette espace où domine la langue arabe (env. 13 000 000 km2, 10 000 000 seulement en soustrayant le Sahara algérien et le Soudan du Sud non arabophones), un ensemble cohérent de 228 millions d'arabophones répartis dans 22 pays ou entités politiques distinctes totalisant environ 300 millions d'habitants. Seules trois entités politiques constituent des îlots à minorité arabe au milieu de ce monde : Israël avec 1 340 000 Arabes sur 7 100 000 habitants et les presides espagnols de Ceuta et Mellila avec 25 000 Arabes sur 143 000 habitants.
Cette zone arabe est entourée de toute une frange de minorités arabophones, tantôt dispersées, tantôt formant des groupes cohérents : en Iran 1 738 000, en Turquie 1 300 000, en Afrique orientale (Éthiopie, Djibouti, Somalie), en Afrique occidentale (Sénégal, Mali, Niger), en Afrique centrale (Tchad et Nigeria) 2 000 000 ( ?). Il faut mentionner l'île de Malte, État indépendant dont la majorité des habitants (400 000) parle un dialecte arabe mais qui, séparé du monde arabe par la religion, la culture, les traditions et la mer, ne s'y sent lié aucunement.
La zone arabe compte en son sein de nombreux îlots non arabes et de nombreux étrangers dispersés. Ils sont particulièrement importants en Irak, mais on en trouve dans tout le Croissant fertile : « Assyriens » et Mandéens de langue néo-araméenne, Kurdes d'Irak et de Syrie (7 200 000 ?), Tcherkesses, Arméniens (700 000 ?), Tziganes... En Arabie même, parmi les nombreux Iraniens, un îlot cohérent parle un dialecte iranien, le komzari, au Oman : des Indonésiens, des Indiens et Pakistanais, de nombreux Noirs en général arabisés... Un îlot intéressant est constitué par les populations (quelques milliers d'individus) parlant encore des dialectes sudarabiques, dérivés des anciennes langues d'Arabie du Sud, au Dhofar et dans l'île de Sokotra. Enfin, au Maghreb (au sens strict : Tunisie, Algérie et Maroc, auxquels on adjoint la Libye et la Mauritanie quand on parle du grand Maghreb), d'importants îlots ont résisté à l'arabisation et parlent encore des dialectes berbères. Le nombre des berbérophones est difficile à estimer, faute de recensement précis. Il approcherait les 20 millions d'individus au début des années 2000.
Les membres de ces îlots linguistiques et les individus dispersés dans la zone arabe sont à des degrés très divers bilingues, et par conséquent en partie arabisés, ce qui ne les conduit pas pour autant à s'identifier en tant qu'Arabes.
En dehors de la zone arabe et de sa frange, il y a des communautés arabes plus ou moins éloignées et détachées, ainsi que des arabophones émigrés dispersés : en Afrique orientale (Ouganda, Kenya, Tanzanie), particulièrement à Zanzibar ; à Madagascar, en Afghanistan (à Aqtché à 20 km à l'ouest de Balkh) ; en Ouzbékistan, au Turkménistan et au Daghestan ; en Indonésie, etc. L'émigration, entraînant souvent un abandon de la langue, est aussi importante aux États-Unis (850 000 personnes d'ascendance arabe d'après le recensement de 2000), en Argentine (1 270 000), au Brésil (plusieurs millions de descendants d'immigrants originaires de l'Empire ottoman, et plus tard du Liban indépendant), au Canada (400 000) et au Chili (importante communauté d'émigré palestiniens). En Europe, l'émigration en provenance des pays du Maghreb des années 1960-1970 s'est fixée en particulier en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Au début des années 2000, les estimations du nombre d'arabophones en Europe oscillent entre 3 et 4 millions.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Maxime RODINSON : directeur d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
AFGHANISTAN
- Écrit par Daniel BALLAND , Gilles DORRONSORO , Encyclopædia Universalis , Mir Mohammad Sediq FARHANG , Pierre GENTELLE , Sayed Qassem RESHTIA , Olivier ROY et Francine TISSOT
- 37 323 mots
- 19 médias
LesArabes entrèrent en Afghanistan vers le milieu du viie siècle sur deux fronts parallèles : par la ville de Herat au nord et par la province du Sistan au sud. De Herat, ils poussèrent vers Balkh, chef-lieu de l'ancienne Bactriane, où ils se heurtèrent aux Turcs, qui s'y étaient établis après la... -
AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale
- Écrit par Roland POURTIER
- 24 463 mots
- 27 médias
...occupent les rives européennes et asiatiques de la Méditerranée. Elles ont connu des brassages millénaires. Les différences qui existent entre Berbères et Arabes, par exemple, sont de nature historique et culturelle. Dans les confins méridionaux, les métissages ont été fréquents entre les Blancs et les... -
AFRIQUE (Histoire) - De l'entrée dans l'histoire à la période contemporaine
- Écrit par Hubert DESCHAMPS , Jean DEVISSE et Henri MÉDARD
- 9 656 mots
- 6 médias
-
ALGÉRIE
- Écrit par Charles-Robert AGERON , Encyclopædia Universalis , Sid-Ahmed SOUIAH , Benjamin STORA et Pierre VERMEREN
- 41 845 mots
- 25 médias
Tandis que, dans l'Algérie occidentale, se reconstituaient de grandes confédérations berbères, lesArabes venus d'Égypte pénétrèrent, dès 647, dans le Maghreb. Mais ce fut seulement en 683 que la grande armée de Sidi ‘Oqba en entreprit la conquête. Byzantins et Berbères, souvent alliés, résistèrent... - Afficher les 39 références
Voir aussi