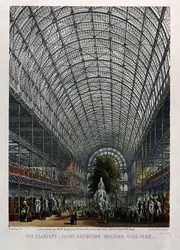ARCHITECTURE (Thèmes généraux) Architecture, sciences et techniques
Article modifié le
La remise en cause de la notion traditionnelle de solidité
Le xviiie siècle voit la montée en régime des préoccupations constructives. En Italie, celles-ci occupent une large place dans l'enseignement du moine vénitien Carlo Lodoli (1690-1761), qui entend fonder l'architecture sur les lois de la statique et sur les caractéristiques des divers matériaux, plus essentielles à ses yeux que les impératifs d'ordre esthétique. En France, les écrits d'un Pierre Patte sont non moins révélateurs de la curiosité qui s'attache aux questions constructives.
La production du bâti ressemble pourtant à s'y méprendre à celle de l'âge classique. L'attention portée à la construction participe en réalité d'une volonté de rationalisation des procédures d'édification qui ne modifie pas encore les grands équilibres technico-économiques. En l'absence d'innovations décisives, il s'agit de recenser l'existant, d'en exploiter pleinement les possibilités dans un souci d'efficacité renforcée. Ce souci d'efficacité conduit à accorder moins d'importance aux proportions des ordres qui constituaient jusque-là le noyau de la théorie architecturale.
Les réflexions des Lumières sont par ailleurs stimulées par la réalisation de toute une série d'édifices dont l'audace va croissant. En France, la colonnade du Louvre sert de modèle à des églises où les arcades traditionnelles cèdent la place à des colonnes isolées supportant des linteaux construits par claveaux. Dans son Essai sur l'architecture de 1753, l'abbé Laugier rattache l'usage de colonnes isolées et de linteaux à la construction primitive en bois. Les temples gréco-romains fournissent bien entendu un autre modèle plausible. Dans un édifice comme l'église Sainte-Geneviève, de Jacques Germain Soufflot, l'actuel Panthéon, le primitivisme et le souci de renouer avec l'élégance des péristyles antiques s'accompagnent toutefois d'un tel déploiement d'artifices – tirants en métal, voûtes de grande portée, arcs-boutants – que l'on est en réalité plus proche du fonctionnement dynamique des cathédrales gothiques que du caractère plus statique des temples grecs ou romains. Les références s'additionnent sans se confondre.
Ce qui naît peut-être de cet ensemble de réflexions et d'expériences, c'est l'idée moderne de structure, fondée sur l'identification de modèles structuraux et sur la prise de conscience de l'écart qui sépare presque toujours le modèle de sa réalisation. Dans son acception moderne, une structure est également caractérisée par la canalisation des efforts qu'elle permet ainsi que par la performance qu'elle accomplit. Canalisation des efforts et performance posent le problème des calculs qui doivent permettre de vérifier le bien-fondé des hypothèses de conception.
Au cours du xviiie siècle, l'usage du calcul infinitésimal se répand dans les milieux scientifiques en ébranlant du même coup la toute-puissance de la géométrie. L'analyse va progressivement devenir l'instrument par excellence du calcul des structures. L'une de ses premières applications est due à l'ingénieur militaire et physicien Charles Augustin Coulomb, qui révolutionne le calcul des voûtes dans un essai soumis en 1773 à l'Académie des sciences. Bien que des théories comme celle de Coulomb rencontrent peu d'écho parmi les praticiens, ces derniers pressentent confusément qu'une page de l'histoire de la conception des structures est sur le point d'être tournée.
Dans les années 1740 déjà, des savants et des ingénieurs comme Ruggiero Guiseppe Boscovitch et Giovani Poleni s'étaient penchés sur les problèmes de stabilité posés par le dôme de Saint-Pierre de Rome en tentant d'y appliquer les résultats scientifiques les plus récents. À la fin du siècle, l'église Sainte-Geneviève, de Soufflot, apparaît à son tour comme un véritable laboratoire où sont testées les théories les plus diverses, avec un succès très relatif il est vrai.
Si les Lumières sont loin de parvenir à des résultats satisfaisants concernant la résistance des matériaux et l'application des théories physico-mathématiques à la stabilité des constructions, tous leurs tâtonnements vont dans le même sens, celui d'une remise en cause radicale de l'approche vitruvienne de la solidité. Dans son acception traditionnelle, la solidité tenait à un dimensionnement correct, effectué au moyen d'outils essentiellement géométriques, mais elle correspondait également à l'impression d'harmonie que le spectateur devait éprouver devant l'édifice réalisé. La solidité marquait ainsi l'accord profond qui était censé régner entre les lois naturelles de la pesanteur et de la cohésion des corps et les enseignements de la théorie. Au xviiie siècle, l'apparition d'ouvrages de plus en plus audacieux, semblant défier le vide, rend cet accord moins évident. La géométrie des proportions semble appelée à céder la place à des procédures de dimensionnement moins directement liées aux canons esthétiques, procédures conduisant à une dissociation entre solidité réelle et impression de solidité. Un écart d'un nouveau type s'accuse entre architecture et construction, la première raisonnant en termes formels, avec leurs connotations psychologisantes, tandis que la seconde prépare l'avènement d'outils physico-mathématiques inédits.
Cet écart va être mis à profit par les ingénieurs qui vont se faire les champions d'une solidité reposant désormais sur la science dont les enseignements doivent, selon eux, primer sur toute autre considération. À la charnière des xviiie et xixe siècles, les professions d'architecte et d' ingénieur, longtemps proches l'une de l'autre, commencent à diverger inexorablement. À la complexité nouvelle des relations entre architecture et construction vont se superposer des tensions professionnelles appelées à prendre de plus en plus d'importance.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Antoine PICON : professeur d'histoire de l'architecture et des techniques à la Graduate school of design de l'université Harvard, Cambridge, Massachusetts (États-Unis)
Classification
Médias
Autres références
-
ARCHITECTURE & ÉTAT AU XXe SIÈCLE
- Écrit par Anatole KOPP
- 3 971 mots
- 3 médias
L'intervention de l' État dans le domaine de l' architecture ne constitue pas un phénomène nouveau. De tout temps et sous tous les régimes, l'État est intervenu dans la mesure où toute réalisation architecturale met en cause les intérêts de couches de population bien plus larges que celles...
-
ARCHITECTURE & MUSIQUE
- Écrit par Daniel CHARLES
- 7 428 mots
- 1 média
La comparaison, tentée à maintes reprises, entre architecture et musique a donné lieu en général à des slogans du genre « l'architecture est une musique figée ». On ne s'est pas privé non plus de constater que les œuvres de la « grande » musique occidentale s'étaient peu à peu solidifiées en objets,...
-
INGÉNIEUR ET ARCHITECTE
- Écrit par Antoine PICON
- 4 262 mots
- 5 médias
Au cours de la Renaissance, les figures de l'architecte et de l'ingénieur se confondent pratiquement. Filippo Brunelleschi, généralement considéré comme un des pères fondateurs de l'architecture renaissante, est presque autant ingénieur qu'architecte. Ne conçoit-il pas les machines destinées...
-
ANDROUET DU CERCEAU JACQUES (1520-1586)
- Écrit par Jean GUILLAUME
- 968 mots
Jacques Androuet du Cerceau (appelé le plus souvent « Du Cerceau », dû au motif de l'enseigne de la boutique de son père qui était marchand de vin) fut à la fois un graveur, un dessinateur, un créateur d'ornements, un inventeur d'architectures réelles ou imaginaires et l'auteur du premier ouvrage...
-
ANTHROPOMORPHIQUE ARCHITECTURE
- Écrit par Martine VASSELIN
- 1 060 mots
De tout temps les architectes ont senti qu'il existait des affinités autres que d'usage entre les édifices et les hommes. La critique architecturale l'exprime confusément qui parle de l'ossature, des membres, de la tête ou de l'épiderme d'une construction. Mais cette impression...
-
APPAREIL, architecture
- Écrit par Roland MARTIN
- 4 326 mots
- 2 médias
En termes d' architecture, l'appareil désigne les modalités d' assemblage, de liaison et de mise en valeur des matériaux de la construction. Il est un des éléments essentiels du caractère de l'édifice dont il souligne au premier coup d'œil les structures et souvent la fonction....
-
ARC DE TRIOMPHE
- Écrit par Gilbert-Charles PICARD
- 1 628 mots
- 9 médias
Un arc de triomphe est une structure architectonique composée de deux pylônes reliés par une voûte en plein cintre ; elle supporte par son intermédiaire un attique, base rectangulaire massive qui elle-même porte des statues. L'arc comprend en outre des colonnes plaquées contre les pylônes qui soutiennent...
- Afficher les 40 références
Voir aussi
- COLONNE
- ARCHITECTURE THÉORIE DE L'
- MÉTAL, architecture
- FER & FONTE, architecture
- DESSIN D'ARCHITECTURE
- PIERRE, architecture
- ACIER, architecture
- ARC, architecture
- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE
- ICTINOS (2e moitié Ve s. av. J.-C.)
- MATÉRIAUX, architecture
- MÉDIÉVAL ART
- TEMPLE, Grèce antique
- INGÉNIEURS
- COMPOSITION ARCHITECTURALE
- BÉTON, architecture
- ARCHITECTURE DU XIXe SIÈCLE
- ARCHITECTURE DU XVIIIe SIÈCLE
- ARCHITECTURE HISTOIRE DE L'
- FRANÇAISE ARCHITECTURE
- ITALIENNE ARCHITECTURE
- ROMAINE ARCHITECTURE
- GRECQUE ARCHITECTURE
- COLONNADE
- ANTIQUITÉ, architecture
- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA
- GOTHIQUE ARCHITECTURE
- ARCHITECTURE DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE
- BÉTON ARMÉ
- SCIENCES HISTOIRE DES