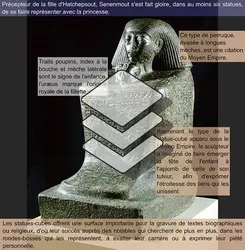ARCHITECTURE (Thèmes généraux) L'architecte
Article modifié le
La formation et la profession d'architecte depuis 1914
De 1914 à 1940
Le marasme de la construction
Pendant le temps où les architectes étaient préparés à construire des palais, la majorité d'entre eux n'avaient pas même à construire des maisons. La cité d'habitations à bon marché confiée par un office public départemental ou la villa de quelque importance constituaient un événement dans la carrière de l'architecte provincial.
Une fois achevée la reconstruction qui occupa les années vingt, la période de l'entre-deux-guerres se caractérise en effet par la grande misère de la construction, en particulier en matière de logements. Les lois sur les loyers, toutes défavorables aux propriétaires, ont détourné l'épargne privée de la construction de logements, aux loyers dépréciés. Le relais fut très insuffisamment assuré par l'État avec la loi Loucheur, en 1928, qui favorisait l'accession à la propriété individuelle.
La pénurie de la construction allait de pair avec la carence des équipements et l'anarchie des extensions urbaines. En dépit de la loi Cornudet de 1919 concernant l'aménagement, l'embellissement et l'extension des villes, les lotisseurs se souciaient peu des effets néfastes de leurs spéculations, et les banlieues ouvrières croissaient de manière désordonnée, sans équipements scolaires, hospitaliers et administratifs.
De nombreuses constructions réalisées entre les deux guerres bénéficient désormais d'un regain d'intérêt. Néanmoins, on a peu construit pendant cette période et beaucoup de ce qui fut fait échappa aux architectes.
La formation et la consécration des architectes : le système académique
L'enseignement : l'École des beaux-arts
L'enseignement « Beaux-Arts » est de type charismatique et vise à faire éclore le don que chaque élu porte en lui. Il s'appuie sur la transmission par osmose, du maître à l'élève et de l'ancien au nouveau, non seulement d'un savoir théorique et pratique, mais d'un ensemble de valeurs. L'atelier est la structure de base de cet enseignement, le folklore en est l'accompagnement. Les rites de passage, l'argot d'école sont partie intégrante de cette pédagogie d'initiation, comme, d'une autre manière, le cycle d'épreuves du prix de Rome. L'École, disent les plus anciens élèves, ce sont « les plus belles années de la vie ». Mais ils disent aussi : l'École n'est rien (tant il est vrai que « le talent et le génie, en matière artistique, ce sont des dons avant d'être des études ») et l'École est tout (puisqu'elle est le lieu d'inculcation de la « manière d'être » architecte). Cette « manière d'être » implique une sensibilité qui est à la fois celle de l'artiste et celle de l'humaniste. Elle suppose une vocation (associée au don) et une mission à finalité humaine (comparable à celle du médecin).
Il est aisé de rappeler les lacunes et les anachronismes de cet enseignement hérité d'un autre âge. Les cours théoriques étaient peu nombreux, souvent peu suivis, les enseignements techniques inadaptés aux exigences de la construction moderne. Plus grave encore, l'architecture demeurait séparée de l' urbanisme, ignoré à l'École des beaux-arts. Cet aspect du « mal français », repérable dans l'anarchie des lotissements de banlieue de l'avant-guerre, est allé s'accentuant avec l'« urbanisme quantitatif » de l'après-guerre. Les sciences économiques et sociales furent absentes, elles aussi, et jusque dans les années soixante, de la formation des architectes. Le « manque de réalisme » de cette formation a été ressenti et souligné par bien des architectes.
La dominante de l'enseignement était artistique. Sur le caractère « routinisé » de cet enseignement, pour reprendre la terminologie de Max Weber, on a tout dit ou presque. L'École, prisonnière d'un académisme dans lequel l'idée du beau se réduit à un système de modèles et la pratique à un système de règles, s'est révélée incapable d'intégrer, sinon sous une forme tardive et atténuée, les innovations architecturales des années vingt. Elle a constitué, entre les deux guerres et au-delà, le bastion de tous les conservatismes. On a tout dit aussi sur les recettes graphiques dispensées aux architectes, comme à d'autres celles de la rhétorique.
Pourtant, l'École des beaux-arts connut encore, dans les débuts du xxe siècle, un grand rayonnement. Le cours de Julien Guadet, Éléments et théorie de l'architecture, n'a pas été qu'en France la bible de générations d'étudiants. Et le procès en révision de cet enseignement, tant décrié pour de bonnes raisons, semble bien être ouvert : d'aucuns, et de plus en plus nombreux, sont attirés par les « belles images » thésaurisées à l'École des beaux-arts ou chez les arrière-neveux d'architectes. Si Le Corbusier fut bien autodidacte, Tony Garnier était premier Grand Prix de Rome. À l'architecte, conçu comme un artiste, on apprenait à dessiner et on fournissait des éléments d'une culture architecturale. Ce n'était pas tout à fait rien.
La consécration des architectes : le prix de Rome
Le prix de Rome est au cœur de l'institution académique. La question avait été soulevée au xixe siècle de savoir si l'École devait préparer des étudiants en vue d'un diplôme ou « faire » des prix de Rome. Le bon fonctionnement du système académique a exigé le maintien des deux objectifs, et la primauté du second sur le premier.
Comble de la virtuosité académique, le prix de Rome imposait aux candidats un itinéraire d'épreuves codifiées sur des sujets d'École, sans relation, ou presque, avec la demande potentielle. La « fabrication » des prix de Rome était, avant la Seconde Guerre mondiale, une sorte d'oligopole. Pour la période de 1914 à 1939, six ateliers sur les vingt-huit qui ont eu des lauréats ont totalisé 64 p. 100 des premiers grands prix. Après-guerre, deux ateliers purent revendiquer à eux seuls 59 p. 100. Du fait que les étudiants complétaient leur apprentissage en « faisant la place », un même patron disposait, dans le cas privilégié où il était membre du jury des grands prix, de deux moyens pour couronner les études du bon élève : accroître ses chances d'être lauréat et lui offrir, en l'associant à l'agence, un tremplin pour aborder la vie professionnelle. Le prix de Rome constituant le point de départ du circuit de cooptation, c'est sur le circuit entier que se répercutaient les effets des positions dominantes des « grands » architectes, patrons d'atelier et patrons d'agence.
La circularité académique : le mandarinat
Le système académique était fondé sur la circularité. Les membres de la section architecture de l'Académie des beaux-arts se recrutaient par cooptation. Au travers de l'École nationale supérieure des beaux-arts et de ses filiales régionales créées en 1903, l'Académie régnait sur l'enseignement, dans la mesure où elle attribuait les récompenses. Les Prix de Rome, architectes de droit des bâtiments civils et palais nationaux, avaient le quasi-monopole des commandes publiques. Les patrons nommés des ateliers « intérieurs » de l'École des beaux-arts (sinon ceux des ateliers « extérieurs », appelés et révocables par les élèves) étaient des grands dignitaires. C'est tout normalement au sein de cette élite titrée qu'étaient cooptés les nouveaux académiciens.
La professionnalisation des architectes : le système libéral
Entre les acquis professionnels du xixe siècle et la création de l'ordre des architectes en 1940, on a tendance à perdre de vue l'entre-deux-guerres, période où de nombreux milieux professionnels, et pas seulement les architectes, ont revendiqué des statuts instituant des garanties de capacité, un pouvoir disciplinaire de la profession et des « moralisations » de la concurrence. La création de l'ordre n'est certes pas indépendante du renouveau corporatiste associé au régime de Vichy ; il faut néanmoins rappeler que les textes ratifiés étaient réclamés depuis longtemps par les associations et syndicats d'architectes.
L'une des associations les plus actives a été la Société des architectes diplômés par le gouvernement (S.A.D.G.), réservée aux titulaires du diplôme des Beaux-Arts. Fondée en 1882 par les premiers diplômés, la S.A.D.G. a connu sa pleine expansion dans la période de 1920 à 1940, regroupant la presque totalité des diplômés. Elle comptait 200 adhérents en 1890 et 1 800 en 1940. Ayant milité en faveur de la réglementation de la profession et de la création de l'ordre, il alla de soi que le président de la S.A.D.G., Auguste Perret, fût le premier président de l'ordre. De nombreux syndicats d'architectes s'étaient constitués pour défendre les architectes diplômés d'une école en particulier, ceux d'un département, ou encore les spécialistes d'un type de commande. Toutes ces associations se sont regroupées en une vaste Confédération générale des architectes français mentionnée, avec environ 5 000 adhérents, dans l'exposé des motifs du projet de loi réglementant la profession d'architecte, présenté par le gouvernement Léon Blum en 1938.
Jusqu'à la loi de 1940, ni l'exercice de la profession ni le port du titre n'étaient protégés : n'importe qui pouvait se parer du titre d'architecte, même s'il ne pouvait y associer la mention D.P.L.G., D.E.A.D. (diplômé de l'École des arts décoratifs) ou D.E.S.A. (diplômé de l'École spéciale d'architecture).
La loi de 1940 et les textes édictés au cours des années suivantes, aboutissement du processus entamé en 1840, ont régi la profession jusqu'à la loi de 1977. La loi de 1940 a assuré la protection du titre d'architecte, mais elle n'a pas réglementé l'acte de construire ni imposé, dans ce dernier, l'intervention de l'architecte : les procès des guérisseurs n'eurent pas d'équivalent du côté des bâtisseurs en tout genre. La profession est représentée par un ordre qui a la capacité d'accorder ou de refuser l'accès à la profession et détient en outre un pouvoir disciplinaire. La profession d'architecte s'exerce sous forme exclusivement libérale ou individuelle. En pratique, en dehors de l'exercice libéral, le salariat dans une agence d'architectes ou dans la fonction publique est toléré. Ce qui a été exclu (et qui est demeuré exclu en 1977, faute de quoi il eût été mis fin à la profession libérale), c'est toute forme de bénéfice né d'une activité commerciale. Entre l'architecte et l'habitant, comme entre le malade et le médecin, s'instaure un colloque singulier, une relation fondée sur la confiance en la responsabilité de l'homme de l'art et sur le « désintéressement » de l'architecte. Dans le cas de l'architecte, la garantie décennale prévue pour la construction confère à la responsabilité un aspect juridique. Le système académique, comme système de formation et de consécration des architectes, associé à l'ordre, comme organisation professionnelle, constituait un ensemble institutionnel cohérent. Mais, en fonction d'une règle sociologique banale, au moment où les systèmes institutionnels sont mis en place, le décalage avec la réalité apparaît, et c'est déjà l'amorce de leur décadence.
De 1940 à 2001
Le « boom » de la construction et la crise de la profession
Après les destructions massives de la guerre et jusqu'à la crise conjoncturelle de 1974, on a beaucoup construit en France. Ce fut le temps de l'urbanisme galopant, placé sous le signe de l'urgence et de la quantité, de la réglementation et de la spéculation.
La profession issue d'un corporatisme malthusien s'est trouvée ainsi affrontée à une demande sans commune mesure avec celle d'avant guerre. Elle s'est trouvée aux prises avec les contraintes issues les unes du marché (l'économie de profit), les autres de l'Administration (la prolifération des normes). Elle était mal préparée à l'importance croissante prise par les données techniques. Les médiateurs, promoteurs publics ou privés, se sont interposés entre l'architecte et l'habitant. Les concurrents, et en particulier les bureaux d'études techniques, ont réussi des empiétements menaçants.
Pour toutes ces raisons, la profession d'architecte a tôt connu une crise qui était d'une part la manifestation d'un phénomène général, la crise de la profession libérale, et d'autre part l'expression d'une incertitude particulière concernant la fonction de l'architecte. Les signes de déclin étaient multiples dès les années 1960 : 70 p. 100 du volume de la construction réalisés sans architecte ; éclatement et fragmentation de la mission traditionnelle répartie en une pluralité d'acteurs en compétition ; multiplicité et ambiguïté des statuts professionnels avec progression du salariat ; hétérogénéité de la « communauté » professionnelle. Le grand voile de la profession libérale dissimulait la disparité des fonctions accomplies par les uns et les autres : il n'y avait plus un mais des architectes, avec des tâches multiples allant de l'expertise la plus pauvre (relation avec l'Administration) à la plus spécifique (conception architecturale et élaboration du projet) et rarement dépositaires d'une mission totale au sens traditionnel.
Même si, dès les années 1950, les cheminements de la réussite s'étaient diversifiés et si la filière académique n'était plus ce qu'elle avait été, les grands patrons occupaient le sommet de la hiérarchie professionnelle. On pouvait, dans les années soixante, évaluer à une trentaine le nombre des architectes ayant une position nationale, tandis que 8 000 architectes étaient inscrits à l'ordre. Au-dessous d'eux se situait la cohorte des bénéficiaires moyens des chasses gardées de la commande publique ou privée. Entre tous les autres architectes, de nombreux clivages étaient encore repérables. Ceux qui, conseils ou consultants, étaient des demi-salariés, en même temps qu'ils avaient une agence, semblaient moins démunis que les libéraux purs soumis aux angoisses des « dents de scie » de la commande.
La dégradation du modèle libéral, les inégalités de fait et le désarroi vécu par les architectes suggéraient deux interrogations auxquelles la loi de 1977 a tenté de répondre. La pratique libérale était-elle ou non condamnée ? Existait-il une expertise rare dans laquelle l'architecte ne soit pas suppléé ou en voie de l'être ?
L'aggiornamento de la profession libérale
La loi de 1977 confirme l'existence de la profession libérale. Le titre demeure protégé et le port du titre soumis à l'inscription sur les tableaux régionaux des architectes. L'Ordre des architectes subsiste, mais le pouvoir disciplinaire est transféré des conseils ordinaux à des « chambres disciplinaires » présidées par un magistrat et composées en majorité de magistrats. Les conditions d'accès à la profession sont élargies. En particulier, l'exercice de la profession est ouvert, sous le titre d'« agréé en architecture », aux professionnels qui exerçaient une activité de conception architecturale avant la publication de la loi. La loi autorise les sociétés d'architecture, que les architectes peuvent constituer soit entre eux, soit avec d'autres personnes physiques, mais dont ils doivent détenir collectivement la majorité du capital. Les modes d'exercice de la profession sont très diversifiés. La profession d'architecte peut être exercée à titre individuel sous forme libérale, mais aussi en qualité de fonctionnaire, d'agent public, de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture, de salarié d'une personne physique ou de droit privé construisant pour son usage propre — à l'exclusion des promoteurs, des organismes financiers et des professionnels de la construction. La loi assure l'extension du champ d'intervention au détriment de l'étendue de la mission.
Elle prévoit enfin la création des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (C.A.U.E.), conçus comme une pièce maîtresse de la politique de sensibilisation à l'architecture et de sauvegarde de la qualité architecturale. Précédés par les expériences pilotes d'« aide architecturale » ou d'« assistance architecturale », les conseils doivent prendre la forme d'une association départementale financée par une taxe sur les permis de construire. La consultation du conseil est gratuite ; elle est initialement prévue comme obligatoire pour tous les maîtres d'ouvrage autorisés à construire sans architecte, mais une loi de 1982 supprime cette obligation.
En redéfinissant la compétence de l'architecte et en portant l'accent sur la conception, la loi devait permettre à la profession de retrouver une identité perdue. La mission pédagogique qui lui était confiée devait y contribuer. L'évolution des années quatre-vingt confirme l'intérêt de l'État pour l'architecture. Mais, alors que la loi de 1977 réglemente l'ensemble de la profession, les mesures postérieures à 1978 concernent des domaines plus restreints, notamment les rapports des architectes avec les maîtres d'ouvrages publics. Les actions en faveur de la maîtrise d'ouvrage publique sont d'abord incitatives et expérimentales, avec la création en 1977 de la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, lieu important de réflexion sur les procédures de conception des équipements publics, puis juridiques, avec la loi du 7 juillet 1985 qui s'inspire fortement des recommandations de la M.I.Q.C.P. Il s'agit notamment de définir le contenu d'une mission de base normalement confiée à l'architecte de toute construction publique et de renforcer la responsabilité du maître d'ouvrage, le programme devant devenir une garantie pour l'architecte. Mais les conditions concrètes d'exécution des contrats ne permettent pas toujours aux architectes de faire respecter leurs nouveaux droits.
Les années 1980 sont aussi celles où l'État s'intéresse le plus à la promotion de l'architecture. En 1980 est créé L'Institut français d'architecture, lieu d'exposition, de documentation et de conférences. Le Salon international de l'architecture se tient pour la première fois en 1988. D'autres manifestations pourraient être citées. Cependant, ces vitrines ne doivent pas masquer une contradiction dont les frustrations provoquées par les Grands Travaux peuvent être considérées comme le symbole : le regain d'intérêt pour l'architecture est indéniable, mais la majorité des architectes sont exclus des avantages qu'il procure. Une oligarchie accapare les profits symboliques et économiques, et la majorité continue à souffrir des faiblesses de la demande et de la rareté des missions valorisantes. La solution pour les générations à venir ne peut reposer que sur une redéfinition des objectifs de la formation.
Les vicissitudes de la formation
Après la guerre, le système d' enseignement, de plus en plus anachronique dans ses méthodes et ses contenus, a été incapable de se rénover. La réforme de 1962 prévoyait la création d'écoles nationales d'architecture, un renforcement de la sélection à l'entrée, la formation des architectes en deux cycles, le premier formant des techniciens du bâtiment. L'idée sous-jacente était celle d'une hiérarchisation de la profession. Les critiques conservatrices ne manquèrent pas : « C'est la fin de l'esprit de l'École », « la fin de l'architecture comme art », « la négation de l'architecte ». Les critiques de gauche non plus, portant sur le caractère antidémocratique de la sélection et l'institutionnalisation des « nègres ». La réforme demeura sans application.
En 1968, le quai Malaquais fut le lieu d'une contestation permanente et aussi d'une activité plastique incessante avec l'atelier d'affiches. La contestation de l'enseignement des Beaux-Arts était assurément plus justifiée et argumentée que tout autre. Mais la crise de 1968 fut suivie d'une phase d'ouverture et d'effervescence où les innovations se multiplièrent sur fond d'anarchie. Les décrets se sont succédé, ainsi que les recours en Conseil d'État et les annulations. Disons, pour être bref, que la réforme Malraux de 1968 a mis fin au système académique et à l'École nationale supérieure des beaux-arts telle qu'en elle-même... Le décret de 1968 visait à la décentralisation et à la diversification de l'enseignement : huit unités pédagogiques ont été mises en place à Paris et treize en province, auxquelles on a accordé l'autonomie de gestion et l'autonomie pédagogique. Depuis, au moins trois changements sont statistiquement vérifiables. Les effectifs étudiants ont plus que quadruplé entre 1966-1967 et 1998-1999, de plus de 4 000 à 18 200. La « place » a considérablement régressé et les études supérieures universitaires (para-architecturales) sont devenues plus fréquentes. Pour le reste, toute tentative de généralisation trahit la diversité des situations concrètes. On peut dire très sommairement que, pendant quelques années, le « discours » s'est substitué au « dessin » – en ce sens que la prolifération dans le champ intellectuel d'un discours « mixte », fortement imprégné de sciences sociales et à forte prétention théorique, n'a pas épargné le champ architectural. Mais, au-delà d'une vulgate, aujourd'hui dépassée, la recherche d'une théorie de l'architecture, le recours à l'archéologie et à l'histoire manifestaient, de la part des nouveaux architectes, la quête, sans cesse renouvelée, d'une identité perdue. La réforme de l'enseignement de 1978 remettait l'accent sur l'apprentissage « pratique » et instituait une sélection au terme de la première année d'études qui fut supprimée dès 1982. La réforme de 1992 crée un corps d'enseignants-chercheurs à temps plein, et redéfinit le contenu des enseignements, l'accent étant mis sur la diversification des formations : une réflexion est engagée sur une filière d'urbaniste ; la formation de paysagistes, la spécialisation dans la conception assistée par ordinateur sont encouragées. L'État tente ainsi de trouver une solution non malthusienne au problème structurel de l'insuffisance de la demande par rapport à l'offre de travail.
En 1997, la durée des études passe de 5 à 6 ans, une place nouvelle est accordée en fin d'études à des enseignements qui aident à découvrir la vie de la profession et un stage obligatoire de 6 mois est instauré. Cette ouverture de la formation sur la réalité des pratiques ne doit cependant pas occulter l'échec d'une tentative de réforme plus radicale, vigoureusement combattue dans les écoles : l'instauration d'une licence d'exercice qui aurait dû permettre de rapprocher le système français de celui qui a cours dans de nombreux pays européens et aux États-Unis. Cette question illustre mieux que toute autre l'incapacité de la profession à s'adapter aux exigences de plus en plus pressantes de la compétition internationale. La directive européenne de 1985 sur l'homogénéisation des enseignements et la libre circulation des diplômés a eu bien peu d'effet sur les programmes des écoles, et les architectes français qui travaillent à l'étranger restent rares.
Le nombre, le statut et l'emploi
Une autre difficulté concerne les déséquilibres structurels entre l'offre et la demande de prestations d'architecture. En décembre 2000, 26 852 diplômés étaient inscrits à l'ordre (dont 18 033 libéraux et 4 309 associés), mais la .croissance des effectifs professionnels au cours des trente dernières années ne s'est accompagnée d'aucune évolution équivalente de la demande qui s'adresse aux architectes. Malgré le monopole d'exercice instauré en 1977, 70 p. 100 de la commande est encore réalisée par d'autres acteurs : les réhabilitations et les maisons individuelles, qui échappent au champ de la loi sur l'architecture, ont connu un essor dont les architectes profitent très peu. Quand ces derniers interviennent, la multiplication du nombre des autres intervenants, notamment les ingénieurs, limite la latitude dont ils disposent encore dans l'élaboration du projet. L'augmentation des effectifs devrait se poursuivre : le nombre moyen de diplômes décernés chaque année depuis 1978 est de 1 200, avec un maximum de 2 861 en 2000. Cependant, de plus en plus de jeunes diplômés ne s'inscrivent pas à l'ordre. Certains se tournent vers des métiers autres que l'architecture : urbanisme bien sûr mais aussi paysage, design, graphisme, publicité, création de logiciels informatiques... où les qualités d'autonomie et de créativité des architectes sont appréciées.
Sur l'ensemble de la profession, l'exercice libéral demeure prédominant, mais avec une inégalité grandissante des situations. Les très petites agences (de moins de 5 personnes) restent les plus nombreuses et se révèlent incapables d'assurer à leurs dirigeants et à leurs éventuels salariés des conditions décentes d'exercice : les architectes sont les professionnels libéraux qui déclarent les bénéfices les plus faibles et, au cours des années 1990, on dénombrait chaque année 15 p. 100 à 18 p. 100 d'entre eux qui ne déclaraient aucune construction à leur mutuelle d'assurance. À côté des milliers de petites agences existent quelques sociétés importantes au sein desquelles les propriétaires tentent de mettre en place une division du travail leur permettant de se recentrer sur l'architecture et la communication. Les tâches administratives et financières sont ainsi assurées par des non-architectes. Cette organisation rationnelle des sociétés doit permettre de lutter contre la concurrence des grosses structures plus nombreuses notamment dans les pays anglo-saxons, mais une autre stratégie consiste à se faire racheter par ces dernières et à en devenir salarié.
La loi de 1977 sur l'architecture et les lois de décentralisation de 1982 ont entraîné une augmentation du nombre des architectes travaillant pour les collectivités locales : environ 750 dans les communes et 250 dans les autres collectivités. De plus, l'État a fait fusionner en 1993 le corps des Architectes des Bâtiments de France et le corps des Urbanistes de l'État, créant le corps des Architectes et Urbanistes de l'État (A.U.E.), qui comprend 350 membres. Mais le nombre total d'architectes travaillant pour l'État reste stable, autour de 1 000 personnes. Si certains occupent une position forte dans le champ de la profession, notamment les 101 architectes-conseils du ministère de l'Équipement, la prééminence dans les services administratifs du corps des ingénieurs n'est pas pour autant remise en question. Ce dernier constat illustre l'incapacité des architectes à s'imposer dans les lieux de pouvoir, ce qui serait pourtant indispensable pour renforcer leurs positions et leur rôle social.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Florent CHAMPY : ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de sciences sociales et docteur en sociologie, chercheur au C.N.R.S. (Centre de sociologie des arts), enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Institut d'études politiques de Sciences Po Paris
- Carol HEITZ : professeur d'histoire de l'art du Moyen Âge à l'université de Paris-X et au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers
- Roland MARTIN : membre de l'Institut
- Raymonde MOULIN : directrice de recherche émérite au CNRS
- Daniel RABREAU : professeur à l'université de Paris-I-Sorbonne, directeur du centre Ledoux
Classification
Médias
Autres références
-
ARCHITECTURE & ÉTAT AU XXe SIÈCLE
- Écrit par Anatole KOPP
- 3 971 mots
- 3 médias
L'intervention de l' État dans le domaine de l' architecture ne constitue pas un phénomène nouveau. De tout temps et sous tous les régimes, l'État est intervenu dans la mesure où toute réalisation architecturale met en cause les intérêts de couches de population bien plus larges que celles...
-
ARCHITECTURE & MUSIQUE
- Écrit par Daniel CHARLES
- 7 428 mots
- 1 média
La comparaison, tentée à maintes reprises, entre architecture et musique a donné lieu en général à des slogans du genre « l'architecture est une musique figée ». On ne s'est pas privé non plus de constater que les œuvres de la « grande » musique occidentale s'étaient peu à peu solidifiées en objets,...
-
INGÉNIEUR ET ARCHITECTE
- Écrit par Antoine PICON
- 4 262 mots
- 5 médias
Au cours de la Renaissance, les figures de l'architecte et de l'ingénieur se confondent pratiquement. Filippo Brunelleschi, généralement considéré comme un des pères fondateurs de l'architecture renaissante, est presque autant ingénieur qu'architecte. Ne conçoit-il pas les machines destinées...
-
ANDROUET DU CERCEAU JACQUES (1520-1586)
- Écrit par Jean GUILLAUME
- 968 mots
Jacques Androuet du Cerceau (appelé le plus souvent « Du Cerceau », dû au motif de l'enseigne de la boutique de son père qui était marchand de vin) fut à la fois un graveur, un dessinateur, un créateur d'ornements, un inventeur d'architectures réelles ou imaginaires et l'auteur du premier ouvrage...
-
ANTHROPOMORPHIQUE ARCHITECTURE
- Écrit par Martine VASSELIN
- 1 060 mots
De tout temps les architectes ont senti qu'il existait des affinités autres que d'usage entre les édifices et les hommes. La critique architecturale l'exprime confusément qui parle de l'ossature, des membres, de la tête ou de l'épiderme d'une construction. Mais cette impression...
-
APPAREIL, architecture
- Écrit par Roland MARTIN
- 4 326 mots
- 2 médias
En termes d' architecture, l'appareil désigne les modalités d' assemblage, de liaison et de mise en valeur des matériaux de la construction. Il est un des éléments essentiels du caractère de l'édifice dont il souligne au premier coup d'œil les structures et souvent la fonction....
-
ARC DE TRIOMPHE
- Écrit par Gilbert-Charles PICARD
- 1 628 mots
- 9 médias
Un arc de triomphe est une structure architectonique composée de deux pylônes reliés par une voûte en plein cintre ; elle supporte par son intermédiaire un attique, base rectangulaire massive qui elle-même porte des statues. L'arc comprend en outre des colonnes plaquées contre les pylônes qui soutiennent...
- Afficher les 40 références
Voir aussi
- ARCHITECTURE THÉORIE DE L'
- FRONTIN, lat. SEXTUS JULIUS FRONTINIUS (30 env.-env. 103)
- PROFESSION LIBÉRALE
- DESSIN D'ARCHITECTURE
- MAQUETTE D'ARCHITECTURE
- ARTS & MÉTIERS, histoire
- PONTELLI BACCIO (1450 env.-1492)
- CAROLINGIEN ART
- BERNWARD D'HILDESHEIM saint (960 env.-1022)
- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE
- ICTINOS (2e moitié Ve s. av. J.-C.)
- ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité
- ORDRE DES ARCHITECTES
- PRIX DE ROME
- INGÉNIEURS
- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVe s.
- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVIe s.
- ANDROUET DU CERCEAU LES
- INÉNI (XVIe s. av. J.-C.)
- TOXIOS
- EURYALOS
- HYPERBIOS
- KINYRAS
- THRASON
- TROPHONIOS
- CHERSIPHRON DE CNOSSOS (VIe s. av. J.-C.)
- THÉODOROS DE SAMOS (VIe s. av. J.-C.)
- PYTHÉOS (IVe s. av. J.-C.)
- CARPION
- SATYROS (IVe s. av. J.-C.)
- SOSTRATOS DE CNIDE (IIIe s. av. J.-C.)
- ROBIRIUS
- RATGAR (IXe s.)
- EIGIL (mort en 822)
- GODERAMNUS (IXe s.)
- HÉZELON (XIe s.)
- JEAN LE LOUP (XIIIe s.)
- JEAN D'ORBAIS (XIIIe s.)
- GAUCHER DE REIMS (XIIIe s.)
- BERNARD DE SOISSONS (XIIIe s.)
- HUGUES LIBERGIER (mort en 1267)
- PORICZER (XVe s.)
- CESARE CESARIANO (XVIe s.)
- JEAN HÜLTZ (XVe s.)
- ULRICH VON ENSINGEN (1350/60-1419)
- MATTHÄUS BÖBLINGER (XIVe s.)
- STETHAIMER HANS (actif entre 1431 et 1459)
- JACQUES DE LONGJUMEAU (XIVe s.)
- NICOLAS DE CHAUMES (XIVe s.)
- PIERRE DE CHELLES (XIVe s.)
- ENSEIGNEMENT DE L'ARCHITECTURE
- ROME, des origines à la République
- ROME, l'Empire romain
- ARCHITECTURE DU XIXe SIÈCLE
- ARCHITECTURE DU XVIIIe SIÈCLE
- ARCHITECTURE DU XVIIe SIÈCLE
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge
- FRANÇAISE ARCHITECTURE
- ITALIENNE ARCHITECTURE
- ROMAINE ARCHITECTURE
- GRECQUE ARCHITECTURE
- ANTIQUITÉ, architecture
- ANTIQUITÉ TARDIVE & HAUT MOYEN ÂGE, architecture
- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA
- ROMANE ARCHITECTURE
- GOTHIQUE ARCHITECTURE
- ARCHITECTURE DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE
- ÉGYPTIENNE ARCHITECTURE
- ARCHITECTURE RELIGIEUSE