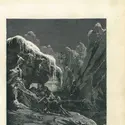ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
Article modifié le
Les œuvres
Les écrits d'Aristote se divisent en deux groupes : d'une part, des œuvres publiées par Aristote, mais aujourd'hui perdues ; d'autre part, des œuvres qui n'ont pas été publiées par Aristote et n'étaient même pas destinées à la publication, mais qui ont été recueillies et conservées.
« Aristote perdu »
Le premier groupe d'écrits fait partie des « œuvres exotériques », expression employée par Aristote lui-même pour désigner des œuvres destinées à un public plus large que celui du Lycée. Ces œuvres ont été perdues, comme beaucoup d'œuvres antiques, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Nous en connaissons néanmoins les titres par les listes conservées des œuvres d'Aristote, et nous avons une idée de leur contenu par les citations ou les imitations qu'en font les auteurs anciens postérieurs.
Ces œuvres sont, par leur forme littéraire, comparables à celles de Platon, et plusieurs d'entre elles semblent avoir été des dialogues. C'est sans aucun doute à elles que faisait allusion Cicéron lorsqu'il célébrait la « suavité » du style d'Aristote et en comparait le cours à un « fleuve d'or » (Topiques, I, 3 ; Acad., II, 38, 119). Mais leur contenu, qu'on travaille à reconstituer depuis un siècle, n'est pas sans poser des problèmes aux historiens. Car cet « Aristote perdu » n'a rien d'« aristotélicien » au sens de l' aristotélisme des œuvres conservées ; il développe des thèmes platoniciens et renchérit même parfois sur son maître (ainsi, dans le dialogueEudème ou De l'âme, il compare les rapports de l'âme et du corps à une union contre nature, semblable au supplice que les pirates tyrrhéniens infligeaient à leurs prisonniers en les enchaînant vivants à un cadavre). Constatant qu'Aristote, dans ses œuvres non destinées à la publication, critique ses anciens amis platoniciens, on a pu se demander s'il ne professait pas deux vérités : l'une « exotérique », destinée au grand public, l'autre « ésotérique », réservée aux étudiants du Lycée. Mais on pense généralement aujourd'hui que ces œuvres littéraires sont aussi des œuvres de jeunesse, écrites à une époque où Aristote était encore membre de l'Académie, donc encore sous l'influence platonicienne. On s'est même servi de ces fragments pour déterminer ce que l'on croit être le point de départ de l'évolution d'Aristote.
Les principales de ces œuvres perdues sont : Eudème ou De l'âme (dans la tradition du Phédonde Platon), De la philosophie (sorte d'écrit programmatique, où se laissent déjà reconnaître certains thèmes de la Métaphysique), le Protreptique (exhortation à la vie philosophique), Gryllos ou De la rhétorique (contre Isocrate), De la justice (où s'annoncent certains thèmes de la Politique), De la bonne naissance, un Banquet, etc.
Œuvres conservées
Le second groupe est constitué par une masse de manuscrits d'Aristote, représentant pour la plus grande part, semble-t-il, les notes dont il se servait pour professer ses cours au Lycée. Ces œuvres sont dites ésotériques ou, mieux, acroamatiques (c'est-à-dire destinées à l'enseignement oral). Dès l'Antiquité se répandit un récit des plus romanesques sur la façon dont ces manuscrits sont parvenus à la postérité (Plutarque, Vie de Sylla, 26 ; Strabon, XIII, 1, 54). Les manuscrits d'Aristote et de Théophraste auraient été légués par ce dernier à son ancien condisciple Nélée ; les héritiers de Nélée, gens ignorants, les auraient enfouis dans une cave de Skepsis pour les soustraire à l'avidité bibliophilique des rois de Pergame ; longtemps après, au ier siècle avant J.-C., leurs descendants les auraient vendus à prix d'or au péripatéticien Apellicon de Téos, qui les emporta à Athènes. Finalement, au cours de la guerre contre Mithridate, Sylla s'empara de la bibliothèque d'Apellicon, qu'il transporta à Rome, où elle fut achetée par le grammairien Tyrannion : c'est de lui que le dernier scolarque (chef d'école) du Lycée, Andronicos de Rhodes, acquit les copies qui lui permirent de publier, vers 60 avant J.-C., la première édition des œuvres acroamatiques d'Aristote et de Théophraste.
Ce récit est partiellement invraisemblable. On comprendrait mal, en effet, que le Lycée, qui subsista sans interruption après Aristote, se soit laissé dépouiller des manuscrits du fondateur de l'école. Il reste que la première grande édition des œuvres d'Aristote est celle d'Andronicos, même si c'est lui qui, pour en accentuer la nouveauté, a répandu la légende que nous avons rapportée plus haut. C'est à partir d'Andronicos, donc près de trois siècles après la mort du philosophe, que les œuvres d'Aristote vont commencer leur véritable carrière en donnant lieu à d'innombrables commentaires. C'est encore dans la forme et généralement sous le titre que leur a donnés Andronicos que nous lisons aujourd'hui les œuvres d'Aristote.
Ces faits ne sont pas sans conséquence pour l'interprétation. Il en résulte en effet que les livres d'Aristote que nous connaissons aujourd'hui n'ont jamais été édités par Aristote lui-même. Aristote n'est pas, par exemple, l'auteur de la Métaphysique, mais d'une douzaine de petits traités (sur la théorie des causes dans l'histoire de la philosophie, sur les principales difficultés philosophiques, sur les significations multiples, sur l'acte et la puissance, sur l'être et l'essence, sur Dieu, etc.) que les éditeurs ont cru bon de rassembler et auxquels, faute d'indications expresses d'Aristote, ils ont donné le titre partiellement arbitraire de Métaphysique(c'est-à-dire traité qui doit se lire après la Physique). Il ne faudra donc pas s'étonner si la Métaphysique et les autres œuvres d'Aristote se présentent le plus souvent comme des recueils d'études plus ou moins indépendantes, sans progression saisissable de l'une à l'autre, comportant des redites et parfois même des contradictions. Mais il ne faut pas en faire grief à Aristote, qui, sans aucun doute, n'aurait jamais livré ces ouvrages au public sous cette forme inachevée.
Andronicos a, d'autre part, publié les traités dans un ordre qui veut être à la fois logique et didactique (ainsi la logique, propédeutique au savoir, vient avant les traités proprement scientifiques, la Métaphysique vient après la Physique, etc.). Cet ordre systématique n'est pas sans inconvénient si on l'admet sans critique : en se substituant inévitablement à l'ordre chronologique de la composition des traités, déjà masqué par le groupement sous un même titre de dissertations d'époques différentes, il n'a pas peu contribué à figer le corpus aristotélicien en une totalité impersonnelle dont on a vite oublié le lien avec le philosophe nommé Aristote. Ainsi est-ce en grande partie d'une circonstance tout extérieure de publication, en même temps que de la nature scolaire des œuvres conservées, qu'est né le caractère systématique souvent attribué par les interprètes à la philosophie d'Aristote.
L'interprétation a enfin intérêt à tenir compte, non seulement de la finalité didactique de ces textes, mais aussi des particularités de l'enseignement aristotélicien, qui, dans la tradition socratique, devait être plus dialogué que monologique : certes, ce n'est plus le maître qui dialogue avec ses disciples ; mais les thèses en présence, souvent empruntées aux philosophes du passé, dialoguent dans l'âme et l'œuvre du maître. Ainsi assiste-t-on, dans l'œuvre d'Aristote, non à l'exposé dogmatique d'une doctrine, mais au devenir parfois laborieux d'une vérité qui se fraie son chemin à travers les difficultés et les contradictions. On ne s'étonnera donc pas de trouver bien peu de syllogismes dans les traités d'Aristote, mais de les voir plutôt s'ordonner selon une structure qu'Aristote appelait lui-même « dialectique », c'est-à-dire procédant à la façon du dialogue, par un échange d'arguments pour et contre.
Liste des œuvres
Il nous reste à rapporter la liste des œuvres conservées d'Aristote. Le plus simple est ici de reprendre les titres, devenus traditionnels, et même l'ordre de l'édition d'Andronicos de Rhodes. Cet ordre a été repris par Bekker dans la grande édition de l'Académie de Berlin (vol. I et II, 1831).
Organon(ce terme, qui signifie instrument, est par exception postérieur à Andronicos et sert à désigner l'ensemble des traités logiques) : 1. Catégories.2. De l'interprétation (en réalité, théorie de la proposition). 3. Premiers Analytiques (deux livres). 4. Seconds Analytiques (deux livres). 5. Topiques (huit livres). 6. Réfutations sophistiques. Physique (huit livres). Traité Du Ciel (quatre livres). De la génération et de la corruption (deux livres). Météorologiques (quatre livres, dont le quatrième inauthentique). Traité De l'âme (trois livres). Petits traités biologiques (Du sens et des sensibles, De la mémoire et de la réminiscence, Du sommeil et de la veille, Des songes, De l'interprétation des songes, De la longévité et de la brièveté de la vie, De la jeunesse et de la vieillesse, De la vie et de la mort, De la respiration). Histoire des animaux (en réalité, recherche sur les animaux : dix livres). Des parties des animaux (quatre livres). Du mouvement des animaux. De la marche des animaux. De la génération des animaux (cinq livres). Problèmes (trente-huit livres). Sur Xénophane, Mélissos et Gorgias.Métaphysique (quatorze livres). Éthique à Nicomaque (dix livres). Grande Morale(deux livres). Éthique à Eudème (quatre livres). Politique (huit livres). Économiques (deux livres). Rhétorique (trois livres). Poétique.
Nous n'avons exclu de cette liste que quelques rares ouvrages manifestement apocryphes : le traité Du mondeet la Rhétorique à Alexandre. Nous avons maintenu les Problèmes (collection de problèmes de mécanique, de médecine, de théorie musicale, etc., avec leurs solutions), bien que seuls quelques-uns d'entre eux remontent à Aristote, les autres ayant été ajoutés au cours des âges.
Il convient d'ajouter à cette liste la Constitution d'Athènes (l'une des 158 constitutions rassemblées par Aristote), retrouvée sur un papyrus en 1890 par E. G. Kenyon.
Évolution supposée d'Aristote
Depuis la fin du xixe siècle, et surtout depuis les ouvrages décisifs de Werner Jaeger (1912 et 1923), les érudits se sont efforcés de discerner dans cette masse d'écrits non datés une évolution de la pensée d'Aristote. Nous avons pressenti plus haut la difficulté de la tâche. La plupart des ouvrages édités par Andronicos rassemblent des écrits d'époques différentes (ainsi la Métaphysique s'étend sur presque toute la carrière d'Aristote ; de même pour la Politique), et c'est souvent à l'intérieur d'un même chapitre qu'une analyse attentive permet de découvrir des couches d'époques différentes. Faute de pouvoir s'appuyer, comme cela avait été le cas pour Platon, sur des allusions historiques, ou sur des critères stylistiques, Jaeger a eu recours à une hypothèse ingénieuse : le corpus d'Aristote pris dans son ensemble renferme, remarque-t-il, des contradictions ; or Aristote ne peut avoir soutenu simultanément des thèses contradictoires ; on admettra donc que ces thèses ne sont pas simultanées, mais successives et, plus précisément, que, de deux thèses contradictoires, la thèse la plus platonisante est la plus ancienne. La vraisemblance qui était à la base de cette dernière règle paraissait du reste confirmée par le platonisme des œuvres perdues, généralement considérées comme œuvres de jeunesse.
Cette hypothèse est séduisante, mais partiellement arbitraire. On pourrait imaginer, à l'inverse, un Aristote dans l'ardeur de la jeunesse s'opposant violemment à son maître et n'hésitant pas, plus tard, lorsqu'il est en possession des principes de sa propre philosophie, à reprendre à son compte telle ou telle thèse platonicienne. De fait, c'est dans les Topiques (ouvrage considéré comme ancien parce qu'il porte encore la marque des discussions de l'Académie) et dans l'Éthique à Eudème (première version du cours d'Aristote sur l'éthique) que l'on trouve l'une des thèses les plus antiplatoniciennes : celle de l'équivocité de l'Être et du Bien. Dans un domaine seulement, celui de la psychologie, on est arrivé à une quasi-certitude depuis l'ouvrage de F. Nuyens (1939) : dans un premier moment (Eudème, Protreptique), Aristote décrit le rapport de l'âme et du corps comme une juxtaposition contre nature ; dans une phase intermédiaire, il considère le corps comme un instrument de l'âme, qui est au corps ce que le pilote est au navire ; enfin, dans le traité De l'âme, il fait un pas de plus dans le sens d'une unité substantielle de l'âme et du corps, en faisant de l'âme la forme du corps. Certains de ses disciples iront plus loin encore dans le même sens, en professant que l'âme est de nature corporelle.
Mais il est peu de domaines dans l'œuvre d'Aristote où une évolution linéaire de cette sorte se laisse dégager. On se trouve le plus souvent en présence de cheminements parallèles ou qui s'entrecroisent et qui n'ont au début qu'un caractère exploratoire : là où la voie paraît libre et le terrain fécond, Aristote s'engage tout entier, et il ne se préoccupera que plus tard, avec plus ou moins de succès, d'unifier les résultats de ces démarches disparates. La philosophie d'Aristote ne déroule pas des conséquences à partir de principes, ni ne déduit la pluralité de l'unité ; elle est d'emblée pluraliste, et son unité n'est que « recherchée ». Ces traits, qui se dégagent déjà de la structure lacunaire et dispersée de l'œuvre d'Aristote, vont se retrouver dans sa pensée.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre AUBENQUE : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne
Classification
Médias
Autres références
-
DE L'ÂME, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 957 mots
Qu'est-ce que l'âme ? La question peut nous paraître incongrue, mais pour l'Antiquité elle était essentielle à la constitution d'une science du vivant (l'âme se définit comme ce qui « anime » un corps, au principe donc de ce qui distingue l'animal du végétal), et partant...
-
ÉTHIQUE À NICOMAQUE, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 943 mots
- 1 média
Le corpus aristotélicien comprend traditionnellement trois ensembles consacrés à la philosophie morale : l'Éthique à Nicomaque, l'Éthique à Eudème et la Grande Morale, ou Grands Livres d'Éthique, dont l'attribution à Aristote (385 env.-322 env. av. J.-C.) est aujourd'hui très...
-
HISTOIRE DES ANIMAUX (Aristote)
- Écrit par Pierre LOUIS
- 325 mots
La date de 335 avant notre ère est très importante dans l'histoire de la science grecque et de la science en général. Elle correspond pourtant à une période assez sombre de l'histoire de la Grèce ancienne. Trois années plus tôt, en — 338, la défaite des Athéniens et des Thébains, battus par Philippe...
-
ORGANON, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 821 mots
- 1 média
Dans l'œuvre immense qui nous reste d'Aristote (385 env.-322 av. J.-C.), ou qui est publiée sous son nom, on peut distinguer trois ensembles : les écrits qui relèvent directement de la connaissance scientifique (dont De l'âme) ; ceux qui traitent plutôt des conduites humaines...
-
POÉTIQUE, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 907 mots
- 1 média
-
ACADÉMIE ANTIQUE
- Écrit par Jean-Paul DUMONT
- 1 376 mots
- 1 média
-
ACTE, philosophie
- Écrit par Paul GILBERT
- 1 282 mots
Leterme « acte » reprend le latin actus, qui traduit deux termes d'Aristote : energeia (« qui est en plein travail ») et entelecheia (« qui séjourne dans sa fin »). Ces deux mots du vocabulaire aristotélicien sont souvent confondus par les traducteurs, mais déjà parfois par Aristote... -
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...de la sensibilité humaine. Ainsi le « pathique » est-il tantôt finement analysé en tant qu'obstacle, mais aussi ressource de la vie éthique, comme chez Aristote, en particulier dans l'Éthique à Nicomaque, tantôt entièrement rejeté comme obnubilant et obscurcissant – comme si tout affect se confondait... -
ÂGE DE LA TERRE
- Écrit par Pascal RICHET
- 5 145 mots
- 5 médias
- Afficher les 178 références
Voir aussi
- ATTRIBUT & PRÉDICAT, logique
- CONTRADICTION
- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE
- ACTION DRAMATIQUE
- TRAGÉDIE THÉORIES DE LA
- OLIGARCHIE
- SENSIBLE
- TÉLÉOLOGIE
- DÉDUCTION
- ANTIQUE PHILOSOPHIE
- UNIVERSEL
- COSMOLOGIES, philosophie
- SAVOIR
- GRECQUE PHILOSOPHIE
- PRINCIPE
- PLURALITÉ, philosophie
- INSTANT
- MULTIPLICITÉ, philosophie
- MIMÉSIS
- PREMIER MOTEUR
- NOÛS
- MÉDIATION
- MAÎTRE-ESCLAVE RELATION
- AXIOME
- GENRE, logique
- DIANOIA
- AMITIÉ
- IDÉES THÉORIE DES
- PRUDENCE
- SENSATION, philosophie
- PÉTITION DE PRINCIPE
- PRÉSOCRATIQUES PHILOSOPHES
- ACTE & PUISSANCE, philosophie
- LOGIQUE HISTOIRE DE LA
- TOPIQUES
- MOYEN TERME, logique
- PHILOSOPHIE POLITIQUE
- IMITATION, poétique
- PRÉMISSES, logique
- TOPOÏ, rhétorique