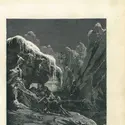ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
Article modifié le
Aristote, critique de Platon
Quelle que soit l'incertitude qui règne sur l'évolution de la pensée d'Aristote, on a tout lieu de croire qu'élevé dans l'école platonicienne il a d'abord eu le souci de préciser les raisons philosophiques de sa rupture avec elle. Reprenant un mot de Platon au sujet d'Homère, il déclare solennellement, au début de l'Éthique à Nicomaque, que, si l'amitié et la vérité lui sont chères l'une et l'autre, il doit néanmoins préférer la seconde à la première (I, 1096 a 11-17).
Critique de la théorie des Idées
Aristote critique la théorie platonicienne des Idées aux livres A, M et N de la Métaphysique : dans le premier de ces textes, il parle des platoniciens à la première personne du pluriel, preuve qu'il se considérait encore comme un des leurs au moment où il l'écrivit. De fait, la critique de la théorie des Idées était déjà devenue un thème classique de discussion à l'intérieur de l'Académie : le premier témoignage littéraire de cette mise en question, qui devait donner lieu bientôt à des séries d'arguments pour et contre de plus en plus stéréotypés, nous est fourni par Platon lui-même, dans la première partie du Parménide. Aristote avait contribué activement à ce débat dans un traité très technique, le De Ideis, malheureusement perdu, mais dont Alexandre d'Aphrodise nous a conservé de larges fragments dans son commentaire de Métaphysique, A, 9, qui n'en est que le résumé.
Aux livres M et N de la Métaphysique, où Aristote parle cette fois des platoniciens à la troisième personne du pluriel, la critique devient plus acerbe encore et s'étend aux développements que Platon avait donnés à sa doctrine dans son enseignement oral, développements que nous connaissons surtout, à vrai dire, par l'exposé critique qu'en donne Aristote. Platon y aurait affirmé que les Idées sont des Nombres, non certes des nombres mathématiques, mais des Nombres idéaux, c'est-à-dire des Idées de Nombres, comme l'Unité, la Dualité (ou Dyade). Platon s'efforçait ensuite d'engendrer les Nombres idéaux eux-mêmes à partir de deux principes, l'Un, ou principe formel, et l'Inégal, ou Dyade indéfinie du Grand et du Petit, qui jouait, selon Aristote, le rôle de principe matériel. Ce mathématisme (« les mathématiques sont devenues pour les modernes toute la philosophie », Mét., A, 9, 992 a 31) répugnait d'autant plus à Aristote qu'il avait pris chez les deux successeurs de Platon à la tête de l'Académie, Speusippe et Xénocrate, un tour souvent outré.
Mais les motifs profonds de l'opposition d'Aristote au platonisme peuvent déjà se déduire de la critique qu'il adressait à la théorie des Idées sous sa forme classique. Une tradition, dont on trouve l'illustration dans la célèbre fresque de Raphaël L'École d'Athènes (où l'on voit Platon lever son index vers le ciel, et Aristote abaisser sa main vers la terre), tendrait à faire croire qu'Aristote fait redescendre sur la Terre une spéculation que Platon aurait préalablement convertie à la contemplation du divin. La situation d'Aristote à l'égard du platonisme est en réalité plus complexe. Il reste dans une tradition qu'il interprète lui-même dans un sens dualiste : celle de Parménide et de Platon, pour qui existe une coupure (chôrismos) fondamentale entre un domaine de réalités stables, immuables, par là même objectivables dans le discours et dans la science, et un domaine de réalités mouvantes, « indéterminées », qui, réfractaires à leur fixation dans le langage rigoureux et cohérent de la science, ne sont accessibles qu'à l'opinion. Aristote ne renonce pas à cette coupure ; simplement, il la déplace ; au lieu de séparer deux mondes comme chez Platon, un monde intelligible et un monde sensible, elle devient désormais intérieure au seul monde qu'Aristote tienne pour réel, séparant alors deux régions de ce monde : la région céleste caractérisée, à défaut d'immutabilité proprement dite, par la régularité immuable des mouvements qui s'y produisent, et la région – ou, au sens étroit, le « monde » – sublunaire (c'est-à-dire située au-dessous de la sphère de la Lune), domaine des choses qui « naissent et périssent » et sont soumises à la contingence et au hasard.
Dès lors, l'intelligible n'est plus transcendant au monde, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'il lui est immanent, comme l'admettront les théologies du Dieu cosmique, mais qu'il en est une partie : la dualité si fortement affirmée des deux mondes, ou plus exactement des deux régions du monde, rétablit un substitut de la transcendance platonicienne ; mais cette transcendance est désormais intramondaine. La conséquence qu'en tire Aristote est qu'on peut faire désormais l'économie de l'hypothèse des Idées. Les Idées platoniciennes avaient été posées, notamment dans le Cratyle, comme conditions de possibilité de la science : immuables, elles fournissent à la science l'objet stable que le sensible, toujours en mouvement, ne parviendrait pas à lui offrir. Et, pourtant, c'est le sensible qui, à travers les Idées, doit demeurer visé par la connaissance, faute de quoi la science des Idées, comme le pressent Platon dans la première partie du Parménide, ne serait que l'Idée de la science, et non la seule science qui nous importe, c'est-à-dire la science des choses de chez nous. Les Idées platoniciennes devaient donc répondre à deux exigences : d'une part, être séparées du sensible ; d'autre part, être identiques aux choses sensibles, avoir le même nom qu'elles ; ainsi, le Lit en soi doit-il en quelque façon être le même que les lits sensibles, sans quoi il ne serait pas l'Idée de ces lits. On peut résumer grossièrement la critique d'Aristote en disant qu'elle tend à dissocier ces deux exigences (ou bien les Idées sont séparées, ou bien elles sont identiques au sensible), puis à montrer, sous forme de dilemme, que chacune de ces exigences, prise dans sa rigueur, détruit la fonction même de l'Idée : 1o si les Idées sont séparées, elles sont inconnaissables pour nous ; 2o si les Idées sont identiques au sensible, elles comportent la même infirmité que lui et sont derechef inconnaissables, quoique pour la raison inverse de la précédente. Pas plus dans un cas que dans l'autre, les Idées ne réalisent leur fonction, qui était d'être, non principe d'intelligibilité en soi, mais principe d'intelligibilité du sensible. Dès lors, on peut en faire l'économie.
L'Idée platonicienne du Bien n'est pas davantage épargnée par Aristote, qui la juge incapable de fonder l'éthique et, plus généralement, de guider les actions humaines concrètes.
Aristote et la philosophie antérieure
Les critiques d'Aristote à l'égard de celui qui avait été son maître et à qui il devait certainement beaucoup, à commencer par une certaine idée de la science et de la philosophie comme science, ont été souvent sévèrement jugées par la tradition. Aristote a été taxé d'ingratitude et de mauvaise foi. On remarquera néanmoins que sa critique du platonisme reste, dans son principe, très différente de celle qu'il adresse aux présocratiques : il est souvent arrivé à ceux-ci de « ne pas comprendre le sens de leurs propres paroles » (Gén. et corr., I, 1, 314 a 13) ; c'est en quelque sorte malgré eux, « sous la contrainte de la vérité » (Mét., A, 3, 984 b 10), et non par la logique de discours qui demeurent « bégayants » (ibid., 4, 985 a 5), qu'ils ont découvert successivement trois des quatre types de causes qui structurent le mouvement de l'Univers : la cause matérielle (Milésiens), la cause formelle (Éléates, Pythagore), la cause efficiente (Anaxagore), la quatrième cause – ou cause finale – étant présentée par Aristote comme sa découverte propre. Avec Aristote, une philosophie qui, jusqu'alors, se cherche parvient à la conscience de sa complétude et se croit en mesure d'annoncer son prochain achèvement (Aristote, rapporte Cicéron dans les Tusculanes, III, 28, 69, « affirme que la philosophie sera bientôt tout à fait achevée », fr. 53 Rose).
Mais où situer le platonisme dans ce schéma (qui, soit dit en passant, représente la première tentative pour penser comme un tout intelligible l'histoire de la philosophie) ? En un sens, l'Idée platonicienne n'est ni cause efficiente (car elle n'explique pas le mouvement), ni cause formelle (car la véritable forme est immanente au sensible), ni cause finale (car les mathématiques, à quoi se réduit finalement la théorie des Idées, ne nous apprennent pas ce qui est bien ou mal), ni, bien entendu, cause matérielle. Le platonisme pourrait ainsi apparaître comme un recul par rapport aux philosophies préplatoniciennes. Mais, si le platonisme est faux, ou plutôt inefficace, dans le détail, c'est qu'il n'est pas à la hauteur de sa propre visée : saisir le monde comme cosmos, c'est-à-dire comme un tout ordonné et intelligible, fixer à l'homme sa place dans cet ordre, faire de la science, savoir acquis sur le cosmos par l'homme, l'agent privilégié de leur relation. Cette visée avait en même temps une pointe polémique : restaurer l'unité de l'homme avec lui-même, et de l'homme avec la nature, que la critique sophistique du langage, de la science et de l'État, réduits par elle au rang de conventions humaines, avait ébranlées. Le programme d'Aristote ne sera pas très différent : mais il estimera que Platon n'a réalisé le sien que de façon fictive, transposant dans un autre monde l'ordre et l'unité dont ont besoin l'homme et ce monde-ci. En définissant la science comme science des Idées, Platon rend impossible toute recherche sur la nature (Mét., A, 9, 992 b 8-9), condamnant dès lors la physique à n'être que vaine ou mythique. Aristote ne veut pas d'une solution aussi coûteuse. D'où l'impression qu'il donne souvent de vouloir remonter en deçà de Platon pour renouer le fil d'une tradition que Platon aurait interrompue et, en tout cas, pour reprendre à nouveaux frais l'examen de problèmes que le platonisme avait, selon lui, masqués plutôt que résolus.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre AUBENQUE : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne
Classification
Médias
Autres références
-
DE L'ÂME, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 957 mots
Qu'est-ce que l'âme ? La question peut nous paraître incongrue, mais pour l'Antiquité elle était essentielle à la constitution d'une science du vivant (l'âme se définit comme ce qui « anime » un corps, au principe donc de ce qui distingue l'animal du végétal), et partant...
-
ÉTHIQUE À NICOMAQUE, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 943 mots
- 1 média
Le corpus aristotélicien comprend traditionnellement trois ensembles consacrés à la philosophie morale : l'Éthique à Nicomaque, l'Éthique à Eudème et la Grande Morale, ou Grands Livres d'Éthique, dont l'attribution à Aristote (385 env.-322 env. av. J.-C.) est aujourd'hui très...
-
HISTOIRE DES ANIMAUX (Aristote)
- Écrit par Pierre LOUIS
- 325 mots
La date de 335 avant notre ère est très importante dans l'histoire de la science grecque et de la science en général. Elle correspond pourtant à une période assez sombre de l'histoire de la Grèce ancienne. Trois années plus tôt, en — 338, la défaite des Athéniens et des Thébains, battus par Philippe...
-
ORGANON, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 821 mots
- 1 média
Dans l'œuvre immense qui nous reste d'Aristote (385 env.-322 av. J.-C.), ou qui est publiée sous son nom, on peut distinguer trois ensembles : les écrits qui relèvent directement de la connaissance scientifique (dont De l'âme) ; ceux qui traitent plutôt des conduites humaines...
-
POÉTIQUE, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 907 mots
- 1 média
-
ACADÉMIE ANTIQUE
- Écrit par Jean-Paul DUMONT
- 1 376 mots
- 1 média
-
ACTE, philosophie
- Écrit par Paul GILBERT
- 1 282 mots
Leterme « acte » reprend le latin actus, qui traduit deux termes d'Aristote : energeia (« qui est en plein travail ») et entelecheia (« qui séjourne dans sa fin »). Ces deux mots du vocabulaire aristotélicien sont souvent confondus par les traducteurs, mais déjà parfois par Aristote... -
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...de la sensibilité humaine. Ainsi le « pathique » est-il tantôt finement analysé en tant qu'obstacle, mais aussi ressource de la vie éthique, comme chez Aristote, en particulier dans l'Éthique à Nicomaque, tantôt entièrement rejeté comme obnubilant et obscurcissant – comme si tout affect se confondait... -
ÂGE DE LA TERRE
- Écrit par Pascal RICHET
- 5 145 mots
- 5 médias
- Afficher les 178 références
Voir aussi
- ATTRIBUT & PRÉDICAT, logique
- CONTRADICTION
- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE
- ACTION DRAMATIQUE
- TRAGÉDIE THÉORIES DE LA
- OLIGARCHIE
- SENSIBLE
- TÉLÉOLOGIE
- DÉDUCTION
- ANTIQUE PHILOSOPHIE
- UNIVERSEL
- COSMOLOGIES, philosophie
- SAVOIR
- GRECQUE PHILOSOPHIE
- PRINCIPE
- PLURALITÉ, philosophie
- INSTANT
- MULTIPLICITÉ, philosophie
- MIMÉSIS
- PREMIER MOTEUR
- NOÛS
- MÉDIATION
- MAÎTRE-ESCLAVE RELATION
- AXIOME
- GENRE, logique
- DIANOIA
- AMITIÉ
- IDÉES THÉORIE DES
- PRUDENCE
- SENSATION, philosophie
- PÉTITION DE PRINCIPE
- PRÉSOCRATIQUES PHILOSOPHES
- ACTE & PUISSANCE, philosophie
- LOGIQUE HISTOIRE DE LA
- TOPIQUES
- MOYEN TERME, logique
- PHILOSOPHIE POLITIQUE
- IMITATION, poétique
- PRÉMISSES, logique
- TOPOÏ, rhétorique