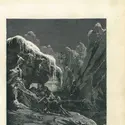ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
Article modifié le
La logique et les autres arts du langage
La logique
Le nom de logique n'est pas aristotélicien, mais remonterait, selon Sextus Empiricus (Adv. Math., VII, 16), à l'académicien Xénocrate. Les platoniciens – Aristote nous le rappelle dans un texte remontant à une période ancienne de son œuvre (Top., I, 14, 105 b 20) – distinguaient trois sortes de propositions et de problèmes : éthiques, physiques, dialectiques (ou logiques). Cette tripartition se retrouvera dans les classifications stoïcienne et épicurienne du savoir. Mais Aristote lui en préfère une autre, selon laquelle il distingue philosophie théorique, philosophie pratique (éthique, politique) et philosophie poétique(celle qui s'occupe de la production, poièsis, en particulier d'œuvres d'art) et subdivise à son tour la philosophie théorique en théologie, mathématiques et physique (Mét., E, 1, 1026 a 13). Cette division aristotélicienne du savoir se caractérise par l'absence, à première vue étonnante, des deux disciplines à l'instauration et au développement desquelles Aristote a précisément attaché son nom : la métaphysique et la logique.
De la première absence nous essaierons plus loin de proposer une explication. Quant à l'omission de la logique, on a cru en trouver la raison dans un texte, à vrai dire obscur, de la Métaphysique (Γ, 3, 1005 b 25), selon lequel l'étude de l'analytique (théorie du raisonnement) devrait précéder celle des autres sciences. Les commentateurs des premiers siècles de l'ère chrétienne diront plus clairement que la logique n'est pas une science, mais un instrument, organon, de la science (d'où le titre d'Organon que l'on donnera à l'ensemble des écrits logiques d'Aristote). Cette façon de s'exprimer est sans doute plus exacte que celle de Ravaisson (1837), selon laquelle la logique ne serait pas une science, mais la forme de la science ; car Aristote n'est jamais parvenu à l'idée claire d'une logique formelle, impliquant une séparation rigoureuse de la forme du discours et de son contenu, au sens où l'entendront les modernes.
Il reste qu'Aristote a attaché une attention particulière au langage, logos, le langage étant selon lui la différence spécifique de l'espèce humaine : l'homme est le ζ̃ώον λ́ογον ε'́χον, expression dont la tradition a fait animal rationale, animal raisonnable, mais qui signifie originellement que l'homme est l'animal qui a la parole. Dans cet intérêt accordé au langage pour lui-même, Aristote avait eu pour précurseurs les sophistes : en accumulant les arguments, voire les arguties, non « par suite d'un embarras réel », mais « pour le plaisir de parler » (Mét., Γ, 5, 1009 a 16-22), les sophistes avaient révélé la puissance propre du discours, capable non seulement d'exprimer, mais aussi de dissimuler les rapports réels. Certes, Aristote, comme Platon, ne professe que mépris pour l'immoralisme des sophistes. Mais il est permis de penser que la mise entre parenthèses immoraliste de la vérité du discours a mis Aristote sur la voie de sa mise entre parenthèses méthodologique.
La rhétorique
Très remarquable à cet égard est la Rhétorique d'Aristote, que la tradition n'a pas rangée dans l'Organon, mais qui n'en est pas moins une partie importante de la théorie du logos. À la différence du discours dialectique, qui s'adresse à l'homme en tant seulement qu'il peut répondre à ce qu'on lui dit, c'est-à-dire à l'homme en tant que parlant, le discours rhétorique s'adresse à l'homme total, capable de jugement, mais aussi de passions, que, selon les circonstances, l'orateur doit savoir apaiser ou, au contraire, exciter. C'est pourquoi Aristote divise la rhétorique en trois genres, non pas tant d'après le contenu du discours que d'après la relation du discours à l'auditeur, relation qui reflète elle-même les trois attitudes possibles à l'égard du temps : le jugement sur le passé appelle le genre judiciaire ; l'attitude spectatrice et non critique à l'égard du présent favorise le panégyrique et le blâme, objets du genre épidictique ; enfin, la délibération sur l'avenir, tâche qui incombe à Athènes à l'Assemblée du peuple, suscite le genre délibératif (Rhét., I, 3, 1358 b 13-20). On ne s'étonnera donc pas que le discours rhétorique suppose, pour être efficace, une certaine psychologie pratique, connaissance de la passion (pathos) et des mœurs (éthos) de ceux auxquels il s'adresse. C'est pourquoi le livre II de la Rhétorique est occupé, pour sa plus grande part, par un traité empirique du caractère et des passions, où la subtilité des analyses « eidétiques » (sur la colère, sur la haine, etc.) ne doit pas faire oublier qu'Aristote ne voyait pas là une étude scientifique (qui aurait exigé une mise en relation de la forme des passions avec leur « matière » physiologique), mais un manuel d'anthropologie pratique, fondement d'une tactique de la persuasion destinée à s'immiscer dans les relations des hommes entre eux. Nous sommes loin ici de la rhétorique philosophique, appuyée sur la science des Idées, que préconisait Platon dans la deuxième partie du Phèdre : Aristote ne propose pas une transmutation philosophique de l'art rhétorique, mais, en dehors de tout jugement de valeur, une élaboration méthodique de la technique plus ou moins spontanément mise en œuvre par les rhéteurs.
Par un de ses aspects, cette Rhétorique se rattache plus directement aux œuvres proprement logiques d'Aristote. L'une des tâches de l'art rhétorique est de dresser un catalogue des lieux ( topoi), c'est-à-dire des points de vue les plus généraux sous lesquels un sujet peut et doit être abordé : prendre en considération la totalité des lieux est le seul moyen de traiter un sujet de façon exhaustive, en même temps que de prévenir les objections ou simplement les doutes ou les résistances de l'auditoire, qu'il s'agisse d'un panégyrique, d'une plaidoirie ou d'un discours devant l'Assemblée. Il y a des lieux propres à chaque genre et des lieux communs à tous. Parmi ceux-ci, Aristote nomme : le possible et l'impossible, l'existence et l'inexistence, le grand et le petit ou encore le plus et le moins (II, 19). Mais dans l'éloge, par exemple, il faudra distinguer en outre entre la nature (le caractère de la personne) et les actes, ceux-ci révélant en général celle-là, mais pouvant aussi en cas de défaillance être rachetés par elle. D'où de nouveaux lieux : celui du général et du particulier, celui de la similitude et de la contrariété, etc. Ainsi voit-on se constituer de façon d'abord empirique, et à des fins seulement mnémotechniques, un réseau de catégories qui sont à la fois les chefs sous lesquels se rassemble l' argumentation et le terrain commun sur lequel se rencontrent, en dehors de toute matière particulière, les discours des hommes.
La « topique »
C'est précisément à l'étude des lieux qu'est consacré le plus ancien des ouvrages qui constituent l'Organon, les Topiques. « Le but de ce traité, dit Aristote, est de trouver une méthode qui nous mette en mesure d'argumenter sur tout problème proposé, en partant de prémisses probables, et d'éviter, quand nous soutenons un argument, de rien dire nous-mêmes qui y soit contraire » (I, 1, 100 a 18 sqq.). Cette méthode est ce qu'Aristote appelle la dialectique, parce qu'elle fixe les règles de la pensée dialoguée. À la différence du monologue rhétorique, celle-ci trouve dans la présence critique de l'interlocuteur l'aiguillon et, en même temps, le frein qui sont les garants à la fois de sa progression et de sa rigueur. Les lieux définissent ici une sorte d'axiomatique de la discussion ; mais leur portée est encore plus vaste si l'on songe que la pensée et, plus particulièrement, la recherche sont, suivant la formule platonicienne que ne désavoue pas Aristote (Du Ciel, II, 13, 294 a 9-10), un « dialogue de l'âme avec elle-même ».
Dans les Topiques, les lieux sont classés selon les différents points de vue d'où une proposition ou une question concerne la chose en discussion, c'est-à-dire selon les différents degrés de l'attribution, ou prédication. Un prédicat peut se dire du sujet de quatre façons : si le prédicat est réciprocable avec le sujet (c'est-à-dire s'il peut devenir le sujet d'une proposition dont le sujet initial deviendrait le prédicat), il en exprime ou bien la définition(ex. : l'homme est un animal doué de parole) ou bien une particularité non essentielle, et pourtant propre au sujet (ex. : le rire est le propre de l'homme) ; si le prédicat n'est pas réciprocable, on aura affaire ou au genre, qui est plus général que le sujet mais fait partie de sa définition (ex. : l'homme est un animal), ou à l'accident, qui advient au sujet sans faire partie de son essence (ex. : Socrate a un nez camus). On obtient ainsi la liste de ce que la tradition appellera les prédicables et qui structure ici la recherche des lieux : lieux de l'accident aux livres II et III des Topiques, lieux du genre au livre IV, lieux du propre au livre V, lieux de la définition aux livres VI et VII. Il n'est pas douteux que, dans ces recherches arides sur les différentes façons dont l'être se dit, recherches où une étude érudite discernerait l'écho de discussions commencées au sein de l'Académie, se laissent lire les premiers linéaments de la spéculation aristotélicienne sur l'être. C'est dans les Topiques qu'est à chercher la préhistoire de la métaphysique aristotélicienne.
Le syllogisme
Cette remarque suffirait à manifester que l'Organon d'Aristote, surtout dans sa partie consacrée à la dialectique, est très éloigné d'une logique proprement formelle ; car la structure de la prédication n'est pas sans comporter un certain savoir de l'être, une sorte de compréhension préontologique du sens – ou des sens – de l'être, qu'il appartiendra à la science de l'être en tant qu'être de thématiser. Mais les Topiques ont un autre intérêt. Ils font allusion à un procédé de raisonnement qu'Aristote y dénomme déjà syllogismeet qui se caractérise, les prémisses étant posées, par le caractère contraignant de la conclusion qu'on en déduit. « Le syllogisme est un discours dans lequel, certaines choses étant posées, une autre chose différente d'elles en résulte nécessairement par le seul moyen de ces données » (I, 1, 100 a 25). Le syllogisme est à l'origine un procédé rhétorique qui tend à manifester, entre des propositions admises par l'adversaire et une autre proposition qu'il refuse d'admettre, un rapport de principes à conséquence, de prémisses à conclusion, qui, une fois dévoilé, doit amener l'adversaire, bon gré mal gré, soit à admettre la conclusion, soit à refuser les prémisses.
C'est dans les Premiers Analytiques (œuvre postérieure aux Topiques, bien que les éditeurs l'aient placée avant les Topiques dans le corpus) qu'Aristote édifie la théorie formelle du syllogisme, compte non tenu de la vérité ou de la non-vérité des prémisses. Pratiquement, le syllogisme consiste à justifier l'appartenance d'un prédicat (majeur) à un sujet (mineur) par l'introduction d'un terme intermédiaire ( moyen terme) qui est tel que, dans le cas le plus favorable, le majeur s'attribue à lui et qu'il s'attribue lui-même au mineur.
Dans l'exemple classique :
Tout homme est mortel Socrate est homme Socrate est mortel,
on voit immédiatement que « mortel » est le majeur, « Socrate » le mineur, « homme » le moyen terme.
Aristote voyait dans le syllogisme le procédé par excellence de la science, du moins de la science constituée, qui, en possession de ses propres principes, en est arrivée au stade de l'exposition démonstrative. Mais, dès l'Antiquité, une grave objection a été formulée contre le syllogisme, accusé de comporter une pétition de principe, en ce sens que la vérité de la majeure implique celle de la conclusion : pour être assuré que tous les hommes sont mortels, il faut savoir déjà que Socrate, qui est un homme, est mortel. Mais, si nous le savons déjà, à quoi bon le conclure ? Autrement dit, on ne peut conclure des prémisses que ce qui y est déjà contenu : le syllogisme serait alors tautologique et se réduirait, comme le dira plus tard Lachelier, à une « solennelle futilité ». À cela Aristote pourrait d'abord répondre que le syllogisme nous permet de passer d'un savoir universel, donc en puissance, à un savoir particularisé, donc actuel, s'il est vrai que l'universel est le particulier en puissance (Seconds Anal., I, 24, 86 a 23-29).
Mais, surtout, l'accusation de cercle vicieux ne vise qu'une interprétation extensiviste du syllogisme ; le syllogisme n'est pas seulement passage de l'universel au particulier, mais – du moins dans le syllogisme de la première figure, qui est finalement le seul en cause – médiationentre un sujet et un prédicat qui n'est pas analytiquement contenu dans le sujet : le moyen terme, comme le dit Aristote (Seconds Anal., II, 2, 90 a 6), est cause de l'attribution du prédicat (majeur) au sujet (mineur).
Limites de l'idéal déductif
La notion de causalité appliquée au syllogisme reste cependant ambiguë. Elle pourrait signifier, puisque le moyen terme est un concept, ou, comme dit Aristote, exprime une essence (Mét., M, 4, 1078 b 4), que le syllogisme manifeste le déploiement immanent d'une essence, qui médiatise dans l'unité synthétique de la conclusion deux moments d'abord disjoints : ainsi serait-ce l'humanité qui fait Socrate mortel (ce qui inspirera à Valéry cette boutade : « Ce n'est pas la ciguë, mais le syllogisme, qui a tué Socrate »). Tel est, sans aucun doute, l'idéal de la science aristotélicienne : manifester, en dehors de tout recours à l'expérience, des enchaînements nécessaires d'essences, comme les mathématiques (auxquelles sont empruntés la plupart des exemples des Analytiques) nous en fournissent le modèle. Mais, dès qu'Aristote emprunte ses exemples à l'expérience, on s'aperçoit que le syllogisme n'est plus alors que la mise en forme d'une expérience constituée en dehors de lui. De fait, Aristote ne recourt que fort peu au syllogisme dans son œuvre scientifique effective. Dans les Premiers Analytiques, il note : « Il ne suffit pas de considérer le développement des syllogismes ; il faut encore être capable d'en former » (43 a 20 sqq.). Or, pour en former, il faut être en possession des prémisses, nécessairement plus universelles que la conclusion. Mais si l'universel est le plus connu en soi (de sorte que le syllogisme déroule l'ordre de l'intelligibilité en soi), il est le moins connu pour nous, qui, dans la sensation, rencontrons d'abord le particulier. D'où la nécessité d'une opération préalable, et de sens inverse, qui est la remontée du particulier à l'universel : c'est l' induction, procédé qui n'a pas la rigueur du syllogisme (Seconds Anal., II, 23), mais qui, dans la mesure où il nous élève à l'intuition de l'universel, est singulièrement plus fécond.
L'induction, qui trouve surtout son domaine d'application en biologie, est néanmoins sans usage là où les principes requis sont d'une généralité telle qu'aucune intuition ne leur correspond. L'idéal d'Aristote demeure donc celui d'une déduction absolue, le même que poursuivaient dans le même temps les mathématiciens dont les travaux aboutiront quelques décennies plus tard à la systématisation d'Euclide. Chaque science repose sur des prémisses premières, nommées axiomes, qui ne peuvent être démontrées sans cercle vicieux à l'intérieur de la science considérée, puisqu'elles sont présupposées par toutes ses démonstrations (par exemple, en arithmétique : le tout est plus grand que la partie). Les axiomes propres à une science peuvent sans doute être démontrés à partir d'une « science plus haute », expression qui, selon les exemples qu'en donne Aristote, désigne une science plus générale et plus abstraite : ainsi les principes premiers de l'optique ou de l'acoustique peuvent-ils être démontrés par les mathématiques. Mais qu'en est-il des principes communs à toutes les sciences, comme le principe de contradiction ? Ici le caractère indémontrable du principe ne sera plus relatif, mais absolu : le principe de contradiction ne peut être démontré sans pétition de principe, c'està-dire sans qu'il soit présupposé dans les prémisses de la démonstration que nous en donnerions, puisqu'il est le principe de toute démonstration. Le principe « le plus solide de tous » et « le plus connu de tous » (puisque sa possession est nécessaire pour connaître quelque être que ce soit)[Mét., Γ, 3, 1005 b 10 sqq.] est donc aussi la plus indémontrable de toutes les propositions. Ainsi l'équation du savoir et de la démonstrabilité (la vraie connaissance est la connaissance du nécessaire, c'est-à-dire de ce qui peut être démontré, ou encore : savoir, c'est savoir par les causes) ne vaut-elle pas pour le fondement du savoir lui-même : la logique d'Aristote, dont Hegel dira qu'elle est « la logique de la pensée finie », reconnaît ses limites dès lors qu'il s'agit pour elle de se fonder elle-même. Le savoir démonstratif, dont les Analytiques nous fournissent le canon, s'enracine dans le non-savoir ou du moins dans un savoir d'un autre ordre. La logique elle-même nous oblige à reconnaître que le rapport de l'homme au fondement n'est pas un rapport d'ordre logique et appelle un mode d'élucidation plus haut.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre AUBENQUE : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne
Classification
Médias
Autres références
-
DE L'ÂME, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 957 mots
Qu'est-ce que l'âme ? La question peut nous paraître incongrue, mais pour l'Antiquité elle était essentielle à la constitution d'une science du vivant (l'âme se définit comme ce qui « anime » un corps, au principe donc de ce qui distingue l'animal du végétal), et partant...
-
ÉTHIQUE À NICOMAQUE, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 943 mots
- 1 média
Le corpus aristotélicien comprend traditionnellement trois ensembles consacrés à la philosophie morale : l'Éthique à Nicomaque, l'Éthique à Eudème et la Grande Morale, ou Grands Livres d'Éthique, dont l'attribution à Aristote (385 env.-322 env. av. J.-C.) est aujourd'hui très...
-
HISTOIRE DES ANIMAUX (Aristote)
- Écrit par Pierre LOUIS
- 325 mots
La date de 335 avant notre ère est très importante dans l'histoire de la science grecque et de la science en général. Elle correspond pourtant à une période assez sombre de l'histoire de la Grèce ancienne. Trois années plus tôt, en — 338, la défaite des Athéniens et des Thébains, battus par Philippe...
-
ORGANON, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 821 mots
- 1 média
Dans l'œuvre immense qui nous reste d'Aristote (385 env.-322 av. J.-C.), ou qui est publiée sous son nom, on peut distinguer trois ensembles : les écrits qui relèvent directement de la connaissance scientifique (dont De l'âme) ; ceux qui traitent plutôt des conduites humaines...
-
POÉTIQUE, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 907 mots
- 1 média
-
ACADÉMIE ANTIQUE
- Écrit par Jean-Paul DUMONT
- 1 376 mots
- 1 média
-
ACTE, philosophie
- Écrit par Paul GILBERT
- 1 282 mots
Leterme « acte » reprend le latin actus, qui traduit deux termes d'Aristote : energeia (« qui est en plein travail ») et entelecheia (« qui séjourne dans sa fin »). Ces deux mots du vocabulaire aristotélicien sont souvent confondus par les traducteurs, mais déjà parfois par Aristote... -
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...de la sensibilité humaine. Ainsi le « pathique » est-il tantôt finement analysé en tant qu'obstacle, mais aussi ressource de la vie éthique, comme chez Aristote, en particulier dans l'Éthique à Nicomaque, tantôt entièrement rejeté comme obnubilant et obscurcissant – comme si tout affect se confondait... -
ÂGE DE LA TERRE
- Écrit par Pascal RICHET
- 5 145 mots
- 5 médias
- Afficher les 178 références
Voir aussi
- ATTRIBUT & PRÉDICAT, logique
- CONTRADICTION
- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE
- ACTION DRAMATIQUE
- TRAGÉDIE THÉORIES DE LA
- OLIGARCHIE
- SENSIBLE
- TÉLÉOLOGIE
- DÉDUCTION
- ANTIQUE PHILOSOPHIE
- UNIVERSEL
- COSMOLOGIES, philosophie
- SAVOIR
- GRECQUE PHILOSOPHIE
- PRINCIPE
- PLURALITÉ, philosophie
- INSTANT
- MULTIPLICITÉ, philosophie
- MIMÉSIS
- PREMIER MOTEUR
- NOÛS
- MÉDIATION
- MAÎTRE-ESCLAVE RELATION
- AXIOME
- GENRE, logique
- DIANOIA
- AMITIÉ
- IDÉES THÉORIE DES
- PRUDENCE
- SENSATION, philosophie
- PÉTITION DE PRINCIPE
- PRÉSOCRATIQUES PHILOSOPHES
- ACTE & PUISSANCE, philosophie
- LOGIQUE HISTOIRE DE LA
- TOPIQUES
- MOYEN TERME, logique
- PHILOSOPHIE POLITIQUE
- IMITATION, poétique
- PRÉMISSES, logique
- TOPOÏ, rhétorique