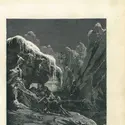ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
Article modifié le
La philosophie de la nature
S'il est vrai que l'ontologie d'Aristote est une élucidation de l'être-en-mouvement du monde sublunaire, s'il est vrai d'autre part que sa théologie, dans ce qu'elle a du moins d'humainement réalisable, pense Dieu négativement à partir de l'expérience du mouvement, on se convaincra que la frontière entre physique et métaphysique n'est pas toujours claire, à tel point que l'on a pu dire que « le thème de la métaphysique n'est que la question limite d'une physique menée avec conséquence jusqu'à son terme » (Wieland, 1962).
Les principes
Ainsi que le livre A de la Métaphysique, le livre I de la Physique est consacré à une confrontation avec les prédécesseurs, qui porte expressément sur le nombre et la nature des principes. En fait, ce qui est en question dans ce débat, c'est la possibilité même d'une physique, c'est-à-dire d'une science des êtres naturels, qu'Aristote assimile tacitement aux êtres en mouvement ou susceptibles de mouvement. Aristote veut montrer que, si l'on ne pose qu'un seul principe, on rend le mouvement impossible. Cette erreur fut celle des Éléates, pour qui l'être est un, n'ayant d'autre réalité que celle de l'essence. À un tel être il ne peut proprement rien arriver. Réciproquement, la prise en considération du mouvement amène à reconnaître que l'être est à la fois un et multiple : un en acte et multiple en puissance. Les Éléates achoppaient également devant cette difficulté : comment du non-être l'être peut-il provenir ? Aristote fait droit à la difficulté en admettant que, en un sens, il est vrai que le non-être ne puisse engendrer l'être et que, dès lors, ce qui est était nécessairement déjà. Mais nous sommes contraints par l'expérience même de reconnaître deux façons pour l'être de signifier : il y a l'être en puissance et l'être en acte, et dès lors on comprendra que l'être en acte vienne de ce qui n'était pas en acte, mais était déjà en puissance. Les Éléates représentent la fidélité la plus haute à l'exigence d'univocité du discours. Mais l'expérience du mouvement contraint la philosophie à ouvrir le langage sur l'être à la pluralité des significations (être en puissance et être en acte, être par soi et être par accident, être selon les différentes catégories), pluralité qui reflète elle-même la scission qu'opère le mouvement dans l'être. Le mouvement, dira Aristote, est « extatique », ce qui veut dire qu'il fait sortir l'être de soi-même en l'empêchant de n'être qu'essence, en le contraignant à être aussi ses accidents, cet « aussi » n'exprimant pas ici une surabondance, mais une profusion parasitaire, donc une déficience ontologique. C'est donc au prix de la reconnaissance d'une pluralité des sens de l'être qu'est acquise la possibilité d'une physique.
Selon Aristote, les principes du mouvement sont au nombre de trois. Il faut d'abord poser deux contraires, qui sont le point de départ et le point d'arrivée du mouvement. Ce dernier principe est la forme, c'est-à-dire ce que la chose devient par génération ; le point de départ de l'avènement de la forme est la privation de cette forme : ainsi, ce n'est pas n'importe quoi qui devient lettré, mais seulement l'illettré. Mais il faut un troisième principe qui assure la continuité du mouvement et l'empêche d'être une succession discontinue de morts et de renaissances (ainsi, l'illettré mourrait en devenant lettré, l'enfant en devenant adulte : thèse qui était celle de certains sophistes) : ce troisième principe est le substrat, ou matière, qui est ce qui subsiste sous le changement ; ainsi, l'argile n'en demeure pas moins argile en cessant d'être informe pour recevoir la forme de la statue.
Nature et mouvement
Le livre II de la Physique définit l'être naturel (physei on), objet propre de la physique. Il se distingue de l'être artificiel en ce qu'il a en lui-même un principe de mouvement et de repos. Alors que, dans l'art, l'agent est extérieur au produit, la nature est un principe immanent de spontanéité : la nature ressemble à un médecin qui se guérirait lui-même (199 b 31). L'analogie de l'art permet de comprendre que, comme l'art, la nature agisse comme cause finale, comme principe organisateur ; en ce sens, la nature et l'art s'opposent à l'image populaire du hasard. Mais, alors que Platon estimait que l'art est antérieur à la nature, voulant montrer par là qu'une construction divine préside à l'organisation de la nature, Aristote institue le rapport inverse : pour lui, c'est l'art qui imite la nature, s'efforçant de reproduire par des médiations laborieuses la spontanéité qui n'appartient par soi qu'aux êtres naturels.
Mais quel est ce principe de mouvement que nous appelons nature ? Est-ce la forme ou la matière ? Aristote soutient que c'est la forme, car la forme est la fin du processus naturel. La physique n'étudie cependant pas la forme séparée de la matière, car cette étude relève plutôt de la philosophie première. Par opposition au physicien matérialiste, qui ne s'attache qu'à la matière, le vrai physicien est celui qui considère à la fois la forme et la matière, lesquelles sont aussi indissociables l'une de l'autre que le camus l'est du nez.
Après des considérations sur le hasard, qu'il essaie ici de ramener à la projection d'une finalité imaginaire sur un enchaînement causal seul réel (ainsi, je vais au marché pour acheter des légumes, et j'y rencontre mon débiteur, qui me restitue sa dette ; tout se passe – mais c'est une illusion – comme si j'étais allé au marché pour y recouvrer mon argent), Aristote aborde, à partir du livre III, ce qui sera l'objet essentiel de la Physique : l'étude du mouvement. Aristote en propose une définition en termes d'acte et de puissance : tentative qui risque d'apparaître comme un cercle vicieux, car l'acte et la puissance ont été eux-mêmes définis par rapport au mouvement. Il serait trop facile de dire que le mouvement est l'actualisation d'une puissance ou le passage de la puissance à l'acte. Car ce serait là une définition extrinsèque du mouvement, envisagé non en lui-même, mais dans les positions qui l'encadrent. Aussi bien Aristote ne tombe-t-il pas dans une telle erreur, que dénoncera plus tard Bergson. Envisagé en lui-même, le mouvement est « l'acte de ce qui est en puissance en tant que tel » (201 a 10), c'est-à-dire en tant qu'il est en puissance. Le mouvement est un « acte imparfait » (201 b 32), c'est-à-dire dont l'acte même, aussi longtemps qu'il est mouvement, est de ne jamais être tout à fait en acte. De ce point de vue, le mouvement se rapproche de l'infini, notion analysée dans la suite du livre III. L'infini a pour caractéristique de ne pouvoir jamais être en acte ; il n'est pas une chose déterminée, à la façon d'un arbre ou d'une maison ; il est plutôt comparable à une lutte ou à une journée, dont l'acte consiste dans un renouvellement perpétuel.
Le livre IV de la Physique est consacré à l'analyse de certaines notions qui sont impliquées par le mouvement : lieu, vide (dont Aristote rejette l'existence) et temps. L'analyse la plus intéressante est celle du temps. Le temps n'est pas le mouvement en général, ni un mouvement privilégié (comme le mouvement du Ciel, qui sert pourtant à le mesurer, parce qu'il est le plus régulier), mais seulement « quelque chose du mouvement » : « le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur ». Si l'on se rappelle que le mouvement est un continu, divisible en puissance, mais indivisible en acte, on pourrait dire que le temps est comme la scansion de la continuité du mouvement. Le temps est-il pour autant discontinu ? Il paraît être composé d' instants perpétuellement différents. Mais ce n'est là qu'une apparence : car l'instant n'est pas une partie du temps, mais seulement une limite qui détermine à chaque fois l'avant et l'après ; et, si l'instant ne cesse de varier quant à son essence, il reste identique quant au sujet, qui n'est autre que le sujet du changement. Le temps n'est donc pas un flux continu, mais une structure : l'unité d'un avant et d'un après qui se constitue toujours de nouveau autour d'un présent qui fuit sans cesse. Il y a donc un primat du présent, mais il faut ajouter que ce présent qui court au fil du temps est, comme le dit Aristote, « extatique », s'ouvrant sans cesse à la rétention du passé et à l'attente de l'avenir. Que les moments du temps ne puissent être maintenus unis que par l'activité d'une conscience, c'est ce qu'Aristote reconnaît à la fin de son analyse en disant que « sans l'âme il est impossible que le temps existe » (223 a 26).
Les derniers livres de la Physique s'élèvent de la considération du mouvement à la nécessité d'un Premier Moteur, rejoignant ainsi une perspective développée par ailleurs dans la Métaphysique.
Il serait vain de vouloir caractériser d'un mot, et encore moins d'un mot en « isme », la physique d'Aristote, qui s'efforce moins d'établir des théories que de décrire l'expérience et ses conditions de possibilité. Comme seul le langage peut faire que notre expérience soit cohérente, ce sont les principes de notre discours sur l'expérience qu'Aristote s'efforce avant tout de dégager. Ainsi la finalité est-elle moins chez Aristote une affirmation dogmatique sur l'ordre qui régnerait dans le monde qu'une condition d'intelligibilité de l'expérience : le concept de hasard ne permet pas de comprendre la réalité de l'ordre ; à l'inverse, le concept de finalité permet de comprendre les échecs de la finalité : c'est en ce sens qu'Aristote en fera usage dans ses traités biologiques, en étudiant notamment la formation des monstres. Les échecs de la finalité seraient un argument contre le finalisme, que l'on prétend trop souvent découvrir chez Aristote ; ils manifestent au contraire la fécondité méthodologique du concept de finalité, tel qu'Aristote l'a élaboré.
Au-delà de ces analyses en quelque sorte phénoménologiques, dont l'absence même de prétention dogmatique assure la pérennité en tant que conditions de l'expérience naïve, en dépit des progrès ultérieurs de la science physique, on ne peut néanmoins nier qu'il y ait chez Aristote une philosophie générale de la nature. La nature est pour les êtres naturels principe de mouvement. En ce sens, l'être naturel se distingue de l'être immobile et suprasensible et se subordonne à lui : c'est pourquoi la physique n'est que philosophie seconde. Mais d'un autre côté, la nature est, de tous les principes de mouvement, le plus stable et le plus substantiel, parce qu'il est intérieur aux êtres qu'il meut : la nature s'oppose, de ce point de vue, au hasard, mais aussi à l'art, l'être artificiel ayant son principe en dehors de lui-même. À mi-chemin de la surnature et de l'artifice, la nature aristotélicienne est le principe qui assure à notre monde – sans le recours à l'hypothèse des Idées ni davantage à des métaphores artificialistes – sa cohérence et sa relative intelligibilité. La physique ne voulait être que mythe chez Platon, elle devient science chez Aristote, sans être pour autant la plus haute.
L'Univers
L'œuvre physique d'Aristote est loin de se limiter à l'ouvrage intitulé Physique, qui n'est, à vrai dire, que l'introduction théorique à un vaste programme d'investigations cosmologiques, météorologiques et biologiques. Le traité Du Ciel n'est pas essentiellement consacré, contrairement à ce que l'on pourrait attendre, à une étude des phénomènes astronomiques, mais plutôt à une étude générale de l'univers et des éléments qui constituent les corps (étude qui sera reprise et complétée dans le traité De la génération et de la corruption). C'est dans le traité Du Ciel que se trouvent la plupart des thèses dont le commentaire et l'amplification occuperont principalement la « physique » médiévale : perfection de l'univers, qui est comparable à un organisme vivant ; finitude de l'Univers dans l'espace, mais infinité de l'Univers dans le temps (thèse dirigée contre le récit de la genèse du monde dans le Timée de Platon et que les philosophes médiévaux, à commencer par Thomas d'Aquin, auront le plus grand mal à concilier avec une théologie de la création) ; unicité et sphéricité du Ciel, en dehors duquel il n'y a rien, même pas de lieu ni de vide.
Le traité Du Ciel est dominé par cette idée, qui sera fatale à l'évolution de la physique médiévale, que les lois de la physique sublunaire sont différentes par nature de celles qui régissent le monde sidéral : alors que celles-ci sont exactes et mathématisables, les lois de la physique sublunaire se contentent de relever ce qui se produit « le plus souvent ». C'est cette idée qui inspire la théorie aristotélicienne des éléments : aux quatre éléments retenus par Empédocle (terre, eau, air, feu), Aristote superpose un cinquième élément, qui sera plus tard la « quintessence » des scolastiques et qu'il appelle pour sa part « premier corps » ou « éther ». Alors que la génération circulaire des éléments, rendue possible par le fait qu'ils communiquent un à un par l'une de leurs qualités (le froid pour la terre et l'eau, l'humide pour l'eau et l'air, le chaud pour l'air et le feu, le sec pour le feu et la terre), rend compte des changements au niveau du monde sublunaire, l'éther, substance constitutive des astres, est immuable, encore que cette immuabilité soit celle d'un mouvement éternel. La doctrine du cinquième élément, inaltérable et qui ne se mélange en aucune façon aux quatre autres, permet à Aristote d'affirmer la transcendance du Ciel : il s'oppose par là, avant la lettre, non seulement à la physique moderne, dont l'acte de naissance coïncidera avec la suppression par Galilée de la distinction entre physique céleste et physique terrestre, mais aussi à la physique stoïcienne, pour qui le principe vital, encore appelé à l'occasion éther, est immanent au monde qu'il anime.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre AUBENQUE : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne
Classification
Médias
Autres références
-
DE L'ÂME, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 957 mots
Qu'est-ce que l'âme ? La question peut nous paraître incongrue, mais pour l'Antiquité elle était essentielle à la constitution d'une science du vivant (l'âme se définit comme ce qui « anime » un corps, au principe donc de ce qui distingue l'animal du végétal), et partant...
-
ÉTHIQUE À NICOMAQUE, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 943 mots
- 1 média
Le corpus aristotélicien comprend traditionnellement trois ensembles consacrés à la philosophie morale : l'Éthique à Nicomaque, l'Éthique à Eudème et la Grande Morale, ou Grands Livres d'Éthique, dont l'attribution à Aristote (385 env.-322 env. av. J.-C.) est aujourd'hui très...
-
HISTOIRE DES ANIMAUX (Aristote)
- Écrit par Pierre LOUIS
- 325 mots
La date de 335 avant notre ère est très importante dans l'histoire de la science grecque et de la science en général. Elle correspond pourtant à une période assez sombre de l'histoire de la Grèce ancienne. Trois années plus tôt, en — 338, la défaite des Athéniens et des Thébains, battus par Philippe...
-
ORGANON, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 821 mots
- 1 média
Dans l'œuvre immense qui nous reste d'Aristote (385 env.-322 av. J.-C.), ou qui est publiée sous son nom, on peut distinguer trois ensembles : les écrits qui relèvent directement de la connaissance scientifique (dont De l'âme) ; ceux qui traitent plutôt des conduites humaines...
-
POÉTIQUE, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 907 mots
- 1 média
-
ACADÉMIE ANTIQUE
- Écrit par Jean-Paul DUMONT
- 1 376 mots
- 1 média
-
ACTE, philosophie
- Écrit par Paul GILBERT
- 1 282 mots
Leterme « acte » reprend le latin actus, qui traduit deux termes d'Aristote : energeia (« qui est en plein travail ») et entelecheia (« qui séjourne dans sa fin »). Ces deux mots du vocabulaire aristotélicien sont souvent confondus par les traducteurs, mais déjà parfois par Aristote... -
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...de la sensibilité humaine. Ainsi le « pathique » est-il tantôt finement analysé en tant qu'obstacle, mais aussi ressource de la vie éthique, comme chez Aristote, en particulier dans l'Éthique à Nicomaque, tantôt entièrement rejeté comme obnubilant et obscurcissant – comme si tout affect se confondait... -
ÂGE DE LA TERRE
- Écrit par Pascal RICHET
- 5 145 mots
- 5 médias
- Afficher les 178 références
Voir aussi
- ATTRIBUT & PRÉDICAT, logique
- CONTRADICTION
- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE
- ACTION DRAMATIQUE
- TRAGÉDIE THÉORIES DE LA
- OLIGARCHIE
- SENSIBLE
- TÉLÉOLOGIE
- DÉDUCTION
- ANTIQUE PHILOSOPHIE
- UNIVERSEL
- COSMOLOGIES, philosophie
- SAVOIR
- GRECQUE PHILOSOPHIE
- PRINCIPE
- PLURALITÉ, philosophie
- INSTANT
- MULTIPLICITÉ, philosophie
- MIMÉSIS
- PREMIER MOTEUR
- NOÛS
- MÉDIATION
- MAÎTRE-ESCLAVE RELATION
- AXIOME
- GENRE, logique
- DIANOIA
- AMITIÉ
- IDÉES THÉORIE DES
- PRUDENCE
- SENSATION, philosophie
- PÉTITION DE PRINCIPE
- PRÉSOCRATIQUES PHILOSOPHES
- ACTE & PUISSANCE, philosophie
- LOGIQUE HISTOIRE DE LA
- TOPIQUES
- MOYEN TERME, logique
- PHILOSOPHIE POLITIQUE
- IMITATION, poétique
- PRÉMISSES, logique
- TOPOÏ, rhétorique