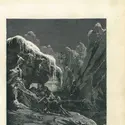ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
Article modifié le
La vie et l'âme
La vie
De la nature à la vie, de la vie à l'âme, la transition est, pour Aristote, continue. Nous avons vu que la nature était définie par lui comme principe interne de mouvement, autrement dit comme spontanéité (ainsi, la pierre tend d'elle-même vers le bas). Dès lors, la difficulté n'est pas tellement pour lui d'expliquer le caractère naturel de la vie que de distinguer la nature animée de la nature inanimée. En fait, si Aristote est bien conscient du fait que la nature animée n'est qu'un cas particulier de la nature en général, c'est la nature animée qui, en raison de sa plus grande perfection, lui sert de modèle pour expliquer la nature en général. Mais, à ce niveau, les références à la vie n'ont de valeur qu'analogique : lorsque Aristote dit, par exemple, que le mouvement est « comme une sorte de vie appartenant à tout ce qui existe par nature » (Phys., VIII, 1, 250 b 14), il ne faut pas voir là plus qu'une métaphore. Mais s'il serait erroné d'interpréter la physique d'Aristote, à cause de ces métaphores, comme une physique vitaliste, il reste que sa biologie est tout le contraire d'une biologie physicaliste : elle est la première tentative cohérente – et qui se constitue déjà en rupture avec toute une tradition matérialiste – pour interpréter les phénomènes vitaux dans leur spécificité, irréductible à toute combinaison mécanique d'éléments.
L'observation biologique a été une des activités les plus constantes d'Aristote, et aussi les plus fécondes, comme en témoignent le nombre et l'importance des traités qu'il a consacrés à la science de la vie. Si l'Histoire des animaux est un recueil d'observations (le mot grec historia ne signifie pas autre chose qu'enquête), les traités Des parties des animaux et De la génération des animaux représentent une systématisation déjà avancée, le premier dans l'ordre de l'anatomie comparée, le second dans l'ordre de la physiologie et, en particulier, de l'embryologie. À côté d'observations erronées et de thèses qui portent la marque de l'époque (le cœur est le siège de l'âme, les artères sont pleines d'air, etc.), on y trouve des classifications qui préparent celles de Linné et de Cuvier, un usage très judicieux de la notion d'analogie (ainsi Aristote est-il le premier à reconnaître l'analogie fonctionnelle entre les poumons et les branchies), et surtout un principe général d'explication, selon lequel la fonction détermine l'organe, et non l'inverse. Ainsi Aristote affirme-t-il contre Anaxagore que « l'homme a des mains parce qu'il est intelligent » et non qu'« il est intelligent parce qu'il a des mains » (Part. anim., IV, 10, 687 a 7) ; il affirme encore que la station droite de l'homme s'explique par la prédominance en lui de la pensée (ibid., 686 a 27).
L'âme et le corps
Le couronnement des œuvres biologiques est à chercher dans le traité De l'âme, du moins dans ses deux premiers livres, qui traitent de « cette sorte d'âme qui n'existe pas indépendamment de la matière » (I, 1, 403 a 28) et qui, à la différence de l'âme immatérielle ou intellect ( noûs), n'est autre que le principe vital, caractéristique non seulement de l'homme, mais de tout être vivant. Aristote n'est pas parvenu d'emblée à cette conception de l'âme et, dans aucun autre domaine de sa philosophie, son évolution n'a été aussi claire que sur cette question. Parti de l'affirmation platonisante d'une dualité radicale entre l'âme et le corps, Aristote parvient, dans le traité De l'âme, à une conception qui, au contraire, voit dans l'âme la forme du corps, donc liée à lui et disparaissant avec lui. Mais l'âme n'est pas la forme de n'importe quel corps : elle est la forme d'un corps naturel, c'est-à-dire d'un corps qui a en lui-même le principe de son propre mouvement. Mais cela ne suffit pas encore à distinguer l'âme et la forme d'un corps physique quelconque, bien que la forme du corps physique, cause finale et formelle de la matière, soit souvent illustrée par l'analogie de l'âme : si la hache avait une âme, cette âme ne serait autre que la forme ou, en termes modernes, la fonction de la hache, de même que la vision est « l'âme » de l'œil. Un pas de plus est donc nécessaire pour définir l'âme au sens strict : il faut préciser que « l'âme est la forme d'un corps organisé ayant la vie en puissance » (De l'âme, II, 1, 412 a 20), c'est-à-dire d'un corps pourvu d'instruments, d'organes, propres à accomplir les fonctions que réclame la vie ; mais une telle vie resterait seulement en puissance, si l'âme ne la maintenait constamment en acte (même en l'absence d'une activité en exercice, comme dans le sommeil). L'âme est définie comme le principe vital, par quoi le corps se trouve « animé » et faute de quoi il retourne à la pure matérialité.
Il est caractéristique qu'Aristote se croie en mesure d'expliquer la vie avec les seuls concepts fondamentaux qu'utilisait sa physique (mais une physique qui, nous l'avons vu, est tout autre que mécaniste) : l'âme est forme, acte, fin ; le corps est matière, puissance, instrument, ce qui n'empêche pas le corps organisé d'être lui-même forme, acte et fin par rapport aux tissus dont il est constitué. L'âme n'est donc pas autre chose que le terme suprême d'une hiérarchie de formes qui expliquent successivement la cohésion de la matière spécifiée (par opposition à la matière première), du corps physique et, finalement, de l'être animé. Quoiqu'elle soit le terme ultime de la série, l'âme semble bien encore appartenir à cette série, somme toute « physique », de sorte que la théorie aristotélicienne de l'âme sera entendue par certains disciples, comme Straton et Aristoxène, en un sens « physiciste », voire matérialiste. Il serait plus exact néanmoins de parler d'organicisme. L'âme est au corps ce que la fonction est à l'organe, ce que la vision, par exemple, est à l'œil. La conséquence en est que l'âme n'est pas un être subsistant par lui-même. La substance, ce n'est pas l'âme, mais le composé d'âme et de corps. À la question posée dès le premier chapitre du livre I du traité De l'âme : « L'âme a-t-elle des attributs qui lui soient propres ? » Aristote répond négativement : ce qu'on appelle improprement « passions de l'âme » n'affecte pas l'âme seule, mais l'âme avec le corps ; c'est l'être vivant tout entier – âme et corps – qui se met en colère, fait preuve de courage, éprouve des désirs ou des sensations (403 a 7).
De la sensation à l'intellection
La psychologie d'Aristote n'en est pas moins construite selon un schéma ascendant, où l'on voit les fonctions supérieures de l'âme se dégager peu à peu de leur conditionnement sensible. Cette gradation apparaît tout d'abord dans la hiérarchie des êtres vivants, qui ont tous une « âme », mais définie par différentes fonctions : ainsi, la plante n'est capable de se nourrir et de se reproduire que parce qu'elle est douée d'une âme végétative ; l'animal doit sa faculté de sentir à l'existence en lui d'une âme sensitive ; enfin, seul l'homme est doué d'une âme intellective. Ces trois âmes ne sont pas les espèces d'un genre commun, mais plutôt les termes d'une série ascendante, dont chacun en dehors du premier suppose le précédent, mais se distingue de lui par l'émergence d'un nouvel ordre.
Cette conception hiérarchique, qui doit assurer à la fois la continuité des stades, mais en même temps l'irréductibilité du supérieur à l'inférieur, se retrouve dans la description des fonctions proprement humaines, c'est-à-dire caractéristiques d'une âme qui est intellective dans son accomplissement le plus haut, mais aussi sensitive et végétative dans ses conditions d'existence. Cette description se distingue d'emblée de la « psychologie » platonicienne en ce que la sensibilité et l' imagination n'apparaissent plus comme des obstacles à la connaissance intellectuelle, mais bien plutôt comme une médiation vers elle. Dans plusieurs parties de son œuvre (Mét., A, 1 ; Seconds Analyt., II, 19), Aristote insiste sur la continuité du passage qui permet de s'élever de la sensation à la science, passage qui n'est au demeurant que l'actualisation de ce qui est en puissance dans la sensation : car le particulier, objet de la sensation, contient en puissance l'universel, objet de la science. Dans le traité De l'âme, Aristote étudie notamment la fonction intermédiaire et médiatrice de l'imagination. L'image, « sensation affaiblie » (Rhétor., 1370 a 28), mais qui a l'avantage de ne pas requérir la présence actuelle de l'objet, est la condition de la mémoire, laquelle permet le rassemblement de plusieurs cas particuliers et met ainsi la pensée discursive ( dianoia) sur la voie de l'universel. C'est d'abord en ce sens qu'il faut comprendre la formule : « Il n'y a pas de pensée sans image » (De l'âme, III, 7, 431 a 17). Mais, dans le petit traité Sur la mémoire et la réminiscence, Aristote va plus loin encore en faisant signifier à cette phrase que la saisie des êtres suprasensibles eux-mêmes ne va pas sans leur projection dans des images : c'est ainsi que le géomètre a besoin de figures pour schématiser et, par là, pour saisir les relations mathématiques, et que, d'une façon générale, l'homme a besoin d'images pour « penser dans le temps ce qui est hors du temps ».
L'intellect
Pourtant, cette psychologie d'abord résolument immanentiste s'achève sur l'affirmation d'une transcendance : celle de l'intellect (noûs). Nous assistons ici à une démarche analogue à celle que nous avions rencontrée dans la preuve du Premier Moteur : une sorte de passage à la limite qui nous transporte dans un autre ordre. La physique fait place brusquement à la théologie. L'intellection, nous dit Aristote au livre III du traité De l'âme, est « l'acte commun de l'intelligence et de l'intelligible » (de même que la sensation était l'acte commun du sentant et du sensible). Mais qu'est-ce qui fait passer simultanément à l'acte l'intelligence et l'intelligible ? Ce ne peut être un intermédiaire matériel à la façon de la lumière, qui, dans l'ordre de la sensation, rend simultanément la couleur visible et l'œil voyant. Ici, ce qui fait passer la puissance de l'intelligence et de l'intelligible à l'acte commun d'intellection ne peut être qu'un principe intellectuel et qui, de surcroît, doit toujours être en acte (car « ce qui est en puissance ne passe à l'acte que par l'action de quelque chose qui est déjà en acte »). Cette analyse, qui reste très allusive chez Aristote (De l'âme, III, 5), sera le point de départ d'une longue tradition d'exégèses, qui commence avec Théophraste et s'étend sur tout le Moyen Âge arabe et latin. D'une façon générale, on distinguera entre un intellect agent (ou en acte) et un intellect patient (ou en puissance), et l'on s'accordera à reconnaître l'intellect agent dans la formule qui clôt l'analyse d'Aristote : « Sans l'intellect rien ne pense » (430 a 22). Mais on débattra longtemps de l'identité exacte de l'intellect agent. S'agit-il de l'intellect individuel dans ce qu'il a de transcendant, de cet intellect dont Aristote nous dit une fois qu'il s'introduit « par la porte » à un certain moment de la formation de l'embryon (De la génération des animaux, 736 b 28) ? Ce sera l'interprétation de saint Thomas. Mais d'autres tireront avec hardiesse, mais non sans logique, une conséquence plus radicale : Alexandre d'Aphrodise assimilera l'Intellect agent et Dieu, cependant que le philosophe arabe Averroès, dans une intuition grandiose, verra dans l'Intellect agent l'unité de la raison, également répandue chez tous les hommes.
Les hésitations du commentaire semblent être ici la rançon des hésitations d'Aristote lui-même, qui, dans le traité De l'âme, ne parvient pas à choisir entre une anthropologie de la médiation et une théologisation de l'homme – qui, du reste, ne pouvait satisfaire les théologiens. Mais nous allons voir que c'est dans la première de ces voies que s'engagent, de façon plus décidée, les traités éthiques et politiques, sans que pour autant la perspective, cette fois simplement régulatrice, de la théologie en soit totalement absente.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Pierre AUBENQUE : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne
Classification
Médias
Autres références
-
DE L'ÂME, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 957 mots
Qu'est-ce que l'âme ? La question peut nous paraître incongrue, mais pour l'Antiquité elle était essentielle à la constitution d'une science du vivant (l'âme se définit comme ce qui « anime » un corps, au principe donc de ce qui distingue l'animal du végétal), et partant...
-
ÉTHIQUE À NICOMAQUE, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 943 mots
- 1 média
Le corpus aristotélicien comprend traditionnellement trois ensembles consacrés à la philosophie morale : l'Éthique à Nicomaque, l'Éthique à Eudème et la Grande Morale, ou Grands Livres d'Éthique, dont l'attribution à Aristote (385 env.-322 env. av. J.-C.) est aujourd'hui très...
-
HISTOIRE DES ANIMAUX (Aristote)
- Écrit par Pierre LOUIS
- 325 mots
La date de 335 avant notre ère est très importante dans l'histoire de la science grecque et de la science en général. Elle correspond pourtant à une période assez sombre de l'histoire de la Grèce ancienne. Trois années plus tôt, en — 338, la défaite des Athéniens et des Thébains, battus par Philippe...
-
ORGANON, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 821 mots
- 1 média
Dans l'œuvre immense qui nous reste d'Aristote (385 env.-322 av. J.-C.), ou qui est publiée sous son nom, on peut distinguer trois ensembles : les écrits qui relèvent directement de la connaissance scientifique (dont De l'âme) ; ceux qui traitent plutôt des conduites humaines...
-
POÉTIQUE, Aristote - Fiche de lecture
- Écrit par François TRÉMOLIÈRES
- 907 mots
- 1 média
-
ACADÉMIE ANTIQUE
- Écrit par Jean-Paul DUMONT
- 1 376 mots
- 1 média
-
ACTE, philosophie
- Écrit par Paul GILBERT
- 1 282 mots
Leterme « acte » reprend le latin actus, qui traduit deux termes d'Aristote : energeia (« qui est en plein travail ») et entelecheia (« qui séjourne dans sa fin »). Ces deux mots du vocabulaire aristotélicien sont souvent confondus par les traducteurs, mais déjà parfois par Aristote... -
AFFECTIVITÉ
- Écrit par Marc RICHIR
- 12 231 mots
...de la sensibilité humaine. Ainsi le « pathique » est-il tantôt finement analysé en tant qu'obstacle, mais aussi ressource de la vie éthique, comme chez Aristote, en particulier dans l'Éthique à Nicomaque, tantôt entièrement rejeté comme obnubilant et obscurcissant – comme si tout affect se confondait... -
ÂGE DE LA TERRE
- Écrit par Pascal RICHET
- 5 145 mots
- 5 médias
- Afficher les 178 références
Voir aussi
- ATTRIBUT & PRÉDICAT, logique
- CONTRADICTION
- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE
- ACTION DRAMATIQUE
- TRAGÉDIE THÉORIES DE LA
- OLIGARCHIE
- SENSIBLE
- TÉLÉOLOGIE
- DÉDUCTION
- ANTIQUE PHILOSOPHIE
- UNIVERSEL
- COSMOLOGIES, philosophie
- SAVOIR
- GRECQUE PHILOSOPHIE
- PRINCIPE
- PLURALITÉ, philosophie
- INSTANT
- MULTIPLICITÉ, philosophie
- MIMÉSIS
- PREMIER MOTEUR
- NOÛS
- MÉDIATION
- MAÎTRE-ESCLAVE RELATION
- AXIOME
- GENRE, logique
- DIANOIA
- AMITIÉ
- IDÉES THÉORIE DES
- PRUDENCE
- SENSATION, philosophie
- PÉTITION DE PRINCIPE
- PRÉSOCRATIQUES PHILOSOPHES
- ACTE & PUISSANCE, philosophie
- LOGIQUE HISTOIRE DE LA
- TOPIQUES
- MOYEN TERME, logique
- PHILOSOPHIE POLITIQUE
- IMITATION, poétique
- PRÉMISSES, logique
- TOPOÏ, rhétorique