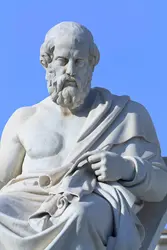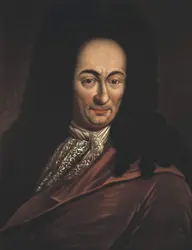ART (Aspects esthétiques) Le beau
Article modifié le
Le retour du beau
Par rapport à cette situation pas si lointaine, il est d'autant plus surprenant que nous assistions depuis la fin de l'époque moderne, et plus exactement durant le dernier quart du xxe siècle (le terme « post-moderniste » fut utilisé pour la première fois en 1968, celui de « postmoderne » en 1974), à une réhabilitation de la beauté.
Pour mesurer l'ampleur de ce retour, il importe de ne pas se limiter au monde de l'art, mais bien, comme c'était le cas dans l'Antiquité et au Moyen Âge, de prendre en compte le monde tel qu'il est aujourd'hui produit, perçu et consommé. C'est affaire ici tout à la fois de culture, de technologie et d'économie. Avançons que ce monde est façonné par une technologie, une économie et une culture de la beauté.
Cette industrie de la beauté corporelle comprend bien sûr la chirurgie esthétique, l'industrie de la forme et du sport, mais également l'ornementation corporelle (piercings, tatouages, traitement de la chevelure). Le cœur de cette « beauté incarnée » est l'industrie des produits de maquillage et de soins corporels, ainsi que la branche la plus importante de l'industrie du luxe, celle des parfums. Rappelons au passage que le vin et le parfum étaient pour Baudelaire, poète de la vie moderne, les insignes même de la beauté. Tous ces phénomènes sont indissociables de modes de production industriels et multinationaux. L'industrie de la beauté des vêtements et parures est également concernée. La mode et les marques sont au cœur de la consommation des groupes sociaux. À cette diffusion de la beauté, qui a aussi valeur d'appropriation, ajoutons la fascination médiatique et publicitaire pour les beautiful people, ces « vedettes » ou personnalités qui peuplent les émissions de télévision grand public et les revues people.
Un autre aspect du retour à la beauté pourrait être décrit par l'expression de « beauté du monde » – à savoir la bimbeloterie commercialisée sous forme de bibelots exotiques, de décoration ethnique, de meubles en provenance d'autres cultures et régions du monde. L'ethnicité devient ici un objet à la fois esthétique et commercial.
Un phénomène significatif non seulement en lui-même, mais par son ampleur, est la vogue du design. Durant l'époque moderne, particulièrement les années 1930, d'ambitieux projets d'esthétisation du monde furent lancés, que ce soit par des artistes (notamment avec le Bauhaus) ou par des régimes politiques (le socialisme stalinien, le national-socialisme hitlérien, le fascisme mussolinien), qui voulaient transformer le monde, y compris dans ses apparences les plus quotidiennes. Il en résulta des styles architecturaux, mais également des lignes d'objets et même de vêtements. Ces projets sont aujourd'hui repris sous forme libérale-commerciale à travers l'offre et la demande de design pour l'ameublement, la décoration intérieure. Bien plus, on voit le design gagner de nombreux autres secteurs : gastronomie, design de mobilier urbain et du cadre de vie, design paysager, design de produit et d'emballage, design d'uniforme et d'objets...
Le tourisme est aussi au cœur de ce retour de la beauté. Depuis ses formes les plus vulgaires jusqu'aux plus accomplies esthétiquement, le tourisme est à la poursuite d'un monde facile et léger, qui puisse être appréhendé dans des attitudes de désintéressement et de distanciation, au plus loin des obligations de la vie quotidienne. La dimension esthétique transparaît dans le fait que le tourisme a besoin de prétextes culturels et esthétiques pour se justifier : la visite d'un site, d'un musée, la participation à une vie culturelle antérieure sacralisée (Borges à Buenos-Aires, Hemingway à Monparnasse, etc.). Il peut être perçu alors comme la modalité esthétique du loisir.
Ce retour de la beauté comporte une dimension morale. En même temps que le Beau, le Bien est réaffirmé, avec les progrès de la vision morale des êtres, des comportements et des échanges. Telle est la signification de l'impératif de la correction politique et morale. Personne n'a aujourd'hui le droit de se montrer ouvertement cynique, malhonnête, égoïste, ou d'avoir la volonté du mal. Quelque grise ou sordide que soit la réalité, il importe de paraître bon et compassionnel. Personne n'oserait aujourd'hui célébrer, à la manière de Baudelaire, la beauté d'un acte de transgression. Oublié, le geste surréaliste qui consistait à descendre dans la rue avec un revolver et à le décharger sur les passants...
L'objectif n'est pas ici de rechercher les raisons de cette montée de la bonté et de la bienveillance, mais de souligner l'importance et la nouveauté de la re-moralisation subreptice qui se réalise, ainsi que la relation ainsi reconstituée entre le beau et le bien. La rupture avec un ordre théologique ou métaphysique est consommée. Ce n'est pas que le beau soit, comme par le passé, identifiable au bien ou fondé en lui, et que la beauté soit le reflet de l'harmonie et de l'ordre des choses. Plutôt, c'est le bien lui-même qui prend valeur de beauté. Il est beau d'être honnête et compassionnel. Réciproquement, on pourrait dire qu'il est bien d'être beau. On a alors le sentiment d'avoir affaire à une sorte de Moyen Âge qui serait esthétique plutôt que spirituel. Le Beau absorbe en quelque sorte le Bien, en même temps qu'il est devenu pour ainsi dire « flottant », sans rien à quoi l'arrimer.
Dans le domaine de l'art, la situation est ambiguë. Dans un tel contexte, en effet, l'idée d'une beauté substantielle (par exemple faite d'ordre, de symétrie, d'harmonie) n'a aucun sens. Il n'existe donc rien de beau à proprement parler dans l'art. Les objets de l'art – dans leur conception en tant que sujet – ne sont pas beaux. En revanche, les « emballages », les modes de présentation possèdent la même beauté que la scénographie de la vie quotidienne : les mises en scène de la misère sont esthétisées, comme celles des vitrines des maisons de luxe. Les moyens technologiques les plus sophistiqués donnent aux images de la violence le brillant et la perfection d'un magazine de luxe ou d'un catalogue de vente aux enchères. Il est significatif qu'une exposition de l'année 2000 consacrée à la beauté ait comporté peu d'œuvres d'art, mais des décorations, des objets naturels, des papillons, des coiffures et maquillages ethniques, du design, des environnements technologiques à effets lumineux diffus. La beauté est partout et nulle part.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Yves MICHAUD : professeur de philosophie à l'université de Rouen, membre de l'Institut universitaire de France
Classification
Médias
Autres références
-
ANTHROPOLOGIE DE L'ART
- Écrit par Brigitte DERLON et Monique JEUDY-BALLINI
- 3 612 mots
- 1 média
L’anthropologie de l’art désigne le domaine, au sein de l’anthropologie sociale et culturelle, qui se consacre principalement à l’étude des expressions plastiques et picturales. L’architecture, la danse, la musique, la littérature, le théâtre et le cinéma n’y sont abordés que marginalement,...
-
ART (notions de base)
- Écrit par Philippe GRANAROLO
- 3 284 mots
- 1 média
-
FINS DE L'ART (esthétique)
- Écrit par Danièle COHN
- 2 835 mots
L'idée des fins de l'art a depuis plus d'un siècle et demi laissé la place à celle d'une fin de l'art. Or, à regarder l'art contemporain, il apparaît que la fin de l'art est aujourd'hui un motif exsangue, et la question de ses fins une urgence. Pourquoi, comment en est-on arrivé là ?
-
ŒUVRE D'ART
- Écrit par Mikel DUFRENNE
- 7 938 mots
La réflexion du philosophe est sans cesse sollicitée par la notion d'œuvre. Nous vivons dans un monde peuplé des produits de l'homo faber. Mais la théologie s'interroge : ce monde et l'homme ne sont-ils pas eux-mêmes les produits d'une démiurgie transcendante ? Et l'homme anxieux d'un...
-
STRUCTURE & ART
- Écrit par Hubert DAMISCH
- 2 875 mots
La métaphore architecturale occupe une place relativement insoupçonnée dans l'archéologie de la pensée structurale qu'elle aura fournie de modèles le plus souvent mécanistes, fondés sur la distinction, héritée de Viollet-le-Duc, entre la structure et la forme. La notion d'ordre, telle que l'impose la...
-
TECHNIQUE ET ART
- Écrit par Marc LE BOT
- 5 573 mots
- 1 média
La distinction entre art et technique n'est pas une donnée de nature. C'est un fait social : fait qui a valeur institutionnelle et dont l'événement dans l'histoire des idées est d'ailleurs relativement récent. C'est dire qu'on ne saurait non plus considérer cette distinction comme un pur fait de connaissance...
-
1848 ET L'ART (expositions)
- Écrit par Jean-François POIRIER
- 1 190 mots
Deux expositions qui se sont déroulées respectivement à Paris du 24 février au 31 mai 1998 au musée d'Orsay, 1848, La République et l'art vivant, et du 4 février au 30 mars 1998 à l'Assemblée nationale, Les Révolutions de 1848, l'Europe des images ont proposé une...
-
ACADÉMISME
- Écrit par Gerald M. ACKERMAN
- 3 543 mots
- 2 médias
Le terme « académisme » se rapporte aux attitudes et principes enseignés dans des écoles d'art dûment organisées, habituellement appelées académies de peinture, ainsi qu'aux œuvres d'art et jugements critiques, produits conformément à ces principes par des académiciens, c'est-à-dire...
-
ALCHIMIE
- Écrit par René ALLEAU et Encyclopædia Universalis
- 13 647 mots
- 2 médias
...phénomènes perçus par nos sens et par leurs instruments. Cette hypothèse peut sembler aventureuse. Pourtant, le simple bon sens suffit à la justifier. Tout art, en effet, s'il est génial, nous montre que le « beau est la splendeur du vrai » et que les structures « imaginales » existent éminemment puisqu'elles... -
ARCHAÏQUE MENTALITÉ
- Écrit par Jean CAZENEUVE
- 7 048 mots
...le succès correspond peut-être à un besoin accru encore par les progrès de la pensée positive et pour ainsi dire en réaction contre elle. D'autre part, on peut trouver dans la vie artistique, sous toutes ses formes, la recherche d'une harmonie entre le subjectif et l'objectif, en même temps qu'un retour... - Afficher les 41 références
Voir aussi