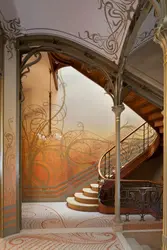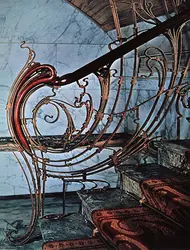MÉTAL ARTS DU
Article modifié le
L'étain, le plomb, le zinc
L'étain
Pour être utilisé, le minerai d'étain, qui était exploité dès l'Antiquité dans les mines à ciel ouvert, doit être lavé et broyé puis chauffé à plusieurs reprises. Il existe trois qualités : la plus basse, d'un gris foncé et mat, comporte une forte proportion de plomb, allant jusqu'à 40 p. 100, elle est appelée en France « claire étoffe » ou « étain mort » ; la deuxième, ou « étain commun », moins terne et moins foncée que la précédente, est très employée : elle est composée de plomb, de cuivre et de bismuth jusqu'à 20 p. 100. La troisième, la plus belle, est l'« étain fin », dont les proportions comprennent 90 p. 100 d'étain allié au bismuth, au cuivre et à l'antimoine et donnent un métal gris pâle, brillant lorsqu'il est poli, et sonnant particulièrement bien. Seuls, l'étain fin et l'étain commun ont été utilisés pour la fabrication des objets mis en contact avec les aliments, la claire étoffe étant dangereuse du fait de ses fortes proportions en plomb. Le saturnisme, dû à l'absorption de plomb, fut jusqu'à la fin du xixe siècle un mal fréquent, provoqué par les fraudes et le manque de précautions dans l'emploi des objets domestiques en étain, qui étaient censés avoir été contrôlés et être de bon aloi. L'étain est un des rares métaux à ne pas supporter le froid : vers – 13 0C, en effet, il devient friable, crevassé et purulent, atteint de cette maladie
irréversible qu'est la peste de l'étain. À plus basse température encore, il tombe en poussière. Il faut tenir compte de cette particularité pour la conservation et pour la qualité de la sonorité des tuyaux d'orgues, par exemple. On a longtemps cru que les pièces atteintes par la peste de l'étain risquaient de contaminer les objets sains, mais des études récentes menées par les laboratoires du musée du Cinquantenaire à Bruxelles semblent remettre ce fait en cause. On « essaie » l'étain à la mouche, en faisant fondre un petit point qui évolue de façons différentes selon la qualité du métal. L'étain est mis en forme de deux manières, au marteau ou fondu.
Salmon, auteur français du célèbre ouvrage L'Art du potier d'étain, publié à Paris en 1788, parle de « planage » et de « forgeage ». Ces opérations sont visibles sur les rares pièces médiévales conservées. Le travail au marteau a été abandonné au xve siècle, mais a été réutilisé au xixe siècle pour surdécorer des pièces du xviie ou du xviiie siècle, repoussées en relief à l'outil après avoir été fondues.
La forme de l'étain et le décor le plus fin, en relief, ajouré, repercé, ciselé, sont obtenus par coulage dans un moule, de bronze ou d'acier, et viennent bruts de coulée, l'étain prenant particulièrement bien les empreintes et ne demandant presque aucun travail de reprise et de reparure, contrairement au bronze ou au laiton. Les anses, les pieds, le couvercle ou les autres éléments sont coulés séparément, puis assemblés par soudure. Une fois la pièce démoulée, il suffit de limer les ébarbures et de pratiquer les moulurations et le polissage au tour. Le décor peut être gravé au burin, à la pointe ou au vernis de graveur, suivant les techniques traditionnelles ; le « décor à l'acide » est propre à l'étain ; il ne consiste pas en une attaque de la surface du métal, mais en un coulage dans un moule dont les décors en creux ont été obtenus par gravure à l'acide, donc en très léger relief. Les célèbres plats dits d'Edelzinn, fabriqués en Allemagne au xvie siècle, relèvent de cette technique.
Dès le xviie siècle, l'étain a aussi été incrusté en plaques ou en filets dans le bois, au même titre que l'écaille, l'ivoire ou le cuivre, dans les célèbres meubles français de A. C. Boulle (1642-1732) et certaines pièces ont été peintes comme des tôles de fer.
Le plus ancien objet d'étain connu est une petite gourde à deux anses, datée de 1850 avant J.-C., trouvée en Égypte à Abydos. En France, une marmite, découverte à Bétricourt en Artois, mais disparue aujourd'hui, aurait daté du ive siècle après J.-C. En Angleterre, des objets du iiie siècle, ainsi que des moules en pierre datant de l'occupation romaine, ont été mis au jours lors de fouilles ; ils étaient fabriqués en Cornouailles, région particulièrement riche en mines. L'emploi de ce métal semble avoir été pratiquement abandonné à la chute de l'Empire romain. Aux xiiie et xive siècles, il apparaît à nouveau dans la vie privée comme dans la vie religieuse. Peu nombreuses sont les pièces françaises parvenues jusqu'à nous ; en Allemagne, en revanche, dans l'église Saint-Nicolas de Rostock et l'église de la Vierge à Mayence, de grandes cuves baptismales, datées des années 1320, rivalisent avec les cuves en bronze. Le musée de Cluny conserve des salières en étain attribuées à la même époque ; pour l'Allemagne du xve siècle, on peut citer les vases à boire de Wismar, ainsi que la grande chope de corporation des boulangers de Breslau (1497). Les vases officiels de corporation, des aiguières ou des cimarres, décoraient les salles des hôtels de ville dans les anciens Pays-Bas.
Au xvie siècle, en France, l'étain rattrape la place occupée par les métaux précieux et on parle désormais d'« orfèvrerie d'étain » ou « à la façon d'argent ». Au xviie siècle et aux siècles suivants, les potiers d'étain continueront à calquer leurs modèles sur des pièces d'orfèvrerie. Le répertoire d'Étienne Delaune et celui de Théodore de Bry utilisent les mêmes dénominations : mascarons, arabesques, rinceaux, grotesques ; l' aiguière de la Tempérance de François Briot de Montbéliard, conservée au Louvre, exécutée vers 1570, est un très bel exemple à rapprocher des grandes pièces décoratives placées sur des buffets ou des dressoirs représentés dans des gravures françaises du xviie siècle. Il existe des exemplaires du même type dans les collections Rothschild, Fould et Dutuit au Petit Palais à Paris. De Gaspard Enderlin, Suisse né à Bâle, potier d'étain à Nuremberg, on a conservé dans cette même ville un plat représentant la Vierge en Gloire. Aux xviie et xviiie siècles, les ateliers de Nuremberg, de Saxe, de Silésie, de Bohême et de Moravie sont particulièrement productifs.
Comme pour l'argenterie, les modèles français ont été imités tout au long du xviiie siècle dans toute l'Europe et nombreuses sont les pièces très marquées par le style français sans renoncer toutefois au baroque. Dans les villes, chaque atelier d'étain avait une spécialité : les vaisseliers pour la vaisselle plate et platerie ; les potiers ronds pour les pichets, les cruches et les mesures ; les menuisiers faisaient les petites pièces, telles que les gobelets, les bénitiers, les calices, les sucriers et les chandeliers ; les bimbelotiers, enfin, ne fabriquaient que les boutons, les jouets, les jetons, les accessoires du costume et les pièces d'assemblage pour la vaisselle de faïence ou de grès.
L'étain décoratif renaît à la fin du xixe siècle avec un goût très prononcé pour la Renaissance et pour les pièces d'apparat. Pour l'Exposition universelle de 1889, Jules Brateau réalise une chope à bière décorée des trois Parques, une cafetière persane, une aiguière et son bassin, inspirés du plat de François Briot. D'autres noms de potiers d'étain sculpteurs doivent être cités ; dans les années 1900, Jean Bafier réalise un surtout de table pour l'hôtel Galliera à Paris, Louis Boucher et Alexandre Charpentier coulent des étains d'inspiration végétale pour des vases et des jardinières. L'étain devient alors, comme le bronze, un matériau se prêtant aux fontes d'art.
Les techniques actuelles restent identiques à celles des siècles passés, mais la qualité des alliages permet de fabriquer en toute sécurité des étains destinés à tous les usages. Proche de l'étain et un peu plus fusible, le bismuth est un métal blanc argentin, légèrement jaunâtre, utilisé en alliage avec d'autres métaux tels que le plomb et l'étain, dont il augmente la dureté. À la fin du xixe siècle en France apparaît une production d'objets décoratifs fondus en série, bon marché, coulés dans des moules peu profonds épousant facilement les moindres contours et reliefs. Ces moules sont composés de plusieurs feuilles de papier mouillé, mis en forme sur un modèle en relief ; une fois séché et enduit d'une sorte de talc réfractaire, le bismuth y est coulé directement et s'y solidifie rapidement sans brûler le papier, car son point de fusion est très bas (100 0C). Les objets ainsi obtenus sont, entre autres, des crucifix appliqués sur fond de velours ou de tissus, des boîtiers de pendules, des petits médaillons, des plats de reliures et des plaques ajourées et découpées pour être appliquées sur des meubles ou sur des objets.
Le plomb
Le plomb, quant à lui, est utilisé pour ses qualités isolantes et pratiques plutôt que pour ses qualités artistiques. Du fait de son poids, qui le rend fragile, sa conservation est difficile et l'usage que l'on en faisait, principalement dans l'architecture, le vouait à la destruction et nécessitait des remplacement réguliers. Des fouilles, tant dans les maisons de Pompéi que dans d'autres villas romaines, ont révélé quelques grandes vasques décoratives et des bassins en plomb. Par la suite et surtout au Moyen Âge, le plomb fut utilisé en numismatique, pour des sceaux, des monnaies et pour les méreaux civils ou religieux qui étaient l'équivalent des jetons de présence, car ils attestaient la participation à une assemblée ou à un pèlerinage. Ces objets étaient fondus en couche mince dans des moules en pierre et recevaient un décor sur les deux faces ou d'un seul côté.
À la même époque, certains objets du culte fabriqués en plomb, tels que les crosses, les calices et les patènes, étaient destinés à être placés dans les sépultures de personnages religieux comme marque de leur dignité. En raison de son prix modéré et de la facilité de sa mise en forme, le plomb a été utilisé pour toutes sortes de petits objets d'usage courant dès le début du Moyen Âge et jusqu'au xixe siècle.
Comme il résiste aux différentes oxydations de l'air, à l'inverse du fer, le plomb a toujours été utilisé en architecture pour les épis de faîtage, les gouttières, puis, au xvie siècle, pour les encadrements de lucarnes, et au xviie siècle il est préféré au marbre et à la pierre pour les bassins, les vasques de fontaines, les luminaires et les statues décoratives dans les jardins.
Le zinc
Le zinc est généralement utilisé en alliage, en particulier avec le cuivre, pour obtenir du laiton. Ce n'est qu'au début du xixe siècle que le zinc seul entre dans la fabrication d'éléments d'architecture et de mobilier. Au même moment, son rôle décoratif est également mis en valeur et développé. En 1819, le sculpteur Malpas présenta à Paris une statue de Louis XVIII en zinc fondu qui fit sensation, mais ce type de réalisation resta exceptionnel. Le zinc peut être travaillé au marteau ou fondu facilement, grâce à son bas degré de fusion (419 0C) ; il prend bien les empreintes du moule, mais il ne semble pas que les artistes et les artisans aient été très séduits par ce matériau.
Le zinc d'art coulé a pour but d'imiter le bronze, mais la technologie ne permet pas avant 1850 de le fondre avec noyau ; les objets coulés étaient donc jusqu'à cette date très lourds et difficilement utilisables. Le zinc était surtout employé en feuilles martelées, plus légères pour des doublures de vases, de rafraîchissoirs ou de jardinières. Le cuivrage, la dorure et l'argenture électrochimique, réalisés au bain galvanique et devenus courants dans les années 1840, pouvaient être appliqués sur le zinc. Dès lors, l'illusion de la ressemblance avec le bronze était parfaite et les pendules, les vases et les garnitures de cheminées furent vendus bien moins cher, tout en produisant le même effet. Le nombre des ouvriers occupés à ces faux « bronzes d'art » s'est multiplié très rapidement.
Laminé industriellement et estampé à la main ou en série, le zinc peut garnir les toits, les crêtes, les chéneaux, les épis de faîtage, des pinacles, des marquises, des lucarnes et des pendentifs de tous styles ; ses qualités lui permettront de s'adapter à la robinetterie et à la tuyauterie, ainsi qu'aux objets de toilette, aux baignoires, aux tubs, etc. Vers la fin du xixe siècle, les métallurgistes ont réussi à mettre au point un métal de plus en plus pur : la dorure du toit en zinc du magasin du Printemps qui sera réalisée en 1882 en est un exemple remarquable ; pour les usages extérieurs et intérieurs, le zinc est associé au fer qu'il protège : en 1925, à l'Exposition universelle, des ornements de zinc estampé, patiné, doré et étamé ont participé à la décoration de différents pavillons.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Catherine ARMINJON : conservateur de l'Inventaire, responsable des Objets mobiliers à l'Inventaire général
Classification
Médias
Autres références
-
AFGHANISTAN
- Écrit par Daniel BALLAND , Gilles DORRONSORO , Encyclopædia Universalis , Mir Mohammad Sediq FARHANG , Pierre GENTELLE , Sayed Qassem RESHTIA , Olivier ROY et Francine TISSOT
- 37 323 mots
- 19 médias
Les orfèvres saka connaissaient depuis longtemps les différentes techniques de transformation dumétal, ainsi que le montage des pierres dures ; ils ont travaillé pour toutes les cours hellénistiques de la mer Noire à l'Oxus ; installés en Bactriane occidentale et au Séistan, ils exécutent les parures... -
AFRIQUE NOIRE (Arts) - Un foisonnement artistique
- Écrit par Louis PERROIS
- 6 867 mots
- 6 médias
Les métaux furent également très employés surtout dans les chefferies centralisées et les royaumes féodaux : l'or, dans les pays baoulé et ashanti, pour la confection des parures (pendentifs, bracelets, colliers en or massif coulé par le procédé de la fonte à la cire perdue) et de certains... -
AFRIQUE NOIRE (Arts) - Histoire et traditions
- Écrit par Jean DEVISSE , Encyclopædia Universalis , Francis GEUS , Louis PERROIS et Jean POLET
- 6 690 mots
...connues. Les plus anciennes figures sont en terre cuite : elles proviennent de lieux de culte et datent, pour les plus anciennes, du xiie siècle environ. Les bronzes d'Ifé (en réalité des laitons ou des cuivres purs) sont beaucoup moins nombreux : moins d'une trentaine. La série des têtes présente une telle... -
AFRIQUE NOIRE (Arts) - Aires et styles
- Écrit par Claire BOULLIER , Geneviève CALAME-GRIAULE , Michèle COQUET , Encyclopædia Universalis et François NEYT
- 15 157 mots
- 2 médias
Les anciens forgerons exécutaient pour les dignitaires des bijoux à la cire perdue en cuivre ou en laiton (bagues ornées de seins ou de cavaliers, pendentifs, bracelets). Des colliers de femme en perles de verre bleues supportant une petite clochette de cuivre évoquaient Nommo, l'eau et la parole. Au... - Afficher les 79 références
Voir aussi
- INDIEN ART
- RESTAURATION, art
- ITALIEN ART
- NOYAU, fonderie
- CHAMPLEVÉ TECHNIQUES DU
- CLOISONNÉ TECHNIQUE DU
- MÉTAL, architecture
- BRONZE, sculpture
- BRONZE D'AMEUBLEMENT
- MÉTAL GRAVURE SUR
- ÉGYPTIEN ART
- GREC ART
- AIGUIÈRE
- DAMASQUINAGE
- FONTE DANS L'ART
- FER ART DU
- ROMAIN ART
- FAUX DAMASSÉ ou NUNAME
- SIMILOR ou PINCHBECH
- FER & FONTE, architecture
- CHINOIS ART
- INCRUSTATION, technique décorative
- BURIN GRAVURE AU
- FERRONNERIE
- FORGERON
- FER FORGÉ
- FONTE DE FER, sculpture
- SERRURERIE
- ÉTAMPAGE, procédé
- ACIER, technologie
- VASES
- REPOUSSÉ TECHNIQUE DU
- POLISSAGE
- SOUDURES
- ASSEMBLAGE, technique
- FORGEAGE
- MOULAGE
- CUIVRES, art
- SABLE MOULAGE AU
- LAITONS
- MAILLECHORTS
- DAMAS, métallurgie
- MÉDIÉVAL ART
- ÉTAMAGE
- RENAISSANCE ARTS DE LA
- BRONZE ART DU
- EXTRÊME-ORIENT ART D'
- BARBARES ARTS DITS
- CIRE PERDUE, techniques
- FONDERIE
- MÉTALLURGIE, histoire
- POTIER D'ÉTAIN
- STYLE 1900
- CHRISTOFLE CHARLES (1805-1863)
- BIENNAIS GUILLAUME (1764-1843)
- GERMAIN FRANÇOIS THOMAS (1726-1791)
- ARGENTURE
- BRUNISSAGE