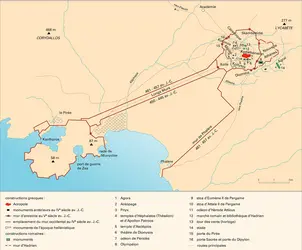ATHÈNES
Article modifié le
Athènes, capitale de la Grèce contemporaine
Pour le touriste et l'homme cultivé, Athènes se résuma longtemps à l'Acropole. Pour l'observateur, elle s'identifia au cours de la seconde moitié du xxe siècle au « miracle » grec, symbole du développement économique du pays. Aujourd'hui, Athènes se pose parfois en « ville globale », quand elle organise les jeux Olympiques (2004), et qu'elle fait jeu égal avec les grands du monde grâce à la marine marchande grecque. C'est une situation paradoxale. Avec 3,8 millions d'habitants au dernier recensement (2001), le « nome » (département) d'Attique, qui regroupe l'essentiel de la région urbaine athénienne, est très loin des agglomérations tentaculaires de la Méditerranée orientale (Le Caire-Alexandrie ou Istanbul). Et, contrairement à la plupart des grandes cités du bassin, et aux images qui s'attachent à leurs noms, l'Athènes contemporaine est une ville neuve, refondée en 1834, dans le souci de doter la Grèce renaissante d'une capitale symbolique. On ajoute ainsi au paradoxe de la démographie l'inconséquence de l'histoire.
Les transfigurations d'une capitale olympique
C'est pourtant cette image banale de l'hypertrophie urbaine, d'une tête trop lourde pour un corps trop frêle, qui retient encore souvent l'attention. L'agglomération athénienne, dans la continuité de l'espace bâti – le triangle de plaine ceinturé par l'Hymette (1 026 m), le Pentélique (1 109 m), le Parnès (1 413 m) et l'Aigaléo –, rassemble quelque 3 millions d'habitants. Mais c'est près de 4 millions de résidents qui sont massés dans la région urbaine de la capitale : entre Corinthe à l'ouest, Thèbes au nord, Khalkis au nord-est, le cap Sounion au sud-est, dans un rayon de 100 kilomètres, la totalité des activités, des flux de transports, d'individus, de biens, d'informations, dépend quotidiennement du cœur de la ville.
Cette condensation spatiale se produit dans un petit pays, faiblement peuplé. Façonnée par une fécondité malthusienne depuis des décennies, minée traditionnellement par l'émigration, mais bénéficiant avec l'effondrement du système communiste d'une forte immigration légale ou clandestine, la population de la Grèce dépasse à peine 11 millions d'habitants (2010). De plus, malgré quelques revivifications provinciales spectaculaires, souvent dopées par le tourisme (les Cyclades) ou le développement agricole (la Crète), la Grèce « utile » se contracte encore autour d'un croissant fertile Thessalonique, Athènes, Patras, même si cet axe des dynamismes a tendance à s'affaiblir. À la jonction des deux cornes dissymétriques de ce dispositif (Patras est à 200 kilomètres, Thessalonique à 600), la capitale accumule tous les déséquilibres : un bon tiers des Grecs y est concentré dans la partie méridionale du pays, la moins dynamique, et la croissance urbaine s'y est faite à un véritable rythme latino-américain pendant plusieurs décennies (la population de l'agglomération ne comptait que 1,1 million d'habitants en 1951) dans une atmosphère générale de vieillissement.
Ces disparités démographiques trouvent évidemment leur répondant économique, plus accentué encore. La région athénienne est la métropole du développement moderne de la Grèce. Malgré une désindustrialisation banale, elle accueille les usines les plus importantes et les plus productives. On y trouve aussi bien des activités à forte valeur ajoutée (édition, laboratoires pharmaceutiques) que les industries lourdes classiques (sidérurgie, raffineries, cimenteries), notamment à l'ouest, autour de la baie d'Éleusis. Et la concentration est plus grande pour les services publics et privés. Cette suprématie peut tourner à la domination absolue pour certaines fonctions spécialisées : transports maritimes avec le port du Pirée, et aériens avec le nouvel aéroport international Eleftérios Vénizélos, théâtres, cabinets d'assurances, agents immobiliers ou bureaux d'architectes. L'accélération des mobilités de tous ordres (autoroutes, aviation intérieure, bateaux rapides, progrès fulgurants des télécommunications) renforce encore cette prééminence athénienne des prestataires de services.
Cette « capitalisation » intérieure se double de la commande quasi absolue de tous les intérêts de la Grèce. Athènes contrôle l'ensemble de la vie économique du pays. Ses banques en drainent l'épargne et y redistribuent le crédit de façon sélective. Ses sièges sociaux gouvernent l'activité des régions les plus dynamiques. Ses grossistes sont à la tête du réseau de distribution le plus puissant. Les filiales enfin des grands trusts internationaux s'installent à Athènes, siège de leur négociation permanente avec le pouvoir politique et instrument de mainmise inégalé sur le marché intérieur grec. Bref, la capitale est tout à la fois le chantier, la vitrine et le poste de commandement de la transformation économique et sociale de la Grèce.
En changeant la donne et en élargissant les échelles géographiques, la mondialisation de l'économie, relayée par l'aide massive des subventions européennes, n'a fait que confirmer ces tendances originelles. Comme toutes les métropoles de cette importance, Athènes a connu un desserrement industriel, notamment sur les confins attico-béotiens, le long de l'autoroute de Thessalonique. Mais les logiques sont complexes et multiples, et beaucoup d'observateurs notent la bonne résistance de l'industrie athénienne, dans son ensemble, notamment l'agroalimentaire, par rapport à des pôles provinciaux plus isolés, pourtant soutenus par des aides à la décentralisation (région de Thrace). L'industrie du bâtiment s'est trouvée relancée par l'urbanisation périphérique, surtout vers le nord, par les chantiers des jeux Olympiques de 2004 et, de façon plus durable encore, par le développement touristique qui se fait en grande partie sous contrôle technique et financier de la capitale.
Pourtant, c'est dans les activités tertiaires et internationales que les bouleversements sont les plus sensibles. La Grèce profite ici de sa position géographique et géostratégique en Europe orientale et méditerranéenne. Elle permet aux grandes entreprises athéniennes, les plus puissantes du pays, de conquérir des marchés dans les « nouveaux » pays de la région anciennement communistes (par exemple, chaîne de distribution d'équipements électroniques Germanos en Roumanie). D'un autre côté, les sociétés multinationales cherchent à s'implanter dans la capitale d'un pays riche, qui est une excellente porte d'entrée vers le Moyen-Orient, les pays du Golfe et même l'Afrique nord-orientale.
Cette réussite économique continue depuis le milieu du xxe siècle s'était surtout traduite par une véritable anarchie urbaine qui faisait d'Athènes une des capitales mondiales de la pollution et le contre-exemple d'un urbanisme réussi : absence d'autorité de régulation, rénovation spontanée et privée des quartiers centraux, lotissements périphériques illégaux.
Les carences des transports publics restaient, à la fin du xxe siècle, le signe le plus évident de l'absence de pensée globale. S'ils n'ont pas créé le sursaut salutaire, les jeux Olympiques ont accéléré la prise de conscience et la mise en œuvre des investissements nécessaires. Jusqu'à la fin des années 1990, les infrastructures sont singulièrement limitées pour une agglomération de cette importance et de cette étendue : un aéroport international, au fort trafic de lignes régulières et de charters, bloqué en pleine ville entre mer et montagne, une ancienne voie ferrée de la fin du xixe siècle transformée en « métro » poussif descendant des banlieues nord (Kiphissia) au Pirée, une flotte de bus et de trolleybus souvent hors d'âge, noyés dans une marée de voitures particulières, à peine découragées par les limitations de la circulation alternée dans le centre.
On assiste, au début du xxie siècle, à un changement spectaculaire, même si les infrastructures mises en service étaient prévues et annoncées depuis des décennies. La fermeture de l'ancien aéroport d'Ellénikon, l'exploitation réussie, après quelques mois d'inévitables mises au point, de la plate-forme aérienne ultramoderne pour passagers et fret Eleftérios Vénizélos, à Spata dans le Mésogée, ouvrent le trafic aérien, libèrent le ciel d'Attique et des terrains convoités en bordure de mer. Les craintes sur l'accessibilité médiocre du nouvel aéroport à partir du centre-ville se sont révélées sans fondement grâce à une branche de l'autoroute Attiki Odos, et la liaison ferrée programmée (interconnexion métro et train suburbain) a même été inaugurée, à l'étonnement général, à la veille de l'ouverture des Jeux.
Dans l'agglomération dense, la mise en service, en 2000, de deux lignes de métro se croisant au centre suscite l'enthousiasme, au moins par leur fréquentation, inattendue, par la modernité du matériel roulant et la beauté des gares transformées en musées archéologiques urbains. Pourtant, la méthodologie appliquée – un métro urbain, plus qu'un réseau express régional, aux stations très rapprochées dans le centre, donc à la vitesse commerciale limitée en bout de ligne, des tunnels percés dans la roche en place (pour ne pas perturber les horizons historiques), très profonds, coûteux – a pu faire craindre un temps que l'effort soit sans commune mesure avec les besoins du trafic qui voudrait un réseau dense et rapide couvrant l'ensemble de la région urbaine.
Car, fidèle aux logiques circulatoires athéniennes, la grande œuvre reste l'ouverture, pour les Jeux de 2004, d'une rocade autoroutière, ceinturant l'agglomération par le nord, du nouvel aéroport à l'est à Eleusis à l'ouest (Attiki Odos). L'investissement est gigantesque : cette rocade est parsemée d'ouvrages d'art remarquables (viaducs, tunnels, échangeurs avec les radiales principales), permet d'accéder au centre d'Athènes et possède une interconnexion avec le réseau national des autoroutes vers Thessalonique et Patras. C'est une nouvelle colonne vertébrale qui est ainsi donnée à la capitale. On peut s'inquiéter simplement qu'elle la fasse ressembler plus à Los Angeles qu'à une métropole européenne. À côté de ce réseau de voies rapides, efficaces et fréquentées, la ligne de tramway de 27 kilomètres, ouverte pour les Jeux, qui descend des quartiers de l'Acropole vers la mer, fait figure de gadget à la mode, avec ses voitures dessinées par Pininfarina.
Il n'empêche. Les visages d'Athènes se sont transformés : « piétonnisation » de certaines voies du centre, promenade pédestre réunissant les sites archéologiques autour de l'Acropole, ouverture de nouveaux musées, notamment celui de l'Acropole (Bernard Tschumi et Michalis Photiadis, 2009), restauration et mise en valeur des ensembles néo-classiques subsistants du xixe siècle – l'extension du siège de la Banque nationale par Mario Botta (2002), qui est une réussite architecturale remarquable, ou le centre culturel Onassis, qui habille de marbre blanc une lourde structure de béton sur l'avenue Syggrou (Architecture-Studio, 2010) –, fréquentation par la jeunesse de quartiers centraux à la mode constituent autant de signes d'une reconquête de la ville ancienne, qui s'ajoutent aux images d'une modernité voyante dans les immeubles de verre et d'acier qui ont surgi sur les avenues périphériques de la capitale. Ils confirment et renforcent l'affirmation d'Athènes comme métropole contemporaine.
Les moteurs historiques de la croissance
Ce maintien de la puissance athénienne en Grèce est d'autant plus étonnant que, depuis des décennies, tous les gouvernements, adeptes plus ou moins inspirés d'un discours sur l'aménagement du territoire, s'efforcent de promouvoir une politique de décongestion de la capitale : décentralisation industrielle, déconcentration administrative, récemment assortie d'un regroupement communal. Les résultats sont médiocres.
Cet échec – prévisible – ressortit à l'incompréhension profonde des mécanismes historiques et économiques, qui ont mis en place le dynamisme athénien. Il est inséparable de l'ascension de la bourgeoisie grecque, à la fois profondément nationale et même nationaliste dans ses sentiments patriotiques, et internationale et cosmopolite dans ses intérêts et ses attachements économiques.
La renaissance – la recréation même – de la ville est intimement liée à l'indépendance du pays. Cinq ans après la reconnaissance de l'État (1829), deux ans après l'arrivée d'un roi bavarois, Othon, sur le trône grec, le choix d'Athènes comme capitale (1834) s'explique par le souci de légitimité de ce souverain d'origine étrangère. Les élites nationales sont alors partagées entre leur sincère désir de n'être pas moins philhellènes que l'Europe éclairée, et leurs affaires éclatées aux quatre coins de la Méditerranée, des Balkans et de la vieille Europe. Pendant près d'un demi-siècle, Smyrne, Constantinople, Ermoupolis dans les Cyclades, Vienne, Marseille ou Londres sont les véritables cités de la bourgeoisie grecque. Mais Athènes, capitale politique d'un royaume centralisé, représente le recours national, en cas de détérioration économique et politique à l'étranger.
Or, de 1880 à 1930 environ, les retournements et les échecs se succèdent pour la diaspora hellénique, confondant pour la première fois le destin économique de ses classes dirigeantes et l'ascension de sa capitale nationale. Après la Première Guerre mondiale, le réveil jeune-turc aboutit à la ruine de la politique annexionniste grecque en Asie Mineure, qui se solde par l'arrivée d'un million et demi de réfugiés en Grèce, dont près de la moitié se fixe plus ou moins rapidement à Athènes (traité de Lausanne, 1923). La crise économique mondiale des années 1930 a, comme partout, une action isolationniste, contractant sur la capitale une économie grecque qui se continentalise. Ces effets sont encore accentués par la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile qui la suit. Athènes est alors la seule région de Grèce où sont en même temps réunis la sécurité politique, les mécanismes de l'État répartissant l'aide américaine (plan Marshall), et l'approvisionnement en énergie et en matières premières (rôle du port du Pirée).
Mais, depuis un siècle, ces moteurs traditionnels de la croissance athénienne – la force de l'État, la puissance du capital – en ont allumé un troisième qui les a relayés à la première place : la pression des hommes. Des années 1950 aux années 1980, les vagues de plus en plus fortes de migrants intérieurs ont formé la main-d'œuvre de la concentration économique athénienne.
L'essor actuel de l'économie mondiale a en outre renforcé le rôle d'Athènes dans la stratégie de l'investissement international. Aux points d'ancrage habituels de l'enrichissement contrôlés par la capitale – revenus de la marine marchande, mouvements de population, avec les mandats de l'émigration hier, la main-d'œuvre issue de l'immigration aujourd'hui, ressources du tourisme – s'est ajoutée l'influence des investissements étrangers (Carrefour, Sephora ou le Crédit agricole qui a racheté la Banque commerciale de Grèce) qui y implantent unités de production, mais surtout sièges de leurs filiales et de leurs représentations commerciales. Elles consacrent ainsi l'identité d'une métropole dynamique, où le patrimoine culturel, l'événement symbolique, l'agrément de loisirs balnéaires proches, l'amélioration des infrastructures le disputent au rattachement, précoce en Méditerranée orientale, à une Europe de la prospérité et de la paix pour composer les ingrédients de la réussite urbaine. Celle-ci reste fragile. Comme toute l'histoire de l'Athènes moderne, la croissance actuelle est marquée du sceau de la consommation plus que de la production, du pari renouvelé sur l'avenir plus que des assurances du présent. Athènes en a toujours été bénéficiaire jusqu'ici, au prix de disparités territoriales et d'inégalités sociales croissantes, malgré l'unification apparente des genres de vie.
Un espace urbain divisé et politiquement faible
Pendant longtemps, la géographie sociale de l'agglomération athénienne est restée simple, articulée par une grande dissymétrie qui traversait la ville du nord au sud : à l'est, de la montagne à la mer, les couches aisées et les fonctions économiques supérieures, à l'ouest, des versants du Parnès au Pirée, l'industrie et les couches populaires et ouvrières. L'origine remonte à la matrice même de la nouvelle Athènes, qui opposait, dès le milieu du xixe siècle, dans une bourgade de quelques dizaines de milliers d'habitants, le palais du roi sur les contreforts du Lycabette et l'usine à gaz sur la route du Pirée. La pérennité de ces caractères originels en dit long sur les forces implicites d'agglutination et de contagion qui animent la constitution des espaces sociaux. Une autre dynamique explique une société longtemps très homogène dans ses origines ethniques et religieuses : la grande perméabilité entre individus et groupes. Riches et pauvres existent évidemment à Athènes, et les écarts de revenus sont même plus accentués qu'en Europe occidentale, eu égard à la faiblesse des processus de redistribution.
Ces permanences sont maintenant bousculées par d'autres modèles, inspirés de la mondialisation et de la modernité métropolitaine. Le renversement, au cours de la dernière décennie du xxe siècle, des mouvements migratoires est ici le phénomène majeur. De pays traditionnellement exportateur de main-d'œuvre, la Grèce est devenue un pays d'accueil pour des centaines de milliers d'immigrants. Venus d'Albanie, d'Europe centrale et orientale ou d'Asie, ils sont séduits par le niveau de vie et les possibilités de travail dans l'industrie, l'agriculture, les services et le tourisme. À Athènes, les chantiers des équipements olympiques, et plus généralement l'embellissement et la rénovation des visages de la ville, les usines et les entrepôts ont attiré des masses nombreuses, peu soucieuses de rythmes de travail et de législation sociale.
Ce bouleversement ne manque pas de transformer les mentalités, les espaces et les pratiques. La société athénienne, naguère accueillante et tolérante, impute aux étrangers la montée de l'insécurité et de la marginalité. Elle est partagée entre ses sentiments de rejet et son intérêt économique pour des populations qui consentent, de plus, à habiter les immeubles denses des quartiers centraux, dévalorisés pour des raisons d'environnement et d'entretien. C'est une modification radicale de la division sociale de l'espace urbain, qui rapproche un peu plus Athènes d'une ville nord-américaine. Ainsi, les couches aisées autrefois attachées au centre et aux pentes du Lycabette se dispersent dans les quartiers aérés du nord-est (de Kiphissia à Dionysos). Motorisation des ménages, accélération des mobilités, déplacement des activités et des centralités commerciales et ludiques constituent un système complexe et interactif de cette nouvelle géographie sociale.
Pour gérer ses complexités, Athènes souffre, comme toutes les métropoles mondiales, du dysfonctionnement entre extension des territoires urbanisés et morcellement politique et administratif des pouvoirs, entre velléités d'autonomie locale et de participation et nécessité d'une autorité centralisée. Pendant longtemps, la gestion impossible de la métropole s'est conclue par le triomphe exclusif de la société civile. Dans les décennies de forte croissance, seuls le consensus social implicite et le consentement du pouvoir politique central ont permis, en l'absence de plan d'ensemble et d'investissements publics considérables, de faire face à une urbanisation galopante, sans « bidonvillisation », et avec même un enrichissement individuel remarquable. Dans les quartiers centraux, l'élévation continue des coefficients d'occupation du sol permettait une rénovation privée et une densification importante du tissu urbain, qui laissait en place le réseau viaire. Dans les zones périphériques se développaient des quartiers spontanés, bâtis illégalement, mais de construction solide, que la régularisation périodique au fil des élections faisait entrer dans l'ordre urbain et dans le cycle d'une spéculation ultérieure possible (édification d'immeubles). Urbanisme sans urbanistes, à l'efficacité économique redoutable, mais aux rançons lourdes en termes d'espaces publics et d'équipements.
Cet équilibre instable n'était plus à la mesure des problèmes de l'agglomération, ni des défis que lui lançait la préparation des Jeux de 2004. Il fallait opérer une réelle révolution des pratiques et inventer pour la circonstance une véritable « gouvernance » d'État qui associait, dans l'urgence absolue, autorité institutionnelle intransigeante et audace technique et juridique des grandes compagnies de travaux publics. Réussite en période critique, ce mode de gestion représente un risque permanent d'encombrements des circuits de décision et de dérives technocratiques, dont l'organisation politique athénienne est le témoignage accablant : dans l'agglomération-capitale, plus d'une centaine de maires, quatre « préfets » élus et un préfet régional représentant le gouvernement central se disputent les pouvoirs. L'électrochoc des jeux Olympiques a incontestablement entraîné, pour Athènes, une réinterprétation de l'espace urbain et une réaffirmation de sa vocation mondiale. Il n'a pas suffi à refonder la cité contemporaine.
Au total, Athènes apparaît comme une capitale politique spécifique en Europe, par la brièveté de son existence, l'originalité de ses modes de fonctionnement social, et surtout l'anonymat, sans monumentalité réelle, de ses paysages urbains, qui la rapprochent plus du nouveau monde que d'une Méditerranée pétrie d'histoire et de mémoire. En même temps, c'est une métropole exemplaire jusqu'à la caricature par la coexistence de l'accumulation et de l'exclusion, la montée des problèmes économiques, sociaux et écologiques et l'impuissance politique à les aborder et à les résoudre. La crise financière qui s'est ouverte en Grèce en 2010 fait d'Athènes l'épicentre matériel et institutionnel d'un séisme national aux conséquences difficilement prévisibles.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Guy BURGEL : professeur à l'université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense
- Pierre LÉVÊQUE : professeur émérite de l'université de Franche-Comté
Classification
Médias
Autres références
-
ACHÈVEMENT DE LA DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE
- Écrit par Christian HERMANSEN
- 279 mots
-
ACROPOLE D'ATHÈNES
- Écrit par Bernard HOLTZMANN
- 8 217 mots
- 9 médias
Presque toute ville grecque est composée de deux éléments que la configuration du site distingue d'emblée : ville haute et ville basse – celle-ci vouée à l'habitat et aux activités civiles et commerciales ; celle-là, l' acropole, réservée à la défense et aux dieux protecteurs...
-
INSTAURATION DE LA DÉMOCRATIE À ATHÈNES
- Écrit par Bernard HOLTZMANN
- 172 mots
Après le départ d'Athènes du tyran Hippias, second fils de Pisistrate, en — 510, les réformes radicales proposées par Clisthène, membre de la famille aristocratique des Alcméonides, mais chef du parti progressiste, sont adoptées. À l'ancienne structure clanique de la société...
-
AGORA
- Écrit par Martine Hélène FOURMONT
- 1 322 mots
- 1 média
À la fois « forme et esprit », l'agora, généralement située à un carrefour important du réseau urbain, matérialise remarquablement la notion de cité grecque. Elle incarne de façon si évidente cette notion que, dans sa Périégèse (X, iv, 1), Pausanias hésite à donner le...
-
ALCIBIADE (450-404 av. J.-C.)
- Écrit par Andrée POUGET
- 2 023 mots
La vie d'Alcibiade, à la fin du ve siècle avant J.-C., coïncide, à Athènes, avec une période de transformations profondes où l'esprit civique et les traditions cèdent devant les progrès de l'individualisme et de la critique. Alcibiade appartient déjà au ive siècle ; c'est...
-
ALCMÉONIDES LES
- Écrit par Claudine LEDUC
- 432 mots
Génos (ou clan) athénien qui parvient à l'archontat dès le ~ viie siècle et joue un rôle important dans l'histoire de la cité à l'époque archaïque. Singulière est sa place dans l'aristocratie athénienne : il n'est pas autochtone mais originaire de Pylos ; il ne dessert aucun culte de l'Attique...
-
ANTÉNOR (fin VIe s. av. J.-C.)
- Écrit par Bernard HOLTZMANN
- 348 mots
Sculpteur athénien, auteur d'un groupe en bronze représentant les « Tyrannoctones », Harmodios et Aristogiton, assassins du tyran Hipparque en ~ 514, et promus héros de la liberté par la démocratie naissante (Pausanias, I, 8, 5). Ce groupe, postérieur à 508 avant J.-C., fut emporté comme butin par...
- Afficher les 113 références
Voir aussi
- GREC ART
- IONIENS, histoire
- CÉCROPS
- AGLAURIDES
- ÉRECHTÉE
- EUPATRIDE
- ARCHONTES
- ARÉOPAGE
- AMPHICTYONIE
- HIPPIAS (mort en 490 av. J.-C.)
- HIPPARQUE (527-514 av. J.-C.)
- STRATÈGE
- HOPLITE
- HÉLIÉE
- DÉLOS LIGUE DE
- HÉRODE ATTICUS TIBÉRIUS CLAUDIUS (101-env. 177)
- ANTIQUE DROIT
- MIGRATIONS HISTOIRE DES
- PATRIARCALE SOCIÉTÉ
- GRECQUE COLONISATION
- GRECQUE RELIGION
- ROUTES & AUTOROUTES
- TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
- TRAGÉDIE ANTIQUE
- DÉMOCRATIES & POUVOIRS POPULAIRES DANS L'ANTIQUITÉ
- CITÉ ANTIQUE
- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE
- MIGRATIONS, Union européenne
- GÉOMÉTRIQUE STYLE, céramique
- ÉPHÉBIE
- GRECQUE PHILOSOPHIE
- TEMPLE, Grèce antique
- CÉRAMIQUE CIMETIÈRE DU
- GREC THÉÂTRE
- TRANSPORTS URBAINS
- GÉOGRAPHIE URBAINE
- MÉTRO
- GRÈCE, géographie
- GRÈCE, histoire, Antiquité
- GRÈCE, histoire, de 1830 à nos jours
- URBANISATION
- CÉRAMIQUE GRECQUE
- CHTHONIENNES DIVINITÉS
- ROME, l'Empire romain
- PEINTURE SUR VASE, Grèce antique
- GRECQUE SCULPTURE
- GRECQUE ARCHITECTURE
- ARGILE, poterie
- ATHÈNES JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ D' (2004)