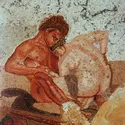EGOYAN ATOM (1960- )
Article modifié le
Si le cinéaste et plasticien canadien Atom Egoyan a intégré, à ses débuts, la vidéo à ses créations, sa démarche ne relève pas, alors, de l'optique formaliste des plasticiens des années 1980 adeptes du « vidéo-art ». Elle cherche plutôt à élargir le domaine de la fiction filmique. L'accroissement constant de son champ d'investigation artistique le conduit, vers le milieu des années 1990, à s'ouvrir à la pratique de l'installation et du multimédia. Influencé par son père, photographe amateur, accompagné par sa femme, l'actrice Arsinée Khanjian présente dans presque tous ses films depuis 1983, la démarche d'Egoyan ne fut cependant pas isolée. L'Autrichien Michael Haneke (Benny's Video, 1992) comme l'Américain Steven Soderbergh (Sexe, mensonges et vidéo, 1989) ou le Hongrois Arpad Sopsits (Video Blues, 1993) utilisent aussi un tel mélange de matériaux, sans en faire toutefois la donnée centrale de leur œuvre ni lui accorder, comme Egoyan, une valeur introspective aussi importante.
À l'instar de Jean-Luc Godard ou de David Lynch, Atom Egoyan se revendique rapidement artiste polymorphe plutôt que cinéaste. Dès 1996, avec Return to the Flock – œuvre constituée d'extraits de son film Calendar (1993), de douze photographies Durotrans et douze moniteurs vidéo –, il prolonge son travail sur pellicule par des expositions et des installations. En 2007, le Centre Pompidou consacre, dans le cadre de l'année de l'Arménie, un double hommage à Atom Egoyan et à un des maîtres de l'abstraction expressionniste, Arshile Gorky, dont l'influence, notamment dans la mise en crise de la figurativité, sera décisive pour le cinéaste torontois.
Le sens des images
Atom Egoyan est né en 1960 au Caire, dans une famille arménienne et artiste. Il émigre avec les siens au Canada en 1963. À dix-huit ans, il s'installe à Toronto où il obtient, en 1982, un diplôme en relations internationales. Mais il s'intéresse surtout au théâtre et au cinéma. La pièce de Samuel Beckett, La Dernière Bande, dont le « héros » écoute un enregistrement de divers épisodes de son passé, lui inspire en 1979 son premier court-métrage, Howard in particular, puis en 2000, la fiction télévisée Krapp's Last Tape. Il revient à cet ouvrage fondateur en 2002 lors d'une exposition londonienne : Steenbeckett. Mais, dès Peep show (1981), il formule les principales données de son œuvre future.
Jusqu'à Calendar (1993), le cinéaste va introduire ses recherches formelles dans ses films, en s'attaquant au matériau fictionnel, par le mélange des temps, la confusion des personnalités, le multiculturalisme, cela d'une manière plus visuelle que strictement narrative. À partir d'Exotica (1994), où l'utilisation de la vidéo se fait plus discrète, tout en jouant un rôle de premier ordre dans Le Voyage de Felicia (1999) ou Ararat (2002), Egoyan se livrera à un travail de « dysnarration » en respectant, tout en les détournant, les codes du récit. Il doublera alors ses films par des installations comme The Origin of the Non-Descript (réalisé en 2001 en collaboration avec Geoffrey James, et inspirée du film The Adjuster : photographie, mono-bande couleur en boucle de 30 s., moniteur, son).
Avec ses trois premiers longs-métrages de fiction : Next of Kin (1984), Family Viewing (1987) et Speaking Parts (1989), Atom Egoyan acquiert une notoriété internationale. Dans Next of Kin, la vidéo n'est encore qu'un déclencheur de fiction. Un jeune homme voit sur un écran de télévision, dans la salle d'attente d'un thérapeute, une famille d'origine arménienne se plaindre de la disparition du fils de la maisonnée. L'adolescent va se substituer à ce dernier et vivre, dans un autre pays, l'existence du disparu auprès de sa famille d'adoption. Tous les thèmes du cinéaste sont déjà là : quête d'identité, recherche des racines, fonctionnement du système vidéo comme « prothèse » de la caméra et révélateur psychique de la personnalité.
Family Viewing représente bien, dans cette optique, le manifeste d'Egoyan à l'époque. Depuis le départ de sa mère, un garçon, Van, vit avec son père et la maîtresse de celui-ci. Le père est entouré de caméras et de magnétoscopes. Il a doublement effacé les origines de son fils : en plaçant sa belle-mère arménienne à l'hôpital et en réenregistrant, sur les bandes familiales prises à l'époque où Van était enfant, ses ébats amoureux avec son actuelle compagne. Le matériau même du film est hybride : vidéo d'assez bonne qualité, pour montrer les relations du père et du fils, images de télévision que Van arrange pour sa grand-mère, images brutes issues des caméras de surveillance quand l'amie de Van se rend à un rendez-vous galant. L'usage de la vidéo évite à Egoyan l'utilisation de nombreux flash-back expliquant ce qui est arrivé à la mère et à la grand-mère, ainsi que le recours à la voix off et à un psychologisme qu'il juge, alors, dépassé. La vidéo est à la fois une source d'aliénation et un instrument de transgression : le « héros » oscille constamment entre le « rêve américain » et la conscience diffuse de n'appartenir à aucun groupe précis. Speaking Parts élargit la sphère familiale (une sœur recherche son frère décédé, à qui un acteur va redonner corps) à celle du spectacle en général.
Avec Calendar (1993), Egoyan pratique une sorte d'exorcisme. Il sature son film de médias divers (à la vidéo s'ajoute la photographie) et met directement en scène sa quête identitaire, qui n'était jusque-là que métaphorique. Il se rend pour la première fois en Arménie, pays dont il parle mal la langue, et met en scène son épouse, Arsinée Khanjian, qui est, elle, parfaitement bilingue. Lui-même tient le rôle d'un photographe parti réaliser un reportage sur les monuments locaux. De retour chez lui, photos, bandes vidéo, ou invitées venues des quatre coins du monde lui permettront de mieux formaliser son échec à comprendre l'Arménie. Le thème du génocide n'apparaîtra, chez l'auteur, que quinze ans plus tard.
Atom Egoyan avait déjà commencé à prendre ses distances avec la vidéo, dès The Adjuster (1991), pour y revenir ensuite, autrement, dans ses films mais aussi en s'ouvrant au multimédia. Ce long-métrage met en scène un assureur qui entretient des relations ambiguës avec ses « protégés ». Ici, la vidéo et l'image reproduite (son épouse travaille pour une commission de censure et visionne des films pornographiques) ne sont plus que des artefacts parmi d'autres de la fiction, qui donneront lieu par la suite à des récupérations et à des réutilisations diverses. Un exemple du recyclage qu'opère perpétuellement le cinéaste, à partir du milieu des années 1990, se retrouve dans Artaud Double Bill, sketch de trois minutes appartenant au film collectif Chacun son cinéma (2007), réalisé pour les 60 ans du festival de Cannes sur le sujet imposé de « la salle de cinéma » : deux spectateurs qui regardent chacun un film différent – Vivre sa vie (1962) de Jean-Luc Godard et The Adjuster – communiquent leurs impressions par SMS.
Son univers agencé, Egoyan estime pouvoir gérer directement ses obsessions à l'intérieur de ses films de fiction. Dans Exotica (1994), deux personnages mêlent leurs fantasmes à travers une recherche ritualisée de sexe et d'êtres proches disparus. De beaux lendemains (The Sweet Hereafter, 1997), adapté du roman de Russell Banks, permet à Egoyan de revenir sur la problématique esquissée dans de The Adjuster : un individu qui cherche à s'immiscer dans la vie d'une communauté, et non plus d'une cellule familiale. Mais ici, l'avocat Mitchell Stephens, fragilisé par le sort de sa fille toxicomane, et qui veut convaincre les parents d'un groupe d'enfants morts dans un accident de bus de porter plainte, sera rejeté comme tentateur.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Raphaël BASSAN : critique et historien de cinéma
Classification
Autres références
-
DE BEAUX LENDEMAINS (A. Egoyan)
- Écrit par Jean COLLET
- 1 554 mots
À Cannes, où il a obtenu en 1997 le grand prix du festival, De beaux lendemains, d'Atom Egoyan, a divisé la critique : certains n'y ont vu que « classicisme postmoderniste », tandis que d'autres étaient sensibles à son architecture rigoureuse. Un tel accueil, passionné autant qu'embarrassé, pourrait...
-
ÉROTISME
- Écrit par Frédérique DEVAUX , René MILHAU , Jean-Jacques PAUVERT , Mario PRAZ et Jean SÉMOLUÉ
- 19 777 mots
- 6 médias
Avec Family Viewing (1987), Atom Egoyan questionne le pouvoir de fascination et d'extase de l'image sur le consommateur. Exotica (1994) reprend en partie ce thème : la ritualisation du sexe conduit, dans le film, à des mises en scène mortifères.
Voir aussi