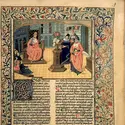AUGUSTINISME
Article modifié le
L'augustinisme politique
La théorie médiévale de la théocratie pontificale
Le concept d'augustinisme politique appartient à l'histoire des doctrines politiques médiévales. C'est, en quelque sorte, par analogie avec ce qu'un certain nombre d'éminents historiens de la philosophie médiévale ont appelé l'augustinisme, et notamment Étienne Gilson, que H. X. Arquillière, dans son ouvrage intitulé L'Augustinisme politique, a élargi au domaine politique les caractéristiques de l'augustinisme en général, considéré comme une tendance « à fusionner l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, à absorber le premier dans le second ». Il le définit comme le mouvement progressif par lequel « la vieille idée romaine de l' État a été absorbée par l'emprise croissante de l'idée chrétienne ». Autrement dit, l'influence des doctrines de la Cité de Dieu, notamment, a trouvé un champ de rayonnement privilégié dans l'élaboration des problèmes politiques qui, dès le haut Moyen Âge, a permis d'aboutir à la constitution de la « théocratie pontificale », c'est-à-dire à l'affirmation de la domination universelle, sur le plan temporel comme sur le plan spirituel, de la suprématie des papes sur les princes et les empereurs. Il s'agit donc, pour l'auteur de L'Augustinisme politique, moins d'analyser les vues proprement augustiniennes sur l'origine du pouvoir temporel, le rôle de l'État ou la nature de la loi que de mesurer l'importance de la référence à l'« autorité » d'Augustin pour les penseurs politiques médiévaux. Tout le Moyen Âge, on le sait, a lu et relu les œuvres des Pères de l'Église, et notamment celles de saint Augustin. Charlemagne lisait la Cité de Dieu ; à l'autre versant du Moyen Âge, à la fin du xive siècle, le roi Charles V la faisait traduire en français par Raoul de Presles, qui y ajoutait des commentaires. On voit donc combien l'œuvre d'Augustin a constitué une référence privilégiée dans l'élaboration de la problématique politique médiévale.
La thématique de la Cité de Dieu telle qu'elle a été élaborée par les penseurs médiévaux est passablement différente de la doctrine d'Augustin lui-même. Elle enveloppe, sous-jacente, celle d'une res publica christiana, d'une communauté politique de tous les chrétiens en tant que telle. Mais il faut distinguer : le peuple chrétien n'est pas l'Église ; il ne peut non plus être identifié à un corps politique, puisqu'il ne poursuit pas des fins temporelles par des moyens temporels, en tant qu'il participe aussi de la cité céleste. De ce point de vue, il passe infiniment la diversité des sociétés politiques. Pour les médiévaux, la république chrétienne est donc un ensemble temporel dont le lien constitutif est spirituel. Les relations de l'Église et de l'Empire, et, d'une manière plus générale, de l'Église et de l'État, pour employer un terme anachronique, mais qui a le mérite d'être parlant, s'éclaireront ainsi à la lumière de celles qui régissent les deux cités augustiniennes, mélangées (le texte d'Augustin dit perplexae) au sein de la cité terrestre. Mais un tel « mélange » implique subordination du temporel au spirituel : de là à dire que l'union du pape et de l'empereur sera celle du chef spirituel de la chrétienté et de son ministre temporel, il n'y a qu'un pas, que le pape Grégoire le Grand franchira aisément. Si le rôle primordial du royaume terrestre est de se mettre au service de l'Église, l'empereur, ou tout autre roi chrétien, aura ainsi des fonctions ministérielles, dont le pontife devra rendre compte à Dieu lui-même.
Saint Augustin, en revanche, donnait à entendre que la cité terrestre, tout comme, du reste, la cité céleste, sont des entités mystiques, des « figures » au sens herméneutique du terme. À ce titre, la première ne doit pas être confondue avec l'État, puisque les futurs élus, ainsi que les damnés, en font partie. De même, l'Église n'est pas la cité céleste, puisqu'une telle cité est « la société de tous les élus, passés, présents et futurs ». Par l'assimilation progressive qu'ils ont faite de la première à l'État et de la seconde à l'Église, les théoriciens de la théocratie pontificale ont établi des liens de subordination de la première à la seconde : l'État peut et doit être utilisé pour les fins propres de l'Église, et, à travers elles, pour celles de la cité de Dieu. Il s'agit là d'un infléchissement, pour ne pas dire d'une subversion de l'enseignement augustinien, qui imposera à l'État comme un devoir de se subordonner aux fins de l'Église. Mais on ne trouverait nulle part, dans l'œuvre de saint Augustin, des affirmations aussi étrangères à sa pensée que celle du fondement divin de l'institution pontificale, ou celle de la primauté romaine ; de la même façon, saint Augustin ignore que la puissance impériale, ou royale, comme le diront les doctrinaires de la théocratie, est transmise par l'intermédiaire de l'Église. Tout au contraire, l'examen des sources scripturaires de la Cité de Dieu ou des Enarrationes in Psalmos, par exemple, prouve que saint Augustin fait sienne la doctrine de l'origine divine du pouvoir du prince, ce que ne manqueront pas d'objecter à leurs adversaires les partisans de l'autonomie et de l'indépendance de l'Empire ou de l'État, comme Marsile de Padoue ou Guillaume d'Ockham. Le docteur africain n'a point, en effet, confondu l'ordre, le droit, les lois de l'État avec ceux de l'Église, en bon disciple des stoïciens et de Cicéron qu'il fut. Il a, au contraire, reconnu la valeur légitime de l'État pour toutes les nations antiques.
L'horizon eschatologique de la thématique augustinienne
L'apparition d'Aristote à l'horizon de la philosophie politique à partir du xiiie siècle ne fut pas un obstacle à la persistance de l'augustinisme politique : les grands docteurs des xiiie et xive siècles traiteront tous des relations du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, ou de l'empire et de la papauté, dans une perspective favorable soit à la théocratie, comme saint Thomas, soit à l'Empire, comme Guillaume d'Ockham.
C'est, en effet, en se réclamant de saint Augustin que les adversaires de la théocratie pontificale ont exalté l'indépendance de l'Empire, son universalité − c'est-à-dire sa catholicité, au nom du fondement divin de sa mission. En la personne de l'empereur se trouvent unis les aspects religieux et politiques du pouvoir.
La même tendance se manifestera également à l'égard de la royauté française – le prince comme « oint du Seigneur » ; c'est là un des « lieux » du traité anonyme du Songe du Vergier, par exemple, au xive siècle en France. Ce texte, écrit à la demande du roi, probablement par un de ses conseillers, Evrart de Trémaugon, exalte la puissance sacrée du roi « thaumaturge », selon l'expression de Marc Bloch. Mais déjà la figure de Charlemagne était centrale, à cet égard ; elle manifeste toute l'ambiguïté de l'augustinisme politique, dont Frédéric Ier Barberousse et Frédéric II, empereurs germaniques, se réclament contre les papes, en revendiquant l'héritage temporel et spirituel de Charlemagne, considéré comme le véritable chef de la société chrétienne. « Quiconque prétend que nous avons reçu la couronne impériale du seigneur pape, celui-là s'érige en contradicteur de son institution divine et de la doctrine de Pierre, et sera convaincu de mensonge », disait Frédéric Barberousse en 1157. Aussi bien, le processus de juridisation qui a conduit à la doctrine de la plénitude de puissance pontificale n'est-il pas une trahison de l'esprit même de la pensée théologico-politique de l'évêque d'Hippone ?
Comme l'a fortement dit Étienne Gilson, le fil conducteur permettant de rendre compte de l'intelligibilité de la doctrine des deux cités, de Jérusalem et de Babylone, est le « principe » en vertu duquel « les deux cités [...] recrutent leurs citoyens selon la seule loi de la prédestination divine. Tous les hommes font partie de l'une ou de l'autre, parce que tous les hommes sont prédestinés à la béatitude avec Dieu, ou à la misère avec le démon. » L'aspect essentiel de la vision augustinienne est celui de la « Cité de Dieu en pèlerinage dans le temps ». En réduisant les deux cités à une seule, par substitution de la cité temporelle et historique à la civitas terrena, qui pour Augustin est éternellement mystique, et transcende tous les régimes temporels, et en forgeant la thématique d'une société universelle incarnée dans la res publica christiana, l'« augustinisme politique » médiéval transformait du même coup l'esprit même de la doctrine d'Augustin par une simplification historique, méconnaissant l'horizon eschatologique de la problématique des deux cités.
D'où l'utopie de Dante, celle de la monarchie universelle sous la conduite de l'empereur ; d'où également les thèses radicales théocratiques. En réalité, le problème central de la pensée politique médiévale a été celui du conflit des deux pouvoirs, temporel et spirituel, dans une cité unique, qui ne pouvait « avoir deux chefs ». S'il est vrai qu'on peut voir dans la pensée d'Augustin, comme on l'a souligné plus haut, une tendance à absorber l'ordre naturel dans l'ordre surnaturel, les penseurs politiques médiévaux ont suivi la tendance exactement inverse : c'est l'ordre surnaturel qui a été pris en compte par l'ordre naturel. Les papes, tout comme les empereurs et les princes, ont voulu gérer le spirituel comme s'il s'agissait du temporel. C'est ce qui rend compte, semble-t-il, de la « reprise en main » des affaires terrestres par les pontifes au nom d'une république chrétienne unique, tout autant qu'à l'inverse se sont manifestées les tentatives de mainmise par les empereurs et les princes d'un certain nombre de prérogatives d'ordre purement spirituel. Ce que l'augustinisme politique a méconnu, c'est la dualité radicale, transcendante, des deux cités ; c'est également leur caractère « figuratif ».
C'est à cette impossible réconciliation de la cité terrestre et de la cité céleste que se mesure toute l'importance de l'augustinisme politique pour l'histoire des doctrines politiques médiévales, sa grandeur et sa faiblesse tout à la fois : avoir cru possible l'universalisation de la société humaine sous l'égide de la foi, sans voir qu'une telle perspective relève de la prédestination plutôt que d'un conflit de juridiction entre deux autorités. Le vrai sens de la pensée théologico-politique d'Augustin est d'avoir situé la thématique des deux cités dans l'ordre, souverain, de l'eschatologie.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Michel MESLIN : professeur émérite à l'université de Paris-Sorbonne, directeur de l'Institut de recherches pour l'étude des religions
- Jeannine QUILLET : agrégée de l'Université, docteur ès lettres, professeur et directeur du département de philosophie à l'université de Paris XII-Créteil
Classification
Autres références
-
ALEXANDRE DE HALÈS (1185 env.-1245)
- Écrit par Charles BALADIER
- 939 mots
Originaire de Hayles (Halès en français), dans le comté de Gloucester, Alexandre de Halès, premier franciscain à enseigner à l'Université de Paris, y fut d'abord un des principaux maîtres séculiers. Il était bachelier sententiaire entre 1220 et 1226. Outre ses Questiones...
-
ARISTOTÉLISME MÉDIÉVAL
- Écrit par Alain de LIBERA
- 4 953 mots
- 1 média
...tentative d'un retour à l'aristotélisme authentique, par-delà les divers éclectismes platoniciens et avicenniens où se sont exprimées les nombreuses formes d' augustinismes pratiquées tant en philosophie qu'en théologie. Réciproquement, quand le théologien allemand Dietrich de Freiberg réaffirme le parallélisme... -
AUGUSTIN saint (354-430)
- Écrit par Michel MESLIN
- 8 971 mots
- 2 médias
La pensée doctrinale d'Augustin s'est développée progressivement, ne parvenant que par étapes, à la suite des circonstances et parfois sous l'action de la controverse, à la prise de conscience de chaque vérité et à la perception lucide du rôle de cette vérité dans l'ensemble de la ... -
AVICENNE, arabe IBN SĪNĀ (980-1037)
- Écrit par Henry CORBIN
- 8 904 mots
- 1 média
... Thomas d'Aquin. Et précisément une grande part de l'activité de saint Thomas fut consacrée à la critique destructive d'une forme d'augustinisme qui conduisit Étienne Gilson à la découverte et à l'analyse mémorable du phénomène qu'il caractérisa comme « augustinisme avicennisant... - Afficher les 19 références
Voir aussi
- LIBRE ARBITRE
- CITÉ CÉLESTE
- CHRÉTIENTÉ MÉDIÉVALE
- ÉGLISE & ÉTAT
- TEMPOREL POUVOIR
- PROSPER D'AQUITAINE saint (390 env.-env. 455 et 463)
- SACERDOCE & DE L'EMPIRE QUERELLES DU
- MÉDIÉVALES PHILOSOPHIES & THÉOLOGIES, jusqu'au XIIe siècle
- MÉDIÉVALES PHILOSOPHIES & THÉOLOGIES, du XIIIe au XVe s.
- SEMI-PÉLAGIANISME
- THÉOCRATIE
- SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE
- LATINE MÉDIÉVALE LITTÉRATURE
- MYSTIQUE CHRÉTIENNE
- MÉDIÉVALE PENSÉE