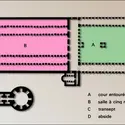AUTELS
Article modifié le
L'autel chrétien
Le culte chrétien se distingue de tous les autres par la nature du sacrifice. En fait, le christianisme n'en reconnaît qu'un seul, celui de son fondateur, qui en est tout à la fois la victime et le prêtre. La croix en est l'autel. Cet unique sacrifice se perpétue dans la messe.
Le prêtre n'est donc pas le ministre d'une offrande de l'humanité à la divinité, mais celui de l'action dans laquelle le Fils s'est offert au Père pour les hommes et à leur place. La messe revient donc à présenter à Dieu ce qui vient de lui au sens le plus strict. Et, s'il subsiste une offrande, celle du pain et du vin, un repas n'est pas offert à Dieu, au contraire, c'est lui qui se donne en nourriture dans la communion.
Sans doute une grande partie des réformés ne partagent-ils pas cette conception. Pour les calvinistes, la Sainte Cène n'est pas un sacrifice. Néanmoins, la valeur qu'ils lui attribuent est un des éléments de la théologie de la messe qui s'est constituée à partir de deux sources :
D'une part, le repas eucharistique qui se célébrait dans la primitive Église et comportait la consécration des saintes espèces. Comme il se tenait dans les demeures des fidèles, des tables servirent d'autels. La plus ancienne figuration qui nous en soit parvenue, une fresque de la catacombe de Calixte, datée du iiie siècle, montre un petit trépied circulaire. Par la suite, l'autel est devenu rectangulaire. Ce fut d'abord un meuble de bois placé devant la chaire de l'évêque, puis, fait en pierre, il devint fixe, tout en conservant la forme de la table.
D'autre part, la messe dérive du sacrifice célébré sur la sépulture des martyrs, associés au Christ. Les autels-tombeaux ont leur origine dans cet usage et semblent s'être généralisés vers le troisième quart du iiie siècle. On ne les rencontrait cependant que dans des lieux de culte situés à l'extérieur des villes, l'inhumation étant interdite intra muros. Même sans contenir les restes d'un martyr, certains autels peuvent avoir la forme d'une sépulture, d'autant que des sarcophages ont été fréquemment remployés à cette fin dans les premiers siècles de l'Église. Mais cette relation entre l'eucharistie et les restes des martyrs n'a pas eu que des conséquences esthétiques.
Quelle que soit la source à laquelle on se réfère, la célébration dérive du sacrifice du Christ et l'autel symbolise son corps : cinq croix gravées sur la table figurent ses cinq plaies. Ce rapprochement est renforcé par la consécration. À l'origine, ce rite était réservé aux autels dans lesquels des reliques avaient été enfermées. Mais rares étaient ceux qui en étaient dépourvus après le vie siècle. Finalement, l'usage a été confirmé par une prescription canonique imposant l'inclusion des reliques et la consécration.
Toutes ces raisons se conjuguent pour conférer une splendeur particulière à l'autel chrétien. Le concile d'Epaone (517) a interdit l'emploi du bois pour sa fabrication. Certes, les autels en bois n'ont pas disparu pour autant ; certains d'entre eux subsistaient en Angleterre à la fin du xie et au début du xiie siècle ; on les rencontre plus tard en Espagne et surtout en France où l'un d'eux existait encore au xvie ou au xviie siècle. Mais, tant en raison des décisions conciliaires que de la multiplication des autels-tombeaux, les plus nombreux sont en pierre. Enfin, on les plaque de cuivre doré, voire d'argent ou d'or massif comme à Saint-Denis où plusieurs d'entre eux étaient ornés de pierres précieuses.
En outre, l'autel est souvent placé sur une confession, sorte de petite crypte où se trouve la sépulture d'un saint ; sa base s'élève alors de quelque deux mètres au-dessus du niveau de la nef. On le surmonte d'un baldaquin, usage tombé en désuétude au cours des siècles derniers. Enfin, on l'isole du reste de l'église par une clôture dont le développement a produit les jubés et les iconostases. À la limite, ces séparations masquent complètement l'autel aux yeux des fidèles, comme c'est le cas dans les Églises orientales au moment de la consécration des saintes espèces.
Il faut noter toutefois que jubés et iconostases procèdent d'un contresens car les frontières du sacré et du profane ne passent pas à l'intérieur de l'église, mais concordent avec ses limites. En Occident, la Contre-Réforme a réduit la clôture à une simple barrière, ou, au plus, à une grille ; elle tend à disparaître complètement aujourd'hui.
Une pratique religieuse plus fréquente est à l'origine de la multiplication des autels portatifs. Au temps des persécutions, ils permettaient de célébrer l'eucharistie dans les prisons, en secret. Après l'édit de Constantin, ils servirent à offrir le sacrifice là où n'existait pas d'église. Eux aussi furent ornés et enrichis.
À l'exception des autels païens remployés à la fin de l'Antiquité, l'autel chrétien s'inscrit lui aussi dans un parallélépipède droit à base rectangulaire dont la plus grande dimension est la longueur. Jusqu'au xiiie siècle, la bordure de la face supérieure se relevait de quelques centimètres. Cette particularité, en rapport avec la communion des fidèles sous les deux espèces qui nécessitait la consécration de grandes quantités de vin, était destinée à empêcher l'écoulement du précieux sang sur le sol si le calice venait à se renverser.
En dehors des cathédrales, l'autel se plaçait soit à la croisée du transept, soit au fond de l'abside mais à condition que l'on pût en faire le tour.
Au cours des premiers siècles, le prêtre était tourné vers les fidèles, les églises étant orientées de telle sorte que ces derniers regardent vers l'est. Mais, à partir du ve ou du vie siècle, sous l'influence de Byzance, on voulut que le prêtre se tînt, lui aussi, dans la même position. Il fallut donc qu'il leur tournât le dos. À partir du ixe siècle, l'ostension permanente des reliques sur l'autel fut autorisée. Ces deux mesures devaient avoir une influence décisive sur son évolution.
Tout d'abord, elles favorisaient son éloignement vers le fond de l'église. En outre, on pouvait remplacer les reliques par une image quand elles n'étaient pas assez importantes pour être incluses dans une châsse. Le retable dérive de cette licence. À l'origine, celui-ci représente des scènes bibliques ou des données de foi ; mais, le culte des saints s'hypertrophiant à partir de la fin du Moyen Âge, on les remplacera par des images tirées de l'hagiographie. De là un déséquilibre entre la foi, commune à tous les fidèles, et les dévotions, de nature individuelle, au profit des secondes. Ce déplacement se manifeste dans l'hypertrophie des retables baroques qui tend à réduire l'autel à un accessoire de l'image et devait contribuer à consacrer les tendances individualistes dans la pratique religieuse.
Au xvie siècle, l'habitude fut prise de placer les luminaires sur un degré, puis il s'en est créé un second, enfin un troisième. Surchargés de statues, de bustes et de châsses aux xviiie et xixe siècles, particulièrement en Italie, ils feront ressembler l'autel à une crédence.
L'un des aspects essentiels du renouveau liturgique contemporain consiste dans le mouvement inverse de ce développement anarchique. Le prêtre se tournant à nouveau vers les fidèles, on revient à la table, ou bloc, plus proche de l'assistance. La généralisation de la concélébration, autrefois réservée au sacre des évêques, est venue renforcer cette tendance ; pour la même raison la surface de l'autel s'accroît. Enfin, le renouveau liturgique a eu pour conséquence de réduire leur nombre. Unique aux premiers siècles chrétiens quand saint Ignace d'Antioche écrivait : « Il n'y a qu'une eucharistie, qu'un autel, comme il n'y a qu'un évêque », il tend à le redevenir aujourd'hui.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Louis LÉVY : diplômé d'art et d'archéologie
Classification
Média
Autres références
-
AUTEL D'OR DE VOLVINIUS, Milan
- Écrit par Christophe MOREAU
- 265 mots
Vers 840, l'évêque de Milan, Angilbert II, commande au maître orfèvre, Volvinius, un autel destiné à accueillir les reliques des saints Gervais et Protais, ainsi que celles de saint Ambroise auquel était consacrée sa cathédrale (l'autel est conservé dans l'église Saint-Ambroise,...
-
DESIDERIO DA SETTIGNANO (av. 1430-1464)
- Écrit par Marie-Geneviève de LA COSTE-MESSELIÈRE
- 481 mots
-
ÉGLISE, architecture
- Écrit par Alain ERLANDE-BRANDENBURG
- 8 059 mots
- 2 médias
...fut soit conservé en l'état, soit inversé et installé au fond de l'abside, épousant, comme dans les premiers temps chrétiens, son plan hémicirculaire. L'autel subit des modifications tout aussi importantes quant à sa signification, à son emplacement et à sa forme. Alors qu'il devait être unique et étroitement... -
ICONOSTASE
- Écrit par Jean GOUILLARD
- 1 217 mots
- 1 média
Pour les contemporains, l'iconostase évoque cet imposant dressoir d'images saintes qui, dans les communautés orthodoxes de souche gréco-byzantine, isole le fidèle de l'espace sacré par excellence, le sanctuaire. Dans l'usage originel, eikonostasion définissait le...
- Afficher les 20 références
Voir aussi