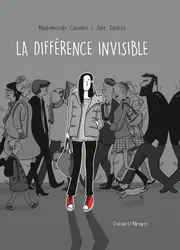- 1. Évolution du soin en psychiatrie de l’enfant et dans l’autisme
- 2. Processus de soin, recommandations de bonne pratique et plans Autisme
- 3. Épidémiologie de l’autisme
- 4. Signes cliniques de l’autisme et nosographie
- 5. Étiologie de l’autisme
- 6. Évaluation et accompagnement des personnes avec TSA
- 7. Perspectives et espoir d’inclusion
- 8. Bibliographie
AUTISME ET TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME
Article modifié le
Évaluation et accompagnement des personnes avec TSA
L’évaluation diagnostique et somatique
En France, les évaluations des personnes avec autisme sont généralement réalisées au sein des centres de ressource autisme régionaux, des plateformes de diagnostic autisme de proximité (PDAP) ou encore des plateformes de coordination et d’orientation (PCO).
Les observations cliniques sont au cœur du diagnostic. Des évaluations fonctionnelles visent également à définir l’impact des signes cliniques sur le quotidien de l’enfant, notamment sur sa vie familiale, avec sa fratrie, à l’école ou en situation de loisirs. L’utilisation de questionnaires, d’échelles et d’entretiens semi-dirigés ou dirigés structure ces observations cliniques et les résultats complètent la connaissance du développement de l’enfant ou de l’adulte dans les domaines affectif, cognitif, moteur, communicatif et social. En objectivant les particularités neurodéveloppementales de la personne, l’évaluation fonctionnelle aide à organiser le projet personnalisé d’intervention selon la priorisation des besoins de la personne.
Si les recommandations de la HAS pour le diagnostic de l’autisme guident les professionnels dans le recours aux instruments d’évaluation en référence à l’evidence-based medicine, celles-ci n’excluent pas l’introduction d’évaluations complémentaires proposées par des équipes expertes dans ce domaine. On trouve parmi ces outils :
– le M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers), qui est un questionnaire composé d’une vingtaine d’items, destiné aux parents et à l’observation de leur enfant âgé de seize à trente mois. Les réponses parentales sont analysées selon un niveau de « risque » ou un niveau de « présence confirmée » ;
– l’ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised), qui est un outil de diagnostic administré dans le cadre d’un entretien parental semi-structuré dont la passation s’effectue avec un clinicien formé et entraîné spécifiquement. Il se réfère aux critères diagnostiques du DSM-IV et de la CIM-10 ;
– le CAST (Childhood Asperger Syndrome Test), qui évalue les signes du syndrome d’Asperger ou troubles autistiques sans déficit cognitif, chez les enfants âgés de quatre à onze ans. Il comporte près d’une quarantaine d’items et les réponses se font par oui ou non. Il s’agit davantage d’un outil de repérage que de diagnostic ;
– la CARS (Childhood Autism Rating Scale), qui apprécie le nombre et l’intensité des traits autistiques en se fondant sur des données comportementales et empiriques. Cet outil est validé, traduit en français, mais un certain nombre de faux positifs peuvent survenir, particulièrement en cas de présence d’un retard sévère du développement associé ;
– l’échelle de Vineland, qui évalue les capacités d’adaptation de l’enfant en analysant son comportement dans quatre domaines de fonctionnement socioadaptatif. Il s’agit de la communication (réceptive, expressive, écrite), de l’autonomie (personnelle, familiale et sociale), de la socialisation (relations interpersonnelles, loisirs, capacités d’adaptation) et de la motricité (globale et fine). Les résultats de l’échelle de Vineland peuvent être essentiels dans la détermination d’un diagnostic différentiel ;
– l’ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule), qui est composé de quatre modules correspondant à des niveaux de développement langagier différents. Son utilisation est appropriée dès l’âge de deux ans, à l’adolescence et à l’âge adulte. Les observations portent sur la qualité de la communication, des interactions sociales réciproques, du jeu, des comportements stéréotypés et des intérêts restreints. L’ADOS-G est très spécifique pour le diagnostic différentiel entre les troubles appartenant au spectre autistique et les troubles spécifiques du langage.
La santé physique des personnes avec autisme nécessite une vigilance en cas d’épilepsie ou de perturbations génétiques identifiées. Mais l’alimentation et le développement staturo-pondéral, le sommeil, le transit gastro-intestinal et l’état bucco-dentaire doivent également faire l’objet de surveillance, car ils peuvent être source d’inconfort ou de douleurs favorisant des états d’agitation ou des comportements perturbateurs.
Les approches recommandées
Les approches éducatives et développementales
À l’issue de l’évaluation médicale et fonctionnelle de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte avec TSA, il est recommandé de mettre en œuvre, de façon participative avec la famille, un projet personnalisé d’intervention (PPI) qui détermine les objectifs de la prise en charge. Les approches développementales et éducatives sont au cœur de ces PPI, mais la recherche n’est qu’au début de l’évaluation de ces traitements. Les troubles associés qui impactent la personne à troubles autistiques et sa famille (avec des risques de burn out), leur quotidien, sa scolarisation, et sa santé physique doivent encore être évalués scientifiquement.
Les différentes prises en charge se combinent, selon le développement et le parcours de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte, à d’autres approches de type orthophonique, psychomotrice ou psychothérapique. Elles sont également évolutives en fonction des compétences acquises au fil du temps par les personnes avec TSA.
La prise en charge éducative s’est d’abord focalisée sur l’adaptation comportementale de l’enfant par des stratégies fondées sur le principe de motivation et de récompense renforçatrice. C’est le cas du programme « Traitement et éducation pour enfants avec autisme ou handicap de la communication » (TEACCH, Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children), et du développement de l’analyse appliquée du comportement (ABA, Applied Behavior Analysis). Par la suite, cette approche s’est enrichie de notions dites développementales qui s’attachent à la recherche de la coopération de l’enfant en s’appuyant sur le principe de compétence cognitive, d’utilisation des intérêts personnalisés et de développement du jeu symbolique pour élargir les compétences en communication non verbale ou verbale et créer des cercles de communication de plus en plus larges. Il s’agit de la thérapie d’échange et de développement, du programme développemental dit de Denver (ESDM, Early Start Denver Model) et du programme de thérapie de communication dans l'autisme préscolaire (PACT, Pre-school Autism Communication Therapy).
Les approches médicamenteuses
La prescription médicamenteuse ne s’applique jamais en première intention chez les personnes avec autisme, mais seulement si des impératifs cliniques l’imposent, avec l’accord des parents qui auront bénéficié auparavant d’une information éclairée. Les traitements médicamenteux s’adressent à certains symptômes associés à l’autisme, mais ils ne sont pas curatifs. Ils trouvent leur intérêt lorsque, en dépit de la mise en place d’approches éducatives et développementales validées et bien conduites, des troubles sévères du comportement ou du sommeil impactent négativement la vie quotidienne de la personne et de sa famille. Les quatre familles thérapeutiques auxquelles le médecin peut se référer sont les antipsychotiques atypiques, les psychostimulants, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et la mélatonine. La balance bénéfice-risque est constamment à réévaluer, les effets secondaires à surveiller de façon rapprochée, la prescription à long terme à éviter, et la monothérapie est la règle.
L’accompagnement social
En France, lorsque l’évaluation clinique, fonctionnelle et médicale est finalisée, il est possible de proposer aux familles et à la personne avec TSA de constituer un dossier destiné à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), en tenant compte de leur sensibilité à accepter cette démarche. La constitution de ce dossier accélère l’intégration scolaire grâce à l’attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ou à l’attribution d’une allocation aidant à la mise en place de prises en charge thérapeutiques non remboursées par la Sécurité sociale ou indisponibles dans le service public.
Les autres approches
Parallèlement aux prises en charge recommandées, le recours à des thérapeutiques complémentaires ou alternatives est une réalité pour plus de 70 % des enfants avec autisme. Si certains résultats semblent prometteurs, il n’existe néanmoins aucune preuve quant à leur bénéfice et elles ne peuvent à ce titre bénéficier de recommandations. Les thérapeutiques complémentaires peuvent être ingérables par voie orale comme la supplémentation en vitamine B12, le régime sans gluten et sans caséine, la supplémentation en oméga 3, les apports de probiotiques. Mais celles-ci restent d’intérêt non consensuel dans le monde scientifique et, pour certaines, l’absence d’effets adverses ne peut être affirmée.
Les thérapeutiques non ingérables ciblent les perturbations de l’intégration sensorimotrice mais, en dépit de certains essais prometteurs en musicothérapie, avec le neurofeedback ou avec les systèmes robotisés, aucun bénéfice fondé sur la preuve n’a encore été démontré.
L’évolution du trouble autistique
Le traitement de l’autisme repose sur des interventions qui promeuvent le développement et le bien-être des personnes avec TSA ainsi que de leurs familles. La mise en œuvre de ces interventions cherche en priorité à éviter un surhandicap chez la personne et à favoriser son inclusion sociale et son autonomie. C’est ce que traduit l’expansion du concept d’empowerment qui a pour objectif que la personne avec TSA assure par elle-même sa santé mentale et physique. On estime que 50 % des programmes proposés sont efficaces, ce qui incite à la poursuite de la recherche dans ce domaine. Alors que seulement un quart des personnes avec autisme ou TSA accède à un travail, l’emploi accompagné connaît un essor significatif. Ainsi, contrairement à une idée reçue, l’espoir d’une évolution positive pour les personnes avec TSA concerne un grand nombre d’entre elles, dans la mesure où leur déficit cognitif n’est pas majeur.
Au sujet de l’évolution de leur santé physique, les personnes avec autisme présentent un taux de mortalité supérieur à celui de la population générale avec un ratio pouvant aller jusqu’à 2. Les facteurs associés à cette mortalité précoce concernent les problèmes neurologiques, cardio-vasculaires, les accidents et les suicides. Dans le cas d’un déficit intellectuel, on peut observer des troubles nutritionnels, de surprescriptions médicamenteuses et de maladies physiques multiples qui accroissent ce risque de mortalité précoce.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Catherine DOYEN : cheffe du service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent au centre hospitalier Sainte-Anne, Paris
Classification
Médias
Voir aussi
- NEUROPSYCHOLOGIE
- HÉRÉDITAIRES MALADIES ou MALADIES GÉNÉTIQUES
- PSYCHOPATHOLOGIE
- ESPRIT THÉORIE DE L'
- HANDICAPÉS
- ENFANT MALADIES DE L'
- IMAGERIE CÉRÉBRALE
- PÉDIATRIE
- ENFANT SAUVAGE
- ÉTIOLOGIE
- PSYCHOSE
- COMPORTEMENT TROUBLES DU
- AUTISME
- KANNER LEO (1894-1981)
- ASPERGER SYNDROME D'
- FACTEUR DE RISQUE, épidémiologie
- CHROMOSOMES
- LANGAGE PATHOLOGIE DU
- DÉVELOPPEMENT HUMAIN
- PSYCHIATRIE DE L'ENFANT
- DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ou MANUEL DIAGNOSTIQUE ET STATISTIQUE DES TROUBLES MENTAUX
- HAS HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
- TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren)
- ABA (Applied Behavior Analysis)
- TROUBLES MENTAUX ou TROUBLES PSYCHIQUES