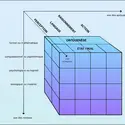- 1. L'automate dans l'Antiquité grecque et byzantine
- 2. L'héritage byzantin et arabe en Occident
- 3. Les « automations » de la Renaissance
- 4. Vaucanson et le biomécanisme. Les successeurs
- 5. Le robot, la cybernétique et les calculateurs
- 6. La liaison science-technique et l'automatisme
- 7. L'automatisme et les mythes littéraires
- 8. L'automatisme ambulatoire
- 9. Bibliographie
AUTOMATE
Article modifié le
Un automate (du grec ἀυτοματ́ον) est une machine imitant les mouvements, les fonctions ou les actes d'un corps animé.
Des origines jusqu'à nos jours, la création des figures animées, d'une complexité de plus en plus grande à mesure que se développent les sciences et les techniques, paraît avoir été – que le but en fût magique, religieux, scientifique ou récréatif – un des besoins élémentaires de l'humanité.
Dès l'origine, l'homme semble avoir cherché à reproduire l'apparence et le mouvement des êtres de son milieu vital. Animer le monde qui l'entoure pour s'en rendre maître va être une des premières recherches d'une humanité qui attribuait aux images et à la parole une force magique. Dans l'univers du primitif où tout a une âme et où l'outil ne peut s'animer et agir qu'avec la permission d'une puissance surnaturelle, l'action devient une participation à la vie cosmique par un jeu de symboles et de signes : le masque, animé ou non, sera pour le sorcier l'expression même d'une nouvelle personnalité qu'il endosse. « L'être humain, semblable parodiquement au dieu de la Genèse, n'a-t-il pas créé l'automate à son image... Pour se reconnaître en lui ! »
Dans toutes les pratiques cérémonielles et magiques : initiations, rites funéraires, danses totémiques, le masque articulé a sa place. On le retrouve aussi bien en Afrique (masque de danse Onéré au musée de l'Homme) qu'en Asie (tête de crocodile articulée, provenant de Ceylan, conservée au musée de Bâle). L'on connaît aussi un masque articulé de l'Anubis égyptien, au corps d'homme et à la tête de chacal : sa mâchoire, mue par des fils cachés, paraissait prononcer les ordres que dictaient les prêtres. L'automate était ici l'auxiliaire du merveilleux. Hérodote, Lucien, Diodore de Sicile font état de statues animées dont les oracles étaient prononcés selon les injonctions de la caste sacerdotale. D'Égypte également nous viennent des statuettes articulées, Boulanger pétrissant sa pâte au Louvre, Paysan au travail, à New York. Les âmes des morts, dans leurs pérégrinations, peuvent habiter ces figurines qui reproduisent les mouvements quotidiens. Ces premiers automates ne mettaient en action que des mécanismes élémentaires : leviers, poulies, treuils, vis, coins, tuyaux, en œuvre dans les machineries monumentales de l'époque. Il appartiendra aux Grecs et aux Alexandrins, héritiers des Milésiens et des thaumaturges d'Orient, de les compliquer de diverses inventions : ressorts, cames et dispositifs hydrauliques simples.
L'automate dans l'Antiquité grecque et byzantine
Aux temps archaïques dont parle Homère, quand le souvenir des « accointances magiques » n'était pas totalement effacé, la pensée technique venue d'Orient avait, semble-t-il, connu un certain essor. Homère parle d'instruments animés et d'ouvrages vivants ; mais c'est chez lui davantage une ironique révérence envers des mythes déjà édulcorés que l'expression véritable de la pensée technique contemporaine.
Cependant des constructeurs d'automates engageaient leur réputation dans la production des thaumata les plus propres à frapper d'étonnement.
L' intense vie technique que paraît avoir ainsi connue surtout la Grèce d'Asie jusqu'au viie siècle aurait pu laisser prévoir de riches développements, mais le blocage en Grèce continentale de la pensée technique par les valeurs et formes de la vie sociale bloqua du même coup l'art des thaumaturges au niveau de l'organon.
Seuls un esprit nouveau et une neuve maîtrise des forces motrices pouvaient en effet permettre aux mécaniciens de développer le comportement des automates et de doter ces mécaniques d'un peu d'autonomie.
Dès sa naissance, Alexandrie s'ouvre aux vents de l'esprit qui vont modifier l'image cosmique des Grecs. La culture égyptienne, qui s'était déjà assimilé l'héritage perse, se frotte alors intensément à la pensée grecque au moment précis où le positivisme ionien y fait retour et à une période où le souvenir d'Alexandre ne fait pas oublier les services et la science de ses ingénieurs ; le nouveau stoïcisme va donner des ailes à l'esprit et la force à l'action.
À partir de ce moment, on voit à Alexandrie comme en Grande Grèce des hommes, que l'on appelle μηχανοποιόι, constructeurs de machines, mais qui sont aussi médecins et mathématiciens, combiner autant par nécessité que par plaisir les mécanismes connus, en inventer d'autres, construire des instruments et des machines, créer des effets nouveaux, expérimenter avec le feu, l'eau, la terre et l'air, accroître la connaissance et préparer modestement une physique méthodique.
Un vent nouveau – Empédocle en Sicile et Épicure à Alexandrie en attendant Posidonius – souffle sur des terres où les mathématiques s'allièrent, très souvent par nécessité (Denys le Tyran), avec la science des machines. Il est significatif que la tradition ait vu en Archytas, général plusieurs fois victorieux (438-365 av. J.-C.), un homme qui inventa le moufle, construisit une colombe volante qui se mouvait « par l'air qui était enfermé et caché », mais encore un novateur qui le premier traita de mécanique « en se servant de principes géométriques » : un siècle après lui, Archimède (287-212 av. J.-C.) calcule π, mais invente aussi la came, le ressort et la fameuse vis qui porte son nom !
Constatation qui exige toutefois un correctif. Sans doute, ces effets et ces machines nouvelles eussent été impossibles sans de nouvelles combinaisons de mécanismes, mais il est bon de se rappeler qu'à toutes les périodes d'innovation les dates retenues renvoient à des attitudes neuves, plutôt qu'elles ne ponctualisent une invention technique au sens propre : la valve attribuée à Ktésibios (iiie siècle av. J.-C.) était certainement connue depuis plus d'un siècle, puisque Philistion de Locres, médecin de Denys le Tyran, exerçant en Sicile vers 365, connaissait les valvules sigmoïdes et illustrait leur fonctionnement « en étudiant l'action d'une colonne d'eau sur ces valvules ».
Si le piston, le siphon, la roue dentée, la came et le ressort n'ont peut-être pas été inventés dans le même milieu, il est assuré toutefois que, dans les trois derniers siècles de l'Antiquité, trois grands ingénieurs alexandrins – Ktésibios, Philon de Byzance, Héron d'Alexandrie – surent admirablement combiner, au moins « sur le papier », tous ces mécanismes et en tirer de merveilleux automates.
Ktésibios, barbier qui vivait à Alexandrie au iiie siècle avant notre ère, perfectionna pour la rendre exacte la clepsydre, ou horloge hydraulique, y adjoignant des oiseaux chanteurs pour lesquels l'orgue hydraulique fut utilisé pour la première fois. Il semble avoir été le premier à remplacer la corne par le fer dans la fabrication des ressorts. En perçant des diaphragmes dans l'or ou les pierres précieuses pour éviter l'oxydation, il donna à ses instruments une précision encore jamais atteinte. Ses horloges à cadran furent si précises que le tambour-cadran faisait exactement un tour par année solaire.
Philon de Byzance (230 av. J.-C.), en maîtrisant les techniques de son époque, orgues hydrauliques, vases communicants, siphons, récipients à niveaux constants, invente des dispositifs complexes tels que son lavabo automatique comportant un robinet en forme de bec d'oiseau avec une main artificielle présentant une pierre ponce : la main s'efface une fois la pierre prise, l'eau coule pour l'humecter, le débit augmente ; puis l'eau cesse de couler, la main réapparaît, offrant une nouvelle pierre.
Héron d'Alexandrie (125 av. J.-C.) indiqua les procédés de construction d'un grand nombre d'automates. Il y a lieu de noter une de ses machines ludiques : l'eau d'une vasque coule dans un piédestal creux, cependant que des oiseaux posés au bord de la vasque chantent jusqu'à ce que le piédestal soit plein. Un siphon le vide alors dans un seau suspendu à une corde avec poulie et contrepoids. Les oiseaux reprennent leur chant. Le seau plein descend en faisant tourner le perchoir d'un hibou, qui reprend, une fois le seau siphonné, sa position première : ses déplacements semblent commander le chant des oiseaux. Héron est connu pour ses machineries scéniques notées dans son Traité des pneumatiques.
Avec Héron, l'automate atteint à un grand degré de perfectionnement :
1. Les mécanismes agissent en vertu de leur structure interne.
2. L'action relève d'un aménagement des forces motrices, naturelles avec la pesanteur (matières pondéreuses, eau), artificielles avec la vapeur ou l'air comprimé.
3. Les plus perfectionnés sont mobiles, l'ensemble pouvant se déplacer seul (trépieds de Vulcain).
On ignore si ces automates furent construits. C'est avec beaucoup de réserve qu'il faut retenir les prétentions de Héron.
L'activité des mécaniciens alexandrins n'eut qu'un temps et le goût des automates passa chez les Grecs de Byzance. Pendant près d'un millénaire leurs techniques resteront presque stationnaires : Vitruve en rend vraisemblablement compte et elles furent transmises par des savants arabes, comme Avicenne ou al-Djazari, avec les perfectionnements qu'ils y apportèrent.
Au ixe siècle, chez les califes de Bagdad comme chez les empereurs byzantins, les voyageurs s'émerveillent de machines ingénieuses et d'oiseaux mécaniques chantant dans des arbres de métal précieux. En 948, l'évêque Liutprand s'étonnera du trône de Constantin Porphyrogénète qui paraissait s'élever dans les airs par une simple application de principes éprouvés par les automatistes grecs. Le Traité des automates de l'Arabe al-Djazari, commencé en 577 de l'hégire, reproduit certaines machines décrites par Ktésibios et notamment une Fontaine au paon dans laquelle un système combiné de flotteurs et de plans inclinés permet à une poupée de présenter du savon quand l'eau de la fontaine coule. De même dans la Fête princière où le son est produit par un orgue hydraulique. Fait nouveau, l'eau en s'écoulant actionne une petite turbine à auges qui anime les musiciens par l'intermédiaire d'un système bielle-manivelle assez rudimentaire.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Claude BEAUNE : professeur à l'université de Dijon
- André DOYON : ingénieur
- Lucien LIAIGRE : ingénieur
Classification
Médias
Autres références
-
AUTOMATIQUE
- Écrit par Hisham ABOU-KANDIL et Henri BOURLÈS
- 11 647 mots
...l'état x s'exprime en fonction des coordonnées xi à l'aide des opérations de base ∨ (« ou »), ∧ (« et ») et ¬ (« non »). Une décision, qui est le résultat d'un tel calcul, peut être prise par un automate se substituant à l'opérateur humain (cf. automatisation... -
AUTOMATISATION
- Écrit par Jean VAN DEN BROEK D'OBRENAN
- 11 885 mots
- 12 médias
Là où l'ordinateur, avec son langage évolué, l'importance de sa mémoire, la rapidité de son traitement, est trop coûteux, on lui préfère l'automate programmable. Ce dernier a la même architecture qu'un petit ordinateur ; mais, pour des raisons d'économie, une partie de sa mémoire ainsi que... -
AUTO-ORGANISATION
- Écrit par Henri ATLAN
- 6 258 mots
- 1 média
On observe, dans des réseaux d'automates en partie aléatoires, des propriétés de classification et de reconnaissance de formes sur la base de critères auto-engendrés, non programmés. Il s'agit là de simulations d'auto-organisation fonctionnelle où ce qui émerge est non seulement une structure macroscopique... -
COGNITIVES SCIENCES
- Écrit par Daniel ANDLER
- 19 265 mots
- 4 médias
Il s'agit d'un ensemble d'automates très simples interconnectés. Les connexions permettent à un automate tel que i de transmettre à un automate j une simulation positive (excitatrice) ou négative (inhibitrice), déterminée par l'état d'activité ui de i et modulée par un poids synaptique... - Afficher les 16 références
Voir aussi
- CYBERNÉTIQUE
- WALTER WILLIAM GREY (1910-1977)
- HOMÉOSTAT
- MÜLLER JOHANNES, dit REGIOMONTANUS (1436-1476)
- KLAUS FREDERIK VON (1724-1789)
- DROZ PIERRE JACQUES (1721-1790) & HENRI (1752-1791)
- TORRES Y QUEVEDO LEONARDO (1852-1936)
- CAUS SALOMON DE (1576 env.-1625)
- VAUCANSON JACQUES DE (1709-1782)
- PHILON DE BYZANCE (IIIe s. av. J.-C.)
- PSYCHOPATHOLOGIE
- MÉCANISMES
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XVe et XVIe s.
- MALADES MENTAUX
- COMPORTEMENT TROUBLES DU
- TORTUE ÉLECTRONIQUE
- GRÈCE, histoire, Antiquité
- CTÉSIBIOS ou KTÉSIBIOS D'ALEXANDRIE (IIIe s. av. J.-C.)
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XXe et XXIe s.
- AUTOMATISME AMBULATOIRE
- KEMPELEN WOLFGANG baron von (1734-1804)