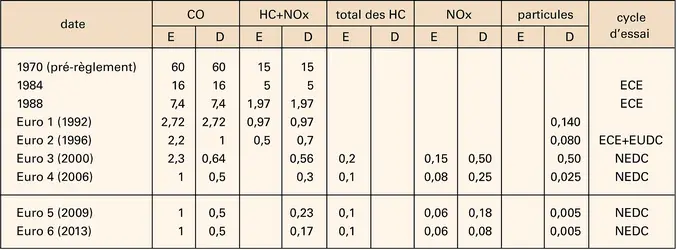AUTOMOBILE Défis
Article modifié le
Automobile et ville
Le développement des grandes métropoles au cours de la seconde partie du xxe siècle et du début du xxie siècle a été intimement lié à celui de l'automobile. Ainsi, ce moyen de transport a permis la croissance de la métropolisation et l'étalement urbain qui lui est lié ; en retour, son essor s'est renforcé de l'extension spatiale des villes, les deux processus s'alimentant l'un l'autre.
Le parc automobile a augmenté de façon considérable durant cette période (en 1966, en France, la majorité des ménages possédait une voiture). L'accession à l'automobile continue de se développer en raison d'une forte demande dans les pays émergents et de l'étalement urbain qui se poursuit dans les pays développés : les enquêtes montrent que les taux de motorisation des ménages augmentent régulièrement avec la distance séparant ces derniers des centres-villes.
L'automobile a transformé radicalement la perception de l'espace des activités de travail, de consommation, de loisirs ou de sociabilité en élargissant les horizons spatiaux des citadins. Elle a été associée à certaines évolutions des modes de vie en autorisant des chaînes de déplacement plus complexes.
L'automobile pose aussi de nombreux problèmes aux villes. Elle est la cause de la congestion urbaine génératrice de perte de temps. Or les heures perdues dans les embouteillages ont un coût économique non négligeable en termes notamment de perte de productivité. Cela est vrai dans toutes les métropoles du monde qui commencent à prendre conscience du problème autant pour des raisons écologiques que pour des raisons économiques. L'automobile est à l'origine de nuisances multiples comme l'exposition à des bruits réguliers supérieurs à 65 décibels, ou encore, l'inquiétant développement de la pollution entraînant la constitution de bulles d'air chaud au-dessus des villes qui peuvent aboutir, dans certains cas, à des canicules meurtrières (Chicago en 1995 ou Paris en 2003).
Automobile et transports en commun : un développement inégal
Parallèlement au succès de l'automobile, les transports en commun peinent à se développer. Ils présentent des avantages en matière de préservation de l'environnement mais connaissent de nombreux handicaps. Sur bien des lignes surchargées, ils présentent des situations d'inconfort notable. Ils favorisent très souvent la mobilité vers l'hypercentre alors que les résidences, mais également, dans une moindre mesure, l'emploi, se développent dans les périphéries. Ils profitent principalement aux habitants des zones denses. Leurs systèmes de tarification défavorisent dans bien des cas les habitants des périphéries alors même qu'ils sont subventionnés (dans les pays où ils le sont) par l'ensemble des habitants de l'agglomération.
Des études réalisées en Amérique du Nord montrent que la possession d'une automobile, en permettant de réduire considérablement les temps de déplacement par rapport aux transports collectifs, facilite l'obtention d'un emploi. Une étude californienne confirme la thèse du spatial entrapment, autrement dit de l'enfermement spatial par manque de moyens de transports. Ce sont à la fois les mauvaises performances des transports en commun en termes de rapidité et, donc de temps de transport, et le mauvais maillage du réseau qui confèrent un rôle central à l'automobile en matière de rapport à l'emploi. Le mauvais maillage du réseau de transports en commun sur l'ensemble des agglomérations entraîne le risque d'un développement urbain fondé sur des bassins de vie et d'emploi segmentés et isolés spatialement.
Comment alors penser une organisation des mobilités dans ces nouvelles nébuleuses urbaines qui, d'une part, soient respectueuses de l'environnement et, d'autre part, corrigent les inégalités en matière de mobilité ?
Des améliorations dans la conception de l'organisation des transports en commun sont déjà apparues. Ainsi, pour répondre à l'augmentation de la mobilité en périphérie, certaines villes ont conçu des infrastructures de périphérie à périphérie. On pense, par exemple, au succès de la ceinture ferroviaire de Berlin et aux projets de lignes tangentielles en Île-de-France. La recherche de nouvelles formes d'intermodalité et l'organisation de systèmes de rabattement des automobiles vers les gares ou les stations de transports urbains rapides (bus rapid transit) constituent d'autres perspectives, mais elles impliquent des politiques d'accompagnement telles que la conception de véritables plates-formes intermodales dotées de services adaptés. Ces projets sont certes efficaces mais ils nécessitent de très lourds investissements financiers. Des solutions innovantes en matière de service sont également explorées pour desservir les zones peu denses. Il s'agit des transports à la demande qui constituent des sortes de taxis collectifs. En fait, pour être réellement performants, ils exigent une forte logistique, des opérateurs solides et, donc, là encore, d'importants investissements.
Mieux réguler l'utilisation de l'automobile
Il serait cependant irréaliste de penser que l'amélioration des transports en commun réglera à elle seule la question des mobilités dans les grandes agglomérations. Il faut donc explorer, dans le même temps, d'autres voies qui reposent sur la rationalisation de l'utilisation de l'automobile.
L'instauration d'un péage urbain est l'une des premières mesures mises en avant dans certaines villes. Il peut prendre la forme d'un péage de zones comme à Oslo (1990), Londres (2003) ou Stockholm (2007) ; celle d'un péage d'infrastructure pour certaines voies rapides urbaines ou avec les passages de ponts, comme à San Francisco ; ou encore celle d'un péage de décongestion, avec la tarification de certains couloirs sur les voies rapides urbaines (H.O.T. – high occupancy toll – lanes aux États-Unis, par exemple). L'Italie a inauguré le concept de « zone à trafic limité » pour éviter la circulation automobile dans les zones denses selon les objectifs de défense du patrimoine, de requalification de l'espace public et de lutte contre la pollution. En réponse à la convergence des trafics vers le centre, la ville de Rome a divisé son territoire en quatre auréoles dans lesquelles la réglementation des véhicules privés est graduée de la plus tolérante à la plus restrictive.
Efficace pour limiter l'accès dans les centres, cette solution soulève des critiques. Certaines dénoncent leur inéquité sociale, s'opposant à ceux qui prônent le principe de l'utilisateur payeur. D'autres expliquent que le trafic limité au centre se reportera sur les périphéries. Par ailleurs, l'exemple romain montre que l'instauration de la « zone à trafic limité » est concomitante de l'augmentation du nombre de scooters : il a augmenté de 121 p. 100 à Rome entre 1996 et 2002 contre 60 p. 100 pour l'ensemble de ce pays durant la même période.
Bien d'autres systèmes de régulation sont explorés : la création de « zones à trafic calmé » avec limitation de vitesse à 30 km/h ; l'obligation de posséder un parking résidentiel pour acheter un véhicule comme au Japon ; le système du car pooling, développé aux États-Unis, qui consiste à inciter de diverses manières les automobilistes à ne pas voyager seuls dans leur automobile, en particulier sur les trajets domicile-travail, en les faisant bénéficier de voies réservées au covoiturage ou H.O.V. – high occupancy vehicle – lanes) ; ou enfin, celui du car sharing, mis en place plus récemment, qui repose sur la multipropriété d'un parc automobile et la mise à disposition de véhicules à la demande.
Mieux penser l'insertion urbaine de l'automobile
Protéger la ville contre l'automobile ne suffit pas. L'avenir est aussi à la réconciliation des usages de la ville et des usages de l'automobile. Il est à l'organisation de la coexistence pacifique entre les différents modes de déplacements. Autrement dit, l'avenir réside dans une organisation plus harmonieuse des relations entre la mobilité et l'espace public. Un des grands enjeux de ce début de siècle est d'élever les espaces de mobilité au rang d'espaces publics à part entière. Bernardo Secchi, spécialiste italien des villes, en usant de métaphores, nous invite ainsi à penser la ville et la mobilité comme une éponge ou un espace de porosité plutôt que comme un réseau hydraulique ou électrique.
En ce sens, de nouvelles questions se posent en matière d'aménagement. Comment transformer un rond-point en place ? Comment transformer une route en rue ? Comment faire de la voie non une rupture mais une couture ? Comment passer de la voie pénétrante qui ignore la ville au boulevard urbain qui ménage sur ses rives des points d'accostage à la ville ?
La question du stationnement devient alors centrale pour mieux penser les rapports entre la ville et l'automobile. Sa conception peut ou non favoriser les continuités territoriales et la plus ou moins grande réconciliation de l'automobile et de la ville. Le point de stationnement est le point de départ de l'exploration pédestre du local. C'est le point d'interface entre la mobilité et la localité qui peut prendre la forme de contre-allée, de stationnement linéaire en rives de voies pour arrêts minutes, d'aires de stationnement aménagées, de parkings intermodaux...
Les solutions ne manquent pas. Elles dépendent des contextes sociaux et urbains car il n'existe pas de modèle unique. La vaste gamme des solutions doit être adaptée aux spécificités socioculturelles des habitants et aux particularités des villes. Transporter n'est pas une fonction isolée qui trouverait sa solution en elle-même : systèmes de transports et systèmes urbains se structurent mutuellement. Il faut donc penser les deux en même temps dans leur complémentarité et non dans leur opposition.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Daniel BALLERINI : ingénieur E.N.S.P.M. (École nationale supérieure du pétrole et des moteurs), ancien chef du département Biotechnologie et chimie de la biomasse à l'Institut français du pétrole, consultant
- François de CHARENTENAY : docteur ès sciences, consultant
- André DOUAUD : directeur technique, Comité des constructeurs français d'automobiles
- Francis GODARD : professeur des Universités
- Gérard MAEDER : ingénieur, École nationale supérieure d'électricité et de mécanique, docteur ès sciences, directeur honoraire de l'ingénierie des matériaux de Renault
- Jean-Jacques PAYAN : professeur honoraire d'Université, ex directeur de la recherche de Renault S.A.
Classification
Médias
Autres références
-
AÉRODYNAMIQUE
- Écrit par Bruno CHANETZ , Jean DÉLERY et Jean-Pierre VEUILLOT
- 7 226 mots
- 7 médias
...vol et de la taille des avions, on a dû se résoudre à essayer en soufflerie des maquettes dont les dimensions sont bien inférieures à celles de l'avion. En revanche, les constructeurs automobiles utilisent couramment des souffleries où sont essayés des véhicules en grandeur réelle, mais il est vrai aussi... -
ALLEMAGNE (Géographie) - Géographie économique et régionale
- Écrit par Guillaume LACQUEMENT
- 12 047 mots
- 10 médias
...stimulés par la proximité de la plus grande place financière du pays, Francfort, qui se situe au cœur d'un appareil bancaire très développé et très ramifié. Les berceaux de l'automobile sont la Souabe et la Saxe, et le bassin de Wolfsburg en Basse-Saxe (usine de Volkswagen) est né de la planification... -
APPRENTISSAGE PROFOND ou DEEP LEARNING
- Écrit par Jean-Gabriel GANASCIA
- 2 646 mots
- 1 média
...digitales ou d’iris), la médecine (avec, par exemple, le diagnostic de mélanomes à partir d’images de grains de beauté et l’analyse de radiographies), la voiture autonome (reconnaissance d’obstacles, de véhicules, de panneau de signalisation, etc.), par exemple. Elles permettent aussi d’améliorer la reconnaissance... -
ASSURANCE - Histoire et droit de l'assurance
- Écrit par Jean-Pierre AUDINOT , Encyclopædia Universalis et Jacques GARNIER
- 7 497 mots
- 1 média
Il aura fallu attendre le 27 février 1958 pour qu'une loi rende obligatoire l'assurance de responsabilité du fait des véhicules automobiles. L'État et certains établissements publics restent dispensés de cette obligation. Le contrat d'assurance automobile peut couvrir également les dommages aux véhicules... - Afficher les 56 références
Voir aussi
- MOTEURS THERMIQUES
- INJECTION, mécanique
- MOTEURS ÉLECTRIQUES
- CONSOMMATION, transports
- ANHYDRIDE SULFUREUX ou DIOXYDE DE SOUFRE
- FILTRATION, physico-chimie
- ACCUMULATEURS, électrotechnique
- MONOXYDE D'AZOTE
- MOTEURS À EXPLOSION
- RECYCLAGE DES DÉCHETS ET DES MATÉRIAUX
- AGGLOMÉRATION
- PILE À COMBUSTIBLE
- BIOMASSE
- VALORISATION DES DÉCHETS
- DÉPOLLUTION
- DIOXYDE D'AZOTE
- HUILES VÉGÉTALES
- DÉSULFURATION
- OXYDES D'AZOTE
- TRANSPORTS URBAINS
- TRANSPORTS EN COMMUN
- BIODIESEL
- ESSENCE, carburant
- GAZ À EFFET DE SERRE
- TRANSPORT ROUTIER
- URBANISATION
- ENVIRONNEMENT, droit et politique
- EFFET DE SERRE
- AUTOMOBILE ou VOITURE HYBRIDE
- AUTOMOBILE ou VOITURE ÉLECTRIQUE
- PROPULSION AUTOMOBILE
- BATTERIE, électrotechnique
- GAZ D'ÉCHAPPEMENT
- MONOXYDE DE CARBONE ou OXYDE DE CARBONE (CO)
- TRANSPORT TERRESTRE
- POT CATALYTIQUE
- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE
- POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ou POLLUTION DE L'AIR
- CIRCULATION ROUTIÈRE ET TRAFIC ROUTIER