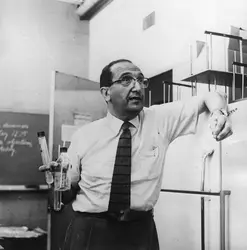BACTÉRIOPHAGES ou PHAGES
Article modifié le
Morphologie et structure
Depuis les surprenantes images de bactériophages « en forme de têtards » observées au microscope électronique par les premiers expérimentateurs (Ruska, en 1941 ; Luria, Delbruck et Anderson, en 1942), le développement considérable des recherches sur la structure des bactériophages a conduit à la description de nombreuses variétés morphologiques et à l'élaboration d'une véritable anatomie ultrastructurale de ces virus. Plusieurs milliers de bactériophages ont été examinés au microscope électronique et ils ont été classés en différents morphotypes suivant la forme et les dimensions de la tête, la structure de la queue, l'existence ou l'absence d'un manchon caudal contractile, la structure (rudimentaire ou complexe) de la plaque terminale, les dimensions globales du virion, la nature de l'acide nucléique (ADN bicaténaire, ADN monocaténaire, ARN), etc.
Les bactériophages les plus anciennement décrits, ceux dont la structure a été la plus étudiée, sont constitués schématiquement d'une coque protéinique ou capside (enveloppant et protégeant la molécule centrale d'acide nucléique), et d'un appareil spécialisé à structure complexe (la queue) par lequel le phage se fixe sur la bactérie sensible pour y injecter son acide nucléique. Mais tous les bactériophages ne répondent pas à ce modèle classique et on peut actuellement les réunir en quatre grands groupes morphologiques : les phages à ADN bicaténaire, avec queue ; les phages sans queue, à symétrie cubique et à ADN monocaténaire ; les phages à ARN ; les phages filamenteux à ADN monocaténaire. On a également décrit des bactériophages isométriques (à ADN) contenant 12 à 14 p. 100 de lipides sous forme d'une double couche située entre les coques externe et interne de la capside virale (phage PM2) ; cette couche lipidique, assimilée à l'enveloppe d'un virus nu, est responsable de la sensibilité de ces phages « lipidiques » à l'activité des solvants organiques. Malgré l'importance capitale en virologie générale de la découverte des phages à ARN (polyèdres réguliers d'un diamètre de 15 nm, d'un poids moléculaire de 4 × 106 dont 30 p. 100 d'ARN) et des phages filamenteux (filaments ou bâtonnets de 700 à 800 nm de longueur et de 5 nm d'épaisseur, d'un poids moléculaire de 11,3 × 106 et renfermant 12,2 p. 100 d'ADN monocaténaire), nous décrirons en détail un des phages du premier groupe, le phage T2. D'une longueur totale d'environ 213 nm, ce phage a une tête polyédrique allongée à contour hexagonal (100 sur 80 nm), une queue (113 nm) avec une gaine contractile (sheath) et une plaque terminale. On admet que la tête, longtemps considérée comme ayant la forme d'un prisme hexagonal, bipyramidal, est un icosaèdre particulier qui a subi une élongation dans sa région équatoriale. Contrairement à ce que l'on observe chez d'autres bactériophages de types morphologiques différents, les sous-unités protéiniques (capsomères), dont l'assemblage en mosaïque constitue la capside de la tête du phage T4, n'ont pu être vues jusqu'à présent sur les micrographies électroniques de ce virus, bien que leur existence ne fasse aucun doute et que leur nombre ait pu être évalué à 1 000 unités d'un poids moléculaire de 80 000.
La queue possède un axe central rigide (core) parcouru sur toute sa longueur par un fin canal (diamètre 8 nm). La gaine coaxiale apparaît formée par l'empilement de 24 anneaux espacés de 4 nm, eux-mêmes constitués de 144 unités protéiques, d'un diamètre de 3 nm et ayant une disposition hélicoïdale. Au cours de la fixation du phage sur la bactérie sensible, cette gaine se contracte à volume constant (Brenner et coll., 1959). D'autres travaux consacrés à la cinétique de cette contraction et à l'agrégation in vitro de gaines caudales isolées sont un exemple frappant de l'intérêt fondamental que présentent en biologie générale ces structures bactériophagiques pour l'étude de l'organisation et des fonctions des protéines contractiles.
La plaque terminale (largeur : 35 nm) comporte six branches rayonnantes ; leurs extrémités, qui occupent les sommets d'un hexagone, sont terminées par de courts prolongements. C'est à ces extrémités que sont fixées les six fibres de la queue, dont le point d'attache supérieur est au niveau de la collerette (fine structure annulaire coaxiale située entre l'extrémité supérieure du manchon et la tête) ; ces fibres forment autour de la queue du phage intact une fragile cage à six barreaux. La contraction de la gaine caudale s'accompagne de la rupture des fibres et d'un profond remaniement de la plaque terminale. Ces différentes parties de la queue jouent chacune un rôle distinct et complémentaire au cours de la fixation du phage sur la bactérie (fibres et plaque terminale) et de l'injection de l'ADN (manchon, plaque terminale et canal central).
Par des méthodes biophysiques et biochimiques, on a montré que l'acide nucléique bicaténaire du phage T2 a un poids moléculaire de 120.106 et un G.C. % de 36, représente 49 p. 100 du poids du virion, contient de la 5-hydroxyméthylcytosine (au lieu de thymine), enfin qu'il est permuté de façon circulaire et redondant aux extrémités. La longueur de la molécule d'ADN a pu être évaluée directement sur les micrographies électroniques : libérée par l'éclatement provoqué de la tête du phage T2, elle mesure 49 μm (Kleinschmidt, 1965). D'autres techniques biophysiques, en particulier la diffraction des rayons X par des préparations orientées de bactériophages, ont permis de comprendre la disposition de l'ADN à l'intérieur de la capside virale. Bien que le bactériophage T2 soit le chef de file d'une vaste famille de bactériophages, il représente un seul des nombreux morphotypes rencontrés chez les bactériophages actifs sur les entérobactéries.
Le bactériophage T2 ne représente pas le seul type morphologique rencontré chez les phages pourvus d'une queue ; à l'intérieur de ce groupe, de nombreuses variétés ont été individualisées en fonction de la forme de la tête (octaédrique, de forme allongée « en roseau », ou régulièrement icosaédrique), de l'existence d'un manchon caudal non contractile, de l'absence ou de la présence d'une plaque terminale de structure variée et enfin de leurs dimensions.
Parmi les très nombreuses mutations que peuvent présenter les bactériophages et qui portent aussi bien sur l'aspect des phages, le spectre d'action ou les propriétés antigéniques des protéines phagiques (tête ou queue) que sur la densité des corpuscules ou sur les différents paramètres du cycle de multiplication, une nouvelle classe de variants morphologiques a été décrite. L'analyse génétique de ces mutations spontanées ou artificiellement induites par des agents physiques ou chimiques, a permis d'acquérir des connaissances approfondies sur certains phages utilisés comme outil génétique, tel le bactériophage λ d'Escherichia coli. L'étude du phage λ a été une des préoccupations centrales de la biologie moléculaire pendant de nombreuses années et la cible préférée des biologistes intéressés par la transcription, la réplication et la recombinaison de l'ADN, l'assemblage des nucléoprotéines, etc. La quantité considérable d'informations recueillies au cours de ces investigations a justifié la publication de cartes génétiques (genetic map) du bactériophage λ (et aussi de quelques autres phages étudiés avec les mêmes préoccupations). Ces cartes génétiques, de plus en plus complètes, marquent bien les étapes des connaissances dans ce domaine. Certaines confrontent sur la même figure la carte des gènes chromosomiques codant pour les propriétés structurales ou biochimiques du virion et la carte des restrictions (restrictions map) consécutives à l'utilisation des endonucléases de restriction (telle EcoR1). Par ailleurs, la formation de corpuscules complets de bactériophages au terme d'un cycle normal de multiplication intrabactérienne est un phénomène génétiquement contrôlé. La découverte et l'analyse d'un système de mutations létales conditionnelles du phage T4, qui empêchent la maturation normale du virus chez certains hôtes bactériens ou encore à une température déterminée, ont été utilisées pour établir la carte génétique de ce virus et pour préciser la séquence et les fonctions des gènes morphopoïétiques (Epstein et coll., 1963). Sur la carte génétique du phage T4 se trouvent plusieurs gènes ou groupes de gènes différents qui commandent la synthèse de l'ADN, l'organisation de la capside, la production de la queue, du manchon ou des fibres ; les mutations affectant le gène 20 s'expriment par la production de structures tubulaires géantes (polyheads), dont l'étude est d'un très grand intérêt pour la connaissance de l'architecture de l'enveloppe protéique de la tête des phages (Kellenberger et coll., 1964).
Diverses tentatives ont été effectuées pour réaliser in vitro l'assemblage des différentes parties anatomiques d'un bactériophage et obtenir artificiellement un virus possédant les caractéristiques structurales, génétiques et enzymatiques du bactériophage infectieux. En utilisant les diverses structures bactériophagiques incomplètes (tête, queues et fibres) produites par l'emploi de mutants létaux conditionnels du phage T4, on a pu obtenir des particules virales complètes et infectieuses (Wood et Edgar, 1967) ; ces expériences de construction artificielle des bactériophages ouvrent des perspectives étendues en virologie générale.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-François VIEU : chef de laboratoire à l'Institut Pasteur
Classification
Média
Autres références
-
ANTICORPS MONOCLONAUX
- Écrit par Michel MAUGRAS et Jean-Luc TEILLAUD
- 2 138 mots
La technique du phage display permet également d'isoler rapidement des fragments d'anticorps humains à partir de banques contenant plusieurs dizaines de millions d'anticorps différents exprimés à la surface de l'enveloppe des bactériophages. -
BACTÉRIES
- Écrit par Jean-Michel ALONSO , Jacques BEJOT et Patrick FORTERRE
- 11 055 mots
- 3 médias
...femelles en sont dépourvues). Ils servent au transfert de matériel génétique de bactérie mâle à bactérie femelle. L'infection des bactéries par certains bactériophages résulte de l'injection de l'acide nucléique du bactériophage à travers le canal central du pilus sexuel qui est alors le site récepteur... -
DELBRÜCK MAX (1906-1981)
- Écrit par Pierrette KOURILSKY
- 582 mots
Physicien et généticien américain d'origine allemande. Après avoir soutenu une thèse de physique théorique en 1930 à l'université de Göttingen, Max Delbrück travaille en Allemagne et au Danemark sous la direction de Max Born et Niels Bohr. Ce n'est qu'après son émigration aux...
-
ENZYMES DE RESTRICTION
- Écrit par Nicolas CHEVASSUS-au-LOUIS
- 198 mots
Comment les bactéries, dépourvues de système immunitaire, se défendent-elles contre les virus (appelés aussi phages) qui les infectent ? C'est le Suisse Werner Arber (né en 1929), qui apporte le premier la réponse à cette question. En 1962, il découvre que des enzymes bactériennes...
- Afficher les 23 références
Voir aussi