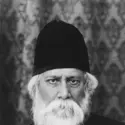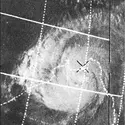BANGLADESH
| Nom officiel | République populaire du Bangladesh |
| Chef de l'État | Mohammed Shahabuddin Chuppu - depuis le 24 avril 2023 |
| Chef du gouvernement | Muhammad Yunus - depuis le 8 août 2024 |
| Capitale | Dhaka ou Dacca |
| Langue officielle | Bengali |
| Population |
171 466 990 habitants
(2023) |
| Superficie |
147 570 km²
|
Article modifié le
Histoire du Bengale oriental (1526-1971)
La colonisation britannique
Le Bengale fut conquis par les musulmans au xiie siècle, et dominé par le sultanat de Delhi jusqu’à la bataille de Pānīpat en 1526, qui marque le début de l’Empire moghol. C’est une période de prospérité et de développement pour la région, qui voit progressivement s’accroître l’influence de la Compagnie anglaise des Indes orientales, créée en 1600. Simple compagnie commerciale, celle-ci se transforme rapidement en une vaste organisation politico-administrative et militaire chargée de défendre les intérêts des Britanniques en Inde. La bataille de Plassey, en 1757, qui voit la défaite de l’armée moghole, ouvre véritablement la voie à la domination britannique. S’octroyant rapidement le monopole du commerce (épices, soie, coton, jute, thé), et celui du versement de l’impôt, la Compagnie exploite massivement les ressources du Bengale. Inquiet de la puissance croissante de la Compagnie, le Parlement britannique adopte, en 1784, le Pitt’s India Act, qui autorise cette dernière à garder le contrôle des activités commerciales dans la région, mais la prive de tout pouvoir politique.
Afin de mieux asseoir leur pouvoir colonial, les Britanniques jouent également des tensions existant entre les communautés hindouistes et musulmanes. À cet effet, ils tentent, en 1905, de partager le Bengale en deux entités administratives distinctes, projet qu’ils abandonneront en 1911 sous la pression des élites hindouistes. Cependant, en se servant d’intermédiaires essentiellement hindouistes pour exercer leur contrôle, les Britanniques attisent la colère des paysans bengalis musulmans, appauvris et écartés de la vie politique. Cette situation encourage la progressive réaffirmation identitaire des musulmans, qui se matérialise par la création, en 1906, de la Ligue musulmane (All India Muslim League), destinée à défendre les intérêts des Indiens musulmans face aux élites hindouistes représentées par le parti du Congrès (Indian National Congress, créé en 1885).
Alors que l’indépendance de l’Inde britannique semble inévitable à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Ligue musulmane joue un rôle clé dans la diffusion de la « théorie des deux nations » promouvant un État spécifique pour les Indiens musulmans. Ainsi, en 1947, deux États voient le jour : l’Inde et le Pakistan. Le Bengale est également scindé en deux : alors que le Bengale occidental reste indien, le Bengale oriental (qui devient le Pakistan oriental), composé majoritairement de paysans bengalis musulmans, rejoint le dominion du Pakistan. La partition de 1947 s’accompagne de déplacements massifs de population de part et d’autre des nouvelles frontières : 6 millions d’Indiens musulmans viennent s’installer au Pakistan, tandis que 4 millions d’hindous vont s’installer en Inde.
La domination pakistanaise
La formation du Pakistan est unique et elle explique en grande partie son échec. Construit sur le principe d’un nationalisme religieux, le nouveau pays comprend cependant deux parties distinctes géographiquement (le Pakistan oriental et le Pakistan occidental), séparées par 1 700 kilomètres de territoire indien. Par ailleurs, le nouvel État n’hérite d’aucune structure politico-administrative de l’époque coloniale, et le Pakistan oriental, qui a été davantage exploité et privé d’infrastructures sous la colonisation britannique, tombe rapidement sous la domination du Pakistan occidental. D’emblée, le Pakistan souffre d’une forte instabilité politique et d’importantes difficultés économiques. Tandis que les élites du Pakistan occidental monopolisent les postes clés dans les domaines politique, administratif, judiciaire et bancaire, le Pakistan oriental s’enfonce dans le sous-développement.
Le mécontentement grandissant des Pakistanais bengalis se cristallise surtout autour de l’enjeu linguistique. Le gouvernement de Karachi (Pakistan occidental) proclame, dès l’indépendance, l’urdu (ou ourdou) langue officielle unique du Pakistan, provoquant à partir de 1952 de vives protestations au Pakistan oriental, qui regroupe la population bengalophone numériquement majoritaire au Pakistan (57 % de la population totale). Par ailleurs, la Ligue musulmane étant alors considérée comme la représentante des intérêts du Pakistan occidental, la Ligue Awami voit le jour en 1949 et devient rapidement le principal parti politique d’opposition pakistanais. Réclamant, dans un premier temps, l’autonomie du Pakistan oriental, la Ligue Awami se radicalise sous l’impulsion d’un de ses fondateurs, Mujibur Rahman, qui réclame la scission complète des deux parties du Pakistan.
Finalement, alors que la population du Pakistan oriental, touchée en novembre 1970 par un cyclone dévastateur, accuse le gouvernement de ne pas apporter une aide rapide et suffisante, son ressentiment augmente encore lorsque, à l’issue des élections législatives de décembre 1970, la Ligue Awami victorieuse est empêchée d’accéder au pouvoir. En effet, rejetant le résultat du vote, le général Yahya Khan, alors au pouvoir, dissout l’Assemblée nationale, ce qui déclenche des vagues de violence politique dans l’ensemble du pays. Incapable de trouver un accord avec la Ligue Awami, le gouvernement décide d’envoyer l’armée au Pakistan oriental.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Alice BAILLAT : doctorante en science politique et relations internationales à SciencesPo Paris et au Centre d'études et de recherches internationales (CERI), chercheuse invitée à l'International Centre for Climate Change Adaptation and Development (ICCCAD) Independent University, Dhaka, Bangladesh
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
BANGLADESH, chronologie contemporaine
- Écrit par Universalis
-
ASIE (Géographie humaine et régionale) - Dynamiques régionales
- Écrit par Manuelle FRANCK , Bernard HOURCADE , Georges MUTIN , Philippe PELLETIER et Jean-Luc RACINE
- 24 799 mots
- 10 médias
...flancs, la partition de 1947 a donné naissance à un Pakistan musulman et bicéphale, dont la partie orientale a fait sécession en 1971 pour devenir le Bangladesh. Au nord, les États himalayens du Népal et du Bhoutan font tampon avec la Chine, qui possède avec l'Inde une frontière commune,... -
BENGALI LITTÉRATURE
- Écrit par France BHATTACHARYA et Jharna BOSE
- 5 134 mots
- 1 média
La littérature bengali duBangladesh est en plein épanouissement. La plupart des auteurs sont à la fois poètes et nouvellistes. Syed Shamsul Huq (1935-2016), premier écrivain bangladais à avoir fait de l'écriture sa profession, a touché avec succès à tous les genres, excellant dans les pièces de théâtre... -
BHOLA (cyclone de)
- Écrit par Jean-Pierre CHALON
- 1 250 mots
- 2 médias
Le 12 novembre 1970, le cyclone de Bhola frappait le Pakistan oriental (auj. Bangladesh) et une partie de l’État indien du Bengale-Occidental, laissant sur son passage plusieurs centaines de milliers de morts, ce qui en fait le cyclone le plus meurtrier jamais enregistré. Cette catastrophe naturelle...
-
BHUTTO ZULFIKAR ALI (1928-1979)
- Écrit par Yvan BARBÉ
- 662 mots
- 2 médias
- Afficher les 20 références
Voir aussi
- DENSITÉ DE POPULATION
- TIERS MONDE
- ACCIDENTS
- BIDONVILLE
- ISLAMISME
- RÉGULATION DES NAISSANCES
- INDES ORIENTALES COMPAGNIE ANGLAISE DES ou EAST INDIA COMPANY
- ATTENTAT
- CRUES
- PAUVRETÉ
- CATASTROPHES NATURELLES
- PARTITION POLITIQUE
- GUERRE CIVILE
- WAJED HASINA (1947- )
- AWAMI LIGUE
- BENGALIS
- MUTINERIE
- DÉMOCRATISATION
- BENGALI, langue
- CHANGEMENT CLIMATIQUE
- ACCÈS AUX TERRES AGRICOLES
- JUTE
- INDE, histoire : l'époque coloniale
- INDE, histoire : de 1947 à nos jours
- CROISSANCE ÉCONOMIQUE
- AIDE ÉCONOMIQUE
- URBANISATION
- TEXTILES INDUSTRIES
- BRITANNIQUE EMPIRE, Asie
- DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
- TIERS MONDE ÉCONOMIE DU
- ÉNERGIE ÉCONOMIE DE L'
- KHALEDA ZIA (1945- )
- BENGALE
- ROHINGYA
- RIZICULTURE
- TRAVAIL DES FEMMES
- INDO-PAKISTANAISES GUERRES
- CONDITIONS DE TRAVAIL
- POLITIQUE INDUSTRIELLE
- SECTEUR INDUSTRIEL
- SECTEUR AGRICOLE
- ÉROSION
- CORRUPTION
- DÉGRADATION DES SOLS
- SALINISATION, pédologie
- MEGHNA
- ERSHAD MOHAMMED (1930-2019)
- DÉMOLITION NAVALE CHANTIER DE
- BHOLA CYCLONE DE