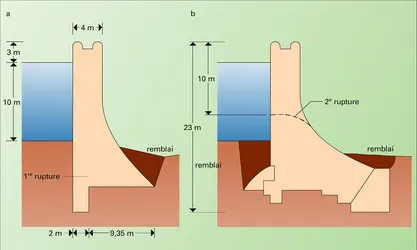- 1. Les différents types de barrages
- 2. Les données de base
- 3. Motivation des choix techniques
- 4. Les barrages en béton
- 5. Les barrages en matériaux meubles ou semi-rigides
- 6. La fondation des barrages et ses traitements
- 7. Les ouvrages annexes
- 8. Surveillance et entretien des barrages
- 9. Barrages et développement durable
- 10. Bibliographie
BARRAGES
Article modifié le
Les données de base
Barrages et environnement
Les barrages existants concernent plus de la moitié des rivières du monde, et les réservoirs ainsi créés représentent une surface équivalente au tiers de la surface des lacs naturels.
Un barrage et sa retenue, comme de nombreuses autres activités humaines, sont partie intégrante de leur environnement, qu'ils influencent et transforment de façon variable d'un projet à l'autre. Souvent considérés aujourd'hui comme contradictoires, sans être nécessairement incompatibles, barrage et environnement sont liés par un mécanisme très complexe, qui rend difficile la tâche de l'ingénieur de barrage. Il lui faut trouver le juste milieu, en harmonisant des besoins différents, et parfois antagonistes.
Nous avons besoin des barrages et des bienfaits que leurs retenues apportent par le stockage de l'eau en période d'abondance et sa fourniture en période de carence. Les barrages permettent de maîtriser les crues dévastatrices et les sécheresses catastrophiques. Ils réalisent la régulation des débits naturels, variables selon les saisons et les aléas climatiques, en les adaptant à la demande en eau pour l'irrigation, l'hydroélectricité, l'eau potable et industrielle, et la navigation. Ils favorisent loisirs, tourisme, pêche et pisciculture, et peuvent parfois améliorer les conditions environnementales.
L'impact des barrages-réservoirs sur le milieu socio-économique est aussi inéluctable qu'évident : avec la mise en eau de l'ouvrage, les terres sont noyées, les populations sont déplacées, la continuité de la vie aquatique le long du cours d'eau est interrompue, le régime d'écoulement est modifié et souvent les débits sont réduits du fait des captages.
Pour ces raisons, les ingénieurs de barrage se trouvent confrontés aux problèmes inhérents à la transformation du milieu naturel en un milieu favorable aux humains. Dans la lutte séculaire d'amélioration des conditions de vie d'une population mondiale à la fois croissante et soumise à un processus d'urbanisation, l'exploitation nécessaire des ressources naturelles, dont l'eau, ne permet pas de préserver le milieu naturel dans son état initial. En revanche, il convient de protéger ce milieu de toute agression ou toute perturbation évitables. Il faut collaborer, de bonne foi, avec la fragilité et le dynamisme propres à la nature sans surcharger son pouvoir de récupération, son pouvoir d'adaptation à un équilibre nouveau. De plus, il faut s'assurer que les personnes directement touchées par un projet se trouvent dans une meilleure situation qu'auparavant.
En résumé, les impacts négatifs ou positifs sur l'environnement sont importants, et certains ont pu être négligés dans le passé. Les plus importants sont :
– le déplacement de la population habitant les zones inondées par le réservoir : en 50 ans, 25 millions de personnes ont été déplacées pour cette raison (principalement en Asie) ; des mesures conservatoires sont prises visant à améliorer leur niveau de vie comme cela a été le cas pour le barrage des Trois Gorges sur le Yang-Tsé, en Chine, où l'équivalent du coût de construction de l'ouvrage a été consacré au déplacement d'un million d'habitants ;
– le développement de l'économie de régions entières, et le maintien sur place dans celles-ci de centaines de millions d'habitants du fait du développement de l'irrigation, de la pêche ou de l'industrie locale ;
– le prélèvement d'une part importante des apports d'une rivière, pouvant pénaliser les populations en aval ;
– le maintien en étiage d'un débit minimal, garantissant le non-assèchement total du lit de la rivière ;
– l'amortissement des crues, et la réduction des pointes de débits restitués en aval ;
– la sédimentation qui affecte certains réservoirs, comme les lacs naturels.
Si un barrage a une influence sur son environnement, sa conception est complètement dépendante de celui-ci, et en particulier – en dehors des conditions climatiques –, de l'hydrologie du cours d'eau qui sera barré, de la topographie de sa vallée et de la géologie du site retenu pour construire l'ouvrage.
L'hydrologie
L' objectif d'un barrage étant de stocker un certain volume d'eau pour diverses utilisations, il faut donc se préoccuper, d'une part, des conditions de remplissage de la réserve envisagée et, d'autre part, de veiller à ce que l'ouvrage ne soit pas un obstacle au passage des crues qui risqueraient de le submerger. Pour cela, il faut étudier les apports mensuels, saisonniers et annuels et les débits instantanés pour définir les crues maximales pouvant entrer dans la retenue. Si les données sont suffisantes, on utilise des méthodes statistiques directes. Si cela n'est pas le cas, il faut étendre l'information par corrélation avec d'autres données disponibles comme la pluviométrie ou le régime de bassins similaires. Toutes ces études demandent de grandes précautions pour couvrir les incertitudes des données.
La topographie
Les renseignements topographiques nécessaires concernent à la fois le bassin-versant de la retenue, dont la morphologie intervient dans les études hydrologiques, la vallée de la rivière à l'amont et à l'aval du barrage, le site de ce dernier et celui de la retenue, et les zones d'emprunts des matériaux qui seront utilisés pour la construction des ouvrages.
La géologie
Les études géologiques et géotechniques donnent des informations concernant la nature des matériaux qui constituent la fondation du barrage ou les berges de la retenue, leurs caractéristiques mécaniques et leur étanchéité, aussi bien en surface qu'en profondeur. Elles nécessitent la réalisation de travaux de reconnaissance dont le coût peut être très important.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Claude BESSIÈRE : ingénieur civil des Ponts et Chaussées, directeur de l'innovation chez Ingérop
- Pierre LONDE : président honoraire de la Commission internationale des grands barrages, ingénieur-expert
Classification
Médias
Autres références
-
AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale
- Écrit par Roland POURTIER
- 24 463 mots
- 27 médias
...mètres, le fleuve s'encaisse dans de profonds défilés formant frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, avant de s'élargir dans le lac de retenue du barrage de Kariba. Plus en aval, au Mozambique, l'aménagement du barrage de Cahora Bassa, à l'emplacement de la dernière cataracte, a créé un autre... -
ALGÉRIE
- Écrit par Charles-Robert AGERON , Encyclopædia Universalis , Sid-Ahmed SOUIAH , Benjamin STORA et Pierre VERMEREN
- 41 845 mots
- 25 médias
La soixantaine de barrages algériens existants, qui ont un taux moyen de remplissage de 66 %, permet une réserve d'eau de 3,8 milliards de mètres cubes – ratio tout juste équivalent à 1 000 m3/an/habitant. Le taux de remplissage des barrages de l'ouest est plus faible (57 %), alors... -
APPALACHES
- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER , Encyclopædia Universalis et Catherine LEFORT
- 5 990 mots
...de l'État aboutit à la création, le 10 avril 1933, de la fameuse T.V.A. ( Tennessee Valley Authority). Le plan prévoyait la construction de sept grands barrages, le développement de la navigation, la lutte contre les inondations, l'irrigation et la production d'électricité. Les premiers travaux furent... -
AQUEDUCS, Antiquité
- Écrit par Philippe LEVEAU
- 4 686 mots
- 4 médias
...aqueducs n'était pas constant mais dépendait fortement du débit des sources et de l'état des canalisations. Dans l'Antiquité, on savait construire des barrages mais ceux-ci étaient sans commune mesure avec les grands barrages-réservoirs qui ont délivré les villes européennes riveraines de la Méditerranée... - Afficher les 60 références
Voir aussi
- COYNE ANDRÉ (1881-1960)
- CONTREFORT, architecture
- MÉCANIQUE DES ROCHES
- RENARD, technologie
- FONDATIONS, bâtiment et travaux publics
- HYDROÉLECTRICITÉ
- SÉCURITÉ
- ÉCOULEMENT, hydrologie
- MÉCANIQUE DES SOLS
- GÉOLOGIE APPLIQUÉE
- TASSEMENT
- CRUES
- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE
- REMBLAYAGE
- ÉTANCHÉITÉ
- COMPACTAGE
- BARRAGES-POIDS
- BARRAGES-VOÛTES
- BARRAGES À CONTREFORTS
- BARRAGES EN ENROCHEMENTS
- BARRAGES EN TERRE
- BARRAGES MOBILES
- DÉFORMATION DES ROCHES
- LÉVY MAURICE (1838-1910)
- DÉVERSOIR
- DRAINAGE
- CALCUL DE STRUCTURE
- BÉTON COMPACTÉ AU ROULEAU (BCR)
- ENROCHEMENT
- ÉNERGIE HYDRAULIQUE
- RISQUES TECHNOLOGIQUES