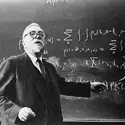BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES
Article modifié le
Bibliothèques numériques et édition
Devant de telles perspectives, que deviennent les équilibres traditionnels entre bibliothèques et éditeurs, déjà fort malmenés depuis une dizaine d'années de numérisation ? De fait, en réunissant des collections, en offrant une nouvelle visibilité thématique (comme pour les approches thématiques que proposent « Voyages en France » ou « Utopies » sur Gallica), les bibliothèques ne sauraient ignorer le rôle éditorial nouveau qu'elles remplissent, du moins pour des ouvrages du domaine public. On peut donc légitimement s'interroger sur les limites imposées concernant l'accès à distance de documents sujets aux droits d'auteur, ou au contraire sur les opportunités de coédition qu'elles pourraient être amenées à explorer avec des éditeurs, des transporteurs de signaux ou des entreprises gestionnaires de contenus multimédias.
Curieusement, l'apparition de supports nomades (e-book) et de formats de lisibilité et de structuration de documents (open e-book par exemple) sont des tentatives pour reconstituer un modèle économique solvable du livre (le « livre électronique ») par déchargement et accès payants à des éditions en ligne. Ces supports nomades parient à l'évidence sur une baisse de leurs coûts à venir et sur la croissance exponentielle de mémoire des composants électroniques (on parle du stockage possible de l'ensemble de la Bibliothèque du Congrès en 2020 sur un support de mémoire de masse de quelques centimètres) ou de débits des réseaux. On le voit, la diversification, la plasticité des usages contraignent les bibliothèques à de nouvelles responsabilités touchant la conservation du patrimoine, qui ne relèvent pas seulement des performances techniques. Une grande partie du droit et de la jurisprudence tend à considérer que le numérique ne change fondamentalement rien au droit d'auteur et à son parent, le copyright, ni à la nécessité de contractualiser les autorisations en traduisant celles-ci dans des rémunérations qui ont valeur pour lever les restrictions. Il nous semble, en ce qui concerne les bibliothèques, que cette approche juridico-économique à laquelle se réduirait la pratique éditoriale est un peu courte. Tout comme on peut s'interroger sur la pertinence, dans ce cadre nouveau, du partage social des rôles qu'historiquement l'État et les bibliothèques, d'un côté, le marché et l'édition, de l'autre, se sont traditionnellement attribués. Aux premiers, le soin d'organiser le dépôt légal, de conserver, de donner accès et de favoriser la lecture publique, la recherche et l'instruction, de mettre en œuvre les outils bibliographiques nécessaires, de valoriser le patrimoine culturel, etc. Aux seconds, la capacité d'organiser la production des créateurs, d'en mettre en œuvre la fabrication, l'impression, la diffusion, la commercialisation et la valorisation, etc.
Il est légitime en effet de s'interroger sur la permanence de ce modèle, dès lors que des utilisateurs vont davantage puiser dans les ressources hétérogènes du Web que dans les documents propres, y compris au sein de bibliothèques transformées en cybercentres, ou encore donnant accès par des abonnements payés aux consortiums de revues en ligne, notamment les revues scientifiques et médicales. Parallèlement, des créateurs, journalistes, scientifiques vont tendre à utiliser directement le Web pour présenter des prépublications, auto-éditer des pages personnelles, constituer des forums ou nourrir des bases de données.
La frontière entre domaine public et droit privé (aussi légitimes soient les volontés conservatoires des intérêts fragiles des éditeurs) nous semble devenir caduque, dès lors que lui fait défaut le modèle économique capable de faire bénéficier le plus large public des mannes numériques. Par exemple, la numérisation de revues scientifiques ou savantes semble trouver, au moins dans le monde anglo-saxon, un marché en développement. Faut-il pour autant interdire la conservation numérique par les bibliothèques, sous des délais courts, des abonnements souscrits ?
À plus long terme, les fonctions publiques (sociales, culturelles, politiques) des bibliothèques peuvent sembler floues : devenues virtuelles, elles ne voient pas nécessairement leurs fonctions ou leurs missions valorisées sur le réseau. L'ampleur du défi représenté par la croissance exponentielle du Web, la multitude des enjeux qualitatifs d'accès qui en découlent, l'ambition du programme de Web sémantique nous semblent au contraire en conforter l'indispensable rôle.
Le rapport conflictuel à l'édition sur le terrain des droits d'auteur est largement un faux débat. Comment justifier par la seule restriction du marché des interdictions d'accès contradictoires avec les possibilités numériques et du réseau, là où des contractualisations en amont seraient plus efficaces pour toutes les parties, au premier chef les utilisateurs ? La diversité des approches des pays européens sur l'exemption au droit d'auteur pour des raisons didactiques ou de recherche, enjeux cruciaux des bibliothèques et des éditions universitaires, montre assez que les uns et les autres manquent d'indicateurs prospectifs.
Pour résumer, on peut dire que, devant le Web, les bibliothèques risquent de perdre en légitimité, là où les éditeurs perdent de l'argent, la valeur ajoutée se déplaçant largement vers les traitements informatiques, les réseaux et les entreprises multimédias. Pour preuve le réseau de distribution en ligne de documents musicaux par Apple (un fournisseur de systèmes et de matériels informatiques !), montrant qu'un autre modèle économique peut émerger, intégrant ces gains de productivité dans la baisse des coûts d'accès.
C'est donc en revenant aux fonctions fondamentales auxquelles les uns et les autres peuvent prétendre au sein du cybermonde que leur avenir se précise quelque peu : en participant à l'organisation encyclopédique des accès aux connaissances numérisées, pour les bibliothèques ; en participant à la mise en forme numérique des créations de contenus, pour les éditeurs.
Il est vraisemblable que cette fonction d'espace public et de lieu de connaissance que sont les bibliothèques aura besoin de se traduire plus concrètement, à l'avenir, par un espace virtuel réellement identifiable sur le Web : organisation multilingue et multiculturelle commune à de nombreuses bibliothèques, fonctions de recherche, de sélection et d'évaluation de l'information, etc. De ce point de vue, la coopération ouverte en 1995 par le projet Bibliotheca universalis, confié dans un premier temps à des bibliothèques d'envergure internationale, apparaît, en termes de complémentarité de collections, comme trop restrictive. Une coopération touchant la structuration des savoirs contemporains (évolution des contenus des classifications, etc.) en liaison avec des centres de recherche (sur les grands sujets planétaires, scientifiques ou écologiques) devrait être engagée, par exemple sous l'égide de l'U.N.E.S.C.O. À cet égard rappelons combien cet organisme est préoccupé par l'ambivalence des évolutions technico-économiques et leurs incidences sur le partage et l'accès au savoir : des scénarios catastrophes de fracture numérique ne sont de fait pas à écarter comme conséquence sur le maillage des bibliothèques publiques de pays du Tiers Monde.
Des initiatives telles que le projet de bibliothèque numérique mis en œuvre par Google à partir de 2005, auquel a répondu celui d'une bibliothèque numérique européenne (Europeana), ou encore le projet European Library, qui a pour objectif de donner accès aux collections des quarante-sept bibliothèques nationales d'Europe, posent à nouveau la question : à quelles conditions Internet est-il une bibliothèque ? Actuellement, la masse des milliards de pages accessibles universellement relève plus du désordre de la bibliothèque illimitée de Babel selon Borges que d'un catalogue raisonné. Cependant, les exigences d'un Web sémantique réactivent des préoccupations intellectuelles qui étaient déjà de mise à Alexandrie. Une des transformations notable à venir sera que, grâce au numérique, les bibliothèques développeront les passerelles de service, d'interaction, avec l'ensemble de la conservation du patrimoine (archives, musées) ; celui de la recherche scientifique et ses communautés ; enfin les plates-formes et réseaux de formation universitaire.
Parallèlement, non par défaut mais par excès, Internet ne saurait être « la » bibliothèque numérique. La révolution de la « société de l'information » n'implique pas le progrès des sociétés du savoir ! Davantage que le dépôt (d'ailleurs fort instable) des cultures du monde, le Web est plutôt une sorte de substitut des activités humaines, au sein desquelles la bibliothèque doit réinventer son espace social, culturel et imaginaire. Que cette réinvention suppose dans le même temps une forme de réappropriation de la mémoire, là nous semble être la paradoxale nouveauté de la notion de bibliothèque numérique.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Yannick MAIGNIEN : enseignant de philosophie, École normale supérieure, lettres et sciences humaines, Lyon
Classification
Média
Autres références
-
CULTURE NUMÉRIQUE
- Écrit par Jean-Yves MOLLIER
- 4 509 mots
- 1 média
...digital immigrants est éclairant de ce point de vue, puisque les forts lecteurs de livres et de revues passent aujourd'hui une partie de leur temps à naviguer sur la Toile, à aller de Gallica 2 vers la Bibliothèque électronique du Québec ou Google Print afin d'y puiser la nourriture spirituelle qu'ils... -
DARNTON ROBERT (1939- )
- Écrit par Roger CHARTIER
- 1 024 mots
L’historien américain spécialiste du xviiie siècle Robert Darnton a entrepris dès les années 1960 une grande recherche sur les Lumières et leur rôle dans la fin de l'Ancien Régime.
Diplômé de Harvard et d'Oxford, Robert Darnton, après avoir enseigné l'histoire européenne à Princeton de...
-
ÉDITION ÉLECTRONIQUE
- Écrit par Alexandra SAEMMER
- 4 014 mots
- 3 médias
...distributeur de la marque d’une liseuse donnée. Elles ne tiennent pas compte non plus des pratiques de partage, d’échange et de don symboliquement liées au livre. Nombreux sont les lecteurs qui s'interrogent sur la patrimonialisation possible de ces bibliothèques numériques. De nouvelles structures d’édition... -
INFORMATION : L'UTOPIE INFORMATIONNELLE EN QUESTION
- Écrit par Armand MATTELART
- 8 126 mots
- 1 média
« Notre mission est d'organiser l'information du monde et de la rendre universellement accessible et utile ». C'est ainsi que la firme Google annonçait en décembre 2004 son méga-projet d'une nouvelle bibliothèque d'Alexandrie en numérisant les fonds de quelques-unes des plus grandes bibliothèques...
Voir aussi
- COMPRESSION DES DONNÉES
- SCANNER, informatique
- AUTEUR DROITS D'
- STOCKAGE D'INFORMATIONS
- DOCUMENTATION
- DÉPÔT LÉGAL
- COPYRIGHT
- SAVOIR TRANSMISSION DU
- PATRIMOINE ÉCRIT
- INFORMATION, informatique et télécommunications
- SUPPORT D'INFORMATION
- WEB ou WORLD WIDE WEB
- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- LIVRE ÉLECTRONIQUE ou E-BOOK
- INFORMATION DIFFUSION DE L'
- NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication)
- RECONNAISSANCE OPTIQUE DES CARACTÈRES (OCR)
- INFORMATION GESTION DE L'
- CLASSIFICATION
- MÉTADONNÉES
- ONTOLOGIE, informatique
- WEB SÉMANTIQUE
- NUMÉRISATION
- CONSERVATION DES DOCUMENTS
- LECTURE PRATIQUES DE
- POLITIQUE CULTURELLE
- CATALOGAGE
- INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE
- NORMALISATION
- NAVIGATEUR, informatique
- IMAGE NUMÉRIQUE
- FRACTURE NUMÉRIQUE