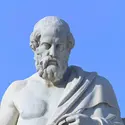BIEN, philosophie
Article modifié le
La notion de bien constitue la notion centrale de la philosophiemorale depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du xviiie siècle. En effet, le concept de bien a été traditionnellement attaché aux concepts de bonheur, de bon état de chose à maximiser, de bonnes conséquences à promouvoir ou de vie bonne. Toutes ces affiliations témoignent d'un élément commun. À chaque fois, le bien est l'objet d'un mouvement, d'une orientation, d'une visée. Les ressources psychologiques qui permettent une telle orientation vers le bien sont essentielles en l'homme. Elles correspondent à la catégorie entière des états mentaux qu'on désigne sous le nom de désirs, volitions, émotions.
Une philosophie morale qui s'organise autour de la notion de bien est ainsi enracinée dans la psychologie et dans l'action. La question de la moralité ne se poserait pas sans un être humain qui connaît, désire, est affecté. Dans la mesure où la réflexion morale, entendue comme philosophie pratique, porte essentiellement sur l'action humaine, la notion de bien devrait être considérée comme le concept clé de la philosophie morale. Elle maintient le lien entre la motivation et la moralité et rend possible de concevoir celle-ci comme une forme du désirable. Elle intègre de nombreux domaines de la vie humaine dans la compétence de la moralité et légitime la question : comment dois-je vivre ? D'où son importance en philosophie morale, même si aujourd'hui de nombreux courants philosophiques plaident pour substituer au bien comme première notion de la philosophie morale les notions de devoir (dans la tradition kantienne) ou de juste (dans les traditions contractualistes).
Comment définit-on le bien ? Quelle faculté humaine permet d'avoir accès au bien ? Quel effet a-t-il sur les valeurs, les actions ou la conduite de la vie ? Une étude des différentes définitions philosophiques du bien permettra de répondre à ces questions relatives à l'ontologie, à l'épistémologie et à la psychologie.
Le bien comme bonheur, ou « eudaimonia »
Les philosophes de l'Antiquité ont lié la recherche du bonheur à la moralité. D'où le nom d'eudémonisme (du terme grec eudaimonia, bonheur, prospérité ou félicité) donné à leur philosophie. La thèse centrale de l'eudémonisme a trait à la coïncidence de la poursuite du bonheur et de l'accès à la vertu. Les philosophes antiques l'ont défendue contre les objections communes qui leur étaient opposées. Polos et Calliclès, les interlocuteurs de Socrate dans le Gorgias de Platon, rappellent que souvent les tyrans et les hommes méchants sont les plus heureux des hommes. En revanche, le cas d'un homme juste qui, refusant de commettre la moindre action coupable, verrait sa réputation détruite, ses biens confisqués, sa famille exterminée montre clairement qu'il est très improbable que la vie vertueuse soit une vie heureuse. On aperçoit déjà combien la thèse eudémoniste est une thèse philosophique, qui va souvent à l'encontre de l'intuition et qui n'attend de l'expérience commune ni vérification ni réfutation.
Platon le rappelle dans l'Euthydème et le Philèbe, les hommes poursuivent une fin dernière, le bonheur, dont la possession permet l'accomplissement objectivement parfait de la nature humaine. C'est ainsi que toutes les éthiques antiques ont défini la recherche du souverain bien – à la fois bien humain, bonheur, et bien moral. Plusieurs traits caractérisent cette recherche. D'abord, ce souverain bien doit porter sur l'ensemble de la vie humaine. Il ne consiste pas en événements, en épisodes ou en sensations, mais doit pouvoir être pensé comme un aspect de l'activité qu'est la vie même. Le deuxième trait est que la recherche du bien est rapportée à une disposition naturelle en l'homme. C'est la tendance naturelle qui « recommande », pour reprendre la belle expression stoïcienne, l'homme à la moralité. Platon est, à cet égard, le seul des philosophes grecs qui ait souligné dans certains textes la spécificité des raisons morales par rapport aux raisons naturelles. Le troisième trait assimile cette orientation naturelle vers la moralité à la rationalité, dont le meilleur exercice est la délibération sur la nature du bonheur et les moyens d'y parvenir.
L'eudémonisme antique, qui identifie la vie heureuse et la vie morale, est caractérisé par deux thèses : la vertu réalise la fonction humaine de raison ; l'accomplissement de cette fonction est le bonheur. Ce sont des thèses sur lesquelles Aristote revient plusieurs fois dans l'Éthique à Nicomaque et dans l'Éthique à Eudème. Or le bonheur est activité, et la fin la plus digne d'être poursuivie. Surtout, l'eudaimonia, qui est le bonheur propre à l'homme, doit se définir par rapport à l'activité spécifique de l'homme, qui est l'activité conforme à la raison et en accord avec la vertu. La vie humaine n'est une vie heureuse que si elle reste soumise à un contrôle rationnel ; sinon, elle ne serait pas la vie bonne pour un être humain. Du reste, la vie la meilleure est celle de l'homme prudent (phronimos), exemplaire vivant de la sagesse pratique, qui réalise au mieux le bien le plus accessible à l'homme. Dans la mesure où le bonheur est une activité, celle-ci a besoin d'un temps minimal, le temps d'une vie humaine complète, pour s'exercer. C'est pourquoi Aristote parle du bonheur « dans une vie accomplie selon son terme, car une hirondelle ne fait pas le printemps ».
Le bonheur se présente comme une réalité à la fois divine et accessible à la plupart des hommes. Il ne peut résulter du hasard ; il exige au contraire un considérable effort ; seuls les êtres présentant une certaine valeur morale et exerçant leur raison peuvent être dits heureux en ce sens, mais cela ne concerne ni les animaux ni les jeunes enfants. Cet effort ne parvient pourtant pas à faire du bonheur une possession inébranlable, comme le penseront les stoïciens. Des malheurs aussi grands que celui de Priam, par exemple, peuvent ruiner le bonheur. Mais ce sont là des cas extrêmes, et on ne saurait faire dépendre le bonheur des faveurs ou des vicissitudes de la fortune. Consistant en une activité conforme à la vertu, le bonheur est en effet une disposition stable et parfaite ; il est du reste la meilleure ressource pour tirer parti de l'adversité. Par ailleurs, ce bien-bonheur est l'expression immédiate de l'ordre de l'âme. La présence en l'âme du bien qui lui est propre, la justice, ou ordre de l'âme, est cause immédiate du bonheur. La nature objective d'un tel bonheur, qui n'a rien de la satisfaction subjective ou du contentement, explique que dans l'éthique socratique la vertu soit considérée comme la condition nécessaire et suffisante du bonheur.
La conception antique du bonheur, en laquelle le rapport avec la vertu est absolument déterminant, suscite quelques remarques. D'abord, que la vertu soit condition du bonheur ne signifie aucunement qu'elle se trouve instrumentalisée. Vertu et bonheur sont les constituants d'une même réalité. Le bonheur ne peut manquer de s'ajouter de surcroît à la vertu. Même dans l'épicurisme, où la vertu est un moyen du plaisir et le bonheur la seule fin choisie pour elle-même, il n'y a pas d'instrumentalisation de la vertu.
Ensuite, il faut souligner le lien entre la définition du bonheur et le choix de la vie heureuse. Faut-il vivre une vie orientée vers la recherche du vrai bien ou une vie vouée au culte des faux biens et aux honneurs de la foule ? Une vie de plaisirs, ou une vie philosophique ? C'est là un des lieux communs éthiques le plus rebattus de l'Antiquité. La seule vie heureuse pour Platon est la vie bonne empreinte de mesure et d'ordre. Aristote mentionne la vie de richesses, dépourvue de toute valeur, la vie active et politique (où l'homme exerce sa vertu pratique dans la communauté de ses semblables, mais sans connaître le loisir ni l'autosuffisance) et la vie de contemplation qui est, selon lui, la vie la plus haute que puisse vivre la partie la plus noble de l'homme : c'est par là qu'il s'assimile à Dieu et s'immortalise.
Une troisième remarque a trait à l'impossibilité de définir l'eudaimonia de façon strictement individuelle. L'autosuffisance du bonheur ne désigne aucunement un état qui ne concerne que l'individu. Il doit toucher aussi, dit Aristote, « ses parents, ses enfants, sa femme, ses amis et ses concitoyens en général, puisque l'homme est par nature un être politique ». Cette idée que le bonheur de l'homme n'est réel qu'autant qu'il est accompagné du bonheur des êtres qui lui sont les plus chers est précisée dans l'analyse qu'Aristote donne de l'amitié comme amour du bien d'autrui. Épicure concevra également le bonheur comme bonheur entre amis. Platon partage avec Aristote l'idée selon laquelle il existe des biens moraux qui ne sont pas accessibles à l'individu indépendamment de la communauté politique. Mais, comme souvent, la pensée platonicienne présente sur ce point une double orientation : le bonheur est, d'une part, conçu de manière strictement individuelle, comme le bon état de l'âme, mais il est, d'autre part, défini à partir de l'excellence de la communauté politique ; dans ce cas, le bonheur n'est ni celui de tous les individus, ni celui de ses membres les plus exceptionnels, mais l'effet de l'ordre politique.
La dernière remarque a trait à l'articulation des biens humains et du bien moral. Tous les philosophes antiques ont le souci de ne pas rompre avec les tendances naturelles des hommes. Les épicuriens reconnaissent comme tendance fondamentale la recherche du plaisir ; les stoïciens, l'instinct de conservation et d'auto-développement. Et même Platon, qui recommande dans le Phédon la rupture avec les plaisirs, reconnaît aussi le rôle des désirs dans la recherche de la vertu. Pour tous ces philosophes, il est essentiel de définir l'eudaimonia, eût-elle pour condition nécessaire et suffisante la vertu rationnelle de l'homme, en continuité avec les tendances naturelles. Il est frappant de constater que c'est la pensée stoïcienne qui illustre la tentative la plus systématique de détacher la jouissance du bonheur de la possession des biens humains. Chez Aristote, en revanche, le bonheur de la contemplation n'est pas privé des biens extérieurs. Ceux-ci sont requis à titre de ressources ou de moyens pour exercer notre spontanéité morale et accomplir des actions vertueuses.
La pensée eudémoniste est propre à l'Antiquité. Mais on en trouve une reprise dans l'œuvre morale, fortement inspirée d'Aristote, de Thomas d'Aquin. Le bien humain, ou bonheur, est recherché en toute action, lit-on dans la Somme théologique. Thomas d'Aquin distingue la ratio finis ultimi, ou notion formelle de la fin ultime, qui consiste en la satisfaction compréhensive de tous les désirs de l'homme – et donc son bien complet et parfait –, et les fins, au sens de choses requises pour satisfaire cette fin ultime. L'homme moralement bon exerce son activité rationnelle, la plus proprement humaine, selon une pluralité de sens. Le bien humain compréhensif contient la fin de toutes les vertus, mais aucune ne suffit à l'accomplissement humain complet dans la contemplation qui est pourtant la perfection de l'activité la plus haute de la raison humaine. Aussi le bonheur réalisé en cette vie est-il un bonheur imparfait, le bonheur parfait étant l'union de béatitude avec Dieu dans la vie à venir.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Monique CANTO-SPERBER : directeur de recherche au C.N.R.S.
Classification
Média
Autres références
-
ANTIQUITÉ - Naissance de la philosophie
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 11 140 mots
- 8 médias
On méconnaîtrait l'importance culturelle de la philosophie antique si l'on n'y voyait qu'une période – la première, donc la plus fruste – dans le développement d'une activité intellectuelle spécifique, et clairement définie, qui serait la philosophie. En réalité, l'Antiquité, et singulièrement...
-
ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)
- Écrit par Pierre AUBENQUE
- 23 793 mots
- 2 médias
...opinion dégrade l'homme au niveau de l'animalité ; quant aux autres, elles prennent pour la fin dernière ce qui n'est que moyen en vue de cette fin. Le bien suprême est donc au-delà des biens particuliers. Mais ce n'est pas à dire qu'il s'agisse d'un Bien en soi, séparé des biens... -
ARISTOTÉLISME
- Écrit par Hervé BARREAU
- 2 242 mots
- 1 média
-
ART (Aspects esthétiques) - Le beau
- Écrit par Yves MICHAUD
- 5 576 mots
- 6 médias
Ce retour de la beauté comporte une dimension morale. En même temps que le Beau,le Bien est réaffirmé, avec les progrès de la vision morale des êtres, des comportements et des échanges. Telle est la signification de l'impératif de la correction politique et morale. Personne n'a aujourd'hui le droit... - Afficher les 22 références
Voir aussi