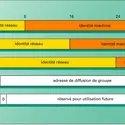BIOMÉTRIE
Article modifié le
Introduit dans le vocabulaire scientifique vers la fin du xixe siècle, le mot « biométrie » (d'abord en anglais : biometry ou biometrics) est parfois employé abusivement, surtout par des auteurs américains, comme synonyme de statistique, alors que cette dernière n'est, pour le biométricien, qu'un instrument de travail. Dans l'usage correct, la biométrie désigne la science des variations biologiques, des phénomènes qui s'y rattachent et des problèmes qui en découlent. Depuis le début du xxie siècle, le mot « biométrie » est aussi utilisé dans le sens, plus restrictif, d'ensemble des techniques permettant l'identification des personnes à l'aide de caractéristiques biologiques telles que les empreintes digitales, l'image de l'iris des yeux, les traits du visage, etc., ce qui pose des questions de bioéthique.bioéthique.
La position classique en science consiste à négliger la plupart des variations, voire à les confondre avec les erreurs expérimentales. Le biométricien, au contraire, constate que les variations sont une caractéristique universelle de la vie dont la méconnaissance entraîne souvent des erreurs.
Il importe de distinguer les diverses formes de variation observables chez les êtres vivants et, en particulier, dans l'espèce humaine : les intervariations, ou différences entre les individus, et les intravariations, qui traduisent l'instabilité des individus dans le temps. Plus importantes à certains égards, ces dernières peuvent atteindre, pour certains caractères physiologiques et biochimiques, une amplitude considérable.
D'autres variations intéressent le biométricien, par exemple celles qui affectent les catégories biologiques — races, sexes, classes d'âge — ou sociales, tels les groupes professionnels. Il tiendra compte enfin, s'il y a lieu, des changements « séculaires » ou « diachroniques » qui se produisent dans les générations successives.
On a cru autrefois que les variations quantitatives, comme celles de la stature ou du rythme cardiaque, dépendaient des seules influences extérieures. On sait, maintenant, que les intervariations de certains caractères relèvent partiellement de l'hérédité ; leur étude intéresse la biométrie génétique. Par exemple, l'héritabilité de la taille est considérable, celle du poids nettement moins forte, celle du taux de cholestérol plus importante que celle de l'hémoglobine ou du glucose sanguin.
Il va de soi que les caractères à héritage faible sont davantage influençables par les conditions de vie. Mais ce problème reste d'autant plus difficile que tous les individus ne sont pas également modifiables et que tous les milieux n'ont pas le même pouvoir modificateur.
Les intravariations posent un problème encore plus difficile. Chez un individu, tous les caractères biologiques ou biochimiques ne varient pas au même degré. Un individu n'est donc pas globalement plus stable — ou plus fluctuant — qu'un autre. Il le sera seulement pour certains caractères. D'autre part, les fluctuations d'un caractère donné n'étant pas les mêmes chez tous, il existe une « intervariation des intravariations ».
Il apparaît cependant que, pour les caractères qui ont pu être ainsi étudiés, les intravariations ne sont pas totalement anarchiques : un individu oscille autour de sa moyenne, selon une marge qui lui est particulière. Cela risque de poser parfois de difficiles problèmes pratiques. Jugé suivant les normes établies sur une population, un individu pourrait apparaître « normal », alors qu'il se trouve, en réalité, hors de sa zone personnelle de normalité.
La biométrie révèle donc la complexité extrême des situations, heurtant parfois les idées admises en physiologie. Ses résultats apparaissent notamment incompatibles avec la notion d'homéostasie, qui postule sinon pour un milieu intérieur parfaitement « fixe », tout au moins des oscillations « infinitésimales », « aussitôt corrigées » et, en pratique, « négligeables ». Cette doctrine, considérée comme fondamentale, n'a pu prendre corps qu'à la suite d'un malentendu : pas une seule fois les variations physiologiques ne furent mesurées.
À les mesurer, on constate, à quelques exceptions près, que les variations augmentent quand on passe de l'anatomique au physiologique et du physiologique au biochimique. Pour donner une image, la stature humaine et la concentration des ions hydrogène du sang donnent des coefficients de variation de même ordre, parmi les plus faibles, alors que les graisses neutres et le carotène du plasma figurent parmi les caractères les plus fluctuants.
L'une des premières démarches du biométricien est l'étude des liaisons entre les phénomènes variables : entre deux caractères physiologiques, ou entre un caractère biologique et une variable « extérieure à l'organisme », par exemple un aspect quantifiable du milieu. La statistique permet de mesurer l'intensité de ces liaisons. Le plus souvent — mais ce n'est pas toujours possible — on détermine un coefficient de corrélation.
Traditionnellement, un grand nombre de corrélations étroites sont affirmées, mais une telle appréciation repose sur la présomption que « tout se tient chez l'être vivant ». La vérification biométrique fait apparaître cette présomption fallacieuse. Certaines corrélations sont étroites, mais la plupart restent médiocres et les corrélations nulles ne sont pas exceptionnelles. Autrement dit, beaucoup de caractères biologiques varient indépendamment les uns des autres.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Eugène SCHREIDER : directeur du laboratoire physique de biométrie humaine du C.N.R.S., professeur à l'Institut de démographie de l'université de Paris
Classification
Autres références
-
APPRENTISSAGE PROFOND ou DEEP LEARNING
- Écrit par Jean-Gabriel GANASCIA
- 2 646 mots
- 1 média
...potentielles de l’apprentissage profond est immense. C’est la raison pour laquelle cette méthode d’apprentissage s’est imposée ces dernières années. Ces techniques permettent d’améliorer la reconnaissance d’images en général et de créer des applications pour la biométrie (reconnaissance d’empreintes... -
CROISSANCE, biologie
- Écrit par Encyclopædia Universalis , André MAYRAT , Raphaël RAPPAPORT et Paul ROLLIN
- 14 766 mots
- 7 médias
Un bon critère de croissance doit se prêter à des mesures faciles, précises, fidèles et, autant que possible, non destructrices ; la « taille », c'est-à-dire une mesure de longueur, est le plus souvent utilisée, mais elle suppose que l'organisme ne soit pas trop déformable, comme celui d'un ver, et... -
INTERNET - Histoire
- Écrit par Danièle DROMARD et Dominique SERET
- 6 984 mots
- 2 médias
Actuellement, des techniquesbiométriques (caractéristiques biologiques d'un individu) identifient un utilisateur avec certitude. Leur utilisation tend à se développer dans les systèmes souhaitant une sécurité maximale. Naturellement, la sécurisation des systèmes entraîne des coûts plus élevés et des... -
POLICE SCIENTIFIQUE
- Écrit par Encyclopædia Universalis , Robert GAURENNE , Bertrand LUDES et Hélène PFITZINGER
- 10 094 mots
- 1 média
Latechnique anthropométrique, proposée par Bertillon, consiste en une énumération méthodique, systématique et précise des éléments descriptifs et invariables des caractéristiques d'un individu qui sont portés sur une fiche signalétique. Le signalement descriptif comporte l'énumération...
Voir aussi