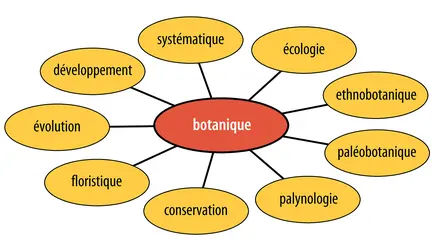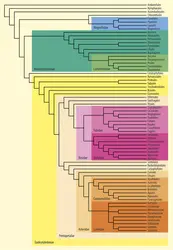- 1. Botanique et systématique
- 2. Botanique et recherche scientifique
- 3. Botanique et biodiversité
- 4. Botanique, paléobotanique et palynologie
- 5. Botanique et enseignement
- 6. Botanique et grand public
- 7. Ethnobotanique
- 8. Le métier de botaniste
- 9. L'avenir de la botanique
- 10. Bibliographie
- 11. Sites internet
BOTANIQUE
Article modifié le
Le terme botanique a longtemps été synonyme de science des plantes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui où seules les disciplines qui concernent la systématique, le développement, l'évolution et l'écologie des végétaux continuent de définir la botanique. Les autres branches que sont la physiologie et la génétique des plantes sont regroupées sous le terme général de biologie végétale (plant sciences en anglais). Le domaine d'application de la botanique, traditionnellement vaste, s'est aussi restreint. En effet, les champignons ne font plus partie du monde végétal. Ces organismes, plus apparentés aux animaux qu'aux plantes du point de vue évolutif, forment désormais un groupe à part (les mycètes ou Fungi) et la science qui les concerne est appelée la mycologie. De même, dans la pratique, l'étude des algues (dont une partie seulement appartient aux plantes vertes) est exclue de la botanique. On parle plutôt de phycologie. Ainsi, la botanique et les botanistes se concentrent aujourd'hui sur les plantes terrestres (ou embryophytes), vaste groupe d'organismes rassemblant toutes les espèces de mousses, fougères, gymnospermes (ou plantes à graines nues) et angiospermes (ou plantes à fleurs).
Les progrès technologiques réalisés depuis la fin des années 1980 – notamment en matière d'informatique, d'imagerie et de génétique – apportent un nouveau souffle à la botanique, en permettant notamment de mieux comprendre l'origine de la diversité des plantes. Ces nouvelles avancées sont intégrées dans les enseignements de la botanique, ce qui a pour effet de dynamiser cette science longtemps considérée comme figée. La botanique connaît aussi un regain d'intérêt auprès du grand public, qui redécouvre l'intérêt et les usages traditionnels des plantes et qui mesure leur rôle majeur dans la biodiversité. Ainsi, la botanique au début du xxie siècle apparaît comme une science riche, vivante et en plein essor.
Botanique et systématique
La systématique est une discipline vaste qui a pour objet d'inventorier, de nommer, de classer et, dans sa signification actuelle, de reconstruire l'histoire évolutive des organismes vivants et disparus. Contrairement à une idée largement répandue, la botanique ne se limite pas à la systématique des plantes et la systématique des plantes (ou botanique systématique) n'est pas une discipline du passé. L'histoire de la systématique des plantes est aussi ancienne que celle de la botanique. Avec l'accumulation croissante des connaissances sur la diversité des espèces végétales au fur et à mesure de l'exploration de la Terre, la recherche d'un système cohérent pour nommer et classer ces espèces a été au cœur des préoccupations des botanistes. Bien que beaucoup plus avancé que celui des divers groupes d'organismes unicellulaires (par exemple, les bactéries) ou d'animaux (à l'exception des vertébrés), l'inventaire des espèces de plantes terrestres reste toutefois aujourd'hui incomplet. On estime que de 10 p. 100 à 20 p. 100 des espèces de plantes à fleurs (ce qui pourrait représenter jusqu'à 70 000 espèces) n'ont pas encore été décrites, c'est-à-dire qu'il reste à les découvrir, les identifier comme espèces nouvelles, les nommer et en faire une description détaillée afin de pouvoir les reconnaître. De plus, il faut souligner que parmi les 270 000 à 350 000 espèces de plantes à fleurs déjà décrites, une grande partie demeure très mal connue. Il reste donc encore un travail considérable à accomplir si l'on veut simplement connaître la biodiversité végétale afin de la préserver ou de pouvoir l'exploiter (à des fins médicinales par exemple).
La description et l'énumération des espèces végétales deviennent rapidement une tâche impossible si l'on ne dispose pas d'un système de classification hiérarchique permettant de rassembler des organismes semblables ou ayant des propriétés communes dans des groupes auxquels on puisse se référer par un nom. De tels groupes sont appelés taxons et la branche de la systématique qui s'occupe de donner ces noms est la taxonomie. La botanique systématique a vu depuis sa naissance l'élaboration d'un très grand nombre de systèmes de classification différents, plus particulièrement au cours du xxe siècle. Cette diversité de systèmes s'explique en partie par la découverte et une meilleure connaissance des espèces végétales, mais aussi par les divergences d'opinion entre les différents auteurs à propos des critères et caractères utilisés pour classer. Dans la mesure où la classification des plantes peut être assimilée au langage de communication des botanistes, il est d'un intérêt général que tous les botanistes parlent la même langue. Heureusement, la plupart des biologistes s'accordent aujourd'hui sur le principe qu'une classification doit refléter l'histoire évolutive d'un groupe d'organismes, c'est-à-dire sa phylogénie. On parle alors de classification phylogénétique. Au-delà de son intérêt scientifique, une telle classification répond à deux qualités pratiques : unicité, parce que l'évolution ne s'est déroulée qu'une seule fois ; stabilité, parce que la reconstruction des relations de parenté évolutives ne cesse de s'améliorer et de se stabiliser au cours du temps. Dans ce domaine, on peut affirmer que les botanistes ont montré l'exemple puisqu'un vaste groupe d'auteurs, collectivement appelés Angiosperm Phylogeny Group, a proposé en 1998 la première classification phylogénétique des angiospermes. Le succès de cette classification est tel qu'aujourd'hui la troisième version de cette classification (APG III), proposée en 2009, est utilisée par la grande majorité des botanistes (fig. 1). Il existe également depuis 2006 un équivalent pour les monilophytes (groupe de plantes vasculaires formé principalement par les fougères et les prêles). Ce n'est pas encore le cas pour le reste des plantes terrestres (mousses, hépatiques, lycophytes et gymnospermes) bien que, dans la pratique, la majorité des botanistes suive de plus en plus des systèmes de classification phylogénétiques pour ces groupes également. La botanique systématique est donc loin d'être éteinte puisqu'elle est en pleine mutation. Plus que jamais, elle s'intègre de façon dynamique avec les nombreuses autres disciplines de la biologie. En particulier, elle repose très largement sur la reconstruction de la phylogénie à partir de données de séquences ADN, qui elle-même représente aujourd'hui un outil essentiel pour répondre à de nombreuses questions scientifiques.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Sophie NADOT : professeure au Laboratoire écologie, systématique, évolution de l'université Paris-Sud
- Hervé SAUQUET : maître de conférences à l'université Paris-Sud, professeur au Laboratoire écologie, systématique, évolution de l'université Paris-Sud
Classification
Médias
Autres références
-
BOTANIQUE (HISTOIRE DE LA)
- Écrit par Lucien PLANTEFOL et Hervé SAUQUET
- 4 844 mots
- 1 média
La botanique, science des plantes, apparaît à l'état pur dans l'œuvre scientifique de Théophraste ; mais elle est bientôt associée étroitement à la médecine dont elle devient simplement un chapitre ; ainsi réduite au rôle pratique de pourvoyeuse de médicaments pendant tout...
-
ACCRESCENT
- Écrit par Jacques DAUTA
- 224 mots
Le qualificatif d'accrescent est donné, en morphologie végétale, à un organe qui, normalement, se trouve d'abord indépendant d'une autre partie de la plante, et qui, ensuite, vient s'y souder. Cette évolution caractéristique survient le plus souvent au cours et autour de la formation des fructifications....
-
ACTINOMORPHIE
- Écrit par Jacques DAUTA
- 187 mots
Type de symétrie florale dans lequel les pièces sont agencées symétriquement par rapport à l'axe de la fleur. Par opposition aux fleurs zygomorphes, les fleurs sont alors appelées actinomorphes ou régulières. Cette symétrie radiale existe, par exemple, chez les mauves et la pomme de terre...
-
ADANSON MICHEL (1727-1806)
- Écrit par Lucien PLANTEFOL
- 605 mots
Né à Aix-en-Provence et amené à deux ans à Paris par son père, il est élève au collège du Plessis-Sorbonne, où il prend conscience de sa passion pour les sciences naturelles. Au Jardin du roi, il travaille sous la direction de Réaumur et de Bernard de Jussieu, décrit toutes les plantes...
-
ADVENTIFS ORGANES
- Écrit par Robert GORENFLOT
- 327 mots
Un organe végétatif est qualifié d'adventif quand, s'ajoutant secondairement à d'autres organes du même type, il est d'une autre origine et occupe une position différente. Par exemple, les racines adventives peuvent apparaître le long de tiges en place : crampons du lierre, racines des rhizomes,...
- Afficher les 97 références
Voir aussi
- PHARMACOPÉE
- AIRES PROTÉGÉES, écologie
- SYSTÉMATIQUE
- GÉNÉTIQUE VÉGÉTALE
- SÉQUENÇAGE, génétique moléculaire
- DÉVELOPPEMENT VÉGÉTAL ou ONTOGENÈSE VÉGÉTALE
- TAXON
- ETHNOBOTANIQUE
- PHYLOGÉNIE ou PHYLOGENÈSE
- BIO-INFORMATIQUE
- INFORMATIQUE, biologie et médecine
- PHYTOTHÉRAPIE
- NUCLÉOTIDIQUE SÉQUENCE
- MORPHOLOGIE, biologie
- ENSEIGNEMENT
- PALÉOBOTANIQUE
- TAXINOMIE ou TAXONOMIE BIOLOGIQUE
- PROTECTION ou CONSERVATION DES ESPÈCES
- ÉVO-DÉVO (evolutionary developmental biology)
- ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP
- MICROTOMOGRAPHIE AUX RAYONS X
- HOTSPOT ou POINT CHAUD DE BIODIVERSITÉ
- VIGIE-FLORE PROGRAMME
- VÉGÉTAL RÈGNE