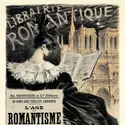CAFÉS LITTÉRAIRES
Article modifié le
La diffusion en Europe
L'introduction du café connaît de nombreuses résistances au cours du xviie siècle partout en Europe. La Faculté de médecine, reprenant les arguments des docteurs arabes, affirme qu'il est la cause de maladies innombrables. En France, après plusieurs tentatives infructueuses, le café est enfin adopté en 1669, pendant le séjour à Versailles de l'envoyé de la Sublime-Porte, Aga Mustapha Racca, qui convertit la cour à cette boisson amère et peu engageante. Jusqu'à cette date, le café est vendu à Paris dans d'obscures boutiques (les premiers témoignages écrits remontent à 1643) et, à partir de 1672, à la foire Saint-Germain. Le premier café littéraire digne de ce nom ouvre ses portes le 18 avril 1689 rue Neuve-des-Fossés-Saint-Germain-des-Prés (aujourd'hui rue de l'Ancienne-Comédie), en face du tout jeune Théâtre-Français créé par Louis XIV. Il porte le nom de son propriétaire, Procope. Le monde des arts dramatiques en fait son quartier général. Mais c'est aussi l'endroit où est diffusée la gazette, en sorte que comédiens et auteurs, régisseurs et amateurs s'y retrouvent avec ceux qu'on va appeler les nouvellistes. Pendant plus d'un siècle, tous les grands noms du théâtre et de la littérature le fréquentent : La Faye, Regnard, Crébillon père et fils, Fréron, Jean-Baptiste Rousseau, Piron, Voltaire, le baron de Grimm... Rebaptisé un temps Café Zoppi, son rôle pendant la Révolution est considérable : il est fréquenté par Danton et Marat, et c'est là que se déroulent les réunions du club des Cordeliers. Avec des hauts et des bas, le café Procope survit aux injures du temps et existe encore de nos jours.
En Angleterre, le café est mieux accepté et le médecin William Harvey s'en fait le défenseur. Ce serait un certain Edwards qui aurait ouvert la première maison de café à Londres vers 1652, d'abord dans la George and Vulture Inn, puis en créant The Rosee's Head, dirigée par son jeune protégé turc. D'autres ne tardent pas à l'imiter, qui ouvrent la Rainbow Tavern à Temple Bar et la Garraway Coffee-House. Très vite, on reproche là aussi aux cafés d'être des repaires de la sédition. On vient y lire la London Gazette et y discuter de politique. Ils sont agrémentés par la présence de jeunes et avenantes serveuses, les Phyllies. Quant au premier club littéraire de la capitale, le Mermaid Club, avec William Shakespeare, John Donne, Ben Jonson, Francis Beaumont, John Fletcher, il se réunit à la MermaidTavern, près du théâtre du Globe, sous le règne d'Élisabeth Ire. Les partisans de Cromwell, après la mort de leur lord-protecteur, complotent au Coffee Club, logé au sein de la Turc's Head. Les hommes de lettres, eux, préfèrent se retrouver à laTom's Coffee-House ou à la RedCow, surnommée Wit'sou Will's. Samuel Pepys vient y écouter John Dryden et Alexander Pope fait partie des habitués. William Congreve y entraîne Jonathan Swift. Celui-ci fréquente d'autres endroits, comme la Bell Tavern, et il fonde le Scriblerus Club. Au siècle des Lumières, triomphe le Kit-Kat Club, où l'on rencontre Horace Walpole au milieu d'une brillante société de lettrés. Samuel Johnson crée lui aussi plusieurs clubs réputés, comme l'Ivy Club Lane, puis l'Essex Head Club et enfin le Literary Club, qui tient ses séances au Turc's Head. Le commerce du thé, la force commerciale des brasseurs et l'évolution des clubs en sociétés élitaires seront cause du déclin des cafés anglais au cours du xixe siècle.
Il semble que c'est en Italie qu'a été créée la première bottega di caffè. À Venise, la première maison de café est enregistrée en 1681, suivie aussitôt par plusieurs dizaines d'autres. Des mesures sont prises par le gouvernement de la sérénissime République pour en limiter le nombre. Mais ils sont vite devenus indispensables aux Vénitiens, qui peuvent y sacrifier à trois de leurs vices majeurs : le jeu, la luxure et l'oisiveté. Ils s'avèrent aussi l'expression d'un idéal de luxe et de raffinement qui s'allie au goût de la littérature. Ce dont témoigne la comédie de Carlo Goldoni, La Bottegadelcaffè. A la Veneziatrionfante, rebaptisé Florian, exprime depuis 1720 l'esprit des Vénitiens, qui vivent la décadence avec une rare désinvolture et une élégance tout aristocratique. Les grandes cités de la péninsule l'imitent bientôt : Rome connaît ainsi ses premières botteghe dans les années 1680, toutes situées aux alentours de la place d'Espagne.
C'est le siège de Vienne par les armées ottomanes en 1683 qui aurait été à l'origine de l'introduction du café dans la ville. Les faits d'armes du jeune Polonais Koltzchirzky lui valent de recevoir en récompense les sacs de café abandonnés par les troupes turques. Il ouvre une maison de café dans la capitale appelée Zur BlauenFlasche (À la bouteille bleue). Ce récit, plus ou moins enjolivé, est contredit par les historiens qui signalent l'existence de plusieurs cafés entre 1640 et 1670. Quoi qu'il en soit, le goût du café se répand à Vienne comme une traînée de poudre.
La fortune des cafés en Europe est très différente en fonction des cultures et des traditions. Par exemple, les Allemands manifestent une réticence obstinée à son encontre, comme en témoigne la Cantate du café de Jean-Sébastien Bach, qui plaisante l'engouement des jeunes filles pour cette boisson. Ce sont en tout cas les femmes qui imposent l'usage des Caffé-Grantzen, réunions de la bonne société au milieu de l'après-midi. Le premier café naît dans la ville portuaire de Hambourg vers 1678. Mais il faut attendre le début du xviiie siècle pour qu'on commence à en adopter la coutume dans les grandes villes allemandes. Le même phénomène se confirme dans la majeure partie de l'Europe centrale et orientale.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Gérard-Georges LEMAIRE : écrivain
Classification
Médias
Autres références
-
FRANÇAISE LITTÉRATURE, XIXe s.
- Écrit par Marie-Ève THÉRENTY
- 7 759 mots
- 6 médias
...la sociabilité ancienne des salons et des cénacles dont l’objectif est de renforcer des esthétiques émergentes se voit concurrencée par une société de cafés et de cabarets. À partir des années 1870, les estaminets du quartier Latin et de Montmartre connaissent une grande effervescence, manifeste dans...
Voir aussi