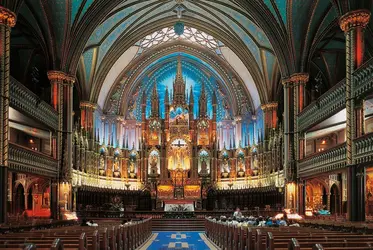CANADA Arts et culture
Article modifié le
La musique
L'histoire culturelle et artistique du Canada est indissociablement liée au fait que cet État fut pendant plusieurs siècles une colonie de deux pays européens, la France puis l'Angleterre. Cette situation historique particulière explique largement qu'il n'existe pas, à proprement parler, de musique « savante » spécifiquement canadienne avant la fin du xixe siècle. Jusqu'à cette époque, il n'y a en effet aucune véritable organisation musicale au Canada, dont la plupart des musiciens – compositeurs et interprètes – se forment en Europe. Les institutions musicales importantes – conservatoires, universités de musicologie, orchestres... – ne commenceront à voir le jour que dans le dernier tiers du xixe siècle.
Situation musicale des origines au XIXe siècle
Si la mosaïque ethnique a façonné les divers aspects de la conscience artistique du pays, les deux groupes prédominants, francophone et anglophone, en ont posé les assises. Dès le XVIIe siècle, une vie musicale intense s'organise en Nouvelle-France grâce à son premier évêque, Mgr François-Xavier de Montmorency-Laval de Montigny, qui suscite la création de ce qui est considéré comme la première œuvre canadienne, la prose Sacrae familiae felix spectaculum (vers 1674), attribuée à Charles-Amador Marin (1648-1711).
Fait plus étonnant, les plus prestigieux artistes de l'école de Versailles sont venus sur les rives du Saint-Laurent : ainsi, Henry Du Mont, maître de chapelle de Louis XIV, Jean-Baptiste Morin, musicien de la maison du duc d'Orléans, André Campra, de la chapelle de Versailles. La correspondance de Mme Bégon (1748-1753) nous informe sur certains aspects de la vie musicale à Montréal et sur l'importance de la danse comme expression de vie. Dans la seconde moitié du xviiie siècle, Pierre de Sales Laterrière écrit : « Jamais je n'ai connu nation aimant plus à danser que les Canadiens ; ils ont encore les contredanses françaises et les menuets qu'ils entremêlent de danses angloises. »
Après la conquête anglaise et le traité de Paris (1763), la musique connaîtra une nouvelle orientation, due à des immigrants allemands, ukrainiens, scandinaves, hollandais.
Les Canadiens eurent le privilège d'entendre des œuvres de l'école de Mannheim, des quatuors de Haydn, exécutés en 1791, des pages de Mozart (le Quintette en ut majeur, K 515, et le Quintette en sol mineur, K 516, jouées à Québec en 1793, six ans après leur composition à Vienne). Il importe également de faire état d'un canon de Beethoven dédié aux Québécois. Parmi les musiciens d'origine allemande qui devaient apporter une contribution exceptionnelle à la vie musicale au Canada, notons Théodore Frédéric (né Johann Friedrich) Molt (1795-1856). Professeur « de piano, de basse chiffrée et de musique » à Québec, où il s'établit en 1822, organiste à la basilique de Québec de 1841 à 1849, il écrivit des traités de musique, les premiers du genre en Amérique du Nord : Traité élémentaire de musique - Elementary Treatise on Music (1828), New and Original Method for the Pianoforte (1835), Traité élémentaire de musique vocale (1845)... Lors d'un voyage en Europe en 1825 et 1826, il rendit visite à Beethoven et le pria d'écrire une œuvre pour ses étudiants. Le maître de Bonn accepta et composa Freu Dich des Lebens, WoO 195 (« Réjouissez-vous de la vie ») ; il s'agit d'un canon dont le manuscrit porte la date du 16 décembre 1825, c'est-à-dire le jour du cinquante-cinquième anniversaire de Beethoven.
Jusqu'à la fin du xviiie siècle, la situation musicale au Canada aussi bien anglophone que francophone est la suivante : la musique populaire est florissante, les concerts de musique « savante » reposent essentiellement sur l'activité d'amateurs très engagés. Même si l'on peut douter de leur valeur proprement artistique, on ne peut que saluer la variété des œuvres proposées et la vitalité de ces amateurs qui se réunissent par amour de la musique. Mais ce serait se leurrer que de penser que la composition se développe alors qu'il n'existe en fait ni ressources artistiques réelles ni institutions musicales, et qu'il est extrêmement difficile de réunir un ensemble instrumental complet.
Au début du xixe siècle, un phénomène nouveau apparaît : les amateurs se voient discrédités et remplacés par de prétendus professionnels, qui sont parfois de bons musiciens, mais, hélas !, le plus souvent, des dispensateurs de distractions faciles, voire des charlatans qui éblouissent des auditoires non avertis avec du spectaculaire. Ces soi-disant maîtres, à la voix et aux doigts habiles, arrivaient en général de grandes villes des États-Unis avec leurs imprésarios, s'annonçaient de manière grandiloquente – « Grand concert de musique vocale et instrumentale » –, et disparaissaient après un certain nombre de spectacles. Le goût du public s'altère, et il n'est pas rare de trouver au programme d'un même concert des mélanges de musique sacrée et de musique profane, ou d'œuvres « savantes » et de chansons. Le musicologue canadien Helmut Kallmann décrit parfaitement ce phénomène dans History of Music in Canada : « Les concerts, à l'exception des exécutions d'oratorios et d'opéras, n'étaient pas encore spécialisés dans les catégories chorale, orchestrale, musique de chambre ou pour soliste telles que nous les connaissons aujourd'hui. Les chœurs constituaient la majorité des sociétés musicales et, pour chaque concert, les instrumentistes étaient recrutés à la hâte. En fait, la plupart des concerts faisaient appel à tous les talents disponibles. [...] Les bons interprètes étaient rares et quiconque voulait bien affronter un auditoire avait toute liberté de le faire. À nombre de concerts, les amateurs se mêlaient aux professionnels, ce qui entraînait un niveau d'exécution très inégal. »
Au printemps de 1850 se produit toutefois un événement important sur le plan musical : la venue au Canada de la Société musicale Germania, un ensemble installé aux États-Unis et se composant de vingt-cinq jeunes musiciens de talent qui, jusqu'aux révolutions de 1848, avaient fait partie des orchestres privés de l'aristocratie allemande. Ils avaient par la suite décidé de devenir indépendants, tout en maintenant un très haut niveau artistique. Ainsi, après avoir mis sur pied un orchestre, ils étaient venus sur le Nouveau Continent afin de transmettre aux Américains et aux Canadiens l'amour du grand art musical en leur faisant entendre les chefs-d'œuvre des plus grands compositeurs allemands, de Jean-Sébastien Bach à Richard Wagner. Après leur premier concert, fort bien accueilli, donné à New York en octobre 1848, ils avaient entamé des tournées dans des villes américaines puis dans des villes canadiennes : le triomphe au Canada sera encore plus grand qu'aux États-Unis. En moins de deux semaines, ils se produiront neuf fois au Théâtre royal de Montréal, et donneront également des concerts à Québec, à Kingston et à Toronto. L'apport de la société Germania est considérable dans l'histoire de la musique au Canada : cet ensemble orchestral a en effet non seulement importé le répertoire allemand – complètement inconnu jusqu'alors, de l'âge baroque au romantisme – mais également fait connaître certaines techniques de jeu jusqu'alors inconnues des musiciens du continent américain.
Cependant, avant le xxe siècle, il n'existe aucune grande formation orchestrale canadienne. Les solistes, l'ensemble des interprètes ainsi que les compositeurs viennent d'Europe ou des États-Unis. Cela est particulièrement vrai en matière d'opéra, un genre qui demeure pratiquement inconnu du public canadien jusque vers 1840. Même si divers opéras-comiques ou opérettes avaient été présentés dès la fin du xviiie siècle, par des compagnies itinérantes, les opéras italiens (Rossini, Donizetti et Bellini) et français (Auber, Meyerbeer et Halévy) étaient complètement inconnus. Cette situation s'explique par le fait que l'opéra exige une mise en scène – et, bien entendu, une scène –, des décors et des costumes, un nombre important de chanteurs – solistes et choristes – et un orchestre. Or on ne pouvait, au Canada et à cette époque, répondre à ces conditions et la présentation de La Sonnambula de Bellini au Théâtre royal de Montréal en 1841 demandera à ses organisateurs beaucoup de courage et d'initiative.
Dans la seconde moitié du xixe siècle, beaucoup d'artistes étrangers, parmi lesquels des célébrités – comme les violonistes Ole Bull et Henri Vieuxtemps, le pianiste Sigismond Thalberg, les cantatrices Henriette Sontag et Adelina Patti –, viennent à Toronto et à Montréal.
La situation des compositeurs était analogue à celle de l'ensemble des acteurs de la vie musicale canadienne : la plupart d'entre eux étaient des Européens émigrés au Canada.
Parmi les plus importants figure Antoine Dessane (1826-1873), musicien français venu s'installer à Québec en 1849. Dépositaire de la tradition musicale française, il ne tardera pas à exercer une grande influence sur les institutions et la vie musicales de la ville. Né en France, à Forcalquier, il avait étudié au Conservatoire de Paris de 1837 à 1841. Organiste à la cathédrale-basilique Notre-Dame de Québec, il fut un des premiers compositeurs de musique savante du Canada, et un des plus actifs. Il composa de la musique d'église – des messes, notamment – sans pour autant négliger la musique d'orchestre et la musique de chambre. Sa Suite pour orchestre, écrite en 1863, est l'une des très rares œuvres du genre créée au Canada pendant la période qui s'étend de 1850 à 1910. Avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, Dessane contribua à l'enrichissement du milieu musical par des concerts, bien sûr, mais aussi en fondant des associations. Il enseigna selon les principes du Conservatoire de Paris, et sa maison devint le point de rencontre des musiciens du Québec. Son importance dans l'histoire de la musique canadienne est considérable, car avant lui la composition musicale était une activité quasi inconnue dans ce pays.
Parmi les contemporains de Dessane se trouvent un certain nombre d'artistes doués, parmi lesquels, notamment, Jean-Baptiste Labelle (1825-1898). Né dans le Vermont de parents canadiens, il arrive à Montréal en 1843. Il étudie le piano avec le pianiste viennois Leopold von Meyer et le célèbre Sigismond Thalberg. En 1863, il devient le chef d'un nouvel orchestre formé de vingt-neuf excellents musiciens, la Société philharmonique canadienne de Montréal. On lui doit plusieurs opérettes, la cantateLa Confédération – composée à l'occasion de la formation du nouvel État fédéral, en 1867 – et de nombreuses chansons.
Le milieu du xixe siècle est marqué par l'arrivée de nombreux musiciens européens décidés à contribuer au progrès musical du Canada. Ainsi, Charles Wugk Sabatier (1819-1862), d'origine allemande, mais français de tempérament et d'éducation – né à Tourcoing, il étudie au Conservatoire de Paris de 1838 à 1840 –, arrive au Canada en 1848 après s'être volontairement exilé d'une France en proie à l'agitation politique. Professeur, pianiste virtuose et compositeur prolixe, il incarne pour les contemporains Canadiens, selon Helmut Kallmann, « le prototype de l'artiste romantique ». Son œuvre la plus ambitieuse est la Cantate en l'honneur du prince de Galles, qui est exécutée en 1860, lors de la visite du futur roi d'Angleterre Edouard VII, à l'occasion de l'inauguration du pont Victoria de Montréal.
La personnalité musicale la plus importante de la fin du xixe siècle est sans conteste Guillaume Couture (1851-1915), que le compositeur et musicologue québécois Léo-Pol Morin considère comme « le premier grand musicien dans l'histoire de la musique canadienne [...] le plus instruit, le plus intelligent, le plus cultivé de son temps. Il fut même le premier grand pédagogue en notre pays ». Ses talents se manifestent très tôt et, à l'âge de seize ans, il devient le plus jeune maître de chapelle qu'on ait vu à la cathédrale Saint-Jacques-le-Mineur de Montréal. Il part en 1873 étudier à Paris. Après de brillantes études au Conservatoire, il occupe en 1877 le poste très convoité de maître de chapelle à l'église Sainte-Clotilde de Paris, où César Franck est organiste. Puis il devient membre de la Société nationale de musique, qui rassemble tous les grands compositeurs français de l'époque. En 1878, il rentre à Montréal. Ses œuvres sont presque toutes à caractère religieux : citons, parmi les plus importantes, le Memorare « Prière à la très sainte Vierge », pour soli, chœur et orchestre, créé à la salle Pleyel, à Paris, le 13 janvier 1877, et son grand oratorio (« poème lyrique religieux ») Jean le Précurseur (1907-1909). Parmi ses pièces profanes se détache Rêverie, pour orchestre, composée en 1876.
L'essor de la musique canadienne au XXe siècle
Au début du xxe siècle, il n'existe pas de réels lieux de transmission musicale au Canada. Ce sont toujours les pratiques amateurs qui dominent largement la vie musicale canadienne, qui demeure animée par des artistes professionnels venus d'Europe et des États-Unis.
Au Canada anglophone, le tableau de la vie musicale avant 1920 est plutôt incohérent. Il n'existe aucune institution réellement établie, même si on compte quelques tentatives de former des orchestres permanents. À Vancouver, un orchestre symphonique de 23 instrumentistes a été fondé dès 1897, mais il sera dissout après avoir donné trois concerts seulement ; il est reconstitué en 1907 avec 36 musiciens, qui se dispersent à nouveau peu de temps après. À Toronto, les nombreuses tentatives de créer des formations symphoniques s'étaient toutes soldées par des échecs. Il faut attendre les années 1920 pour voir émerger les grandes formations orchestrales pérennes que l'on connaît encore aujourd'hui : l'Orchestre symphonique de Toronto est créé en 1922, l'Orchestre symphonique de Vancouver en 1930.
En matière d'enseignement, le McGill Conservatorium of Music de Montréal avait bien été créé en 1904, mais ses professeurs avaient presque tous été formés en Europe, le plus souvent en Angleterre ; rares étaient en effet les musiciens canadiens compétents en matière de pédagogie. Mais des professeurs isolés ne constituent pas une école et, si quelques élèves talentueux eurent au début du xxe siècle la chance de recevoir un enseignement de qualité, la plupart d'entre eux souffrirent d'un manque de formation de qualité, et, plus peut-être encore, de l'absence de toute tradition établie. Le Canada ne comptait en effet à cette époque aucune institution musicale digne de ce nom, à l'exception du McGill Conservatorium.
C'est en 1930 qu'est fondé The Montreal Orchestra ; cet orchestre symphonique de 70 instrumentistes environ choisira comme premier chef le doyen de l'université McGill, Douglas William Clarke. Dès sa création, cet ensemble va présenter annuellement une vingtaine de concerts sous la direction de Clarke. Mais du fait de sa formation – en composition, direction de chœur, piano et orgue – dans les universités britanniques de Cambridge et de Reading, Clarke a tendance à faire la part trop belle à des compositeurs britanniques comme Gustav Holst, Edward Elgar ou Frederick Delius, même s'il est également le chef qui impose et fait connaître l'œuvre de Brahms.
Ces deux institutions, d'obédience anglo-saxonne, ne réussiront jamais à s'imposer dans la communauté francophone de la population canadienne. C'est dans les années 1930 que se mettent en place de véritables institutions musicales spécifiques à cette communauté. C'est ainsi qu'est fondée en 1934 la Société des concerts symphoniques de Montréal (S.C.S.M.). Mais il faut attendre 1942 pour assister à la création, à l'instigation de Claude Champagne, du Conservatoire de musique du Québec à Montréal, entièrement subventionné par l'État, et dont les méthodes d'enseignement sont calquées sur celles du Conservatoire de Paris.
Parmi les grandes figures de la création musicale canadienne au xxe siècle, il faut citer Claude Champagne (1891-1965), qui est à la fois un compositeur important, le plus célèbre peut-être au Canada – il est notamment l'auteur de la Symphonie gaspésienne (1945) et du poème symphoniqueAltitude (1959) – mais également le premier grand professeur de composition musicale de son pays. En effet, après avoir étudié à Paris, il réussit à imposer au Canada les méthodes européennes, son autorité intellectuelle et artistique lui permettant de prôner les principes de cet enseignement, fondé sur la science et la rigueur. Il est alors le premier professeur à transmettre à ses étudiants le sens d'une discipline impliquant l'étude approfondie du solfège et de tous les aspects théoriques des classes d'écritures – harmonie, contrepoint, fugue –, auxquels il ajoute l'analyse musicale et l'orchestration. Claude Champagne a établi cet enseignement au Conservatoire de musique du Québec à Montréal. La plupart des compositeurs canadiens francophones ont bénéficié de l'enseignement de Claude Champagne ; parmi eux, citons François Brassard, Serge Garant, Rhené Jaque, Roger Matton, Pierre Mercure, François Morel, Clermont Pépin, Gilles Tremblay, Jean Vallerand. Notons que beaucoup de ces compositeurs se sont perfectionnés en Europe, notamment à Paris, auprès de maîtres comme Nadia Boulanger ou Olivier Messiaen ; c'est en Europe que la plupart se sont initiés au sérialisme et à l'électroacoustique. De tous ces compositeurs, Gilles Tremblay est certainement celui qui s'est le plus engagé dans les nouvelles techniques et voies de la musique contemporaine, notamment par le biais de l'électronique.
À la différence de leurs collègues francophones, les compositeurs canadiens anglophones se sont formés ou ont parachevé leurs études plutôt en Angleterre, en Allemagne, en Autriche ou aux États-Unis. Parmi les plus importants, on citera R. Muray Schafer – promoteur de la notion de « paysage sonore » – et Barbara Pentland (1912-2000). L'œuvre de cette dernière, encore aujourd'hui trop peu connue, n'en est pas moins importante. Après avoir reçu une formation à la Juilliard School of Music de New York, Barbara Pentland étudie la composition auprès d'Aaron Copland. Très prolixe, elle compose pour toutes les formations instrumentales. Glenn Gould s'est intéressé à son œuvre et a enregistré Shadows, pour piano seul. Divers courants esthétiques jalonnent l'œuvre de cette compositrice, du sérialisme à l'électroacoustique en passant par la microtonalité.
Peut-on dire qu'il existe une musique canadienne contemporaine ? Non, car, même si la musique au Canada a connu un essor extraordinaire au cours du xxe siècle, on ne peut pas vraiment parler de musique typiquement canadienne, les œuvres de musique savante y étant, comme partout ailleurs dans le monde, déterminées par les mêmes langages et les mêmes processus.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Andrée DESAUTELS : musicologue, professeur au Conservatoire de Montréal, Canada
- Roger DUHAMEL : membre de l'Académie canadienne-française
- Marta DVORAK : professeur de littérature canadienne et de littératures postcoloniales à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle
- Juliette GARRIGUES : musicologue, analyste, cheffe de chœur diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, chargée de cours à Columbia University, New York (États-Unis)
- Constance NAUBERT-RISER : professeur agrégé d'histoire de l'art
- Philip STRATFORD : professeur titulaire à l'université de Montréal, département d'études anglaises
- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis
Classification
Médias
Autres références
-
PALÉOESQUIMAU
- Écrit par Yvon CSONKA
- 68 mots
Le terme paléoesquimaux désigne toutes les populations préhistoriques établies de la rive sibérienne du détroit de Béring au Groenland, en passant par l'Arctique nord-américain, qui manifestent un mode de vie de type esquimau. Elles ont disparu peu après l'arrivée d'immigrants venus d'...
Voir aussi
- RÉALISME, littérature
- PORTRAIT, peinture, XVIIIe s.
- PORTRAIT, peinture, XIXe, XXe et XXIe s.
- BORDUAS PAUL-ÉMILE (1905-1960)
- MOLT THÉODORE (1795-1856)
- GOTHIC REVIVAL ou NÉOGOTHIQUE
- CHOPIN RENÉ (1885-1953)
- CHOQUETTE ROBERT GUY (1905-1991)
- GRANDBOIS ALAIN (1900-1975)
- DESROSIERS LÉO-PAUL (1896-1967)
- GUÈVREMONT GERMAINE (1900-1968)
- CHARBONNEAU ROBERT (1911-1967)
- GARNEAU FRANÇOIS XAVIER (1809-1866)
- BROOKE FRANCES (XVIIIe s.)
- CONFÉDÉRATION POÈTES DE LA
- DUNCAN SARA JEANNETTE (1877-1927)
- CALLAGHAN MORLEY (1903-1990)
- FANTASTIQUE LITTÉRATURE
- BOIS, sculpture
- NELLIGAN ÉMILE (1879-1941)
- LOZEAU ALBERT (1878-1924)
- MORIN PAUL (1889-1963)
- SAINT-DENYS GARNEAU (1912-1943)
- ROQUEBRUNE ROBERT DE (1889-1978)
- PANNETON PHILIPPE (1895-1960)
- SAVARD FÉLIX ANTOINE (1895-1982)
- ROY GABRIELLE (1909-1983)
- LEMELIN ROGER (1919-1992)
- MONTPETIT ÉDOUARD (1881-1954)
- MACLENNAN HUGH (1907-1990)
- PEINTURE DU XXe SIÈCLE, de 1900 à 1939
- PEINTURE DU XXe ET DU DÉBUT DU XXIeSIÈCLE, de 1939 à nos jours
- POSTCOLONIALES LITTÉRATURES
- GROVE FREDERICK PHILIP (1879-1948)
- ROSS SINCLAIR (1908-1996)
- MITCHELL WILLIAM ORMOND (1914-1998)
- WATSON SHEILA (1909-1998)
- BUCKLER ERNEST (1908-1982)
- KING THOMAS (1943- )
- WIEBE RUDY (1934- )
- VANDERHAEGHE GUY (1951- )
- JOHNSTON WAYNE (1958- )
- DAVIES ROBERTSON (1913-1995)
- RICHARDS DAVID ADAMS (1950- )
- CLARKE AUSTIN (1932-2016)
- KROETSCH ROBERT (1927-2011)
- URQUHART JANE (1949- )
- HODGINS JACK (1938- )
- CANADIEN THÉÂTRE
- COULTER JOHN (1888-1980)
- HIGHWAY TOMSON (1951- )
- SEARS DJANET
- LUSCOMBE GEORGE (1926-1999)
- REANEY JAMES (1926-2008 )
- SCHAFER MURRAY (1933- )
- FRASER BRAD (1959- )
- JOHNSON PAULINE (1861-1913)
- LIVESAY DOROTHY (1909-1996)
- KLEIN ABRAHAM MOSES (1909-1979)
- PAGE PATRICIA KATHLEEN (1916-2010)
- WEBB PHYLLIS (1927- )
- BOWERING GEORGE (1935- )
- BPNICHOL (1944-1988)
- SURRÉALISME & ART
- CANADA, histoire jusqu'en 1968
- CANADIEN ART
- THÉÂTRE POLITIQUE
- AVANT-GARDE, théâtre
- DESSANE ANTOINE (1826-1873)
- LABELLE JEAN-BAPTISTE (1825-1898)
- SABATIER CHARLES WUGK (1819-1862)
- COUTURE GUILLAUME (1851-1915)
- PENTLAND BARBARA (1912-2000)
- GERMANIA SOCIÉTÉ MUSICALE
- MURRAY ROBERT (1936- )
- GOULET MICHEL (1944- )
- HAYDEN MICHEL (1943- )
- MISE EN SCÈNE, théâtre
- AUTOMATISME, art
- CANADIENNE MUSIQUE
- QUÉBEC, littérature et théâtre
- THÉÂTRE-DOCUMENT
- MAILLET ANTONINE (1929-2025)
- CANADIENNE DE LANGUE ANGLAISE LITTÉRATURE
- JUIVE LITTÉRATURE
- ANGLAISE LITTÉRATURES DE LANGUE
- CANADIENNE DE LANGUE FRANÇAISE LITTÉRATURE
- ROMANTISME ANGLAIS
- HISTORIOGRAPHIE AMÉRICAINE
- PEINTURE DU XIXe SIÈCLE
- ARCHITECTURE DU XIXe SIÈCLE
- MUSIQUE OCCIDENTALE, XVIIe siècle
- MUSIQUE OCCIDENTALE, XVIIIe siècle
- MUSIQUE OCCIDENTALE, XIXe siècle
- MUSIQUE OCCIDENTALE, XXe et XXIe s.
- PEINTURE DU XVIIIe SIÈCLE
- SCULPTURE DU XVIIIe SIÈCLE
- ARCHITECTURE DU XVIIe SIÈCLE
- MODERNISME & POSTMODERNISME, art
- ROMANTISME, littérature
- NÉOPLASTICISME
- ARCHITECTURE DU XXe ET DU XXIe SIÈCLE
- BAROQUE SCULPTURE
- GOODWIN BETTY (1923-2008)
- MCEWEN JEAN (1923-1999)
- LYMAN JOHN (1886-1967)
- LASNIER RINA (1915-1997)
- LANGEVIN ANDRÉ (1927-2009)
- MARTIN CLAIRE FAUCHER dite CLAIRE (1914-2014)
- FILIATRAULT JEAN (1919-1982)
- PARENT ÉTIENNE (1802-1874)
- LEVASSEUR NOËL (1680-1740)
- QUÉVILLON LOUIS (1749-1823)
- BEAUCOURT FRANÇOIS MALEPART DE (1740-1794)
- DULONGPRÉ LOUIS (1754-1843)
- LÉGARÉ JOSEPH (1795-1855)
- PLAMONDON ANTOINE (1804-1895)
- KRIEGHOFF CORNELIUS (1815-1872)
- KANE PAUL (1810-1871)
- CULLEN MAURICE (1866-1934)
- SEPT GROUPE DES
- THOMSON TOM (1877-1917)
- HARRIS LAWREN (1885-1970)
- FORTIN MARC-AURÈLE (1888-1970)
- HÉBERT ADRIEN (1890-1967)
- RÉALISME MAGIQUE
- POLITIQUE CULTURELLE