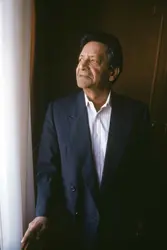CARAÏBES Littératures
Article modifié le
Le terme « Caraïbe » s'est peu à peu imposé pour nommer l'ensemble des îles et des pays qui bordent la mer des Antilles, en particulier lorsqu'il s'agit de désigner les réalisations culturelles de la région. Il tend à remplacer le mot « antillais » qui s'était diffusé au xixe siècle dans un contexte colonial. Renvoyant aux Indiens caraïbes, victimes du génocide lent de la colonisation, il manifeste la volonté d'ancrer la vie culturelle dans les racines les plus profondes des îles.
Si la culture caraïbe originelle n'est plus qu'un objet d'études pour les archéologues, il s'est développé, dans la créolisation de cette partie du monde, un ensemble de cultures très originales aussi bien dans la vie quotidienne (cuisine...) que dans les formes esthétiques (musique, peinture, littérature...). Les littératures, en langues européennes importées mais aussi dans les langues – les créoles – qui se sont développées sur place, apparaissent dès le xviiie siècle. Elles prennent au xixe siècle et surtout au xxe siècle une ampleur considérable. Des mouvements comme la « négritude » ou le « négrisme », le « réalisme magique » ou « merveilleux », la « créolité » connaissent une influence débordant largement la Caraïbe. Le prix Nobel de littérature a récompensé deux grands écrivains caribéens : Derek Walcott (1992) et V. S. Naipaul (2001).
La littérature de langue française
Les origines
Malgré le discrédit que jettent, aux premiers siècles de la colonisation, les créoles expatriés ou les voyageurs sur la vie culturelle aux îles françaises de la Caraïbe (« Les talents n'y sont point connus ; et l'homme de lettres, fût-il créole, y porte un air étranger », écrivait à la fin du xviiie siècle le Guadeloupéen Léonard, installé en France et admiré pour ses Idylles [1766], auxquelles Sainte-Beuve devait reprocher de manquer de couleur locale), il existe, surtout à Saint-Domingue, une importante activité intellectuelle : en témoignent l'existence de cabinets de lecture, la mise en place d'imprimeries (la première en 1763) diffusant des almanachs et des journaux (La Gazette de Saint-Domingue à partir de 1764), la publication de travaux d'érudits locaux, le succès des théâtres (dès 1740 dans la ville du Cap-Français), qui donnent parfois des pièces d'inspiration locale, où l'on fait même une place à la langue créole. Cependant, l'essentiel de la littérature des îles aux xviie et xviiie siècles est constitué de textes écrits par et pour des Français de la métropole : récits de voyage, « relations » des missionnaires, descriptions à visée scientifique. Ces textes, qui opèrent une prise de possession des îles par l'écriture, veulent intéresser leurs lecteurs à ce monde nouveau, voire susciter des vocations coloniales. L'Histoire générale des Antilles habitées par les Français (1667-1671) du père Du Tertre rassemble une documentation qui se veut exhaustive et expose un point de vue « officiel ». Les Nouveaux Voyages aux îles de l'Amérique (1722) du père Labat, plus pragmatiques, agrémentent d'anecdotes souvent savoureuses la peinture des mœurs coloniales. Avec Moreau de Saint-Méry, né à la Martinique, se fait jour le projet d'une encyclopédie du savoir colonial : sa Description[...] de la partie française de l'île de Saint-Domingue (1797) nous donne un inventaire longtemps inégalé des réalités créoles.
La littérature haïtienne
Bien que l'accession à l'indépendance, en 1804, ait bouleversé de fond en comble toutes les structures de l'ancienne colonie de Saint-Domingue, le français est demeuré langue officielle d' Haïti. Sans doute le créole est-il la langue maternelle de la plupart des habitants, mais l'usage du français, langue de grand prestige culturel, devait manifester, aux yeux de l'étranger, le haut degré de civilisation atteint par les Haïtiens. De plus, à l'intérieur du pays, la maîtrise du français constitue l'un des critères d'appartenance à l'élite nationale. Une telle situation ne pouvait que favoriser la pratique littéraire : la production d'Haïti est, proportionnellement, la plus abondante d'Amérique, après celle des États-Unis. Elle est étroitement liée à l'œuvre de construction nationale, et ne peut donc être que patriotique. En même temps, elle est longtemps restée tournée vers la France (et ce tropisme n'a pas complètement disparu), comme pour recevoir sa légitimation d'un pays considéré comme l'arbitre des valeurs littéraires.
Un nationalisme littéraire
Les premiers textes (avec Vastey, Chanlatte ou Colombel) sont donc militants. Ils jouent leur partie dans les conflits pour le pouvoir qui ravagent le jeune État ; surtout, ils défendent l'indépendance de la nation et magnifient les mérites du peuple noir. Le théâtre et les chansons reflètent l'actualité et l'évolution des mœurs (François Lhérison, dans ses Chansons créoles, publiées aux Cayes au milieu du xixe siècle mais aujourd'hui perdues, est sans doute le premier à recourir systématiquement à la langue populaire). La poésie, d'abord classique et élégiaque, s'accorde aux nouveautés du romantisme triomphant ( Coriolan Ardouin et Ignace Nau cultivent leur mélancolie de jeunes gens promis à une mort précoce). Des revues littéraires, comme L'Abeille haytienne de Milscent, fondée en 1817, tentent de durer et de constituer un public littéraire. Le succès des idées romantiques favorise le développement d'un nationalisme littéraire : Émile Nau propose de prendre des distances avec « l'atticisme parisien » et de « naturaliser » le français, « langue quelque peu brunie sous les tropiques ». On se tourne vers l'histoire pour fonder l'identité nationale. Thomas Madiou publie trois volumes d'une Histoire d'Haïti (1847-1848), qui conduisent jusqu'en 1808 et bénéficient de nombreux témoignages oraux. Beaubrun Ardouin les complète et les continue dans ses Études sur l'histoire d'Haïti (1853-1860). Le premier roman haïtien est nécessairement un roman historique : c'est Stella (1859) d'Émeric Bergeaud, qui raconte un épisode des luttes pour l'indépendance. Tout au long du siècle, les écrivains célébreront Haïti comme le pays qui témoigne pour tout le peuple noir. C'est le titre explicite d'un ouvrage d' Hannibal Price publié en 1900 (Réhabilitation de la race noire par la république d'Haïti), de son côté, Anténor Firmin, en 1885, réfute Gobineau (L'Égalité des races humaines). Tout en continuant de suivre les modèles français, la poésie se fait volontiers patriotique, même chez Oswald Durand (1840-1906), très populaire en son temps et pourtant plus à l'aise dans l'aimable mélancolie des chansons créoles (Choucoune), ou dans les poèmes d'amour malheureux parce que traversé par le préjugé de couleur. Tertullien Guilbaud et surtout Massillon Coicou (qui devait mourir fusillé par un peloton d'exécution) sont les maîtres d'une poésie qui cherche à exorciser le déchaînement des guerres civiles. Des romanciers comme Frédéric Marcelin (Thémistocle-Epaminondas Labasterre, 1901) ou Fernand Hibbert (Séna, 1905) font le tableau amusé des mœurs populaires et la satire de la vie politique. Justin Lhérisson donne avec La Famille des Pitite-Caille (1905) un classique de la littérature haïtienne : il innove en empruntant sa forme à l'audience (sorte de palabre de la haïtienne) et sa langue au parler national créole.
L'appel de l'Afrique
L'intervention armée des États-Unis en 1915, qui entraîne l'occupation jusqu'en 1930 et la mise sous tutelle du pays, provoque un choc considérable. Une grave crise intellectuelle et morale ébranle la société haïtienne. Malgré la considération que l'on porte aux poèmes philosophiques d'Etzer Vilaire, malgré le charme des poésies symbolistes de Duraciné Vaval et Damoclès Vieux, l'élite haïtienne éprouve le besoin de rompre avec une tradition culturelle trop française. Infléchissant l'orientation nationaliste de La Ronde, revue qui a marqué les années 1900, La Revue indigène (fondée en 1927) et Les Griots (qui commence à paraître en 1938 et qui évoluera vers le populisme « noiriste » de l'ère Duvalier) soulignent par leurs titres la volonté de se retremper aux sources populaires et africaines. Lancé par Normil Sylvain, contesté par Dantès Bellegarde qui revendique l'appartenance d'Haïti à la culture française, le thème du recours à l'Afrique a trouvé son héraut en la personne du docteur Jean Price-Mars. Ses conférences, réunies en 1928 dans Ainsi parla l'oncle, plaident contre le mépris porté à la langue créole et pour la réhabilitation du vaudou. « Nous n'avons de chance d'être nous-mêmes que si nous ne répudions aucune part de l'héritage ancestral. Eh bien ! cet héritage, il est pour les huit dixièmes un don de l'Afrique. »
Toute une nouvelle littérature haïtienne est née de ces mots d'ordre enthousiastes. La poésie se libère peu à peu : fantaisiste avec Émile Roumer et Léon Laleau, plus engagée avec Carl Brouard et Jean F. Brierre, ouvertement révolutionnaire chez René Bélance et René Depestre (Léopold Sédar Senghor, dans son Anthologie de 1948, accueille avec gourmandise ces jeunes poètes haïtiens chez qui il reconnaît l'inspiration de la négritude). Le roman, qui avait rendu compte du traumatisme de l'occupation américaine (Léon Laleau, Le Choc, 1932), est fortement influencé par le mouvement indigéniste. Jean-Baptiste Cinéas inaugure le roman paysan haïtien (Le Drame de la terre, 1933) ; il s'agit de décrire sans complaisance la vie réelle dans les campagnes, précaire et abrutissante, mais aussi de montrer la subtilité de l'art de vivre paysan (organisation familiale, pratiques collectives du coumbite, vaudou, etc.). Illustré par Maurice Casséus, les frères Pierre et Philippe-Thoby Marcelin (Canapé-Vert, 1944), Félix Morisseau-Leroy (Récolte, 1946), ce genre a produit son chef-d'œuvre avec Gouverneurs de la rosée (1944) de Jacques Roumain, tragédie rurale de la sécheresse et de l'amour contrarié par les haines familiales, transfigurée par une écriture savante et poétique, qui laisse affleurer le créole sous le français.
Un demi-siècle de violences et d'exils
Dans la seconde moitié du xxe siècle, la littérature haïtienne est nécessairement marquée par les périodes de dictature et de violence que traverse le pays. Une répression brutale s'abat à plusieurs reprises sur ceux qui veulent vivre et écrire en hommes libres. Le romancier Jacques-Stephen Alexis meurt sous la torture en 1961. Beaucoup d'Haïtiens – et parmi eux beaucoup d'écrivains – sont acculés à l'exil, au Québec, à New York, à Miami, ou encore à Paris. Certains, comme Edwige Danticat (née en Haïti en 1969 et installée aux États-Unis depuis l'âge de douze ans), choisissent d'écrire dans la langue du pays d'accueil. Mais malgré la saignée opérée par une diaspora régulièrement renouvelée, de nouvelles générations littéraires surgissent au pays même, soutenues par quelques structures tenant bon contre toutes les catastrophes (la revue Conjonction, les éditions Deschamps ou Mémoire...).
Pourtant la situation linguistique d'Haïti reste commandée par l'analphabétisme massif : 10 p. 100 seulement des Haïtiens peuvent maîtriser le français. Les écrivains ont cherché à conquérir un public en donnant au créole un rôle plus important, notamment au théâtre. Ce théâtre en créole adapte des chefs-d'œuvre de la littérature universelle : Antigone (1953) transposé par Félix Morisseau-Leroy ; JénéralRodrig (1973) inspiré du Cid et mis en créole par Nono Numa. Franck Fouché et surtout Frankétienne inventent une dramaturgie créole originale. Les pièces de ce dernier (Troufoban, 1977 ; Pelin Têt, 1978 ; Bobomasouri, 1984 ; Kaselezo, 1985 ; Totolomannwel, 1986) jouent sur le débordement verbal, la force d'une gestuelle ancrée dans la tradition orale et la réactivation des mythes populaires. C'est en français que, dans son exil parisien, Jean Metellus a porté à la scène des moments clés de l'histoire haïtienne : Anacaona(1987) évoque la figure d'une reine amérindienne ; Le Pont rouge (1991) célèbre Dessalines, héros de l'indépendance.
Le renouvellement de la poésie, très net depuis 1962 et la fondation du groupe Haïti littéraire, a puisé sa force dans un dialogue permanent entre français et créole, entre inspiration savante ou surréaliste et ressourcement aux traditions nationales et au concret populaire. Clément-Magloire Saint-Aude (1912-1971) traverse le surréalisme pour aboutir aux poèmes souvent désespérés de Dialogue de mes lampes (édition définitive, 1970). Davertige (Idem et autres poèmes, 1964) et Anthony Phelps (Les Doubles Quatrains mauves, 1995) se replient sur un exil intérieur, dans la recherche de la « couleur humaine de l'œuvre », opposée à la couleur locale. Jean Metellus célèbre lyriquement le paysan haïtien dans Au pipirite chantant (1978). René Depestre a donné dans son Anthologie personnelle (1993) le bilan et l'autocritique d'un itinéraire poétique épousant les contradictions du demi-siècle. Frankétienne, qui se réclame du mouvement du « spiralisme », joue de la déconstruction du langage et des associations libres. Son grand poème Ultravocal (1972) pousse cette recherche à la limite. Georges Castera choisit délibérément d'écrire ses poèmes en créole pour arracher sa langue au folklore.
Dans le prolongement du réalisme social de Jacques Roumain, Jacques-Stephen Alexis (Compère général Soleil, 1955 ; Les Arbres musiciens, 1957) a exploré les voies du « réalisme merveilleux », version haïtienne du « réalisme magique » des écrivains latino-américains de langue espagnole : alliance baroque du mythe et du concret, goût des images vives et d'une écriture virtuose, tropicale, travail sur une langue européenne naturalisée américaine. Cette tendance se prolonge dans les romans de Francis-Joachim Roy (Les Chiens, 1961), de René Depestre (Le Mât de cocagne, 1979 ; Hadriana dans tous mes rêves, 1988), de Jean Metellus, qui développe un cycle autour du lieu magique de sa ville natale, Jacmel (Jacmel au crépuscule, 1981 ; La Famille Vortex, 1982 ; Louis Vortex, 1992), mais qui écrit aussi des « romans européens », mettant au premier plan des personnages qui sont comme coupés du réel (Une eau-forte, 1983 ; La Parole prisonnière, 1986).
Un grand nombre de romans écrits à l'époque de la dictature duvaliériste plongent dans les convulsions de la folie et de la violence (Marie Chauvet, Amour, colère et folie, 1968 ; Anthony Phelps, Moins l'infini, 1972 ; Gérard Étienne, Le Nègre crucifié, 1974 ; Roger Dorsinville, Mourir pour Haïti, 1980). La narration, souvent éclatée, mêle volontiers bouffées de rumeurs populaires, transfiguration du réel par les mythes vaudouisants, délires des personnages. Ainsi dans la turbulence spiraliste de Frankétienne (Dézafi, version créole, adaptée en français sous le titre Les Affres d'un défi, 1979 ; L'Oiseau schizophone, 1993) qui vise à retrouver les mouvements désordonnés d'une foule en fusion. Le spiralisme influence aussi les romans de Pierre Clitandre (Cathédrale du mois d'août, 1982), de Jean-Claude Fignolé (Les Possédés de la pleine lune, 1987 ; Aube tranquille, 1990), de René Philoctète (Une saison de cigales, 1993), de Gary Victor (Clair de mambo, 1990). L'œuvre d'Émile Ollivier, exilé au Québec, tente de débrouiller l'écheveau des rumeurs, des histoires contradictoires et des non-dits pour décrypter l'histoire d'une famille (Mère-Solitude, 1983) ou faire apparaître l'infinie vitalité de la terre haïtienne (Les Urnes scellées, 1995).
Dany Laferrière, lancé par un roman astucieusement provocateur (Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, 1985), a développé en une dizaine de romans fortement autobiographiques une œuvre qui joue sur les allers et retours de la mémoire, de l'exil nord-américain à la terre natale haïtienne (L'Odeur du café, 1991 ; Pays sans chapeau, 1996 ; Le Charme des après-midi sans fin, 1997 ; Le Cri des oiseaux fous, 2000). Jean-Claude Charles explore les détours mentaux d'une errance définitive (Manhattan Blues, 1985), tandis qu'un autre exilé, Louis-Philippe Dalembert (Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, 1996), dit l'impossible retour à l'enfance.
Dans les années 1990, les écrivains restés au pays dressent la carte du désastre. Yannick Lahens interroge à nouveau les déchirures de la société haïtienne (Dans la maison du père, 2000). Lyonel Trouillot (Rue des Pas-Perdus, 1998) invente, dans le télescopage de ses voix narratrices, une « esthétique du délabrement ». Mais faut-il accepter qu'« ici la terreur se perpétue » ?
La littérature en Guadeloupe et en Martinique
À l'inverse d'Haïti, les Antilles françaises ont longtemps connu un désespérant vide culturel. Peu de livres, peu de librairies, peu de bibliothèques. On allait en France poursuivre ses études. Beaucoup d'intellectuels antillais (du poète Léonard au romancier naturaliste Léon Hennique) se sont exilés en Europe, ne gardant au mieux qu'une vague nostalgie de leurs origines créoles. Les premiers essais littéraires antillais, au xixe siècle, sont l'œuvre de Blancs créoles (ou békés) qui écrivent pour vanter les charmes de leur société esclavagiste. Le roman de Prévost de Traversay, Les Amours de Zémédare et Carina (1806), inaugure cette mythologie créole. Les poèmes de Poirié de Saint-Aurèle affirment la prédestination du Noir à la servitude éternelle. Après 1848 et l'abolition de l'esclavage et avec les crises sucrières, la nostalgie de la vie coloniale passée domine l'œuvre des écrivains békés : Rosemond de Beauvallon (Hier, aujourd'hui, demain !, 1885), Drasta Houel (Cruautés et tendresses, 1925). Mais c'est dans les premiers poèmes de Saint-John Perse (originaire de la Guadeloupe et dont la langue intègre de nombreux créolismes de syntaxe et de vocabulaire) qu'il faut trouver le véritable chant de gloire en l'honneur de la vieille société créole.
Les hommes de couleur libres constituent, après l'abolition, une petite bourgeoisie aisée, souvent cultivée, qui entend se démarquer du prolétariat noir libéré et qui choisit donc la voie de l'assimilation. Ses intellectuels prennent pour règle l'imitation des écrivains métropolitains, l'adoption de leur point de vue (même et surtout pour évoquer des réalités antillaises). Ainsi naît et se développe une poésie exotique, avec Daniel Thaly (Lucioles et cantharides, 1900) ou Emmanuel-Flavia Léopold (Adieu foulards, adieu madras, 1930). Leur douceâtre imagerie tropicale permet, lors des fêtes du Tricentenaire du rattachement des Antilles à la France (1935), d'assurer le succès du mythe des « îles heureuses ». Cependant, des poètes comme Gilbert de Chambertrand (Images guadeloupéennes, 1938), ou Gilbert Gratiant (Credo des sang-mêlé, 1961) se démarquent de ce conformisme en se montrant plus attentifs à l'authenticité des mœurs et types antillais. Leur poésie voudrait restituer la saveur particulière du terroir, et, pour ce faire, ils n'hésitent pas à recourir au créole (Fab'CompèZicaque, de Gratiant, 1958).
Une première mise en cause radicale de la tentation de l'acculturation est venue en 1932, avec la publication de la revue-manifeste Légitime Défense. Au nom du marxisme et du surréalisme, de jeunes intellectuels antillais (Étienne Léro, René Ménil, Jules Monnerot) dénonçaient la trahison de la petite bourgeoisie de couleur et récusaient le « doudouisme » et la « littérature de décalcomanie ». Ils appelaient à une prise en compte de l'identité culturelle antillaise et de ses composantes négro-africaines. La leçon devait porter, puisque la publication de Pigments (1937), poèmes du Guyanais Léon Gontran Damas, et du Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, dans la revue française Volontés en 1939, marquait les premiers succès du mouvement de la « négritude ».
La négritude est révolte : refus des facilités de l'exotisme et des complaisances assimilationnistes ; mais aussi exaltation de la souffrance et valorisation de l'homme noir. Elle s'est exprimée dans la revue Tropiques, publiée à la Martinique, sous le régime de Vichy, par Aimé et Suzanne Césaire (« Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre », disait la Présentation du premier numéro en 1941). Aimé Césaire lui a donné pleine ampleur dans son œuvre poétique (Les Armes miraculeuses, 1946 ; Ferrements, 1960 ; Cadastre, 1961 ; Moi, laminaire, 1982) et théâtrale (La Tragédie du roi Christophe, 1963 ; Une saison au Congo, 1963 ; Une tempête, 1970). La négritude s'affirme dans l'œuvre de nombreux poètes : Paul Niger, Guy Tirolien (révélés tous deux dans l'Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Léopold Sédar Senghor en 1948), Georges Desportes (Sous l'œil fixe du Soleil, 1961), Ellie Stephenson (Une flèche pour le pays à l'encan, 1975).
Par sa nature, le roman est moins propre à « pousser le grand cri nègre ». Mais il dénonce le préjugé de couleur, avec Oruno Lara (Questions de couleur : Noirs et Blanches, 1923) et avec Raphaël Tardon, dont La Caldeira (1948) évoque les tensions raciales dans la société de Saint-Pierre à la veille de la catastrophe de la montagne Pelée. Le roman présente un tableau critique des réalités sociales antillaises, avec Léonard Sainville (Au fond du bourg, 1964) et surtout Joseph Zobel, peintre de la vie rurale, sur les plantations de cannes, près de l'usine à sucre (Diab'là, 1946 ; La Rue Cases-Nègres, 1958).
Dans un ouvrage devenu classique (Peaux noires, masques blancs, 1956), le psychiatre Franz Fanon établit un diagnostic sévère de la pathologie psycho-sociale causée par la situation coloniale et la hiérarchie raciale. Avec Les Damnés de la terre (1961), il est devenu le théoricien du Tiers Monde révolutionnaire. De Fanon, Édouard Glissant a retenu l'idée que la communauté antillaise est malade : il faut travailler à la guérir, en analysant les causes du mal, en lui permettant de se réapproprier un espace (la terre antillaise a été accaparée par les colons) et une histoire (la mémoire antillaise est occultée, émiettée, brisée par la faille de la traite et le temps mort de l'esclavage). Les thèses de Glissant, d'abord diffusées dans la revue Acoma (1971-1973), ont été rassemblées, autour du concept d'« antillanité », dans Le Discours antillais (1981). Elles sous-tendent une poésie d'une haute tenue protéiforme, innovatrice, généreuse (Les Indes, 1956 ; Le Sang rivé, 1961 ; Pays rêvé, pays réel, 1985 ; Fastes, 1991), et une œuvre romanesque d'une rare ampleur (La Lézarde, 1956 ; Le Quatrième Siècle, 1962 ; Malemort, 1975 ; La Case du commandeur, 1981), qui cherche à faire flamboyer le « passé frémissant d'un pays réel ».
Dans les dernières décennies du xxe siècle, la vie intellectuelle antillaise évolue vers une prise de conscience plus nette de l'identité et des complexités des îles. Des éditions locales se créent, journaux et revues se multiplient, l'université se développe. Certes, la fascination exercée par la métropole reste encore très forte. Des écrivains comme Raphaël Tardon (Starkenfirst, 1947), Mayotte Capécia (Je suis martiniquaise, 1948), Marie-Madeleine Carbet continuent à revendiquer vivement leur identité française. Un tel sentiment peut être renforcé par l'exil en France d'une partie de la population antillaise, par l'alignement sur le mode de vie et de penser français. Inversement, des écrivains d'origine française enracinent leur œuvre dans une réalité antillaise dont ils adoptent le point de vue : André Schwartz-Bart, La (Mulâtresse Solitude, 1972) ; Salvat Etchart, (Le Monde tel qu'il est, 1967) ; Jeanne Hyvrard (Mère-la-Mort, 1976).) Le retour à l'Afrique, qui avait été inauguré dès 1921 par René Maran, d'origine guyanaise, dans Batouala, roman qui obtint le prix Goncourt, aboutit souvent à un échec (Maryse Condé, Heremakhonon, 1976 ; Myriam Warner-Vieyra, Juletane, 1982).
L'évocation romanesque de la situation coloniale et de ses retentissements sur la vie personnelle des individus nourrit les romans de Bertène Juminer (Les Bâtards, 1961), de Michèle Lacrosil (Demain, Jab-Herma, 1967), de Vincent Placoly (L'Eau-de-mort guildive, 1973), qui s'oriente vers une écriture de la violence et de la folie. Simone Schwarz-Bart déroule dans Pluie et vent sur Télumée Miracle (1972) la généalogie d'une lignée de femmes guadeloupéennes et compose une admirable défense et illustration de la culture créole. Dans Ti-Jean L'horizon (1979), elle plonge dans le merveilleux des contes pour construire une sorte d'inventaire de l'imaginaire antillais. Xavier Orville joue lui aussi sur le registre du conte pour dérouler des histoires fugitives, qu'il invente au plaisir des mots et des images (Le Marchand de larmes, 1985).
Maryse Condé revient aux îles et à l'Amérique dans les romans de sa maturité (Moi, Tituba sorcière, 1986 ; La Vie scélérate, 1987 ; Traversée de la mangrove, 1989 ; La Colonie du Nouveau Monde, 1993 ; Desirada, 1997 ; La Belle Créole, 2003) : ce sont des fresques familiales où, paradoxalement, la famille n'est pas un point d'ancrage, où les personnages semblent, comme la romancière, voués à une errance continuelle. Daniel Maximin laisse dériver ses textes (L'Isolé Soleil, 1981 ; Soufrières, 1987 ; L'Île et une nuit, 1995 ; Tu, c'est l'enfance, 2004) au gré des alliances de mots, des éruptions d'images, des ruptures heureuses de construction.
La créolité
Les Martiniquais Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant élaborent une théorie de la culture créole, lancée par leur Éloge de la créolité (1989). La créolité procède de la rencontre aux îles d'hommes apportant des éléments culturels de tous les horizons, qui se métissent et qui inventent, dans la résistance à l'oppression coloniale et à l'esclavage, une culture nouvelle, imprévue, bien vivante. La langue créole est la pierre de touche de la créolité : c'est elle qui porte la voix populaire des conteurs, celle que les écrivains de la créolité veulent faire entendre à l'intérieur même de leur écriture en français.
Auteur prolifique, Patrick Chamoiseau se veut d'abord un « marqueur de paroles », celui qui capte la parole vivante, les rumeurs populaires, les jeux verbaux du créole. Son œuvre commencée avec Chronique des sept misères (1985) et Solibo Magnifique (1988), couronnée par le prix Goncourt avec Texaco en 1992, s'est continuée, après un détour par les souvenirs d'enfance (Antan d'enfance, 1990 ; Chemin d'école, 1994 ; À bout d'enfance, 2005), par un récit symbolique (L'Esclave vieil homme et le molosse, 1997) et surtout par une œuvre d'une ampleur démesurée, mêlant les tons et les genres, Biblique des derniers gestes (2002). Non moins prolifique, Raphaël Confiant, qui avait d'abord écrit en créole (Marisosé, 1987), a adopté lui aussi une écriture où le créole vient habiter le français. Ses romans et récits (Le Nègre et l'amiral, 1988 ; Eau de café, 1991 ; Commandeur du sucre, 1994 ; L'Allée des soupirs, 1994 ; L'Archet du colonel, 1998 ; Le Cahier de romances, 2000 ; Brin d'amour, 2001 ; Adèle et la pacotilleuse, 2005) constituent une fresque de l'histoire antillaise, non pas composée et structurée à la manière de Martin du Gard ou de Jules Romains, mais foisonnante dans la prolifération verbale, l'entassement des anecdotes et des discours. Gisèle Pineau (La Grande Drive des esprits, 1993 ; L'Espérance-Macadam, 1995 ; L'Âme prêtée aux oiseaux, 1998 ; Chair piment, 2002) a donné une voix féminine à cette écriture de la créolité, tandis qu'Ernest Pépin, autant poète que romancier, débride un imaginaire hypersexualisé (L'Homme-au-bâton, 1992) ou capte le langage du tambour créole (Tambour-Babel, 1996).
Le mouvement de la créolité doit beaucoup à l'influence d'Édouard Glissant, même si celui-ci lui oppose le terme de « créolisation », qui insiste davantage sur le processus en mouvement et la mise en relation. Sa pensée a évolué, comme l'a montré l'inflexion de ses romans (Mahagony, 1987 ; Tout-Monde, 1993 ; Sartorius, 1999) et surtout la publication d'une série d'essais (Poétique de la relation, 1990 ; Faulkner, Mississippi, 1996 ; Traité du Tout-Monde, 1997). À l'identité-racine, monolithique, raciale ou nationale, il oppose l'identité-rhizome, se développant dans la diversité de la relation. Sa « poétique de la relation », dont le monde créole lui fournit le modèle, propose ouverture et libération, « une dimension inédite qui permet à chacun d'être là et ailleurs, enraciné et ouvert, [...] en accord et en errance ».
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Pierre DURIX : professeur émérite, université de Bourgogne, Dijon
- Claude FELL : professeur émérite à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle
- Jean-Louis JOUBERT : professeur à l'université de Paris-XIII
- Oruno D. LARA : professeur d'histoire, directeur du Centre de recherches Caraïbes-Amériques
Classification
Médias
Autres références
-
AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie
- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE
- 24 173 mots
- 23 médias
...d'années, a séparé les continents du Gondwana et de la Laurasia, dont l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord restaient respectivement parties intégrantes. C'est cette histoire qui détermine une première fois un domaine caraïbe jurassique, d'où vont naître des chaînes dont la logique et la structure sont... -
AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géographie
- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER , Danièle LAVALLÉE et Catherine LEFORT
- 18 110 mots
- 9 médias
...des influences adoucissantes et régulatrices du Pacifique, aux latitudes tempérées où la circulation atmosphérique se fait normalement d'ouest en est. Dans l'étroit cordon isthmique de l'Amérique centrale, et surtout dans les Antilles, où prédominent les vents alizés soufflant du nord-est,... -
ANTIGUA-ET-BARBUDA
- Écrit par Encyclopædia Universalis , Janet D. MOMSEN , David Lawrence NIDDRIE et Richard TOLSON
- 1 139 mots
- 3 médias
Antigua-et-Barbuda est un État insulaire indépendant (78 200 hab. en 2006) des Caraïbes orientales, situé dans l'archipel des Petites Antilles, à la pointe sud des îles Sous-le-Vent. Il possède une dépendance, le petit îlot inhabité de Redonda. Antigua-et-Barbuda, dont la capitale...
-
ANTILLES NÉERLANDAISES
- Écrit par Encyclopædia Universalis et Jean-Claude GIACOTTINO
- 468 mots
Formée en 1854, la fédération des Antilles néerlandaises constituait, dans la mer des Caraïbes, un État autonome associé aux Pays-Bas jusqu’à sa dissolution, décidée le 15 décembre 2008 et effective depuis le 10 octobre 2010.
Un ensemble de six îles étaient regroupées sous...
- Afficher les 56 références
Voir aussi
- INDES OCCIDENTALES FÉDÉRATION DES (1958-1962) ou WEST INDIES
- HISPANO-AMÉRICAINE LITTÉRATURE
- POSTCOLONIALES LITTÉRATURES
- FRANKÉTIENNE FRANCK ETIENNE dit (1936-2025)
- CONFIANT RAPHAËL (1951- )
- CRÉOLITÉ
- VALDÉS ZOÉ (1959- )
- GRANGER JAMES (1721-1767)
- PHILLIPS CARYL (1958- )
- TROUILLOT LYONEL (1956- )
- CRÉOLE
- VELOZ MAGGIOLO MARCIO (1936- )
- CABIYA PEDRO (1971- )
- HERNÁNDEZ RITA INDIANA (1977- )
- PORTELA ENA LUCÍA (1972- )
- CLIFF MICHELLE (1946-2006)
- DANTICAT EDWIGE (1969- )
- SCOTT LAWRENCE (1943- )
- D'AGUIAR FRED (1960- )
- LÉONARD NICOLAS GERMAIN (1744-1793)
- MILSCENT JULES SOLIME (1778-1842)
- NAU IGNACE (1813-1845)
- PRICE HANNIBAL (1841-1893)
- PRICE-MARS JEAN (1876-1969)
- VILLAVERDE CIRILO (1812-1894)
- NÉGRISME
- ARDOUIN CORIOLAN (1812-1836)
- ARDOUIN BEAUBRUN (1796-1865)
- CINÉAS JEAN-BAPTISTE (1895-1958)
- EXOTISME, littérature
- HEREDIA JOSÉ MARIA (1803-1839)
- DUTERTRE père (XVIIe s.)
- ESPAGNOLE LITTÉRATURE, XIXe, XXe et XXIe s.
- ANGLAISE LITTÉRATURES DE LANGUE
- CUBAINE LITTÉRATURE
- CARAÏBES ou ANTILLES LITTÉRATURES DES
- MITTELHOLZER EDGAR AUSTIN (1905-1965)
- CESTERO TULIO M. (1877-1955)
- LISSER HERBERT G. DE (1878-1944)
- NUGENT MARIA lady (1771-1834)
- SCHWARZ-BART SIMONE (1938- )
- BERGEAUD ÉMILE (1818-1858)
- DURAND OSWALD (1840-1906)
- GALVÁN MANUEL DE JESÚS (1834-1910)
- LHÉRISSON JUSTIN (1873-1907)
- MADIOU THOMAS (1814-1884)
- NAU ÉMILE (1812-1860)
- ROUMAIN JACQUES (1907-1944)
- ROMANTISME, littérature
- INDIGÉNISME, littérature
- ALVAREZ JULIA (1950- )
- SÁNCHEZ LUIS RAFAEL (1936- )
- TRIANA JOSÉ (1931-2018)