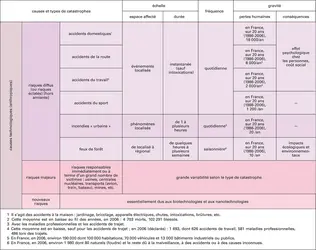CATASTROPHES
Article modifié le
La prise de risque
La prise de risque suppose une bonne perception du risque et s'appuie sur la fiabilité, ou non, de la prévision de tel ou tel événement. L'avis du scientifique est toujours sollicité mais non déterminant, car d'autres critères, en particulier économiques, influent sur les prises de décision des autorités responsables.
Les prises de risque individuelles peuvent être d'ordre sociologique (alcoolisme, tabagisme, accidents de la route, etc.), et correspondent à des réalités personnelles. Mais d'autres sont directement liées à l'obligation de survie, notamment dans les régions particulièrement pauvres. Les cendres déposées après une éruption volcanique explosive ou les limons amenés par de redoutables inondations constituent les terres les plus fertiles : les populations reviennent s'installer après les désastres, malgré une bonne perception des risques encourus. Le Bangladesh, pays de mousson, est situé au pied des montagnes les plus hautes du monde (forte hydrographie) et au ras de l'eau. À chaque arrivée de cyclone (1,5 par an), la montée des eaux marines, due aux baisses de pression atmosphérique, et les précipitations inondent de 20 à 60 p. 100 de ce pays, provoquant des dizaines de milliers de victimes. Dès qu'une nouvelle île naît du delta après une inondation, des familles s'y installent, en attendant d'être balayées par un prochain cataclysme. Ont-elles le choix ?
Les prises de risque collectives, concernant essentiellement les risques majeurs, ne s'embarrassent que très inégalement de l'opinion publique. Dans le cas des séismes, si la perception du risque est bien réelle, la prévision de ces événements est quasi nulle. Pour la plupart, on connaît les zones où ils risquent de se produire, mais on ne peut pas dire quand. La seule approche fiable s'établit sur les grandes failles tectoniques le long desquelles les portions où il ne s'est pas produit encore de séisme, c'est-à-dire là où les contraintes accumulées par les confrontations des plaques lithosphériques ne se sont pas encore libérées, sont les plus menacées sismiquement. San Francisco (plus de 7 millions d'habitants pour la métropole formée avec Oakland et San José) est établie sur la faille de San Andreas, la plus surveillée au monde. Imaginons que les scientifiques parviennent à prévoir la survenue d'un séisme avec une fourchette de ± 3 jours. On évalue (cf. C. Allègre, Les Fureurs de la Terre, 1987) le coût d'une évacuation totale – arrêt de travail, évacuation, encadrement, logistique, etc. – à 2 milliards de dollars par jour. Les autorités sont aujourd'hui formelles : on n'évacue pas, le coût économique est trop élevé. Autre exemple et autre lieu : Haicheng, en Chine. En janvier et début février 1975, plusieurs signes (variations du champ magnétique, du niveau de l'eau des puits, comportements étranges des animaux, etc.) incitent les sismologues à alerter les autorités de l'imminence d'un séisme. Celui-ci eut lieu dans la nuit du 4 au 5 février et détruisit la ville de Haicheng : aucune victime ne fut à déplorer, car 3 millions de personnes avaient été évacuées deux jours plus tôt. Dix-huit mois plus tard, à 300 km à l'ouest de Haicheng, un séisme, que ni les poules, ni les poissons rouges, ni les sismologues n'avaient pressenti, fit de 300 000 à 1 million de morts (selon les sources). On voit bien les différences qui déterminent la prise de risque entre ces deux grandes nations que sont les États-Unis et la Chine : San Francisco est largement construite en parasismique (on estime cependant qu'il y aurait quelques dizaines de milliers de morts en cas de Big One) et le coût est essentiellement économique dû aux cessations d'activité et à l'évacuation ; en Chine les pertes humaines et les dégâts sont généralement importants, le coût économique plus faible, l'évacuation des populations plus disciplinées se fait sans panique (et les pillages sont moindres). Dans tous les cas, ce type de prise de risque collectif se fait d'autorité.
Autre cas, les éruptions volcaniques explosives. Leur cause est simple. Plus un magma est riche en silice, plus sa viscosité est grande : il remonte lentement dans la cheminée du volcan et, ayant le temps de se refroidir, y forme un bouchon. Les gaz dissous dans le magma s'accumulent dans la chambre jusqu'à ce que la pression soit suffisamment importante pour pulvériser le bouchon : c'est l'éruption explosive qui caractérise les volcans de zone de subduction. En effet, leur magma est dû à la fusion de la plaque plongeante et de la croûte continentale, riche en silice. On connaît donc les lieux de ces volcans dangereux ; ils se répartissent principalement sur la « ceinture de feu » circumpacifique, de la cordillère des Andes aux Aléoutiennes, des Kouriles à l'Indonésie. On sait aussi à présent relativement bien prévoir une éruption volcanique à quelques jours près (séismes synchrones des bouffées magmatiques, épanchements de surface, gonflement du volcan, anomalies thermiques et gravimétriques...). Des cartes des risques permettent de prévoir la trajectoire des coulées (laves ou boues), les lieux de retombées des blocs et des cendres, les couloirs des nuées ardentes, etc. On réunit donc une bonne perception du risque et une bonne prévision ; de plus, généralement, les densités de population sont limitées (sauf dans quelques lieux comme autour du Vésuve à Naples). Dans ce cas-là, il est délicat de parler de prise de risques ; il s'agit plutôt, en cas d'inaction, d'une non-réceptivité des autorités aux alertes des scientifiques et d'un fatalisme ancestral des populations où se mêlent culture, mythologie et refus de quitter le sol nourricier. Le défi pour les scientifiques est de convaincre les autorités de décider l'évacuation et les populations de se laisser évacuer. Ainsi, le 13 novembre 1985, l'éruption du Nevado del Ruiz (Colombie) fit fondre une partie de son glacier sommital, lequel, dans une gigantesque coulée de boue et de blocs, engloutit une partie de la ville d'Armero et 22 000 de ses habitants. La carte des risques avait été bien établie, les autorités locales averties de l'imminence du risque, mais le volcan a pris les hommes de vitesse. Le 19 avril 2007, même scénario, mais cette fois-ci c'est l'éruption du Nevado del Huila (proche du del Ruiz) qui génère une coulée de boue et de pierres, provoquant de nombreux dégâts (habitations, cultures) mais aucune victime (environ 10 000 personnes évacuées). De même, le 15 juin 1991, la nuée ardente qui s'abattit du Pinatubo (Philippines) aurait pu faire de 10 000 à 20 000 victimes si la population n'avait été évacuée par les autorités, grâce aux prédictions des géologues et, aussi, à la force des images d'une cassette vidéo réalisée par le volcanologue Maurice Krafft, commandée par l'U.N.E.S.C.O. pour inciter à ce type de décision. Ironie du sort, quelques jours plus tôt, sur les pentes du mont Unzen (Japon), Katia et Maurice Krafft avaient trouvé la mort, comme 39 autres personnes dont une majorité de journalistes, victimes d'une nuée ardente.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Yves GAUTIER
: docteur en sciences de la Terre, concepteur de la collection
La Science au présent à la demande et sous la direction d'Encyclopædia Universalis, rédacteur en chef de 1997 à 2015
Classification
Médias
Autres références
-
MCDONNELL JAMES SMITH JR. (1899-1980)
- Écrit par Bernard MARCK
- 1 240 mots
En 1974, le constructeur américain doit surmonter la crise provoquée par lacatastrophe d’Ermenonville (Oise) : le 3 mars, un DC-10 de la compagnie Turkish Airlines s’écrase, provoquant la mort des trois cent quarante-six occupants. Une autre tragédie se produit le 25 mai 1979 : un DC-10-10 d’American... -
TRAUMATISME PSYCHIQUE
- Écrit par Hélène THOMAS
- 1 221 mots
...conscience que, lors d'un conflit, c'est toute une population qui est concernée et pas seulement les soldats. Par ailleurs, la prise en compte des catastrophes « civiles », telles que les tremblements de terre, les inondations ou les prises d'otages, s'est révélée très importante pour la recherche...
Voir aussi
- ACCIDENTS
- SÉCURITÉ
- ACTION HUMANITAIRE
- CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES
- PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE
- PINATUBO, volcan
- PRÉVISION ET PRÉDICTION DES SÉISMES
- INTRODUCTION D'ESPÈCES
- SÉCURITÉ SANITAIRE
- CATASTROPHES NATURELLES
- FAILLE DE SAN ANDREAS
- PRÉVENTION
- FAILLES
- PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PED)
- DÉFAILLANCES ARBRE DES ou ARBRE DES ÉVÉNEMENTS
- INVS (Institut national de veille sanitaire)
- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE
- RISQUES SANITAIRES
- ÉPIDÉMIES
- CENTRALE NUCLÉAIRE
- NAVETTE SPATIALE
- ACCIDENTS NUCLÉAIRES
- TRANSPORT & TRAFIC MARITIMES
- TRANSPORT & TRAFIC AÉRIENS
- ASTRONAUTIQUE, histoire
- SECOURS SANITAIRES
- MÉDECINE PRÉVENTIVE ET PRÉVENTION MÉDICALE
- SÛRETÉ NUCLÉAIRE
- TCHERNOBYL
- RISQUES NATURELS
- RISQUES TECHNOLOGIQUES
- ÉRUPTIONS VOLCANIQUES EXPLOSIVES