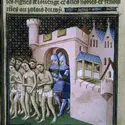CATHARES
Article modifié le
D'origine grecque, le vocable « cathare » (καθαρ́ος, pur) désigne les hérétiques dualistes qui se manifestèrent en Occident dans la seconde moitié du xiie siècle. Le plus ancien document où il apparaît est un acte de Nicolas, évêque de Cambrai (1164-1167), qui enregistre la condamnation portée par les évêques de Cologne, Trèves, Liège, entre 1151-1152 et 1156, contre un clerc, Jonas, « convaincu de l' hérésie des cathares ». Dans ses sermons visant les hérétiques rhénans (1163), Eckbert, abbé de Schönau, leur reproche d'avoir « eux-mêmes assumé cette appellation de purs ». À l'inverse, le théologien Alain de Lille ironise sur l'étymologie latine du nom (catus, chat) « parce qu'ils baisent le postérieur d'un chat en qui leur apparaît Lucifer ». Ce sont les « sectateurs du chat », les « chatistes, dirions-nous », commente de nos jours avec conviction un ingénieux polémiste. L'Église médiévale les traite d'ariens, de manichéens, sans pouvoir, à l'origine, définir leur doctrine.
Le dualisme et les Églises
Pour les cathares, le problème crucial est celui du mal, qu'on trouve dans l'univers rempli de créatures vaines et corruptibles, et qu'ils ne peuvent imputer à Dieu. Leur foi repose sur la conviction commune que ce monde visible et tout ce qu'il renferme est l'œuvre du diable. Selon le traité de Bartholomé de Carcassonne, « il y a un autre monde formé de créatures incorruptibles et éternelles ». L'existence des deux royaumes leur fait présumer l'existence de deux principes. Les uns, modérés, proches du monothéisme, croient en un seul Dieu, bon, tout-puissant, éternel, créateur des anges et des quatre éléments qu'il a permis à Satan, ange rebelle, d'organiser. Les autres, d'opinion radicale, croient en deux principes absolus, rivaux, le bon et le mauvais, également créateurs et éternels. Cette opposition de croyance, foncière à l'origine, détermine dans le monde cathare trois ordres distincts : modéré de Bulgarie, absolu de Dragovitza et nuancé de Slavonie.
À l'origine, selon l'inquisiteur Anselme d'Alexandrie, l'hérésie s'est répandue en Drugonthie, Bulgarie, Philadelphie, sous la direction de trois évêques. En Bulgarie, des marchands grecs de Constantinople, venus pour affaires, contractent l'erreur, qu'ils propagent ensuite, de retour chez eux. Au cours de la deuxième croisade (1147), des Francigènes rencontrent à Constantinople des représentants de l'ordre de Bulgarie, dont ils adoptent la doctrine modérée, et s'organisent en Église. Retournant en France, ces hérétiques y instituent un évêque de France. Ils influencent au sud de la Loire les provinciales, qui embrassent leurs idées et créent à leur tour quatre évêques : de Carcassonne, Albi, Toulouse et Agen. Leur rayonnement s'étend jusqu'en Lombardie.
C'est tout ce réseau franco-italien, d'ordre bulgare, que Papaniquintas ( Niquinta, Nicetas), évêque ou pape des hérétiques de Constantinople, vient, vers 1176, convertir à son dualisme absolu (de Dragovitza). Il préside en Lauragais, au château de Saint-Félix de Caraman, près de Toulouse, une assemblée de cathares albigeois et italiens. Les actes de ce concile, publiés au xviie siècle d'après une copie de 1232 – d'authenticité controversée –, rigoureusement examinés en 1946 par A. Dondaine, qui a découvert ensuite d'autres sources les corroborant, ont fait l'objet d'une édition critique par F. Šanjek ; B. Hamilton est venu depuis lors en renouveler l'intérêt et en rectifier la date (env. 1176). L'énoncé de cette charte permet de connaître l'expansion de l'hérésie cathare aux xiie-xiiie siècles.
Six Églises sont représentées à Saint-Félix : celles des Francigènes au nord de la Loire, d'Albi au sud, avec leurs évêques Robert d'Épernon et Sicard Cellerier. celle de lombardie, que dirige Marc ; et les conseils des Églises de Toulouse, Carcassonne, Aran (Agen), qui réclament et élisent chacun leurs chefs respectifs. Voulant rattacher ces Églises au dualisme absolu, Niquinta confère à tous le consolamentum de son ordre. Il consacre ensuite et renouvelle dans leurs fonctions épiscopales Robert d'Épernon et Sicard Cellerier ; il titularise Marc, évêque de Lombardie, et consacre les trois dignitaires élus : Bernard-Raimond à Toulouse, Guiraud-Mercier à Carcassonne, Raimond de Casals à Agen. Prônant l'exemple des sept Églises d'Asie qui, distinctes et circonscrites, vivent dans la concorde, Niquinta propose de fixer les limites territoriales des diocèses languedociens, pour faciliter la paix entre eux. Avant la fin du xiie siècle, près d'une vingtaine d'Églises cathares se trouvent disséminées au nord du bassin méditerranéen, du Languedoc au Proche-Orient. La Summa de Raynier Sacconi (1250), ancien hérétique devenu frère prêcheur et inquisiteur, confirme ces données, que renforce plus tard le Traité d'Anselme d'Alexandrie (vers 1270).
Les Églises languedociennes restent fidèles aux instructions de Niquinta et vivent en bons termes. On signale toutefois le cas d'un habitant de Castelnaudary, Ponce de Gibel, qui, tombé malade à Narbonne (1226), refuse le secours de deux dignitaires « qui n'étaient pas de la foi des hérétiques de Toulouse ». Mais c'est là un fait exceptionnel. L'hérésie prospère au point que, dans le Razès, les adeptes, partagés entre les Églises de Toulouse et de Carcassonne, réclament un évêque particulier. En 1225, les chefs cathares se réunissent en concile à Pieusse, près de Limoux. À l'unanimité, ils délimitent le nouveau diocèse, élisent un membre du Razès, Benoît de Termes, selon la procédure pratiquée à Saint-Félix et confient à l'évêque de Toulouse le soin de consacrer le nouvel élu. Dès leur origine et depuis près d'un demi-siècle, la paix règne entre les Églises du Languedoc, selon le vœu de Niquinta. Tout le long de l'histoire albigeoise, pendant la croisade, la persécution ou l'exil, aucune ombre ne viendra jamais la ternir.
En Italie, au contraire, apparaissent bientôt des germes de dissension qui provoquent six factions cathares. L'Église de Desenzano, au bord du lac de Garde, groupe les Albanenses, apparentés aux Églises narbonnaises qui, lors de l'Inquisition, vont essaimer et trouver refuge à Vérone, d'où le nom en Lombardie, d'Ecclesia Francie. Rivale de la première, l'Église de Concorezzo, au nord de Milan, l'emporte par le nombre de ses adhérents qui étaient attachés à l'ordre bulgare modéré et qui s'appelaient d'abord Garatenses, de Garattus, nom d'un de leurs premiers évêques. Des liens amicaux l'unissent à l'Église de Mantoue-Bagnolo (ou Baiolo), de même tendance mais de rite lavon. Tout proche, le centre de Vicence se réclame des mêmes directives, qu'il abandonne au milieu du xiiie siècle pour suivre les Albanenses. Cette Église mineure de la Marche et celles de Toscane (Florence et val de Spolète), restent assez indéterminées et oscillent entre les deux obédiences. Primitivement orientées vers l'ordre bulgare, à la fin du xiie siècle, comme leurs voisines dalmates, dont elles ont reçu le rite slave, elles durcissent peu à peu leur attitude, remarque Raynier Sacconi en 1250. Malgré la diversité de leurs opinions, ces Églises entretiennent entre elles de bons rapports, à l'exception des Albanenses et des Concorezenses, qui se condamnent mutuellement. Toutefois, vers 1230, les Albanenses sont divisés par le schisme de Jean de Lugio, originaire de Bergame, fils majeur ordinatus episcopus de Belesmanza de Vérone. On lui doit un grand traité, que Sacconi a eu entre les mains, qui est aujourd'hui égaré et qu'un de ses disciples a résumé comme Livre des deux principes. Leurs rivaux de Concorezzo connaissent aussi la division, qui est ignorée en 1250 de Raynier Sacconi, mais que révèle son confrère Anselme d'Alexandrie en 1270. Desiderius, fils majeur, et ses disciples s'opposent à l'évêque Nazaire et à ses partisans, fidèles au docétisme inspiré de l'Interrogatio Iohannis, que détient le prélat. Desiderius serait mort en 1235.
À ces Églises franco-italiennes, il faut ajouter les foyers promoteurs des Balkans et d'Orient. Tout d'abord, celui de Bulgarie, qui s'étend en Macédoine et en Bulgarie occidentale, avec une branche latine à Constantinople. Il est à l'origine des dualistes : francigènes, provinciales, de Concorezzo, slavons et rhénans. L'ordre de Dragovitza, implanté en Languedoc-Lombardie par Niquinta de Constantinople, se situe en partie en Macédoine, mais surtout il s'incruste en Thrace, aux alentours de Philippopolis, où il a subi l'influence paulicienne. L'Église de Romanie rayonne dans l'Empire byzantin et en Asie Mineure, peut-être à Philadelphie en Lydie ; celle de Mélenguie, difficile à identifier, aurait eu pour centres Melnik et Moglena. La dernière Église citée au concile de Saint-Félix-de-Caraman, celle de Dalmatie, sur le littoral croate, se répand ensuite à l'intérieur dans les régions de Bosnie et de Slavonie. Au milieu du xiiie siècle, Raynier Sacconi énumère toutes les Églises comme des centres actifs de propagande dualiste.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Christine THOUZELLIER : directeur d'études à l'École pratique des hautes études (Ve section)
Classification
Médias
Autres références
-
ALBIGEOIS (CROISADE CONTRE LES)
- Écrit par Jacques LE GOFF
- 4 153 mots
- 2 médias
Le terme « albigeois » a servi, dès le milieu du xiie siècle, à désigner les hérétiques du Languedoc, bien que l'Albigeois ne paraisse pas, aux yeux des historiens modernes (qui ont continué à user de cette appellation devenue traditionnelle), avoir été le principal foyer de l' ...
-
CROISADE CONTRE LES ALBIGEOIS - (repères chronologiques)
- Écrit par Laurent ALBARET
- 748 mots
1145 Le cistercien Bernard de Clairvaux organise une mission de prédication à Toulouse et dans l'Albigeois. Il découvre à Verfeil une dissidence religieuse qui revendique une filiation apostolique et rejette les sacrements de l'Église. Il la nomme l'hérésie des « albigeois »....
-
DOMINIQUE saint (1170 env.-1221)
- Écrit par Sebastian BULLOUGH
- 826 mots
Fondateur de l'ordre des Frères prêcheurs (Dominicains), Domingo de Guzmán est né vers 1170 à Caleruega (Castille), dans une famille noble. Il étudie la théologie à Palencia. Vers 1196, il entre comme chanoine dans le chapitre du diocèse d'Osma, dont il devient le sous-prieur quelques années plus tard....
-
LANGUEDOC, histoire
- Écrit par Jean SENTOU
- 2 167 mots
- 1 média
...troubadours et les sculptures romanes (Saint-Sernin de Toulouse et abbaye de Moissac). Alors naît une civilisation languedocienne vraiment originale, avec le développement du catharisme, religion populaire, ignorant le latin, s'efforçant de retrouver la pureté de l'Église primitive avec la vie exemplaire des... - Afficher les 10 références
Voir aussi
- PERSÉCUTIONS RELIGIEUSES
- MÉTEMPSYCOSE ou MÉTEMPSYCHOSE
- CHRISTOLOGIE
- APOCRYPHES DE L'ANCIEN TESTAMENT
- APOCRYPHES DU NOUVEAU TESTAMENT
- CONSOLAMENTUM
- NICÉTAS ou NIQUINTA (2e moitié XIIe s.)
- DRAGOVITSA ORDRE DE
- ALBANENSES
- DESENZANO ÉGLISE DE
- CONCOREZZO ÉGLISE DE
- JEAN DE LUGIO
- PARFAIT
- MÉDIÉVALES PHILOSOPHIES & THÉOLOGIES, jusqu'au XIIe siècle
- RITES SACRÉS
- MÉDIÉVALES PHILOSOPHIES & THÉOLOGIES, du XIIIe au XVe s.