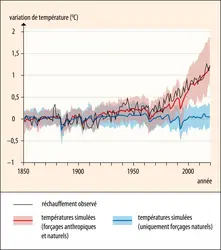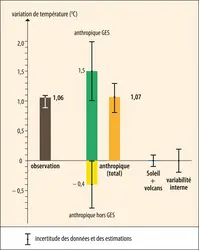- 1. Comment a-t-on pris conscience de l’effet de l’homme sur le climat global ?
- 2. L’homme a-t-il déjà influencé le climat global ?
- 3. Quelle pourrait être l’ampleur des changements climatiques futurs ?
- 4. Comment le changement climatique affecte-t-il les sociétés humaines et les écosystèmes ?
- 5. Comment limiter les changements climatiques futurs ?
- 6. Comment s’adapter à ce changement climatique ?
- 7. Bibliographie
- 8. Sites internet
CHANGEMENT ANTHROPIQUE DU CLIMAT
Article modifié le
L’homme a-t-il déjà influencé le climat global ?
La température de surface de la Terre a toujours connu des fluctuations. Cette température s’ajuste de sorte que l’énergie que la Terre gagne par absorption du rayonnement solaire soit égale à l’énergie qu’elle perd par émission de rayonnement infrarouge vers l’espace. Le rayonnement solaire absorbé dépend du rayonnement émis par le Soleil, de la façon dont la Terre l’absorbe et le réfléchit, et de la distance Terre-Soleil. L’émission du rayonnement infrarouge dépend de la température de la Terre ainsi que de l’effet de serre auquel différents gaz contribuent même si ceux-ci sont présents à de faibles concentrations (moins de 1 %). Les principaux gaz à effet de serre sont, par ordre d’importance : la vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’ozone (O3), le méthane (CH4).
Perturbations anthropiques
La concentration de l’atmosphère en CO2 est mesurée directement depuis la fin des années 1950 par prélèvement continu de l’air sur quelques sites, ces données étant complétées par des mesures satellitaires depuis les années 1990. Elle est passée de 315 parties par million en volume (ppmv ; ici, nombre de molécules de CO2 par million de molécules d’air) en 1958 à 415 ppmv en 2020. Elle est quasi uniforme sur toute la surface du globe et sur l’épaisseur de l’atmosphère. L’analyse de bulles d’air piégées dans la glace permet de remonter plus loin dans le temps et d’estimer la concentration en CO2 à différentes époques. Celle-ci a varié entre 280 et 300 ppmv au cours des 800 000 dernières années et était de 280 ppmv au début de l’ère industrielle (vers 1850). Il faut remonter au Pliocène (entre 5,3 et 2,5 millions d’années) pour retrouver des concentrations de CO2 comparables à celles d’aujourd’hui. Plusieurs méthodes (composition isotopique du carbone dans l’air, différence interhémisphérique de la concentration en CO2, estimation des différents flux de carbone, etc.) permettent de montrer sans ambiguïté que l’accroissement depuis le milieu du xixe siècle est principalement dû à la combustion d’énergies fossiles du fait des activités humaines. Environ la moitié du CO2 émis a été absorbée par l’océan et par les plantes, autrement dit l’augmentation de la concentration en CO2 serait double si ces « puits » naturels – qui stockent une partie du carbone émis – n’existaient pas. Le déséquilibre énergétique, appelé forçage radiatif, dû à cet accroissement en CO2 depuis le début de l’ère industrielle, est de 2,1 watts par mètre carré (W·m-2). C’est la plus importante des perturbations dues aux activités humaines.
Pour les autres gaz à effet de serre, la mesure du forçage radiatif pour la même période donne les valeurs suivantes : 0,55 W·m-2 pour le méthane ; 0,4 W·m-2 pour les halocarbones ; 0,4 W·m-2 pour l’ozone ; 0,2 W·m-2 pour le protoxyde d’azote. Contrairement aux autres gaz, l’ozone n’a pas une concentration uniforme dans l’atmosphère. Il se trouve principalement dans la stratosphère (ozone stratosphérique), entre 15 et 50 kilomètres d’altitude, où sa concentration a légèrement diminué, notamment au-dessus de l’Antarctique. Il est également présent près de la surface terrestre, dans la troposphère (ozone troposphérique), où sa concentration a au contraire augmenté.
Les activités humaines produisent aussi des petites particules en suspension dans l’air appelées aérosols. Ceux-ci résultent de réactions chimiques de gaz émis par les activités humaines. Les plus importants d’un point de vue climatique sont les aérosols sulfatés provenant des composés soufrés émis lors de la combustion d’énergies fossiles. Ces aérosols réfléchissent une partie du rayonnement solaire vers l’espace (sinon il serait absorbé par la surface) et refroidissent la Terre. Leur forçage[...]
La suite de cet article est accessible aux abonnés
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Jean-Louis DUFRESNE : directeur de recherche au CNRS
- Céline GUIVARCH : directrice de recherche à l'École des Ponts
Classification
Médias