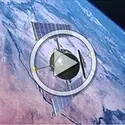- 1. Évolution générale
- 2. Préhistoire et archéologie
- 3. L'Âge du bronze
- 4. Orfèvrerie
- 5. Jade
- 6. Ivoire
- 7. Architecture
- 8. Jardins
- 9. Mobilier
- 10. Sculpture
- 11. Calligraphie et peinture
- 12. Estampes et gravures
- 13. Estampage
- 14. Céramique
- 15. Émaux
- 16. Arts populaires
- 17. Le connaisseur chinois
- 18. L'art contemporain
- 19. Bibliographie
CHINOISE CIVILISATION Les arts
Article modifié le
Les tendances esthétiques chinoises ordonnent les créations artistiques selon une hiérarchie profondément différente de celle de l'Occident : elles tiennent compte de leur lien plus ou moins direct avec l'esprit. L'écriture – et donc la calligraphie, véhicule par excellence de la pensée – prend ainsi la première place qu'elle partagera avec la peinture. Architecture et sculpture sont en revanche considérées comme œuvres d'artisans, de professionnels, au même titre que la céramique, le bronze, le laque ou l'orfèvrerie. Cette distinction entre des arts gratuits, animés par la seule quête spirituelle, apanage des « lettrés », et des arts de commande liés à la religion, aux exigences du monde officiel ou de la vie quotidienne, demeure essentielle. Cette primauté de l'esprit n'exclut cependant pas l'amour des matières précieuses en ce pays qui révéla au monde la soie, le laque, la porcelaine, et qui porta à sa plus haute perfection la technique du bronze. Le connaisseur chinois, sensible au rythme de la ligne, le fut aussi au raffinement visuel et tactile qui seul peut donner à la jouissance esthétique sa véritable dimension.
Si l'on excepte certaines manifestations religieuses de l'art chinois (les bronzes archaïques, l'art funéraire et la sculpture bouddhique), il semble que la création artistique soit ici marquée par la recherche de la pérennité à travers l'éphémère et le fluctuant. Les matériaux d'abord en témoignent, périssables par essence : papier, bois, laque, soie, porcelaine. Les thèmes en sont aussi l'illustration, goût du transitoire, importance accordée à la fluidité d'une sensation, à la fragilité d'un moment, thèmes à travers lesquels la poésie comme la peinture à l'encre atteignent l'intemporel. Sur le plan stylistique, enfin, l'animation constante de la ligne, la prédominance du mouvement, de l'aigu, de l'oblique, de l'onde apparaissent comme le dénominateur commun de créations très différentes.
La première impression que laisse l'art chinois à celui qui tente d'en approfondir l'approche est peut-être celle d'une immense diversité temporelle et spatiale. Marqué, dès l'abord, par une continuité de trois millénaires, cet art s'est épanoui sur un continent dont les variations régionales se révèlent très marquées. La continuité temporelle n'a d'ailleurs jamais impliqué, en Chine, l'uniformité ; chaque siècle apporta ses innovations, ses dominantes, son potentiel d'évolution. Il ne faut pas oublier enfin que notre connaissance de cet art, liée aux découvertes archéologiques et aux recherches historiques, est encore dans l'adolescence, et que chaque jour apparaissent de nouvelles données éclairant des manifestations artistiques jusqu'alors ignorées.
Évolution générale
La critique picturale apparaît en Chine au ive ou au ve siècle de notre ère, mais les œuvres transmises de génération en génération, ainsi que les monuments, ne sont que rarement antérieures au xe siècle. Aussi, l'art qui s'est constitué avant la chute des Tang doit-il beaucoup de son histoire aux innombrables découvertes faites dans le sol chinois à partir des années vingt. Étant assujettie à l'archéologie, la connaissance que nous avons de cet art s'appuie sur des œuvres dont la beauté n'était, pour leurs contemporains, qu'un critère secondaire en regard de leur destination, de leur fonction rituelle ou de leur caractère symbolique. Dans leur majorité, les pièces qui jalonnent l'évolution de l'art chinois sont en effet associées à des pratiques funéraires. Elles reflètent souvent le goût des classes favorisées de la société à des époques et en des lieux où ces classes jouissaient d'une relative quiétude. Enfin, leur appréciation esthétique ne saurait faire oublier qu'elles sont d'abord des documents sur un passé que seuls des textes anciens permettaient naguère d'approcher.
De la légende à l'histoire : les Xia et les Shang (env. fin du IIIe millénaire-XIe s. av. J.-C.
La mise au jour de vestiges attribués à la légendaire dynastie des Xia apporte une révélation comparable à celle qu'avaient fournie, à la fin des Qing, la reconnaissance et le déchiffrement des os divinatoires des Shang, puis, à partir de 1928, la fouille du site d'Anyang. Aujourd'hui, tout donne à penser que les Xia – une dynastie ? un État ? une population ? – ont bien précédé les Shang ; contrairement à ces derniers, ils semblent ne pas avoir laissé d'écrits rendant possible l'identification de leur culture parmi l'ensemble des vestiges du début du deuxième millénaire. Si des légendes se rapportent à eux dans quelques régions de la Chine centrale, c'est près de Luoyang qu'une culture pré-Shang ne relevant plus du Néolithique offre une certaine consistance. En effet, deux établissements de cette région annoncent la formation de la cité : les ruines d'une enceinte en terre damée découverte à Wangchenggang et les fondations de deux bâtiments, palais ou temples, à Erlitou (vers 2200-1600 av. J.-C.). Originaires de Erlitou, les premiers bronzes sont des couteaux et des vases aux parois minces, imitant souvent des terres cuites. Cette soumission à un modèle révèle bien la naissance d'un art dont la gestation n'a cependant pas encore été reconstituée. Des tombes du début des Shang (Erlitou, périodes IV et V) ont livré de belles armes rituelles en jade, des fragments de laques rouge de cinabre et deux plaques en bronze incrusté de turquoise dont le décor préfigure le motif énigmatique du taotie, masque animalier fantastique aux yeux globuleux, dépourvu de mâchoire inférieure.
Le site de Zhengzhou s'inscrit entre la phase Erlitou (périodes I à III ou IV) et la phase Yin (début xive-xie s. av. J.-C.) qui doit son nom à la dernière capitale des Shang. Protégée par des fortifications en terre damée de 9 à 10 mètres de hauteur et de près de 7 kilomètres de longueur, cette ville de plan presque carré comprenait plusieurs quartiers aux fonctions distinctes. Les vases en bronze que l'on a retrouvés enfouis dans les fondations ou déposés dans des tombes occupent alors une place importante dans le rituel. Leurs formes se diversifient mais acquièrent surtout un équilibre des proportions qui manquait aux premières pièces. Le décor, d'abord limité en surface et relativement abstrait, couvre bientôt tout l'objet en s'enrichissant de thèmes animaliers. L'apparition de formes architecturées est imputable à la technique de la fonte en sections de moule qui conduit à disposer le décor en registres horizontaux, à accentuer les profils anguleux et à masquer les raccords par des arêtes.
On est mieux documenté sur la phase Yin grâce aux milliers d'inscriptions oraculaires déchiffrées depuis le début du xxe siècle et portant sur les campagnes militaires, les sacrifices mais aussi sur la chasse ou l'agriculture. Ces informations donnent tout leur sens aux vestiges exhumés près d'Anyang. Le site, traversé par une rivière, comprend au nord la nécropole royale, et au sud les fondations de plusieurs édifices, des palais sans doute, des vestiges d'habitations et d'ateliers, et de petites tombes. Découverte en 1976 dans la zone sud, la tombe inviolée d'un personnage très important, peut-être Fu Hao, l'une des épouses du roi Wu Ding (fin du xive ou fin du xiiie s. av. J.-C.), renfermait, malgré des dimensions réduites, quelque 1 600 pièces de mobilier. Qu'il s'agisse de minuscules amulettes en jade ou de grands vases en bronze, une même inspiration puisant ses sources dans un bestiaire où se côtoient animaux réalistes et créatures fabuleuses nourrit presque toutes ces œuvres. Dans l'art des Shang, le taotie occupe une place centrale tandis que l'homme n'est que rarement évoqué. Ces dispositions ne répondent pas à des critères purement esthétiques, et le décor des bronzes, aussi complexe dans le détail des motifs que dans les associations qu'il met en jeu, attend toujours une interprétation d'ensemble capable d'expliciter ses liens avec la religion.
Dès cette époque sont produites des pièces promises à une longue histoire : des cloches et des miroirs en bronze, des chars. Aux découvertes d'Anyang s'ajoutent de très nombreux vestiges similaires, dispersés entre le Liaoning et le fleuve Bleu, qui rendent compte du large rayonnement, direct ou indirect, de la civilisation des Shang. Si l'étendue de leur territoire demeure conjecturale, il est probable que les membres de la noblesse disposaient d'un pouvoir sur des terres assez éloignées de la capitale. Ainsi, la cité-palais exhumée à Panlongcheng au Hubei en 1974 présente de grandes affinités avec le site contemporain de Zhengzhou, malgré la distance qui l'en sépare. Beaucoup de sites de la phase Yin, comme Taixicun au Hebei, portent également la marque de ce rayonnement, alors que des régions plus lointaines comme le Hunan, où une métallurgie originale a été révélée, témoignent d'échanges répétés avec la métropole et de transmissions de techniques.
Formation des principautés. Diversité des cultures : les Zhou (env. XIe s. av. J.-C.-221 av. J.-C.)
Vers le milieu du xie siècle, les Zhou, qui étaient établis au Shaanxi, se disent mandatés par le Ciel ; ils renversent la royauté et fondent leur capitale près de l'actuelle Xi'an. Dès le début de la dynastie, l'art se ressent de ces bouleversements car les Zhou possédaient une tradition du bronze et du jade qui, tout en étant tributaire de celle des Shang, s'en démarquait sensiblement. Ces changements se traduisent par la présence sur les vases de longues inscriptions attestant qu'ils ne sont plus fondus pour les seuls besoins de la religion mais pour commémorer des événements. Formes et décors subissent le contrecoup de cette évolution qui donne plus de liberté aux bronziers. La figure du taotie en perdant de son intégrité se fond au milieu de motifs géométriques déjà plus nombreux, d'oiseaux à longue crête, de dragons et de combinaisons d'animaux souvent arbitraires dans lesquelles les artisans excellent. Les motifs dont la cohérence est ainsi mise en péril vont tendre progressivement vers l'abstraction ou ne retenir de leur configuration initiale que le mouvement dont ils étaient animés. Quant aux formes, d'audacieux ornements en haut relief viennent en tempérer le caractère massif. Dans la Chine du Centre et du Nord, région mieux contrôlée par les Zhou, on a retrouvé quantité de pièces datées des trois premiers siècles de la dynastie, surtout des bronzes et des jades, parfois des vases en bois laqué incrusté de coquillages. Dans le Sud, une tradition de grès à couverte se constitue vers le xe siècle. Fortes d'une telle avance technique, les régions du Jiangsu et du Zhejiang donneront naissance au début de notre ère aux premiers céladons.
Le sac de la capitale Zhou en 771 par des nomades venus des Ordos devait considérablement affaiblir le pouvoir royal contraint de s'établir à Luoyang. Les rivalités entre les principautés issues des fiefs créés par les Zhou se traduisent par des guerres incessantes et par l'affirmation d'entités culturelles régionales distinctes. Mais, en même temps, les relations qui se nouent entre tous les pays favorisent l'échange des idées et des biens. Malgré les incertitudes du temps, les principautés – depuis les plus grandes comme Chu ou Qin jusqu'aux plus petites, réhabilitées par de prestigieuses découvertes, comme Zeng ou Zhongshan – concourent au développement d'un art dominé par de vifs contrastes de couleurs ou de matières et un sens inné du rythme. Le mobilier des tombes princières se partage désormais entre les insignes du pouvoir que sont les vases rituels ou les armes et d'autres pièces de caractère profane destinées à assurer la survie du défunt dans un au-delà construit sur le modèle de la vie d'ici-bas. Conventionnels par nature, les premiers attestent un réel déclin de la qualité dès le ive siècle et se voient supplantés par les secondes où se concentre tout le génie de l'époque. Les bronzes entrent dans une période très féconde grâce aux multiples effets tirés de l' entrelacs. Cet ornement apparu vers le ixe siècle pourrait émaner du décor des laques au rendu plus fluide. Aussi différente que soit leur expression, les arts du bronze et du laque se font alors écho. De plus, ils bénéficient, au même titre que le jade ou la soie, de progrès techniques décisifs pour leur avenir. L'ampleur des progrès de la métallurgie a pu être mesurée grâce à la découverte des vestiges d'une mine de cuivre à Tonglüshan dans le Hubei et d'un important atelier du bronze à Houma dans le Shanxi. Beaucoup d'interrogations subsistent cependant sur cet art inventif dont les produits ont largement circulé, mais dont certaines créations originales n'ont, semble-t-il, pas fait d'émules, comme ces bronzes de Leigudun (fin du ve s.) dont le décor réticulé pourrait avoir été fondu à la cire perdue. Témoins de contacts plus lointains, les agrafes de ceinture et quelques thèmes animaliers pénètrent en Chine vers le vie siècle. Les plus anciennes scènes figurées que nous connaissons, datées des vie-ve siècles, doivent leur survie au support utilisé, le laque peint et le bronze incrusté ou incisé. Elles illustrent surtout la vie des princes, alors que les deux premières peintures sur soie (ive-iiie s.), qui proviennent de Changsha, ont pour thème l'ascension du défunt vers l'immortalité.
Naissance de l'art impérial : les dynasties Qin (221-207 av. J.-C.) et Han (206 av. J.-C. - 220 apr. J.-C.)
Après s'être épuisées dans de vaines luttes, les principautés ne purent résister aux assauts du royaume de Qin, mieux organisé, qui les réunit en 221 et proclame l'empire. Le nouvel ordre social imposé s'accompagne de prodigieux travaux (Grande Muraille, palais, etc.). Mais les activités artistiques les plus sensibles du règne de Qin Shi huangdi restent attachées à sa sépulture : le tumulus de 350 mètres de côté qui signale son emplacement, à l'est de Xi'an, a livré en 1981 sur son flanc occidental deux chars de bronze en modèle réduit. La découverte, à l'extérieur du tumulus en 1974, de plus de 6 000 guerriers a révélé que le programme du mausolée était autrement plus ambitieux. Les statues composant cette armée, dont la présence avait une vertu magique, sont idéalisées par la taille (hauteur entre 1,75 et 1,96 m) mais le rendu de la posture, du visage qui est individualisé, du vêtement, est réaliste. Ce type de sculpture qui n'avait jamais atteint à cette vérité procède des mannequins en bois placés dans les tombes dès le vie siècle et peut-être antérieurement, notamment à Chu. Il s'agit là des premières manifestations d'une statuaire vraiment autonome, une fonction utilitaire ayant été souvent assignée à la sculpture monumentale par le passé. Ainsi un art impérial, bientôt fertile en créations de toutes sortes, voit-il le jour. Bien qu'il tire ici son inspiration de la guerre, exaltée jusqu'à la démesure, il sait garder des accents profondément humains.
Les troubles qui suivirent la mort de l'empereur en 210 ne s'apaisèrent que quelques années après la fondation de la dynastie Han, qui restaura la féodalité tout en s'appuyant sur les structures héritées des Qin. Jusqu'au règne de Wudi (140-87 av. J.-C.), les créations suivent les formules en vigueur à la fin des Zhou. Ainsi, dans l'ancien pays de Chu, où une tradition artistique à la fois puissante et originale s'était élaborée, le laque supplante-t-il le bronze. À la limite de l'abstraction, ses motifs font preuve d'une constante invention et, quand ils ne répondent pas à l'ornementation des soieries brodées ou façonnées et des céramiques, c'est pour rivaliser avec la peinture sur soie dont plusieurs chefs-d'œuvre ont été retrouvés dans deux des trois tombes de Mawangdui. Dans la bannière en T de la tombe no 1, la parfaite maîtrise du trait et l'équilibre savant de la composition qui représente l'ascension vers l'immortalité prouvent que cette peinture s'inscrit dans une tradition solidement établie. La politique expansionniste des Han vers le sud, dont l'empreinte est visible jusqu'à Canton (sur les pièces provenant de la tombe du deuxième roi de Nanyue, fin du iie siècle av. J.-C.), et l'ouverture de la route de la Soie (ier s. av. J.-C. ?) ont pour conséquence l'apparition de thèmes exotiques dans l'iconographie. Parallèlement, avec la prospérité croissante de l'empire, un art de cour se reforme, plus serein que n'était celui de Qin. Plusieurs sépultures de membres de la famille impériale, comme celles de Mancheng au Hebei, ont livré des objets utilisés du vivant de leur propriétaire – lampes, brûle-parfums, etc. –, dont les qualités plastiques alliées à une réelle ingéniosité sont servies par les matières les plus précieuses. De la même époque datent les premières sculptures en pierre connues : elles bordaient l'allée conduisant au tumulus d'un général mort en 117 avant J.-C. : leurs formes à peine dégagées du granit opposent à tous les raffinements de la cour la force d'une expression sans fard.
Une mutation radicale intervient alors dans la conception des tombes qui depuis plus d'un millénaire consistaient en une fosse verticale abritant plusieurs cercueils emboîtés. Les plus riches s'élargissent et se subdivisent pour traduire dans leur plan l'agencement symbolique d'un palais. Au bois sont progressivement substituées la brique et la pierre. Leur usage occasionne un renouvellement des méthodes de construction sous la forme d'emprunts à l'architecture civile, mais aussi avec la mise au point de la voûte dont l'emploi restera cependant confiné aux tombes. Les surfaces ainsi ménagées s'offrent à une décoration peinte dont l'iconographie allie des thèmes mythologiques ou propitiatoires à des références historiques et à des évocations de la vie terrestre, plaisirs que le défunt souhaite retrouver dans l'au-delà. Les décors de Helingeer (milieu du iie s.) ou ceux de Jiayuguan, un peu plus tardifs, prodiguent quantité d'informations sur la vie matérielle de leur époque mais s'élèvent rarement au-dessus de l'anecdote. En revanche, certaines briques estampées et certaines pierres gravées aux ier et iie siècles sont de véritables chefs-d'œuvre en dépit – ou peut-être à cause – des contraintes imposées par la matière. N'ayant que la ressource de découper des silhouettes, tout au plus agrémentées de quelques traits et d'un peu de volume, les artistes ont découvert, dans des styles très différents suivant les régions et les moments, la quintessence du mouvement et l'expression la plus synthétique des formes. Les meilleures réussites sont peut-être les scènes de chasse, les divertissements avec danseurs et musiciens et les cavalcades de voitures. Si des essais pour figurer l'espace ont été tentés dans bon nombre de ces scènes, le paysage en est exclu, sauf dans les dalles estampées du Sichuan, aux iie et iiie siècles. La sensibilité à la nature se révèle beaucoup plus dans les mille et une évocations de la vie à la campagne qu'ont transmis les modèles en terre cuite, les mingqi, de qualité souvent médiocre, mais d'une indéniable sincérité. À la fin de la dynastie, les manufactures officielles déclinent et sont relayées par des artisanats spécialisés suivant les régions : miroirs en bronze dans le bassin du fleuve Bleu, premiers céladons de Yue, etc.
Traditions du Nord, traditions du Sud : les Six Dynasties (265-581)
Le repli des régions sur elles-mêmes, perceptible à la fin du iie siècle, anticipe le morcellement de la Chine. Par-delà les divisions politiques, ce sont deux cultures qui s'opposent et s'influencent tour à tour : celle de la Chine du Nord et celle du bassin du fleuve Bleu. Dans le domaine de la céramique, les expériences dont le Sud est un peu partout le creuset conduisent à l'invention des fours-dragons et à la création de grès contenant du kaolin mais n'ayant ni la transparence ni la finesse de la porcelaine. Nul doute que ces techniques ont favorisé le renouveau complet qui s'empare de la forme et du décor des pièces.
En ces temps troublés, les aristocrates lettrés du Sud vont, à l'instar des « Sept Sages de la forêt de bambous », trouver refuge dans la nature et composer les premières peintures de paysage. C'est alors que se codifient les grands styles de la calligraphie, un art déjà fort apprécié sous les Han. Si la postérité a retenu les noms du peintre Gu Kaizhi (vers 344-vers 406) ou du calligraphe Wang Xizhi (vers 306-361) et reçu quelques reflets de leurs œuvres, elle le doit au travail de copie, de commentaire ou de citation auquel les artistes chinois se sont très tôt pliés. Parallèlement à ces œuvres où pour la première fois l'émotion de l'artiste supplante le savoir-faire de l'artisan, une réflexion s'engage sur le processus de la création et sur les critères esthétiques intervenant dans une définition du goût. Elle aboutit, notamment, au début du vie siècle, à l'énoncé des Six Principes sur la peinture par Xie He.
Si l'on excepte les sculptures rupestres de Kongwangshan (près de Lianyungang, Jiangsu) illustrant l'interpénétration du bouddhisme naissant et du taoïsme vers le iiie siècle, l'art religieux n'a laissé que de discrets vestiges dans les pays méridionaux, puisque tous les temples ont disparu. En revanche, dans le Nord, le soutien des dynasties barbares à la nouvelle religion a permis la création de grands sanctuaires taillés dans des falaises. Cette tradition héritée de l'Inde s'est transmise par le relais de plusieurs sites de la route de la Soie, dont celui de Dunhuang. Les grottes de Yungang et, après 494, celles de Longmen, creusées sous les Wei du Nord (386-534), naissent d'une intense dévotion qui s'exprime dans le sourire délicatement esquissé et confiant des premières configurations du Buddha. Une égale sérénité imprègne les statuettes déposées dans les tombes en de longues processions de musiciennes et de servantes à la grâce nonchalante, de gardes à l'allure débonnaire et de toutes sortes de personnages savoureux.
L'empire reconstitué : les dynasties Sui (581-618) et Tang (618-907)
Au cours du vie siècle, les relations entre le Nord et le Sud s'amplifient constamment sous la forme d'échanges économiques qui favorisent le mouvement des hommes et la diffusion des idées. Le mérite de la réunification revient à la dynastie Sui qui, tout éphémère qu'elle ait été, n'en a pas moins exercé une influence décisive sur les arts. Une politique très audacieuse de grands travaux se concrétise en particulier dans l'édification d'une capitale grandiose, à l'urbanisme étonnamment fonctionnel, Chang'an. De l'architecture des Sui, il ne subsiste rien ; cependant, nous pouvons considérer que le sarcophage d'une fillette enterrée en 608 près de Xi'an offre la parfaite réplique d'un élégant pavillon dont la toiture couronnée par un puissant faîtage s'incurve avec douceur. La statuaire bouddhique, finement modelée dans l'argile à Dunhuang et à Maijishan, ou taillée dans la pierre des grands sanctuaires rupestres de la Chine centrale, utilise enfin toutes les possibilités de la ronde-bosse. Cette conquête progressive de l'espace à laquelle les sculpteurs Sui aspirent transparaît encore dans le domaine profane et funéraire. Les dragons ornant en haut relief la balustrade du pont Anji de Zhaoxian (Hebei, début du viie s.) semblent lutter pour se dégager de la pierre avec laquelle ils font corps. Le mouvement des masses souligné par un trait nerveux annonce les meilleures réussites de la statuaire des Tang qui s'est jouée de toutes les matières : laque sec, terre cuite polychrome ou pierre.
L'unification de la Chine, renforcée au début de la nouvelle dynastie, aboutit à la création d'un empire s'enfonçant très loin dans l'Asie centrale et étendant son influence de la Corée au Vietnam. Sur les bases d'une prospérité sans précédent allait se constituer jusqu'au milieu du viiie siècle une civilisation à la fois novatrice et perméable aux influences étrangères, dont celle, capitale, du bouddhisme. La peinture, à défaut d'œuvres attestées, a fait passer à la postérité plusieurs noms d'artistes ayant acquis auprès de leurs contemporains un prestige incomparable, signe de l'évolution définitive de leur statut. Yan Liben, mort en 673, est connu comme portraitiste ; Wang Wei (699-759), peintre et poète à la fois, représente l'idéal du lettré pour les générations à venir, sans doute parce qu'il a libéré le paysage de tous les enjolivements dont il se parait encore pour lui conférer une réelle valeur poétique, grâce à la technique du monochrome dont il serait l'inventeur. Wu Daozi enfin, actif dans le deuxième quart du viiie siècle, a dominé son époque et se voit attribuer quelque trois cents peintures murales dans les temples de Luoyang et de Chang'an. Si aucune d'entre elles n'a survécu, les grottes de Dunhuang, où un style proprement chinois commence à percer vers le viie siècle, nous donnent une idée assez exacte sinon de l'esprit et des couleurs de ses œuvres, du moins des sujets qu'il a pu aborder : trinités, paradis, légendes accréditant la foi bouddhique mises en scène dans de véritables paysages et souvent émaillées de sujets profanes. Le style des peintres de la cour, même transmis par les mains d'artisans anonymes, est aujourd'hui mieux apprécié grâce aux nombreuses découvertes de tombes, dont certaines sont princières, dans les environs de Xi'an. Reflet d'une société cosmopolite, ces peintures sur enduit sec, déployées sur de larges surfaces, s'inspirent de scènes de palais et des divertissements de la noblesse. Les arts décoratifs ne sont pas en reste. Toutes les audaces leur semblent autorisées : taches des céramiques « trois-couleurs » jetées sans tenir compte du sujet ou du dessin des pièces ; combinaison délibérée de thèmes ou de formes exotiques avec le répertoire traditionnel chinois dans l'orfèvrerie (trésor de Hejiacun) ou les textiles (découvertes de Turfan, au Xinjiang) ; animation poussée jusqu'à la véhémence des sculptures funéraires au vigoureux modelé, etc. La révolte d'An Lushan en 755 et ses conséquences dramatiques devaient porter un coup d'arrêt au rayonnement de cet art somptueux et l'obliger à plus de retenue.
L'époque des Cinq Dynasties (907-960)
La dynastie Tang s'effondre au début du xe siècle, laissant la Chine épuisée par les désastres militaires et économiques. L'Empire restera, pendant près d'un siècle, en proie à l'anarchie, partagé en royaumes indépendants où se succèdent d'éphémères dynasties. Les cours locales demeurent des centres actifs où l'art pictural se développe et s'enrichit dans la voie tracée par Wang Wei sous les Tang. Dong Yuan (actif vers 937-975) introduit ainsi dans l'art du paysage toute la gamme poétique de la Chine du Sud, humide et boisée, aux sommets noyés de brume. Ses recherches techniques et l'univers qu'il transpose auront une influence considérable sur la peinture Song. Il inaugure ces paysages aux lointains illimités où s'estompent les formes, ces compositions orchestrées autour des vides et des brumes.
La dynastie Song (960-1279)
Sous les Song, la Chine, enserrée par les Barbares, se recueille sur ses richesses, approfondissant l'acquis d'un patrimoine déjà prestigieux. En ce qui concerne l'art architectural, cette époque développe et parachève les caractéristiques plus rudes et plus simples de l'architecture Tang. Les progrès de la charpente, la place plus importante donnée à la décoration, l'innovation que constitue la courbure des toits et la tendance à la verticalité marquent l'esthétique Song. Mais les plus belles réalisations artistiques de cette période appartiennent au domaine de la peinture et à celui de la céramique. Sous l'égide de l'empereur Huizong (1082-1135) qui régna de 1101 à 1126 et fut à la fois collectionneur, calligraphe, esthète et peintre, un style de cour se crée, réaliste et décoratif, d'un esprit opposé aux recherches de cénacle des lettrés contemporains. Parmi ces lettrés, Mi Fu (1051-1107), grand calligraphe, ne se mit à peindre qu'à la fin de sa vie, faisant appel à son expérience calligraphique pour évoquer la nature, et construisant ses paysages avec des points qui suggéraient les masses montagneuses, les arbres et les bois accrochés aux pentes. Influencée par Dong Yuan, sa technique marque un progrès vers l'évanescence.
Loin du romantisme qui régnait à la cour de Hangzhou, au xiie siècle, avec des artistes comme Ma Yuan et Xia Gui, des peintres retirés dans les monastères de la secte bouddhique Chan développaient un style spontané et indépendant. Deux grands maîtres, à la fin des Song du Sud, ont exprimé les expériences spirituelles de cette secte : Liang Kai (1140-1210), qui parvint à un style abstrait et expressif, à un art de l'essentiel sans redites ni concessions ; Muqi (actif 1240-1270) dont la vision empreinte de tendresse se plut aux thèmes simples (kakis, animaux, barques rentrant au village).
La céramique Song, comme la peinture, demeure l'évocation parfaite d'une culture de dilettantes, raffinée, close sur ses rêves. Sa perfection technique, servie par une plus grande rapidité du tour et une meilleure surveillance de la cuisson, restera inégalée. La fabrication reste parfois empirique et les accidents de préparation ou de four donnent à certaines pièces un charme particulier et mystérieux. Les formes sont sobres et pures, les décors (fleurs, oiseaux, poissons) sont le plus souvent incisés ou moulés sous la couverte monochrome. Parfois aussi, les tonalités de la matière, le velouté de son toucher tiennent lieu de décor.
Le lettré Song sensible aux jeux du pinceau et au raffinement de la porcelaine se passionne pour l'Antiquité. L'empereur Huizong donne l'exemple, faisant fouiller à Anyang et collectionnant bronzes et jades archaïques. Les artisans reprennent les thèmes anciens sans toujours en comprendre la signification première, et les arts mineurs (bronzes, jades) se ressentent de cette tendance. En revanche, l'art du laque connaît un grand essor et plusieurs techniques nouvelles semblent avoir été mises au point à cette époque.
La dynastie Yuan (1280-1368)
En 1276, Hangzhou capitule devant les Mongols, et la Chine, pour la première fois, tombe tout entière aux mains des envahisseurs. Certains lettrés se rallient au nouveau régime. Le plus célèbre, Zhao Mengfu (1254-1322), fut un excellent calligraphe, paysagiste et peintre de chevaux.
Le plus grand peintre de ce temps reste peut-être Ni Zan (1301-1374), esprit bohème, solitaire et sensitif à l'extrême. Ses paysages dépeuplés sont en général de petit format ; son pinceau incliné et sec renforce le trait nerveux en laissant jouer les blancs du fond. Les vides prennent ainsi toute leur résonance. Appartenant avec Ni Zan, Wang Meng et Wu Zhen au groupe des paysagistes retirés en Chine du Sud, Huang Gongwang (1269-1354) revient aux compositions riches et détaillées, aux structures solides du xe siècle.
Sous le règne des Yuan, la plupart des fours Song poursuivent leur activité, et les exportations augmentent tant vers l'Iran que vers l'Inde et l'Indochine. L'apparition en Chine du bleu de cobalt importé d'Iran date vraisemblablement du xiiie siècle. Les progrès de la technique de cette nouvelle porcelaine décorée en bleu sous couverte aboutissent à des pièces au décor complexe de dragons, de phénix et de motifs végétaux.
La dynastie Ming (1368-1644)
La nouvelle dynastie chinoise qui prit le nom de Ming voulut se rattacher à la tradition des Tang. L'empereur Yongle (1403-1424) établit la capitale à Pékin qu'il embellit de palais, de terrasses de marbre et de jardins.
La peinture restait l'apanage des lettrés. Certains, comme Shen Zhou (1427-1509), étaient des amateurs qui concevaient la peinture comme une expression de la personnalité. Leur style, souvent « à la manière de », est éclectique, faisant prédominer une technique parfaite, un jeu du pinceau et de l'encre associé à la poésie et à la calligraphie.
À la fin du xive siècle et au xve siècle, les arts mineurs connaissent une période de renouveau, tant dans le domaine de l'inspiration créatrice que dans celui des matières précieuses : émaux cloisonnés destinés aux cérémonies religieuses, laques sculptés d'une perfection sans égale. Le laque est également le revêtement des meubles précieux, armoires, coffres au décor à la fois riche et d'une sobre élégance. La céramique participe à cet essor de l'artisanat d'art. La technique, mise au point sous les Yuan, qui consiste à peindre des motifs en bleu de cobalt sur le corps de la porcelaine ensuite revêtu d'une couverture, connaît une vogue croissante. L'époque Xuande (1426-1435) produisit peut-être les « bleu et blanc » les plus parfaits ; les formes sont pures, la porcelaine fine et le bleu appliqué en lavis moucheté. À côté de ces pièces, les potiers Ming ont associé le bleu sous couverte aux émaux colorés, et ont décoré de motifs floraux les grès recouverts de glaçures plombifères. La clarté du décor, la somptuosité des couleurs s'allient à des formes robustes caractéristiques des Ming.
La dynastie Qing (1644-1911)
Sous le nom dynastique de Qing, les Mandchous réussirent à se maintenir en Chine près de trois siècles. Trois souverains de valeur se succédèrent de la seconde moitié du xviie siècle à la fin du xviiie : Kangxi (1662-1722), Yongzheng (1723-1735) et Qianlong (1736-1796).
L'ensemble du palais impérial de Pékin avait été incendié à la chute des Ming en 1644, les empereurs mandchous le restaurèrent et le complétèrent. Au nord-ouest de la capitale, ils firent construire des palais d'été entourés de parcs, de pièces d'eau et de pavillons. Au sud-est de Pékin, Qianlong fit restaurer l'autel du Ciel édifié par Yongle.
L'époque Qing fut l'ère des grandes encyclopédies, des collections littéraires, du goût pour l'archéologie et les compilations. Dans cette ligne, un grand nombre de peintres suivirent les idéaux des lettrés de la fin des Ming férus de tradition. L'étude et la copie des maîtres anciens devinrent avec la maîtrise technique la recherche essentielle des quatre maîtres Wang, dont Wang Hui (1632-1720) fut certainement le plus éclectique et Wang Yuanqi (1642-1715) le plus original.
À côté de ces peintres orthodoxes, des artistes isolés poursuivent une voie plus personnelle, manifestant leur mépris envers la domination étrangère et les recherches des peintres officiels. Ainsi, Shitao (qui travaille entre 1660 et 1707), réfugié dans un monastère bouddhique, réclame pour l'artiste la plus complète liberté. À côté de grandes compositions violentes, il se plaît au petit format des feuilles d'album, et son art témoigne d'une compréhension globale et convaincante des éléments naturels. Moine lui aussi, Zhu Da (1626-1705) peint avec une égale spontanéité paysages et animaux. Le pinceau large ou crispé, l'encre sèche ou coulante dialoguent en des esquisses vigoureuses, rapides et spirituelles.
Les arts décoratifs connaissent sous le règne de Kangxi une dernière époque d'harmonie avant de subir aux xviiie et xixe siècles les déformations de la surcharge. La perfection technique à laquelle sont parvenus les potiers va permettre toutes les recherches décoratives, mais aussi les virtuosités les plus néfastes. Une division extrême du travail, la surveillance de la manufacture impériale par l'Académie de peinture enlèvent à l'artisan toute initiative personnelle et à l'art de la porcelaine toute possibilité de renouvellement. Le goût de l'archaïsme et les commandes occidentales précipiteront encore le déclin de la céramique à la fin du xviiie siècle. Au siècle suivant, la complication constante des formes, la multiplication d'éléments décoratifs disparates rendront manifeste, dans tous les domaines de l'art, la décadence du goût.
Accédez à l'intégralité de nos articles
- Des contenus variés, complets et fiables
- Accessible sur tous les écrans
- Pas de publicité
Déjà abonné ? Se connecter
Écrit par
- Corinne DEBAINE-FRANCFORT : docteur-chercheur au C.N.R.S. (UMR 7041) , directeur de la Mission archéologique franco-chinoise au Xinjiang (Chine)
- Daisy LION-GOLDSCHMIDT : chargée de mission au Musée national des arts asiatiques-Guimet
- Michel NURIDSANY : critique d'art, écrivain, commissaire d'exposition
- Madeleine PAUL-DAVID : ancien maître de recherche au CNRS, professeure honoraire à l'École du Louvre, chargée de mission au Musée national des arts asiatiques-Guimet
- Michèle PIRAZZOLI-t'SERSTEVENS : directrice d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)
- Pierre RYCKMANS
:
reader , Department of Chinese, Australian National University - Alain THOTE : directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, section des sciences historiques et philologiques, membre de l'Institut
Classification
Médias
Autres références
-
ASTRONOMIE
- Écrit par James LEQUEUX
- 11 343 mots
- 20 médias
Quant auxChinois, ils pratiquent l’astronomie depuis l’Antiquité. Ils s’intéressent alors surtout aux événements temporaires survenant dans le ciel et qui leur paraissent comme autant de présages : éclipses, apparition d’étoiles nouvelles, de comètes, etc. Ils consignent soigneusement... -
CALENDRIERS
- Écrit par Jean-Paul PARISOT
- 9 907 mots
- 4 médias
Nos connaissances surl'astronomie et le calendrier chinois sont dues au travail monumental réalisé entre 1723 et 1759 par le jésuite français Antoine Gaubil. Pendant les trente-six années qu'il passe à Pékin, sa fonction de traducteur et d'interprète lui permet d'être en contact permanent avec la cour... -
CHINE - Hommes et dynamiques territoriales
- Écrit par Thierry SANJUAN
- 9 801 mots
- 5 médias
...comme l'extension d'un monde chinois qui trouve son foyer originel dans le bassin moyen du fleuve Jaune dès le IIe millénaire avant J.-C. Plus largement, la Chine se veut le foyer de civilisation de l'Asie orientale dans la mesure où elle était elle-même l'ensemble du monde, « tout ce qui était sous le... -
CHINE : L'ÉNIGME DE L'HOMME DE BRONZE (exposition)
- Écrit par Viviane REGNOT
- 934 mots
L'expositionChine : l'énigme de l'homme de bronze. Archéologie du Sichuan (XIIe-IIIe s. av. J.-C.), un des sommets de l'année de la Chine en France, eut lieu du 14 octobre 2003 au 28 janvier 2004 à la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville de Paris. Elle avait pour commissaires...
- Afficher les 10 références
Voir aussi
- PORTRAIT, peinture, jusqu'au XVe s.
- PORTRAIT, sculpture
- PAYSAGE, peinture, jusqu'au XVe s.
- ILLUMINATION
- PEINTURE SUR PAPIER
- CLOISONNÉ TECHNIQUE DU
- COLONNE
- PIERRE, sculpture
- GRÈS, poterie dure
- CHINOISE PEINTURE
- DRAPÉ, sculpture
- MONUMENTALE SCULPTURE
- FUNÉRAIRE SCULPTURE
- BRONZE, sculpture
- SOIE PEINTURE SUR
- CHINOISE SCULPTURE
- CHINOISE ARCHITECTURE
- FUNÉRAIRE ARCHITECTURE
- FUNÉRAIRE PEINTURE
- TOMBEAU
- BANPO CULTURE DE
- DALLE FUNÉRAIRE
- FONTE DANS L'ART
- CANON, esthétique
- OR ORFÈVRERIE D'
- BOUDDHIQUE ART
- PARURE
- SCULPTURE RELIGIEUSE
- SCULPTURE DÉCORATIVE
- HAUT-RELIEF
- BAMBOU
- MODELÉ, arts
- BLEU & BLANC, céramique
- CHINOIS ART
- AMULETTE
- CHINOIS JARDIN
- ROCAILLE STYLE
- INSCRIPTIONS, archéologie
- ESTAMPAGE REPRODUCTION PAR
- MÉTAUX PRÉCIEUX, histoire
- TEMPLE
- BLEU DE COBALT
- CONSOLE, architecture
- BEI QI [PEI TS'I] STATUAIRE DES
- CALLIGRAPHIE CHINOISE
- ENCRE, peinture
- COUVERTE, céramique
- CÉLADON
- LI TANG (1050 env.-? 1130)
- HU [HOU], poterie
- MINGQI [MING-K'I], céramique
- MEIPING [MEI-P'ING] VASE
- MA YUAN (actif vers 1190-1225)
- REN BONIAN [JEN PO-NIEN] (1840-1896)
- GLAÇURE, céramique
- FOGUANGSI [FO-KOUANG-SSEU] SALLE DU
- GÉOMANCIE
- NÉPHRITE, gemme
- ZHENGZHOU, site archéologique
- SHANG SÉPULTURES
- DIAN [TIEN], pavillon
- TANG [T'ANG] LES (618-907)
- YU, pierre précieuse
- SYMBOLE DANS L'ART
- YUE, céramique chinoise
- ROYAUMES COMBATTANTS (Ve-IIIe s. av. J.-C.)
- ZHOU OCCIDENTAUX ou XI ZHOU [SI TCHEOU] dynastie chinoise (1111 av. J.-C. ou 1050-771 av. J.-C.)
- ZHOU ORIENTAUX ou DONG ZHOU [TONG TCHEOU], dynastie chinoise (770-256 av. J.-C.)
- CHU [TCH'OU] ROYAUME DE
- WEI, royaumes et dynasties chinois
- QIN [TS'IN] LES (221-206 av. J.-C.)
- FONCTIONNAIRES-LETTRÉS, Chine ancienne
- INCRUSTATION, technique décorative
- GALETS, industrie lithique
- CHAN & ZEN ARTS
- RITES FUNÉRAIRES
- COLLECTIONNEURS
- TEINTURE
- INDIGO
- ENCEINTE
- PEINTRE-LETTRÉ
- QING ART DES
- BAS-RELIEF
- VASES
- FUNÉRAIRE ART
- FU BAOSHI [FOU PAO-CHE] (1904-1965)
- SUPPORT, arts plastiques
- PEINTURE TECHNIQUES DE LA
- CIMETIÈRE
- ZHOUKOUDIAN [TCHEOU-K'EOU-TIEN] SITE PRÉHISTORIQUE DE, Chine
- VANNERIE
- CONSTRUCTION TECHNIQUES DE
- MOULAGE
- GRÉCO-BOUDDHIQUE ART
- LANTIAN [LAN-T'IEN]
- LONGSHAN [LONG-CHAN] CULTURE DE, préhistoire
- HUILE PEINTURE À L'
- PINCEAU TECHNIQUE DU
- MICROLITHES, préhistoire
- TOMBE
- NÉCROPOLE
- TUMULUS
- MOBILIER FUNÉRAIRE
- TEMPLE, Extrême-Orient
- GALERIES D'ART
- IMPRIMERIE EN CHINE, histoire
- BRONZE ART DU
- ACADÉMIE IMPÉRIALE DE PEINTURE, Chine
- EXTRÊME-ORIENT ART D'
- CHINE, préhistoire
- CÉRAMIQUE CHINOISE
- BODHISATTVA REPRÉSENTATIONS DES
- BOIS, architecture
- FERME, charpente
- EXTRÊME-ORIENT, préhistoire et archéologie
- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU
- CHARPENTE
- CIRE PERDUE, techniques
- RIZICULTURE
- YANGSHAO [YANG-CHAO] CULTURE DE, préhistoire
- MAJIAYAO CULTURE DE
- HEMUDU CULTURE DE
- DAWENKOU CULTURE DE
- QINGLIANGANG CULTURE DE
- LIANGZHU CULTURE DE
- QUJIALING CULTURE DE
- ERLITOU [EUL-LI-T'EOU] CULTURE D'
- ERLIGANG [EUL-LI-KANG]
- ANYANG, site archéologique
- ORDOS CULTURE DE L', préhistoire
- TAILLE DES ROCHES DURES
- LITHIQUES INDUSTRIES
- VILLE, urbanisme et architecture
- TERRE CUITE, poterie
- BOUDDHISME CHINOIS
- RITUELS DE LA CHINE
- ÉLITES
- MÉTALLURGIE, histoire
- CIVILE ARCHITECTURE
- ANIMALIER ART
- MUDRĀ
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, préhistoire
- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge
- MARCHÉ DE L'ART
- CHAMBRE FUNÉRAIRE
- EXTRÊME-ORIENT, architecture
- EXTRÊME-ORIENT, sculpture
- EXTRÊME-ORIENT, peinture
- FOSSE, sépulture
- LONGMEN, Chine
- GROTTES BOUDDHIQUES
- PALÉOZOOLOGIE
- TAOTIE, masque
- MAWANGDIU [MA-WANG-TIEOU], site archéologique
- AGRAFE, parure
- PINGTUO, technique
- MANCHENG [MAN-TCH'ENG], site archéologique
- BI ou PI, Chine
- MING SÉPULTURES
- WULIANGZI [WOU-LEANG-TSEU], site archéologique
- TIANLONGSHAN [T'IEN-LONG-CHAN], grottes bouddhiques
- LI DI [LI TI] (1100 env.-apr. 1197)
- ÉCLATS INDUSTRIES SUR, préhistoire
- XUJIAYAO SITE PRÉHISTORIQUE DE
- CISHAN CULTURE DE
- PEILIGANG CULTURE DE
- MIAODIGOU CULTURE DE, préhistoire
- TAOSI CULTURE DE
- HONGSHAN CULTURE DE
- CHANGZIYAI SITE PRÉHISTORIQUE DE
- MAJIABANG CULTURE DE
- DAXI CULTURE DE
- SHIXIA CULTURE DE
- BAIYANGCUN CULTURE DE
- KARUO SITE PRÉHISTORIQUE DE
- FU HAO TOMBE DE
- COUR, architecture
- FIGURINE
- TOUR DE POTIER
- PAPIERS DÉCOUPÉS
- LAVIS
- ARCHITECTURE RELIGIEUSE
- ARGILE, poterie
- ARGILE, sculpture
- TERRE CUITE, sculpture
- XING XING ou GROUPE DES ÉTOILES
- HUANG YONG PING (1954-2019)
- XU BING (1955- )
- ZHANG XIAOGANG (1958- )
- HUANG RUI (1952- )
- YUE MIJUN (1962- )
- ZHOU CHUNYA (1955- )
- ZHANG HUAN (1965- )
- SONG DONG (1966- )
- XU ZHEN (1977- )
- YANG FUDONG (1971- )
- MARTIN JEAN-HUBERT (1944- )
- SINOGRAMME ou CARACTÈRE CHINOIS